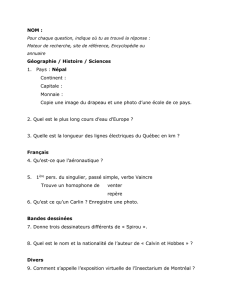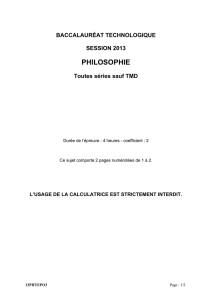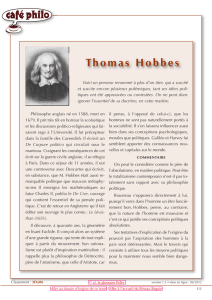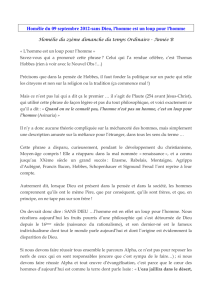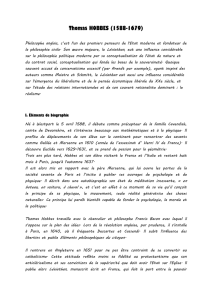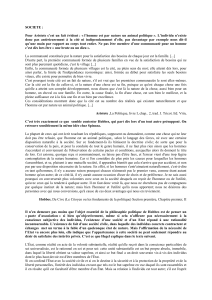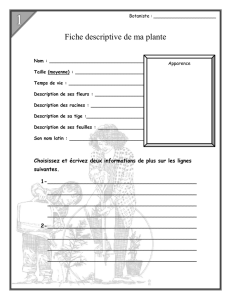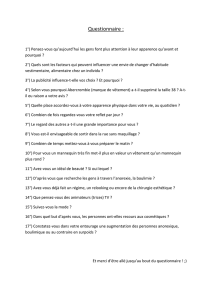Position de thèse - Université Paris

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE/UNIVERSITÀ DEL SALENTO
ÉCOLE DOCTORALE 5
Laboratoire de recherche EA 3552
T H È S E en cotutelle
pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE et
DE L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Discipline : Philosophie
Présentée et soutenue par :
Francesca GIULIANO
le : 28 Janvier 2017
Il lessico dell’apparenza in Thomas Hobbes.
Questioni e sviluppi terminologici e concettuali
Sous la direction de :
M. Vincent CARRAUD – Professeur, Université Paris-Sorbonne
Mme Giulia BELGIOIOSO – Professeur, Università del Salento
Membres du jury :
M. Vincent CARRAUD – Professeur, Université Paris-Sorbonne
Mme Giulia BELGIOIOSO – Professeur, Università del Salento
Mme Martine PÉCHARMAN – Docteur, CNRS, CRAL
M. Franco GIUDICE – Professeur, Università degli Studi di Bergamo

1
Position de thèse
Le lexique de l’apparence chez Thomas Hobbes.
Questions et développements terminologiques et conceptuels
L’objectif de cette thèse consiste à analyser une partie du lexique hobbesien, que nous
définissons ici comme « lexique de l’apparence ». Par le terme d’apparence, que nous utilisons en
tant que catégorie conceptuelle, nous nous référons à la problématique philosophico-scientifique –
typique des XVIe-XVIIe siècles – qui met en lumière une conscience nouvelle de la nature de la
perception sensible. L’apparence de l’image montre, d’un côté, l’existence réelle et objective d’un
monde en mesure de déterminer la sensibilité ; de l’autre, la conscience que nos représentations ne
nous livrent pas un portrait fidèle du monde que nous observons. Autrement dit, l’apparence est
essentiellement le résultat de notre rapport avec la réalité ; elle est ce que la puissance
représentative du sujet fait émerger quand elle perçoit les objets dans ses éléments constitutifs :
figure, grandeur, distance, mais aussi couleur, odeur ou saveur (c’est-à-dire la grande distinction
entre qualités primaires et secondaires, sur laquelle se fonde ce qu’on appelle le
« représentationnalisme » ou le «phénoménisme » de l’époque moderne).
La réflexion de Hobbes s’insère parfaitement à l’intérieur de ce contexte : considérant la
sensation comme le stade initial de la connaissance, dont dérive l’entière vie psychologique du
sujet, le philosophe anglais réduit nos représentations à des « apparences » qui n’ont aucune réalité
en dehors de notre esprit.
Notre travail s’annonce, donc, comme une tentative d’examen terminologique et conceptuel d’un
certain nombre de termes (phantasm/phantasma, fancy, image/imago, etc.) qui rentrent à l’intérieur
d’un vocabulaire « idéalement » constitué et utilisé par Hobbes pour traiter le thème complexe de
l’apparence des phénomènes.
L’exigence d’une enquête lexicale naît, en premier lieu, de la constatation de l’absence presque
totale, dans le champ des recherches sur Hobbes, d’instruments de support lexicographique relatif à
l’œuvre du philosophe anglais : indexations et lemmatisations. Il me semble, en deuxième lieu,
qu’une telle enquête puisse apporter ses fruits aussi pour la possibilité de reparcourir, à partir de
bases textuelles et donc objectives, les étapes de la pensée de Hobbes sur le thème de la philosophie
naturelle.
En effet, sur le phénoménisme de Hobbes et sur sa théorie cognitive, diverses études ont été
réalisées ; cependant, les différentes perspectives interprétatives qui, ces dernières années, ont
abordé le problème du rapport entre Hobbes et ses sources (antiques, de la Renaissance,
scientifiques) n’ont pas abouti à une résolution définitive de la question. Le thème de la

2
représentation et de la production des apparences sur lequel se fonde le phénoménisme du
philosophe anglais a été étudié tantôt en en privilégiant un aspect, tantôt un texte, pour tenter de
reconstruire, en relation à une ou plusieurs traditions de pensée, le parcours entrepris par ce dernier.
La seule véritable exception, dans ce sens, est représentée par l’ouvrage collectif édité par Yves-
Charles Zarka, Hobbes et son vocabulaire. Études de lexicographie philosophique, basée non sur le
simple « recueil » et la définition du vocabulaire hobbesien, mais sur son interprétation critique.
Toutefois, les résultats obtenus sont, à tous les effets, partiels. En particulier, à partir de l’analyse
que Zarka lui-même effectue dans son essai, « Le vocabulaire de l’apparaître : le champ
sémantique de la notion de phantasma », j’ai vérifié les nombreuses implications que cette
recherche n’avait pas épuisé et que, par conséquent, restaient à étudier.
Notre travail se propose, donc, de reconstruire la réflexion hobbesienne sur la problématique de
l’apparence en privilégiant une approche de type lexicographique, fondée sur la vérification de
l’élément matériel (occurrences et concordances), mais aussi conceptuel, à travers les entrées
répertoriées à cet effet. La méthodologie choisie est celle d’un examen des écrits de Hobbes mené
dans un sens diachronique (depuis la correspondance des années 30 jusqu’au De corpore et aux
écrits polémiques contre J. Wallis et R. Boyle), en partant du principe qu’il s’agit là de la seule
façon de vérifier la modulation des entrées dans leurs différents contextes (de la physiologie de la
vision à l’imagination et au rêve) tout en éclairant la pertinence par rapport à Hobbes du thème de
« phénoménisme ».
Méthodologie de recherche adoptée :
a) Constitution d’une banque de données : A cause de l’absence d’une édition digitale intégrale
des textes de Hobbes, nous avons mené notre enquête à partir de la création d’une série
d’instruments de support lexicographique et méthodologique. Nous avons avant tout procédé à la
création d’une banque de données des textes du philosophe anglais, utilisant un logiciel spécifique
pour la reconnaissance des fichiers images obtenus grâce à un précédent travail de scan des textes
mêmes. Ce travail nous a permis de pourvoir notre thèse d’un appareil important, qui constitue le
second volume, à notre connaissance unique et inédit dans le champ des recherches sur Hobbes,
comprenant les occurrences et les concordances relatives à chacune des œuvres analysées.
b) Liste des mots : Le travail de digitalisation nous a permis de vérifier la fréquence des
occurrences des mots du lexique de l’apparence. Le choix des mots n’a pas été fortuit, mais a été le
fruit d’une lecture précédente des textes, qui nous a permis d’opérer une première sélection de
termes sur lesquels orienter notre recherche. Le nombre des mots s’est élargi in itinere grâce aux
résultats que la recherche dans la base de données a produit au fur et à mesure. Nous avons ainsi pu
vérifier la proximité sémantique de certains termes et leurs modulations dans les différents

3
contextes ; nous avons tenté de comprendre les choix faites par Hobbes quand il utilise un terme
plutôt qu’un autre, donnant également de l’importance à la présence de prépositions et autres
locations grammaticales dont le philosophe se sert pour créer des syntagmes et établir des liens
entre les termes, indiquant qu’il s’agit d’équivalences ou de synonymes (and/et/atque, or/sive/vel,
that is/which is/id est, et ainsi de suite). Les mots sur lesquelles porte notre enquête sont les
suivantes : 1) en anglais : apparition, apparent, appearance, to appear, colour, coloured, conceit,
to conceive, conceivable, conception, conceptive, dream, to dream, fancy/phancy, to feign, fiction,
figment, figure, figured, ghost, idea, idol, image, to imagine, imaginable, imaginary, imagery,
imagination, impression, to imprint, phantasm, phantasy, phantastical, phenomenon, perception, to
perceive, perceptible, resemblance, to resemble, representation, to represent, seeming, to seem,
similitude/dissimilitude, space, species, spectrum ; 2) en latin : apparitio, apparentia, appareo,
color, coloratus, conceptio, conceptus, concipio, conceptibilis, fictio, figmentum, figura, figuratus,
idea, idolum, imago, imaginatio, imagino, imaginabilis, imaginarius, impressio, imprimo,
phaenomenon, phantasma, phantasia, phantasticus, perceptio, percipio, perceptibilis,
repraesentatio, repraesento, similitudo/dissimilitudo, somnium, somnio, spatium, species, spectrum.
De l’analyse lexicale à l’analyse conceptuelle :
Nous avons consacré le premier volume de la thèse a l’interprétation des données textuelles. Ce
volume est divisé en deux partie : dans la première partie, nous nous concentrons sur les années 30
et la première moitié des années 40 et analysons le lexique de l’apparence dans les textes suivants :
la correspondance de 1634-1636, en même temps qu’un inédit sur la réfraction – “Mr Hobbes
Analogy”, MS 4395, British Library, ff. 131-133 – (chap. 1), les « Elements of Law (1640) » (chap.
2), les deux traités latins d’optique et la correspondance avec Descartes de 1641 (chap. 3), et la
critique du De Mundo de Thomas White (chap. 4) ; la seconde partie concerne la deuxième moitié
des années 40 jusqu’aux années 70, selon la division suivante en chapitres : « A Minute or First
Draught of the Optiques (1646) et le De homine (1658) » (chap. 5), « Le Leviathan anglais (1651)
et le Leviathan latin (1668) » (chapitre 6), « Le De corpore (1655) et les polémiques scientifiques
(1656-1678) » (chap. 7).
Nous avons considéré les années 1634-1636 comme terminus ad quem puisque la
correspondance de ces années-là représente le premier témoignage des intérêts scientifiques de
Hobbes et, surtout, la première preuve textuelle de la présence, dans son vocabulaire, d’un lexique
de l’apparence. C’est en effet dans ses lettres que Hobbes confie ses premières opinions sur la
philosophie naturelle et sur l’optique en particulier.

4
Ière partie : le lexique de l’apparence des années 30 à la première moitié des années 40 : Les
principaux résultats de l’enquête effectuée sur le plan lexical dans cette première partie de la thèse
sont au nombre de deux :
I) Uniformité et difformité relevées dans le choix de la langue, le latin ou l’anglais. Très
logiquement puisqu’il s’agit de deux langues différentes, Hobbes ne peut pas utiliser, pour chaque
terme du lexique de l’apparence, une équivalence univoque. En effet si, dans certains cas,
l’uniformité se dessine aussi bien sur le plan lexical que sémantique (par exemple, figure et figura,
image et imago se correspondent « formellement » et « sémantiquement »), dans d’autres cas,
l’uniformité lexicale ne trouve pas son pendant sémantique (par exemple, phantasm et phantasma
possèdent une « extension » sémantique différente). Il est ainsi évident que le philosophe (a) ou
abandonne certains mots (b) ou modifie, tout en maintenant l’uniformité lexicale, le profil
sémantique des termes latins et anglais. C’est ce qui se produit pour trois termes en particulier :
conception, phantasm et phantasma. 1) Le terme anglais de conception est utilisé dans les Elements
of Law avec la fonction de désigner, dans des termes génériques, les différents moments du
processus de l’apparaître, de la première représentation ou sensation des qualités d’un objet
extérieur à les images obscures de l’imagination. Il s’avère évident que Hobbes utilise le mot
anglais de conception en s’éloignant totalement de la tradition sémantique des termes latins
conceptus ou conceptio : plus que des produits de l’intellect, les concepts sont des produits des sens,
à égalité avec ce qu’on désigne plus communément par le terme d’images ; 2) dans les deux traités
d’optique latins et dans la correspondance avec Descartes, c’est-à-dire les textes qu’écrit Hobbes
après les Elements of Law, le substantif « concept » disparaît. On n’observe en effet aucune
occurrence d’une éventuelle contrepartie latine du terme (conceptus ou conceptio) ;
Deux raisons sont à l’origine de cet « abandon » : 1) la progressive substitution lexico-
conceptuelle de conception par le terme latin de phantasma. Cette opération se réalise
effectivement dans l’Anti-White (chap. 4), où Hobbes transfère au phantasma les propriétés
sémantiques qui appartenaient à la conception. Ainsi, phantasma devient le nom « générique » par
lequel on indique tous les moments inhérents à la dynamique de l’apparaître ; 2) le développement
sémantique du terme phantasma. Non seulement le mot se substitue à celui de conception, mais il
inclut désormais deux acceptions : la première apparaît dans le contexte de l’optique et de la théorie
de la vision : phantasma y indique proprement la sensation ou apparition de la lumière (chap. 3) ; la
seconde acception surgit dans l’Anti-White et est reprise dans les Elements of Law où Hobbes avait
utilisé le terme anglais de phantasm pour désigner des images illusoires, comparables à ghosts et
spectra. Dans ce sens, phantasma n’est rien d’autre que la traduction de phantasm.
Dans le laps de temps pris en considération, donc, c’est-à-dire dans la première phase de sa
réflexion, Hobbes semble abandonner, sur le plan lexical, l’utilisation du substantif « concept » et,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%