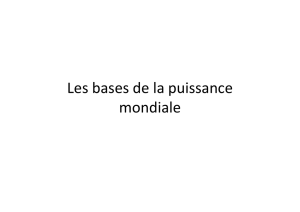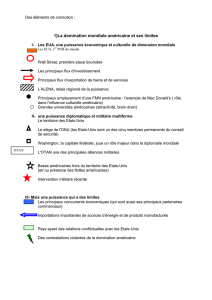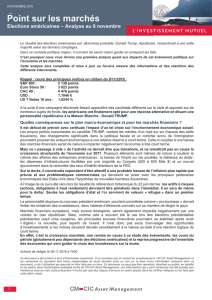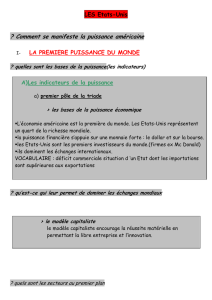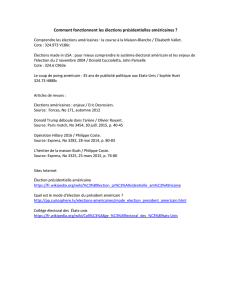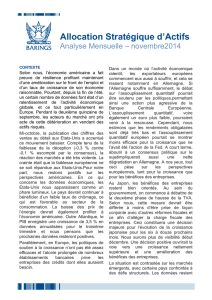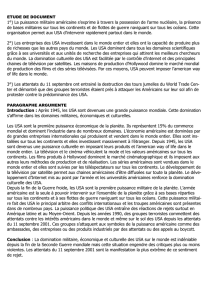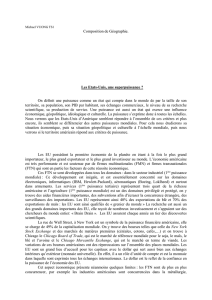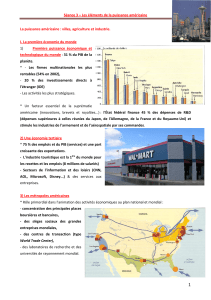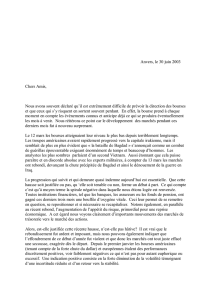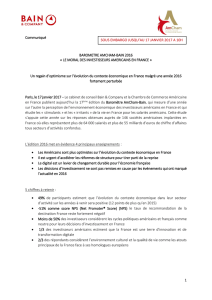La Chambre de Commerce américaine en France et les filiales

UNIVERSITE PARIS-SORBONNE (PARIS IV)
ECOLE DOCTORALE D’HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE
2013
Philippe ROCHEFORT
sous direction du Pr. Pascal GRISET
La Chambre de Commerce américaine en France et les
filiales américaines (1890-1990) : cohérences et dissonances
POSITION DE THESE
Dans l’historiographie américaine, les études du développement des entreprises à
l’étranger sont relativement rares (Kindleberger 1971, Wilkins 1970, 1975 et 1991,
Dunning 1980) et la France y occupe une place réduite. Les entreprises américaines en
France ont été étudiées dans l’historiographie française soit dans le cadre d’études
sectorielles, comme l’automobile (Fridenson 1994) ou les communications (Griset
1993), soit dans le cadre des nombreuses études sur les entreprises multinationales
(Mucchielli 1998). Leur influence, sous l’angle de la diffusion de la modernité, a été
étudiée (Barjot 1997 & 2002, Bonin 2009).
Naturellement, chaque entreprise met en œuvre sa propre stratégie de développement
international en fonction de ses avantages concurrentiels et de sa position sur le marché
mais il n’existe pas d’étude des éléments éventuels de solidarité mis en œuvre par les
entreprises américaines pour accompagner leur développement à l’étranger.
Ce qui nous a semblé particulièrement intéressant et nouveau est d’étudier avec les
outils d’analyse des actions collectives (Olson 1971) si et comment les entreprises ont
mis en œuvre des actions communes et dans quels objectifs partagés entre elles.
Les archives de la Chambre de Commerce Américaine en France (AmCham),
organisation constituée très tôt par les entreprises américaines, fournissent un outil qui

2
permet de mieux comprendre les étapes successives qu’elles ont traversées en
identifiant sur un longue période les actions collectives qu’elles ont menées et
l’influence qu’elles ont eue sur leur environnement français.
Depuis la fin du 19
ème
siècle, le flux d’implantations d’entreprises américaines en
France et la nature de leurs interactions avec les entreprises et le milieu français ont
traversé des étapes très différentes. Notre périodisation en distingue cinq, avec des
ruptures nettes en 1914, 1945, 1970 et 1990.
Dans les deux premières périodes, l’AmCham était une association d’hommes
d’affaires, et les entreprises agissaient par opportunisme et tâtonnements. Avant 1914,
les échanges commerciaux étaient limités et les barrières douanières donnaient lieu à de
fréquents conflits. Les entreprises américaines étaient très peu nombreuses et les
premiers arrivants, qui étaient principalement des commerçants et des entreprises de
services, cherchaient à s’intégrer à un milieu difficile pour eux et dont ils admiraient le
French industrial art. Ils créèrent une association, l’AmCham, pour les représenter
auprès des autorités françaises et du gouvernement américain, tandis que se constituait
une communauté américaine structurée dont la naissance s’explique aussi par la
nécessité de se regrouper devant l’hostilité de leur propre gouvernement pour qui les
expatriés sont considérés plus comme des « traitres à l’Amérique » que comme les
vecteurs de la puissance américaine.
Les deux gouvernements étaient également protectionnistes et les efforts de lobbying de
l’AmCham s’effectuaient dans le cadre d’une loyauté absolue à l’égard de son
gouvernement, par exemple dans sa défense du Payne-Aldrich Act (1909). A l’égard de
son pays d’accueil, l’AmCham, « institution ethnique », se comportait en interlocuteur
mondain et déférent, comme l’illustrent les portraits de ses présidents Stephen Tyng et
Walter Berry.
L’AmCham suscita des actions qui contribuèrent à aider l’économie américaine à
prendre conscience de sa puissance, notamment par sa participation à l’Exposition de
1900. Cependant en 1914, la présence des entreprises américaines restait très limitée,
surtout pour les entreprises industrielles, dont rares étaient celles, comme Otis, qui
s’étaient implantées selon le modèle étudié par Wilkins (1970) : les autres se
contentaient d’exporter à partir des Etats-Unis. Les commerçants, les avocats (comme

3
Coudert Frères) et les banques dominaient et les rares entreprises industrielles
américaines qui avaient des ambitions de développement mondial n’étaient présentes à
l’AmCham, « conservatoire d’américanité » (Fouché 1999), que pour des raisons
purement mondaines. Au temps des pionniers solidaires dans un monde prestigieux,
c’est une logique de commerçants, dominants parmi les entreprises américaines, qui
animait l’AmCham, dont l’influence était, globalement, limitée mais dont tous les
membres partageaient les mêmes objectifs.
Dans la guerre et la crise, les entreprises américaines tentèrent de maintenir leur
solidarité malgré les conflits politiques (à propos des dettes de guerre) et entre les deux
guerres, l’AmCham suivit, avec difficulté, les hésitations et les changements de la
politique du gouvernement américain. Après 1918, la politique américaine vis-à-vis de
l’investissement à l’étranger était versatile, ce qui contraignit les entreprises américaines
à des adaptations constantes et n’encouragea pas les implantations industrielles. Dans la
Crise, elle joua un rôle actif, et parfois critiqué, dans la gestion des quotas d’importation
et ses membres, comme E. Baldwin, que nous avons choisi pour illustrer cette période,
sont souvent associés aux opérations anti-concurrentielles caractéristiques de l’époque.
Contraintes à une stratégie « opportuniste », les entreprises ne se trouvèrent pas
facilement des intérêts et des objectifs communs et l’influence des entreprises
étrangères resta limitée. Pendant cette période, l’AmCham suivit sans les maîtriser les
variations désordonnées de son environnement et les représentants des entreprises
américaines furent parfois entrainés dans des opérations complexes et aventureuses
(gestion des surplus américains après 1918, organisation des commissions de quotas
dans les années 1930).
Pendant les deux guerres mondiales qui vont marquer cette période, l’AmCham
témoigna d’une fausse neutralité et d’une réelle solidarité avec son pays d’accueil,
surtout dans la Première Guerre Mondiale. Pendant l’Occupation allemande, les
entreprises américaines se comportaient comme leurs homologues françaises.
Pour lutter contre la concurrence européenne, les entreprises américaines devaient
renforcer leur présence en France mais elles hésitaient sur les moyens à mettre en
œuvre : licence, joint-venture ou implantation greenfield. Cependant, aucun modèle-
type d’implantation ne se dégage et les échecs furent nombreux. La seule façon de

4
contourner les protections douanières était de produire sur place mais très peu
d’entreprises américaines y étaient préparées. On propose une typologie des
implantations, différente de celle de M.Wilkins et basée sur la sécurité dans le maintien
de la capacité innovatrice en distinguant les formes stables et les formes transitoires
d’implantation.
De 1945 à 1990, en revanche, les éléments de solidarité entre les entreprises étaient plus
déterminants. L’Amérique triomphante envahit le marché européen et l’AmCham,
illustrant l’efficacité américaine pour la conquête des marchés et la diffusion des
pratiques managériales, contribua activement à la conquête méthodique du marché et de
la société française, constituant ainsi un outil efficace de la domination américaine.
Après la Seconde Guerre Mondiale, il fallait renforcer l’économie française, en
maintenant la supériorité américaine. L’AmCham fut un acteur actif du Plan Marshall
par l’European Liaison Office qu’elle hébergea et elle aida effectivement les entreprises
françaises dans leurs efforts pour aborder le marché américain. Avec la multiplication
des unités de production et la perception du Défi Américain elle dut affronter un
environnement politique et social parfois hostile et fit preuve, au moins dans la première
partie de cette période, d’une solidarité absolue entre ses membres. Dans un
environnement politique et monétaire difficile, les négociations avec les autorités
françaises étaient inégales et les entreprises américaines, soutenues par leurs avocats et
fiscalistes firent souvent évoluer à leur profit leur environnement législatif et
règlementaire.
Après la conquête des marchés, il fallait aussi conquérir les esprits des consommateurs
et des dirigeants locaux : le modèle américain s’imposa et l’AmCham y contribua
activement. Les nouveaux métiers de conseil aux entreprises accélérèrent la
convergence des entreprises françaises et américaines vers un modèle commun, malgré
la persistance des différences inter-culturelles (d’Iribarne 2002). Une nouvelle
génération de managers français comme Jacques Maisonrouge et Hubert Faure, tous
deux choisis pour illustrer cette période, le traduit et la « francisation » (Kuisel 1993 et
2012) des filiales américaines s’accompagna de celle de l’AmCham.
Les réticences locales au rôle croissant des implantations américaines étaient fortes :
celles des communistes puis celle du Gaullisme et l’AmCham était au cœur de ces

5
conflits, qui s’aggravèrent momentanément avec l’arrivée de la Gauche au pouvoir en
1981. La crise du gazoduc soviétique en 1981-1982 vit cependant l’AmCham soutenir
la position française, introduisant ainsi une première rupture majeure dans ses relations
avec son gouvernement. Ce conflit illustra la difficulté, pour les Etats-Unis, à fixer des
limites aux transferts de technologie lorsque leurs entreprises produisaient à l’étranger.
Pendant la Guerre Froide, les entreprises américaines ont été très nombreuses à
s’implanter en France pour bénéficier de coûts de production moindres, conquérir le
marché européen et limiter la concurrence croissante des entreprises européennes. Ces
« conquérants » avaient une stratégie commune claire et s’étaient dotées des outils pour
la mettre en œuvre, même contre les changements décidés par leur propre
gouvernement. Le rachat d’entreprises françaises est devenu une forme très fréquente
d’implantation (comme l’illustre un groupe comme UTC).
Autour de 1970, une rupture très importante fut créée par l’évolution de la politique du
gouvernement américain, qui multiplia les obstacles monétaires et réglementaires à
l’expansion des entreprises américaines à l’étranger. Simultanément, autour de cette
date, les éléments de solidarité qui avaient réuni les entreprises du défi américain
s’atténuèrent et la représentativité de l’AmCham accusa une chute brutale et mesurable,
qui ne cessera de s’aggraver.
Mais, progressivement, devant le coût des expatriations et la prise de conscience de la
qualité des dirigeants locaux, il se produisit une réelle « francisation » des filiales
américaines, malgré la persistance des différences interculturelles au risque d’une
dissociation des valeurs culturelles entre les entreprises et la société française.
L’évolution des entreprises montre le succès d’un management qui a parfaitement
intégré les méthodes américaines. Cette francisation atteignit l’AmCham elle-même, où
les administrateurs américains devinrent minoritaires. Simultanément, la diffusion de
l’innovation dans les entreprises françaises rééquilibra les relations, sous l’effet des
recrutements de cadres et dirigeants formés aux méthodes américaines et des centres de
R&D créés par les groupes américains en France. La diffusion de l’innovation
s’effectua aussi dans l’administration (comme le montrent les exemples de Chronopost
et de la CDC). Après la signature en 1959 d’un Traité de Réciprocité qui ne fit que
 6
6
 7
7
1
/
7
100%