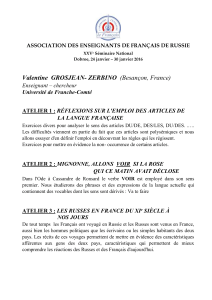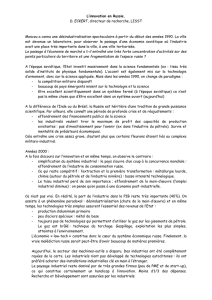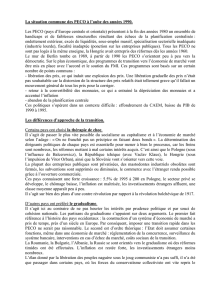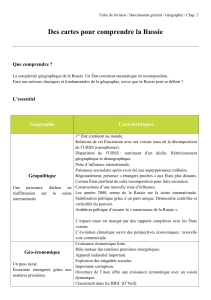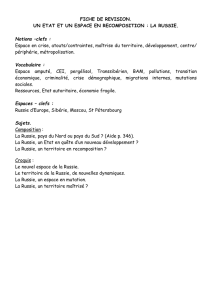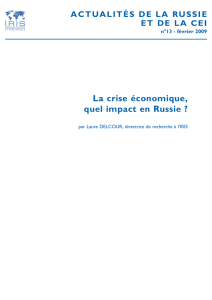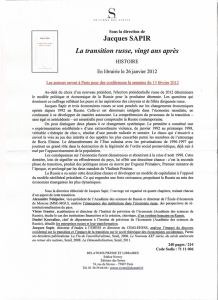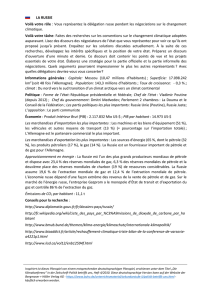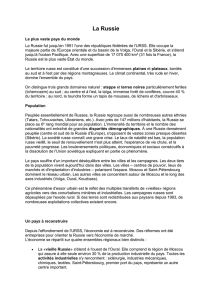Coup d`œil sur la Russie d`aujourd`hui

Philippe MARCHAT
Inspecteur général des finances (H.) et ancien chef de la mission interministérielle Euro
Coup d’œil sur la Russie d’aujourd’hui...
Un retour en Russie après quelques années montre l’ampleur des
changements que l’on y peut constater, dès l’aérogare agrandie
et modernisée de Moscou, puis sur la route menant au centre de
la capitale. A ces premiers aspects qui frappent immédiatement
s’en ajoutent d’autres, moins perceptibles, mais plus importants,
qui concernent autant la situation politique et économique de
ce vaste pays, que les mentalités et le comportement de ses
populations et de ses autorités dirigeantes. Pour délicate qu’elle
soit, toute analyse, forcément succincte, que l’on peut faire de
ces différents éléments au lendemain du conflit russo-géorgien
conduit à penser qu’il marque un moment important de l’histoire
de la Russie, dans ses relations avec l’Occident. Car, bien que
bref, ce conflit a brutalement fait resurgir nombre de tensions et
ravivé un climat de guerre froide que l’on pouvait espérer révolu.
D’autant que, paradoxalement, il a éclaté alors que s’ouvraient
à Pékin en présence de nombreux chefs d’Etat, dont Vladimir
Poutine, les jeux Olympiques, rendez-vous mondial s’il en est, de
sportifs venus du monde entier pour des joutes sportives purement
pacifiques.
Il apparaît comme le signe, à certains égards comparable au
fameux « réveil » chinois, d’une affirmation manifeste de la volonté
qu’a la Russie d’aujourd’hui, en digne héritière de l’Empire tsariste
et de l’URSS, de se voir de nouveau reconnue et respectée
comme l’une des grandes puissances de ce monde, en mesure
de jouer dans leur cour. Après une période ressentie comme un
humiliant retrait temporaire de la scène mondiale, elle estime
avoir recouvré, et tient à le faire savoir alors que pâlit l’image des
Etats-Unis, une puissance qui fait d’elle un acteur incontournable
de tout ce qui concerne, surtout, sous quelque forme que ce soit,
les territoires voisins du sien qui étaient il y a peu dans le giron du
monde soviétique.
QUE DE CHANGEMENTS VISIBLES !
Ce n’est pas sans raison que la Russie figure désormais au nombre
des quatre BRIC, ce néologisme désignant les puissances émer-
gentes que sont, à ses côtés, le Brésil, l’Inde et la Chine. Sans que
ces quatre Etats aient, fort heureusement, perdu leurs caractères
propres, l’on y retrouve désormais nombre de traits communs qui
les rapprochent à grands pas des pays encore qualifiés – mais
pour combien de temps ? – de développés. L’on est d’emblée
frappé dans les villes, et surtout la capitale, par une forte urbani-
sation que traduit le grand nombre, cependant moindre qu’en
Chine, d’immeubles nouveaux et de chantiers en cours. Cette
évolution tient, comme ailleurs, à un exode rural qu’expliquent les
progrès de l’agriculture et, pour les ruraux souvent dépossédés
de leurs terres, un attrait de la ville qui n’est souvent qu’un leurre.
Mais à ces migrants russes s’ajoutent nombre d’immigrés, souvent
musulmans, en quête de travail, venus de pays voisins de l’ex-
URSS. Cet ensemble constitue une part notable de la main-
d’œuvre multiethnique relativement pauvre qu’occupe actuel-
lement une industrie du bâtiment qui risque fort d’être à brève
échéance touchée elle aussi par la crise. Elle contribue, par la
rénovation de différents quartiers dispersés dans la capitale, à sa
profonde modification qui laisse une certaine impression de
désordre. Ainsi, la localisation sur un site intra-muros, d’un vaste
ensemble de logements et de bureaux à un stade encore peu
avancé appelé à dépasser celui de notre Défense parisienne
risquerait de poser des problèmes d’accès.
Le dynamisme et le modernisme urbains sont omniprésents à
Moscou. Ils frappent par la multiplicité et surtout la dispersion des
chantiers ouverts et des nouvelles tours de logements et de
bureaux dont la hauteur et l’architecture, généralement moins
novatrice et d’avant-garde qu’à Shanghai ou Singapour, tran-
chent avec l’urbanisme ancien des quartiers au milieu desquels
elles se dressent. Ce dynamisme, apparemment plus débridé que
concerté, contribue à apporter une note supplémentaire aux
deux styles d’urbanisme et d’architecture dont Moscou avait
hérité, qui portaient la marque de chacune de leurs deux
périodes de construction, tsariste et soviétique. La périphérie en
constante extension s’est, elle, comme partout ailleurs, couverte
de zones commerciales et de vastes hypermarchés dont les
immenses parkings regorgent aux heures d’affluence de véhi-
cules qui ne risquent pas d’être à court de carburant, si l’on en
juge par le nombre des stations-service aux marques et logos
divers qui se font concurrence.
Ce « boom » de la construction, signe de la croissance écono-
mique de ces dernières années, n’en pose pas moins différents
problèmes. L’un d’eux touche à l’aspect même de la ville qui,
sans rivaliser sur ce point avec Saint-Pétersbourg, présentait une
homogénéité d’ensemble. Celle-ci résultait du regroupement,
dans des quartiers distincts généralement séparés, de deux types
d’architectures marquant deux périodes historiques. L’émer-
gence, dispersée, et sans plan d’urbanisme tel que celui de
Shanghai, de ces tours nouvelles, souvent l’œuvre d’architectes
étrangers, au cœur de ces différents quartiers, est en train
d’apporter une touche nouvelle de modernisme. Mais, pour
nécessaire qu’elle soit, une extension de ce type conduit en
l’occurrence à instaurer une sorte de stéréotype commun à la
plupart des grandes villes. Elle n’a, fort heureusement, à la diffé-
rence de Pékin et de sa Cité interdite, pas encore touché les
abords immédiats du Kremlin, et il est à souhaiter qu’il en soit ainsi
à l’avenir.
D’autre part, cette densification en hauteur a pour double effet
de rendre plus difficile une circulation qui manque déjà cruelle-
ment de fluidité, et d’accroître une pollution qui, sans atteindre
celle des mégalopoles asiatiques, va à l’encontre des politiques
actuelles de réduction des effets de serre contribuant au réchauf-
fement de la planète. Car le trafic n’est plus à ce jour ce qu’il
était sous le régime soviétique, celui d’un petit nombre de
varia
No5 - Mai 2009 -
426

modestes Lada ou d’imposantes Ziss noires officielles. Devenu,
comme partout, très dense, surtout aux heures de pointe, il est à
forte proportion de quatre-quatre et de puissantes berlines aux
vitres teintées de fabrication étrangère (allemande et asiatique),
à l’encontre desquelles les taxes douanières à l’importation vien-
nent d’être relevées. Les aménagements décidés il y a plusieurs
années par la Douma de Moscou, l’équivalent de notre Conseil
de Paris, pour améliorer le trafic en y construisant un premier péri-
phérique, puis un second plus éloigné, se révèlent maintenant
insuffisants, ce qui laisse entier un problème qui mérite une solution
urgente.
Cette urbanisation débridée et cet accroissement du trafic tra-
duisent une augmentation générale du niveau de vie et une
ouverture du pays sur l’extérieur. Elles proviennent de l’exploita-
tion et de la vente, surtout à l’Europe, du pétrole, du gaz et de
différents minerais traités dont dispose la Russie. Celle-ci a pu,
ainsi, se libérer de ses dettes, et élargir rapidement ses ressources
financières et son influence économique et politique. La crois-
sance interne qui en est résultée apparaît sous d’autres formes
au cœur même des villes, dans différents quartiers de la capitale
dont l’aménagement et la modernisation n’ont pas pour seul
objet des constructions nouvelles. Nombreuses sont en effet les
transformations et réhabilitations d’immeubles, et la mise aux
normes occidentales des magasins, hôtels et restaurants, dont des
ultra-chics et de fort coûteux. Ce qui confirme la double émer-
gence, aux côtés d’oligarques riches et même très riches, d’une
classe moyenne dont le pouvoir d’achat s’est fortement accru
ces dernières années. Par l’ouverture de ses frontières et les pers-
pectives qu’elle offre désormais aux étrangers, la Russie attire un
flux croissant d’investisseurs et de touristes qui, au même titre que
les oligarques et la classe moyenne, contribuent à sa croissance
rapide. Ainsi s’explique, en plus des imposants centres commer-
ciaux de la périphérie, une forte implantation, en différents quar-
tiers comme au centre de la capitale, de la plupart des grandes
marques internationales bien connues de vêtements, bijoux, pro-
duits de luxe et de beauté... Celles-ci font aussi, bien évidemment,
l’objet d’une large publicité sous ses différentes formes que sont
les panneaux lumineux, les affiches, la radio, la télévision, et le
net... Elles n’ont pas manqué non plus d’envahir ce haut lieu mos-
covite qu’est resté, au centre de la Place-Rouge, le Goum, entiè-
rement rénové pour la circonstance.
QU’EN EST-IL DE LA SITUATION RUSSE ?
C’est une question à laquelle il est particulièrement difficile de
répondre, après un séjour en Russie passé au lendemain de
l’affaire géorgienne, qui a permis d’y rencontrer divers interlocu-
teurs attentifs aux problèmes politiques et économiques qui s’y
posent. Ces entretiens ont eu pour mérite de dégager, dans un
environnement bien particulier, quelques impressions émanant
d’observateurs chevronnés, conscients des limites à ne pas
dépasser dans leurs propos à des visiteurs étrangers, sans pour
autant s’en tenir à une simple « langue de bois », si souvent pra-
tiquée de nos jours. Ainsi ont pu être démêlés quelques fils, et
levés quelques voiles sur une situation que la « guerre des Cinq
jours » russo-géorgienne a contribué à rendre plus complexe
encore qu’elle n’était.
La situation politique. – L’incontestable appui à 80 % de la popu-
lation au Premier ministre Poutine et à 70 % au nouveau président
Medvedev constitue une donnée de base fondamentale. Elle
s’inscrit toutefois dans un contexte particulier qui est celui du
comportement et des réactions de l’opinion vis-à-vis du pouvoir.
Traditionnellement, la population russe dans son ensemble n’a,
depuis des siècles, cessé de manifester un caractère passif, soumis
sans état d’âme aux rigueurs d’un système. Ce dernier était à la
fois « paternaliste » pour sa « prise en charge » de l’homme tout
au long de sa vie, et contraignant, l’Etat, qu’il soit tsariste ou
soviétique, y régnant en maître absolu. Cela tient à l’existence
d’un « pacte de non-participation », ou d’un « accord silencieux »
à ce qu’impose le pouvoir, aujourd’hui fondé, non plus sur la peur,
mais depuis le changement de régime, sur la capacité que doit
avoir l’Etat à apporter – au moins pour le plus grand nombre –
une amélioration progressive d’un standing de vie, qui est réel si
l’on en juge par le développement urbain et les changements
apparus dans la façon de vivre. Cette exigence prioritaire de la
majorité touche bien plus aux conditions matérielles de vie et à
l’économie qu’à l’environnement politique et philosophique, et
surtout au respect des « droits de l’homme » – auquel l’Occident
attache de son côté la même importance prioritaire, ce qui est
à la base d’un désaccord profond. Dans leur ensemble, les gens
semblent, ou bien indifférents, ou bien moins sensibles à la réduc-
tion de leurs droits politiques qu’à toute limitation de leurs droits
sociaux et surtout économiques. Quand celle-ci vient à se pro-
duire, elle a toute chance de provoquer des contestations sus-
ceptibles de se transformer en émeutes, comme ce fut, par
exemple, le cas début 2005, lorsque descendirent dans la rue
quelque 100 000 personnes venues protester contre une réforme
sociale impopulaire.
Cette « société passive » continue aujourd’hui de soutenir le pou-
voir, bien qu’il ait « fermé la vie politique », ce qui lui assure un
contrôle de nouveau complet. Il s’exerce aussi bien sur les partis
politiques dont la formation et la dissolution dépendent entière-
ment de lui, que sur l’ensemble du système judiciaire, et sur les
responsables des 84 « sujets » que sont les gouverneurs des diffé-
rentes collectivités du pays. Ils sont, comme les deux maires de
Moscou et de Saint-Pétersbourg, désormais directement nommés
par lui, et non plus élus. La fraction la plus âgée et la plus fragile
de la société – les retraités et la population rurale – après avoir
profondément souffert dans ses conditions de vie de la disparition
du régime soviétique, bénéficie aussi depuis ces dernières
années, dans une moindre mesure et à l’exception des plus
démunis, d’une amélioration générale des conditions de vie due
aux importants profits que la Russie tire de ses fortes exportations
d’hydrocarbures et de différents produits miniers.
Les médias. – Au correspondant d’un journal qui lui posait une
question sur la liberté des médias, M. Poutine a répondu qu’il y
en avait plus de 2 000, ce qui les rendait incontrôlables, donc bien
libres en Russie. Ce sont des propos à nuancer, du fait qu’en raison
de leur nombre, ces médias sont loin d’être homogènes et qu’ils
se divisent en deux groupes fort distincts. Le premier est celui des
deux chaînes de télévision nationales, regardées par 90 % des
Russes, dont plus de la moitié n’a pas d’autres sources d’informa-
tion. Elles sont possédées par l’Etat et contrôlées à 100 % par le
Kremlin, avec lequel les directeurs de chaînes élaborent leurs pro-
grammes et entretiennent des rapports étroits et réguliers. Le
second regroupe les autres médias, télévisions et radios privées,
organes de presse d’une diffusion et d’influence bien moindres.
Ils disposent d’une certaine liberté d’expression et de critique,
mais leurs responsables et leurs équipes sont parfaitement
conscients des limites à ne pas dépasser. Ce non-respect ne man-
querait pas d’entraîner, à tout moment, restrictions et interdictions
de parution ou d’émission, voire poursuites et condamnations
judiciaires. Ce que rappelle « l’avertissement », qualifié de
« mesure de prévention », du service des médias et de la commu-
nication envoyé au quotidien Vedmosti pour avoir publié le
6 novembre 2008 un commentaire jugé pessimiste du sociologue
Evgeni Gontmakher sur l’économie. Aussi, la loi donnant la possi-
bilité, après deux avertissements officiels, de demander la ferme-
ture d’un journal, dirigeants et rédacteurs sont conduits à exercer
en permanence une autocensure.
La guerre de Géorgie et ses conséquences. – La « guerre des Cinq
jours » a modifié la situation d’une Russie qui tient à marquer son
retour comme grande puissance sur la scène internationale. Elle
aintroduit entre la politique internationale et la politique inté-
rieure, dont elle est devenue une partie intégrante, une relation
qui n’avait jamais été aussi étroite pendant la période postcom-
muniste. Elle a par ailleurs provoqué au sein même de l’élite russe,
varia
-N
o5 - Mai 2009
427

Océan Arctique
Mer de Kara
Mer de
Barents
Mer de Sibérie Orientale
Mer de
Bering
Mer des
Laptev
KAZAKHSTAN
CHINE
MONGOLIE
Grozny
Nijni-Novgorod
Volgograd
Perm
Berezniki
Surgut
Arkhangelsk
Vorkouta
Anderma Nachodka
Norilsk
Omsk Novossibirsk
Irkoutsk
Yakoutsk
Okhotsk
Chabarovsk
Vladivostok
Petropavlovsk-
Kamtchatski
Magadan
Anadyr
Pevek
Tiksi
Namcy
Mourmansk
St-Petersbourg
MOSCOU
et jusqu’à son plus haut niveau, une scission qu’ont révélée les
deux approches opposées apparues lorsqu’il s’est agi de régler
la crise internationale née du conflit russo-géorgien.
L’on a vu, d’un côté, émerger, comme un retour à la guerre
froide, une ligne très dure, ravivant le conflit d’intérêt avec l’Ouest
– plus précisément les Etats-Unis et l’OTAN – au point de ne pas
exclure une politique de confrontation générale. Les marques les
plus visibles en ont été, notamment, l’envoi, rappelant le précé-
dent des fusées russes à Cuba, de bombardiers stratégiques au
Venezuela, zone traditionnellement considérée comme une
« chasse gardée » des Etats-Unis, et, beaucoup plus récemment,
la menace nullement déguisée de faire de Kaliningrad, cette
enclave russe au sein d’Etats « européanisés », une base de lan-
cement de fusées. L’on a, par ailleurs, assisté à une recrudes-
cence en Russie de diverses actions de propagande internes,
telles que des manifestations de jeunes ou des distributions de
tracts - autant de signes laissant apparaître, dans la capitale
notamment, une montée du « patriotisme » aux forts relents de
« nationalisme ». D’aucuns se préoccupent de l’étendue des
conséquences graves que pourrait avoir une éventuelle extension
de tels courants s’ils continuaient d’être encouragés par l’Etat, ou
s’ils venaient à échapper à son contrôle.
Face à cette ligne dure est parallèlement apparue une position
modérée, faisant valoir que l’affaire géorgienne n’est qu’un
conflit purement local, non régional et surtout sans aucune portée
internationale. Aussi ne doit-elle avoir, pour ses tenants, aucune
raison d’entraîner une dégradation des relations entre la Russie
et l’Ouest, avec lequel il convient de continuer à traiter en
commun des problèmes plus fondamentaux, car d’importance
mondiale. Tels que, par exemple, la non-prolifération nucléaire,
la lutte contre le terrorisme international, l’approvisionnement de
l’Union européenne en pétrole et en gaz, ou encore, et peut-être
surtout, les relations avec les Etats-Unis. Cette position est celle de
membres d’une élite politique et économique au pouvoir, pour
laquelle l’intérêt de leur pays et de l’ensemble de sa population
– comme d’eux-mêmes –, est de poursuivre, sans la modifier, la
politique menée jusqu’à présent qui était, à leurs yeux, avant la
crise financière et économique, la seule de nature à continuer
d’assurer une croissance indispensable pour la Russie comme
pour le monde. Elle seule permet d’exporter en quantités crois-
santes un pétrole et un gaz qui attirent de l’étranger les capitaux
et surtout les technologies nécessaires pour l’entretien d’installa-
tions vieillissantes, leur modernisation et leur développement, et
pour accélérer la recherche de nouveaux gisements et édifier les
installations de production, de transport et de raffinage corres-
pondants. Ces perspectives concernent, entre autres, la mer de
Barentsz aux énormes réserves encore peu connues, dont la déli-
mitation des frontières avec la Norvège voisine donne lieu à
d’âpres négociations et controverses. Les importants retraits de
capitaux étrangers consécutifs au conflit géorgien, comme les
effets en Russie de la crise internationale,
sont autant de confirmations de l’interdé-
pendance économique et financière liant
désormais la Russie au monde extérieur,
dont se prévalent les tenants de la thèse
modérée.
Entre ces deux orientations opposées, il est
à ce jour difficile de savoir ce que sera en
définitive le choix du Kremlin, en raison de
la multiplicité des signaux, parfois contradic-
toires, dont on dispose. Comment, par
exemple, aux yeux des observateurs, conci-
lier l’ouverture, puis la poursuite d’un dia-
logue avec les Européens que paraissait pré-
coniser l’interview de Vladimir Poutine au
Figaro, avec la reconnaissance immédiate
parMoscoudel’indépendancedesdeux
régions géorgiennes séparatistes de
l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, la signa-
ture non moins immédiate de deux traités d’alliance y pérennisant
le maintien de troupes russes, l’échec à Genève le 15 octobre 2008
des « discussions internationales » prévues par les textes de cessez-
le-feu, ou encore l’envoi au Venezuela de bombardiers stratégi-
ques ? Comment ne pas s’inquiéter également de la faible proba-
bilité de réaction des Etats-Unis jusqu’à l’installation le 20 janvier
prochain de leur nouveau président, si d’aventure la Russie, forte
du résultat positif de son test en Géorgie, s’avisait d’en tenter un
second en d’autres lieux précédemment soviétiques, tels que, par
exemple, la Crimée et la base de Sébastopol qui abrite des navires
de guerre russes et ukrainiens ? L’élection aux Etats-Unis d’un pré-
sident démocrate, disposant d’une forte majorité, mais aux posi-
tions encore peu connues, ne permet pas de savoir en quel sens
évolueront les relations entre la Russie et les puissances occiden-
tales. Une nouvelle orientation positive leur serait donnée si, d’aven-
ture, prenait corps la solution avancée par certains, dont le prési-
dent Sarkozy au sommet UE-Russie de Nice du 14 novembre 2008,
d’annuler conjointement les deux projets, qualifiés de purement
défensifs, d’installation de missiles, l’un en Pologne et en République
tchèque voulu par le président George W. Bush, et l’autre à Kali-
ningrad évoqué en réponse par Vladimir Poutine.
Ce problème est loin d’être simple, tant sont nombreux les élé-
ments, internes et exogènes, en perpétuelle évolution, susceptibles
d’influer sur l’orientation que donnera demain le Kremlin à sa poli-
tique étrangère. A ces incertitudes actuelles s’en ajoute une autre,
non des moindres, dont il est difficile d’évaluer la pertinence, rela-
tive aux interrogations que l’on peut avoir sur les chances de péren-
nité du tandem récent et inédit Medvedev-Poutine, qui dirige
depuis peu la Russie. Car celle-ci a été historiquement habituée à
n’avoir eu à sa tête, parfois au terme de luttes sanglantes, qu’un
seul et unique dirigeant à la poigne de fer.
Le problème crucial soulevé par la « guerre des Cinq jours », est
celui de ce que seront demain les relations avec l’Occident d’une
Russie qui revient en force pour jouer désormais de nouveau, tout
comme la Chine, dans « la cour des Grands », après avoir connu
depuis l’éclatement de l’ex-URSS et l’ère Gorbatchev une
période de retrait et de déclin. Elle estime avoir, depuis la chute
du mur de Berlin, suffisamment manifesté son désir et montré sa
volonté de se rapprocher de l’Occident, en laissant par exemple
les Américains installer des bases militaires dans des Etats proches
de l’Afghanistan pour mieux y combattre les Talibans, participant
ainsi à la lutte contre le terrorisme international, comme elle
affirme le faire elle aussi dans des conditions comparables en
Tchétchénie. Elle considère cependant n’avoir pas été payée en
retour, mais avoir été ignorée et même méprisée, ce qu’elle sup-
porte très difficilement. C’est là un sentiment profond que paraît
ressentir une grande majorité de Russes, sans que l’opinion
publique occidentale en soit apparemment consciente. Il faut,
semble-t-il, y voir la raison d’une regrettable incompréhension
mutuelle. Celle-ci explique, en partie du moins, le non moins
varia
No5 - Mai 2009 -
428

regrettable raidissement des positions russes vis-à-vis d’un Occi-
dent avec lequel s’étaient progressivement développés un cer-
tain nombre de liens. Ceux-ci, heureusement, perdurent au moins
en partie, si l’on en juge par le bon déroulement et le rapide
accord obtenu à l’initiative du président Sarkozy, par l’activité
que continue de déployer l’OSCE (Organisation de sécurité et de
coopération européenne), ou encore par la tenue de « sommets
Union européenne - Russie ». Le premier après le conflit géorgien
a été celui de Nice le 14 novembre 2008, qui a longuement
débattu des questions posées par « la sécurité paneuropéenne »
et marqué une reprise des négociations en vue de l’établissement
d’un « partenariat » appelé à régler des problèmes politiques et
économiques, dont l’approvisionnement énergétique de
l’Europe est l’un des principaux.
La Russie se juge aujourd’hui injustement menacée par l’Occi-
dent, plus précisément par les Etats-Unis et son bras militaire,
l’OTAN, davantage que par une Union européenne manquant
encore, ce qui est regrettable, surtout dans une telle situation,
d’une diplomatie et d’une défense propres. Elle n’a apprécié ni
l’ouverture, ni le déroulement des négociations visant à faire de
la Géorgie, et plus encore de l’Ukraine, des membres de l’Union
européenne (UE) et surtout de l’OTAN. Elle s’est en outre estimée
attaquée par l’ardeur des Etats-Unis, et de leur président en fin
de mandat, à déployer, à proximité de ses frontières, en Pologne
et en République tchèque, un bouclier antimissiles dont elle dénie
le caractère défensif.
Quelle est, à ce titre, la perception qu’ont les Russes, et surtout
leurs dirigeants, de ce que représentent pour eux les termes,
aussi génériques qu’imprécis, d’Ouest ou d’Occident ? Ces
termes, bien plus que le Canada, l’Australie ou la Nouvelle-
Zélande, évoquent au premier chef les Etats-Unis, et leur bras
armé, l’OTAN, qui leur rappelle la guerre froide. Ils reprochent à
cet organisme militaire, auquel les rattachent pourtant certains
liens, de ne pas s’être reconverti comme ils l’auraient souhaité
après la chute du mur de Berlin. Quant à l’Europe, sans défense
ni tête politique, elle constitue pour eux un ensemble loin d’être
homogène. Mais elle est inquiète de l’élargissement en cours
d’une Union qui vise, sans en avoir fixé la limite, à étendre ses
frontières au plus près du limes russe. Surtout lorsqu’il s’agit, en
son voisinage immédiat, d’Etats membres, hier de l’ex-URSS,
comme la Géorgie et surtout l’Ukraine en raison du rôle qu’elle
a joué dans l’histoire de la Russie.
D’autres facteurs contribuent à différencier les jugements portés
sur divers autres Etats européens. Ce n’est pas l’histoire proche
qui, paradoxalement, explique l’étroitesse et la cordialité des rap-
ports avec l’Allemagne. Non seulement son ancien chancelier
Gerhard Schröder est devenu l’un des associés du puissant
conglomérat Gazprom, mais son pays figure dans les sondages,
avant Chypre et la Biélorussie, au nombre des « amis de la Russie ».
En revanche, les relations sont loin d’être cordiales avec d’autres
anciens membres de l’ex-URSS, comme ses trois voisins Baltes,
préoccupés par le projet d’installation de missiles russes Iskander
dans l’enclave de Kaliningrad et, pour l’un d’entre eux, par les
incursions cybernétiques extérieures dues à sa qualification
reconnue dans cette technologie de pointe. Les rapports sont
aussi tendus avec la Pologne et la République tchèque, en raison
de leur accord donné à Washington pour installer sur leur territoire
un bouclier antimissiles et de l’opposition de la seconde, deux
mois avant qu’elle n’accède à la présidence de l’Union euro-
péenne (UE), à la suggestion française de suspendre toute nou-
velle implantation de missiles. La France continue d’être appré-
ciée pour sa culture plus que pour sa présence industrielle limitée.
Elle l’est aussi pour le rôle qu’a joué Nicolas Sarkozy, plus en tant
que président français que de l’Union européenne, dans le conflit
russo-géorgien, en obtenant un cessez-le-feu et le retrait russe de
la Géorgie, à défaut de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud.
La Russie, qui a de la démocratie une vision différente de celle
de l’Occident, a tout d’abord regretté dans cette affaire géor-
gienne, considérée comme « d’intérêt national russe », l’appui
porté par l’Occident au président géorgien Saakachvili, tout en
ayant reconnu « des avancées positives », au cours des négocia-
tions ultérieurement reprises avec l’UE. L’attitude d’ouverture sur
l’Occident qu’elle fait remonter à Pierre le Grand, mais avec un
intérêt plus marqué pour sa technologie que pour son « système
moral et politique » est de nature, si elle perdure et s’élargit, à
satisfaire les ambitions de ses oligarques.
Le facteur religieux est un dernier élément, dont l’importance est,
dans la conjoncture actuelle, aussi grande en Russie que dans les
Etats, orthodoxes et musulmans, de l’ancienne galaxie soviétique,
sur lesquels Moscou continue de porter une grande attention et
d’exercer son influence. En y distribuant, par exemple comme en
Abkhazie et en Ossétie du sud, des passeports russes aux minorités
ethniques russophones de territoires « sensibles » pour elle.
L’église orthodoxe, après avoir été persécutée, interdite, et avoir
beaucoup souffert sous le régime soviétique, est redevenue lar-
gement populaire, et connaît un renouveau frappant. Il se traduit
dans les vocations, de moines en particulier, et dans la fréquen-
tation des monastères et des églises qui sont l’objet de rénova-
tions, voire de reconstruction pour celles qui, comme celle du
Saint-Sauveur à Moscou, avaient été détruites sous le régime
soviétique. Fermement dirigée par le patriarche de Moscou,
l’église passe pour être aujourd’hui, non une entité indépendante
et apolitique susceptible de jouer le rôle que d’aucuns pouvaient
espérer, mais un instrument de pouvoir lui aussi contrôlé par un
Etat, dont les représentants les plus élevés apparaissent fréquem-
ment aux côtés du patriarche Alexis II. Malgré sa forte implanta-
tion, elle se sent aujourd’hui menacée sur son propre territoire,
comme le catholicisme l’est sous d’autres cieux par de nouveaux
mouvements religieux. Elle s’efforce de contenir l’influence du
principal d’entre eux, celle des églises protestantes évangélistes
d’obédience américaine, dont d’abondants financements favo-
risent l’expansion.
Il est toujours des Russes pour qui la religion est, en raison de son
conservatisme, un obstacle sur la voie de la modernisation. Ce
jugement s’applique autant à l’orthodoxie qu’à l’Islam qui, quel
que soit son degré de pratique, reste la religion prédominante,
sous sa double forme chiite et sunnite, dans la plupart des pays
caucasiens de l’ancien empire soviétique. Son dévoiement
radical sous la forme du courant islamiste a été depuis plusieurs
années combattu, sans résultat en Afghanistan, et sans relâche
en Tchétchénie, où il constitue un problème majeur qui touche
au politique et à la sécurité. Il se manifeste, avec la brutalité que
l’on sait, dans des attentats terroristes perpétrés, aussi bien en
Russie, dans des circonstances parfois troubles, que chez certains
de ses voisins les plus proches, en premier lieu en Tchétchénie.
Celle-ci passe pour être pourtant aujourd’hui en voie de recons-
truction et pour bénéficier d’une situation stable, grâce à une
économie en voie d’amélioration depuis deux ans. Mais le regrou-
pement dans les zones montagneuses de bataillons de jeunes
générations apparaît comme le symptôme d’une tendance
séparatiste, dans un pays dont les groupes ethniques et religieux
différents sont habitués à vivre en bonne intelligence. Ce fait nou-
veau risque d’être une menace pour l’avenir, surtout si le dicta-
teur constamment menacé qui tient le pouvoir depuis son intro-
nisation par les Russes, Ramzan Kadyrov, venait à disparaître.
Pour divers observateurs, c’est une vraie guerre qui se poursuit
depuis 1992 au sein de la Russie fédérale entre Moscou et l’isla-
misme, dont l’opposition à caractère religieux s’expliquerait par
un renforcement de l’autoritarisme d’un régime qui laisserait de
moins en moins de place à toute opposition civile modérée. Ce
qui, dans les régions musulmanes, ne laisserait à l’opposition
d’autre alternative que de recourir à la violence et au terrorisme,
et de faire appel à l’Islam radical, dont les liens étroits avec divers
pays du Moyen-Orient lui assurent le financement et la base
arrière dont il a besoin. Le pouvoir ne pouvant tout contrôler, des
régions du Caucase du nord aux ethnies variées, comme le
varia
-N
o5 - Mai 2009
429

Daghestan ou l’Ingouchie proche de l’Ossétie, aujourd’hui zones
d’insécurité secouées par des enlèvements et des attentats, ris-
quent de devenir demain des zones de conflits plus sérieux et plus
étendus.
UNE DÉMOGRAPHIE
QUI POSE PROBLÈME...
Avec ses onze fuseaux horaires couvrant 9 000 kilomètres d’Ouest
en Est, et 2 500 du Nord au Sud, et d’une superficie d’environ
17 millions de kilomètres carrés, dont 13 à l’est de l’Oural et 4 en
Europe, la Russie est le pays le plus étendu du monde entre
l’Europe et l’Asie. Elle a, fait exceptionnel, quatorze voisins : Nor-
vège et Finlande au Nord-Ouest, Pologne, Estonie, Lettonie,
Lituanie, Ukraine et Biélorussie à l’Ouest, Géorgie, Azerbaïdjan et
Kazakhstan au Sud, Chine, Corée du Nord et Mongolie au Sud-Est.
Sa population, composée de 134 nationalités, qui en 2006 comp-
tait 143 millions d’habitants, dont 10,4 dans sa capitale en plein
développement, est très inégalement répartie. La partie euro-
péenne, soit le quart du territoire, abrite, avec une densité de
30 habitants au kilomètre carré (contre 8,5 pour l’ensemble du
pays), 80 % d’une population, dont environ le quart vit dans les
dix villes les plus importantes, avec un taux d’urbanisation de 73 %.
Une telle disparité pose un premier problème, car la Sibérie lar-
gement sous-peuplée fait face à une Chine surpeuplée.
Un second problème, plus grave pour l’avenir, tient à ce que la
Russie, qui depuis 1992 a perdu 6 millions d’habitants, voit, comme
d’autres Etats européens, sa population décroître. L’on y enregis-
trait en 2006, 16,1 décès pour 10,4 naissances sur 1 000 habitants,
avec un taux de natalité de 1,34 enfant par femme, insuffisant à
assurer l’équilibre démographique. Ce qui a poussé le Gouverne-
ment à mettre en œuvre, comme en France, une politique nata-
liste, qui ne pourra cependant avoir d’effet qu’à terme.
UNE ÉCONOMIE
EN CROISSANCE RÉGULIÈRE...
JUSQU’A LA CRISE MONDIALE
Sur cet immense territoire, la Russie dispose en abondance de
ressources minérales et agricoles, notamment sur les fertiles terres
noires du tchernoziom, qui font d’elle le quatrième producteur
mondial de blé, le cinquième de bois, le septième de millet et le
onzième de bovins. En plus de ressources minérales nécessaires
au développement des industries de pointe (fer, bauxite, cobalt,
cuivre, manganèse, nickel, plomb, zinc, lithium, magnésium...),
elle recèle une énorme part des réserves mondiales de charbon
(58 %), de lignite (68 %), et surtout de gaz et de pétrole. Elle est,
depuis 2003, respectivement le premier et le second producteur
et le second exportateur mondial d’or noir, leur ensemble repré-
sentant 20 % du PIB russe et procurant le tiers des ressources bud-
gétaires. Leur exportation constitue, comme le labourage et le
pâturage de la France de Sully, les deux facteurs d’une crois-
sance régulière, de 7,1 % en 2004, 6,4 % l’année suivante et 6,7 %
en 2007, grâce à laquelle son PIB, en augmentation régulière,
atteignait 979 Mds$ en 2006.
La Russie est ainsi en mesure d’avoir des excédents budgétaires,
de, respectivement, 7,7 % du PIB en 2005, 7,3 % l’année suivante
et 7,4 % sur les sept premiers mois de 2007. Une performance qui,
après un remboursement par anticipation en août 2006 de
23,7 Mds$ au Fonds monétaire international (le FMI), lui a permis
de réduire son endettement public de 11 % fin 2005 à 9 % en 2006
– un taux parmi les plus faibles au monde, fort éloigné du plafond
des 60 % du traité de Maastricht... A cette amélioration du risque
de l’Etat correspond toutefois, du fait de la croissance, un fort
accroissement depuis 2003 de la dette extérieure des banques
et des entreprises, qui, fin 2006, était de 260 Mds$, soit près du
quart du PIB. Les fortes entrées de devises résultant aussi bien des
investissements étrangers que des exportations d’hydrocarbures
aux prix en hausse sont à l’origine d’une sensible appréciation de
la monnaie nationale, le rouble. Constante depuis 1999, elle a été
sur les marchés des changes de 7,4 % en 2006 et de 3,9 % au
cours des sept premiers mois de 2007.
Mais ces bons résultats ont eu pour effet un relâchement bud-
gétaire, porteur, selon le FMI, de deux formes de risques pour
l’avenir. D’une part, l’excédent budgétaire provenant des
recettes pétrolières et gazières cachait un déficit latent, de
l’ordre de 5 % du PIB en 2007, qui aurait encore augmenté si
des mesures n’avaient été prises pour corriger le projet de
budget triennal 2008-2010. Par ailleurs, la dégradation de la
conjoncture due à la crise financière n’a manqué d’induire,
comme dans bien d’autres pays, un fort accroissement des
dépenses qui ont atteint 20,3 % du PIB avec, pour résultat, une
réduction à 2,8 % du PIB de l’excédent budgétaire. L’inflation,
de son côté, après sa réduction de 9,6 à 8,7 % entre 2006 et
2007, augmente depuis son point bas de mars 2007. Cette
hausse, pilotée par la Banque centrale pour limiter l’apprécia-
tion du rouble sur des marchés qui enregistraient alors de fortes
entrées de devises, a été suivie de l’augmentation mondiale
des prix qui a conduit à relever à 10 % le taux prévisionnel
d’inflation.
L’approvisionnement de l’étranger en hydrocarbures est la
caractéristique principale de son commerce extérieur. Ils y tien-
nent une place prépondérante, ce qui est un sérieux avantage
dont la Russie tire partie dans sa politique étrangère, par son
contrôle sur les approvisionnements et les prix. Mais elle est aussi
en situation de dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Le retourne-
ment de conjoncture qui a entraîné une réduction de ses expor-
tations et un double reflux de capitaux, provoqué successivement
par le conflit géorgien, puis par la crise internationale, a même
conduit certains économistes à estimer que l’économie russe,
pour brillante qu’elle soit aujourd’hui, pourrait n’être demain
qu’ « un colosse aux pieds d’argile ».
Son commerce extérieur, en développement constant depuis
1992, hormis la chute brutale provoquée par la crise de 1998,
révèle un fort déséquilibre qui a joué pour l’instant en sa faveur.
En 2006, sur 137 Mds$ d’importations – supérieures de 40 % à
celles de l’année précédente –, seulement 15 %, composés de
produits finis et de biens d’équipement, provenaient de la CEI
(la Communauté d’Etats indépendants regroupant douze des
quinze anciennes Républiques soviétiques), et 85 %, composés
de machines et de biens d’équipement, émanaient des pays
hors CEI. Les exportations, deux fois plus importantes en valeur,
soit 300 Mds$, et elles aussi en croissance, mais de 25 % seule-
ment sur 2005, et intégrant pour près des trois quarts des produits
minéraux, du pétrole et surtout du gaz, étaient pour 86 % dirigées
sur les pays autres que ceux de la CEI. L’UE, destinataire à elle
seule des deux tiers de ces exportations, a toute chance de
rester, pour des années, le principal client de la Russie en raison
de ses besoins croissants et de la difficulté d’y apporter à brève
échéance des solutions alternatives. Peut-être même aura-t-elle
à compter un jour avec une OPEP du gaz, que la Russie, l’Iran,
le Qatar, l’Algérie et le Venezuela qui contrôlent 73 % des
réserves mondiales, ont le projet de créer. Ce qui devrait
conduire Bruxelles à définir et mettre en œuvre sans retard la
politique énergétique de l’Europe, que nécessitent aussi bien la
conclusion d’accords pour ses approvisionnements en pétrole
et en gaz, que la définition du tracé de nouveaux gazoducs et
oléoducs contournant la Russie, comme vise à le faire le projet
Nabucco. La pérennité de la prédominance de l’Europe
comme principal fournisseur pose également problème, en
raison de la compétitivité croissante des pays asiatiques.
Les revenus de cette manne gazière et pétrolière sont confiés,
comme en Norvège, mais sous une forme différente, à divers
organismes créés à cette fin. Le Fonds de stabilisation, instauré
en 2004 pour combattre les conséquences des variations des
varia
No5-Mai2009 -
430
 6
6
 7
7
1
/
7
100%