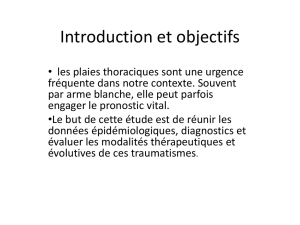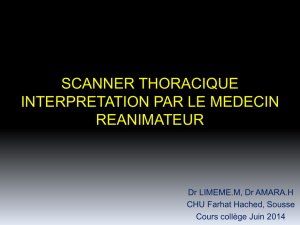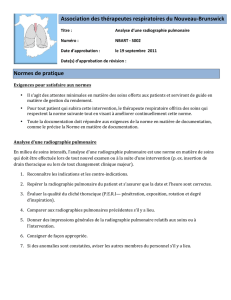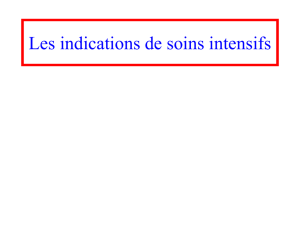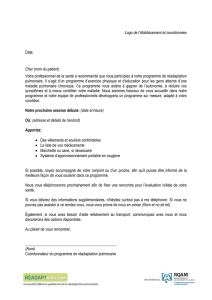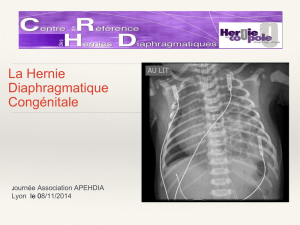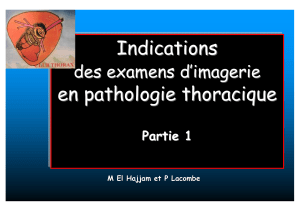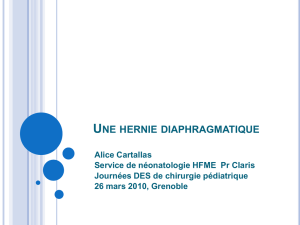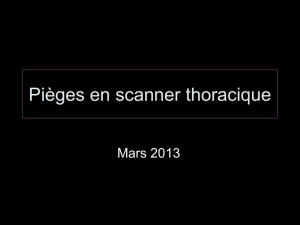F2-IMAGERIE THORACIQUE Techniques d`imagerie thoracique

F2-Imagerie thoracique / Mars 2008
Document publié sur le Site Internet http://www.respir.com 1 / 29
F2-IMAGERIE THORACIQUE
Olivier TOUBAS, Sandra DURY, François LEBARGY,
Boris MELLONI, Jacques MONTEIL
De nombreuses techniques d’imagerie s’offrent au praticien pour étudier le thorax.
Certaines sont irradiantes, d’autres coûteuses, toutes ont leurs limites.
Il est donc capital d’adapter la demande à la situation clinique et d’informer clairement le
radiologue : antécédents, histoire clinique actuelle, dossier antérieur d’imagerie.
Techniques d’imagerie thoracique
la radiographie standard
l’échographie
la tomodensitométrie
l'imagerie par résonance magnétique
la scintigraphie ventilation-perfusion
l’artériographie bronchique
la Tomographie par émission de positon TEP Scann

F2-Imagerie thoracique / Mars 2008
Document publié sur le Site Internet http://www.respir.com 2 / 29
I - Radiographie standard
Parmi les techniques citées, la radiographie standard est la plus ancienne (un
siècle). Peu coûteuse, peu irradiante, disponible en urgence, reproductible, elle
donne en quelques minutes une vision globale de la cage thoracique et de son
contenu : le poumon et ses enveloppes (plèvre), le médiastin (cœur, vaisseaux,
ganglions).
En revanche, il s’agit d’une imagerie par projection dont l’interprétation est parfois
délicate : elle doit donc répondre à des critères de qualité stricts et à une analyse
précise s’appuyant sur des signes (sémiologie).
a - Principes
Il repose sur l’absorption d’un rayonnement photonique émis par un tube à rayons
X. Le contraste observé sur les clichés est dû à une absorption du rayonnement qui
varie selon les tissus traversés. Sur le film, moins l'absorption du rayonnement est
importante, plus le film est impressionné et sombre. Il existe quatre densités
radiologiques :
calcaire (os),
liquide (tissus mous, sang, gros vaisseaux, cœur…),
graisseuse,
aérique.
Ainsi, sur un cliché thoracique, l’opacité du sang, des muscles, du cœur est
identique à celle de l’eau. L’opacité des côtes est celle du calcium, l’opacité des
poumons est celle de l’air et la "trame pulmonaire" correspond aux vaisseaux qui,
remplis de sang, ont une densité liquidienne.
Les densités radiologiques
air
os
peau,
tissu mou
graisse

F2-Imagerie thoracique / Mars 2008
Document publié sur le Site Internet http://www.respir.com 3 / 29
Ö Le signe de la silhouette
Quand deux structures anatomiques de même densité sont en contact, leur surface
de séparation disparaît. Ainsi, une pneumonie (densité hydrique) en contact avec le
bord du cœur qui a la même densité, efface le bord du cœur. A l’inverse, si deux
structures de même densité se projettent l’une sur l’autre dans des plans différents,
elles conservent leur silhouette propre. Par exemple, l’aorte descendante reste
visible dans son trajet rétrocardiaque.
Ce signe est d’une grande valeur pour localiser une opacité par rapport à une
structure anatomique dont le siège est connu.
L'image conserve son contour ; elle n'est
pas dans le plan du cœur. L'image perd son contour ; elle est dans
le plan du cœur donc antérieure dans le
lobe moyen.
Opacité effaçant le bord
droit du cœur, située dans
le lobe moyen. Opacité conservant son contour donc en arrière du cœur,
dans le lobe inférieur comme le confirme le cliché de profil.

F2-Imagerie thoracique / Mars 2008
Document publié sur le Site Internet http://www.respir.com 4 / 29
b - Techniques : Incidences radiologiques du thorax
Ö Radiographie du thorax de face
C’est l’incidence la plus souvent effectuée.
Le cliché est réalisé :
debout,
faisceau de rayons X postéro-antérieur, la face antérieure du thorax contre
la plaque,
les omoplates sont dégagées,
le cliché est réalisé en apnée et inspiration profonde.
Ö Critères de qualité du cliché thoracique debout de face
Tout le thorax est sur le film.
Inspiration correcte : les 6 espaces intercostaux antérieurs apparaissent
au-dessus du diaphragme.
Symétrie : les extrémités internes de clavicule sont à égales distances des
épineuses.
Pénétration correcte : le rachis est visible jusqu'en T4.
Dégagement des omoplates.
Thorax de face
omo
p
late
arc
p
ostérieur de côte
arc antérieur de côte
p
oche à air
g
astri
q
ue
ombre mammaire
coupole
diaphragmatique
Sinus
costo-diaphragmatique

F2-Imagerie thoracique / Mars 2008
Document publié sur le Site Internet http://www.respir.com 5 / 29
Ö Radiographie du thorax de profil
Elle est réalisée :
debout,
en apnée inspiration profonde,
bras en avant,
côté gauche contre la plaque pour diminuer l'agrandissement du cœur.
Cliché en ex
p
iration Cliché en ins
p
iration
Critères de s
y
métrie
extrémités internes
des clavicules
ligne des apophyses
épineuses
Thorax de profil gauche
sternum
coeur
cou
p
oles dia
p
hra
g
mati
q
ues
li
g
nes des omo
p
lates
rachis
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%