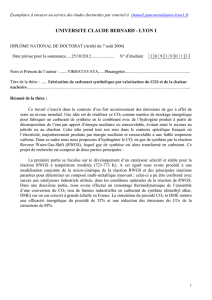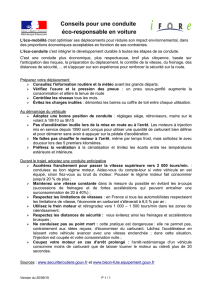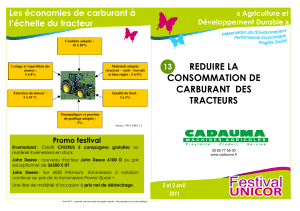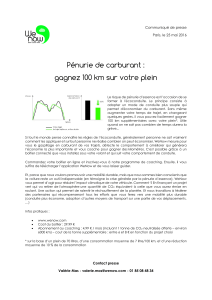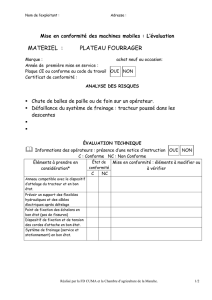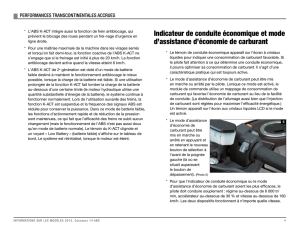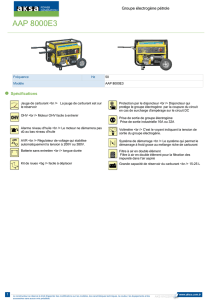Économiser du carburant - Chambre Agriculture Yonn

Économiser
du carburant
Les bons leviers pour réduire sa consommation
Chambres d’agriculture
de Bourgogne
3 rue du Golf
21800 QUETIGNY
Économiser du carburant
Les bons leviers pour réduire sa consommation

1 - Fortes variations de prix et tendance « lourde » à la hausse
Depuis août 2007, le prix du carburant a fortement varié (Tableau 1).
D’abord à la hausse, le coût du oul standard a presque doublé entre août 2007 et juillet 2008, atteignant 0.80 €/litre HT. Ensuite
à la baisse, puisque en mai 2009 il afchait une valeur de 0.38 €/litre HT, en deçà de sa valeur constatée en août 2007 qui était de
0.48 €/litre. Après un an de relative stabilité, il est à nouveau reparti à la hausse pour s’établir aujourd’hui à 0.70 €/litre HT.
Sur les campagnes 2007-2008 et 2010-2011, l’augmentation du prix du car-
burant se traduit par un surcoût moyen proche de 2 200 € par
exploitation (Tableau 2). Ainsi, pour conserver un niveau de charges
identique à la campagne 2006-2007, il aurait fallu réaliser une économie
de 26 litres/ha soit réduire de 30% la consommation. La chute
du prix du carburant sur les campagnes intermédiaires n’a pas suf à retrou-
ver le niveau de facturation antérieur à 2007.
Cette tendance à la hausse des charges de carburant pour les exploitations
agricoles s’accentue encore avec le passage au Gazole Non Routier (GNR)
effectif au 1er novembre 2011 dont le coût est de quelques centimes supplé-
mentaires au oul de qualité supérieure.
2
Tableau 1

Analysées dans le cadre de l’Observatoire des Charges de ME-
CAnisation (OCMECA) en Bourgogne, ces données prennent
encore plus d’importance. Avec un coût de 0.60 €/litre HT, le
«carburant» devient le second poste de charges de
mécanisation des exploitations agricoles bour-
guignonnes, devant la récolte (21%) et derrière la traction
(30%). Traction, carburant et récolte constituent près de 75%
des charges de mécanisation des exploitations agricoles.
Ces quelques chiffres conrment que la tendance d’évo-
lution du coût de l’énergie d’origine fossile est
inexorablement à la hausse et qu’il est indispensable
pour les exploitations agricoles de réduire les consom-
mations de carburant pour maîtriser ces charges.
2 - Des consommations variables expliquées par de nombreux
facteurs
Les consommations de carburant varient selon le
système de production.
En grandes cultures, elles s’échelonnent de 56 litres /ha pour
les exploitations situées sur les sols superciels des plateaux de
Bourgogne exploités sans labour à 99 litres /ha pour les exploi-
tations situées en sols profonds des vallées et plaines labourés
notamment pour l’implantation de cultures industrielles.
Ces données par système de production cachent de fortes
variabilités.
En moyenne, la consommation de carburant des exploitations à
production laitière dominante et intensive s’élève à 98 litres /ha.
Pour 50% d’entre elles, elle est comprise entre 85 et 125 litres
/ha. Les valeurs extrêmes observées se répartissent de 65 litres
/ha à plus de 200 litres/ha.
De nombreux facteurs expliquent ces variations.
On peut citer : le parcellaire (nombre, taille, forme, éloignement
des parcelles), le type de sol (% d’argile, présence de cailloux),
le relief (pente, dévers), le parc matériel (âge du matériel, adap-
tation tracteur-outil, type de matériels…), l’organisation du tra-
vail (organisation spatiale et temporelle) l’itinéraire cultural (type,
nombre d’interventions), l’état mécanique et le réglage du maté-
riel, la conduite…
Ils sont liés à la structure de l’exploitation, aux choix d’investisse-
ment et aux méthodes de travail. L’inuence de l’agriculteur sur
ces facteurs est plus ou moins grande.
3
Tableau 2

3 - Les bons leviers pour réduire la consommation de carburant
Pour agir, l’analyse globale du sys-
tème de production est indispensable.
Une réexion approfondie doit permettre
d’aboutir à la hiérarchisation des actions à
mettre en œuvre :
- des actions simples et faciles, qui relèvent
du bon usage des technologies et des
bonnes pratiques (entretien, réglage et
bonne utilisation du tracteur…),
- des actions d’ajustements qui s’appuient
sur des investissements mais qui n’en-
gendrent pas de modications profondes du
système de production (suppression du la-
bour et passage au semis simplié, recours
au compostage…),
- des actions stratégiques parfois lourdes et
difciles à mettre en œuvre mais qui auront
souvent un intérêt énergétique majeur (chan-
gement du système de production, mise en
commun des moyens de production...).
De la bonne utilisation
du tracteur...
En moyenne, 75% de la consomma-
tion de carburant des exploitations sont
liées à l’utilisation des tracteurs.
Le reste se partage entre les engins de
récolte (20 à 25%), les chargeurs télesco-
piques (3 à 5%) et les automoteurs de pulvé-
risation (3 à 5%) pour lesquels réaliser des
économies de carburant est plus difcile.
Ces matériels fonctionnent soit peu d’heures
dans l’année à charge constante et élevée
(moissonneuse-batteuse, ensileuse...) soit
souvent mais à faible charge (chargeur té-
lescopique, pulvérisateur).
Ceci explique les nombreuses plaquettes
d’information et articles de presse
traitant de l’utilisation, du réglage et
de l’entretien du tracteur.
Suivre les préconisations données laisse
envisager une réduction de 15 à 20%
de la consommation, ce qui repré-
sente tout de même une économie de 10 à
15 litres/ha.
4

A- Adopter les principes de
la conduite économique
Le comportement du chauffeur a une incidence
sur la consommation : éviter les accélérations et
les freinages intempestifs, anticiper et adopter
les principes de la conduite coulée.
Observé en Poitou-Charentes au cours d’un
stage de formation à la conduite économique,
l’écart de consommation peut atteindre 50%
entre 2 conducteurs pour la conduite d’un trac-
teur de 130 ch et d’une remorque de 12 tonnes
dans une parcelle. (Source : Fédération Na-
tionale des Entrepreneurs des Territoires).
B- Utiliser un tracteur bien
entretenu et bien réglé
Le passage au banc régulier permet de déceler
les dysfonctionnements.
En Bourgogne, la synthèse des passages de
tracteurs au banc d’essais et de diagnostic
montre qu’il est possible d’économiser jusqu’à
1.5 litre /heure.
(Source : Fédération CUMA de Bourgogne).
C- Choisir la bonne
transmission
Les boîtes de vitesses ont largement évolué.
Grâce aux embrayages multidisques à bain
d’huile, les rapports peuvent se passer sous
charge, sans débrayer. Les systèmes de sur-
puissance proportionnelle (augmentation pro-
gressive de la puissance) sont plus économes
que les systèmes « tout ou rien »
Sur route, la différence de consommation peut
atteindre 19 litres /100 km entre un power
boost proportionnel et un modèle «tout ou rien»
(Source : New Holland).
D- Utiliser du carburant et
des lubriants «haute
performance»
Ils sont la garantie d’un meilleur fonctionnement
du moteur ; ils améliorent le rendement.
Des essais sur route, au transport et au banc
d’essai réalisés par Total et validés par la
Chambre Régionale d’agriculture de Poitou-
Charentes sur des tracteurs de 150 ch montrent
une réduction de la consommation de carburant
de l’ordre de 3%. (Source : Total)
E- Maîtriser les pressions de
gonage
Au transport, la pression de gonage doit être
augmentée pour supporter la charge et mini-
miser les pertes par roulement. Pour les tra-
vaux d’adhérence, il faut la baisser pour limiter
les pertes par patinage. Il est recommandé
d’évaluer la charge par pneu avec précision et
d’adapter la pression de gonage selon les pré-
conisations des manufacturiers.
F- Lester à bon escient
Il s’agit d’améliorer l’adhérence en augmentant
la surface de contact avec le sol. Minimiser le
patinage réduit la consommation par hectare.
Attention, un tracteur qui ne patine pas (taux
de patinage < à 10%) est souvent signe d’un
sur-lestage. L’énergie sert en partie à déplacer
du poids ! L’utilisation du relevage avant est
une bonne solution pour ajuster facilement le
lestage. Il faut toutefois ne pas oublier de dépo-
ser ces masses rendues inutiles au transport et
pour des travaux réclamant peu d’adhérence.
Une tonne de poids supplémentaire sur sol
meuble et plat à 10-12 km /heure nécessite de 6
à 8 chevaux de plus soit une sur-consommation
de plus de 1 litre /heure.
(Source : Chambre d’agriculture de la
Manche)
F- Utiliser le relevage avant
L’adaptation d’outils à l’avant du tracteur permet
de mieux valoriser la puissance de traction. La
charge reportée sur l’avant améliore l’adhé-
rence tout en fournissant un travail (diminution
du nombres de passages, augmentation du
débit de chantier).
A conditions équivalentes, il faut un tracteur de
190 ch lourd pour tirer une charrue 8 corps se-
mi-portée sur chariot tandis qu’un 160 ch léger
est sufsant pour travailler avec 8 corps répartis
entre l’avant (3) et l’arrière (5).
G- Éviter les séquences de
travail trop courtes
Les pertes de puissances sont importantes
quand le tracteur est froid. Il faut compter 15
à 20 minutes pour qu’un moteur monte cor-
rectement en température et 10 à 12 km pour
atteindre la bonne température d’une huile de
transmission.
H- Utiliser des outils bien
attelés et bien réglés
L’utilisation des réglages du relevage (contrôle
d’effort, contrôle de position) associée à un bon
attelage de l’outil permettent d’optimiser les
reports de charges et d’améliorer l’adhérence
sans lestage excessif. Il est indispensable de
suivre les préconisations du constructeur sur les
tolérances concernant la géométrie des points
d’attelage.
I- Utiliser des outils bien
entretenus
L’affûtage des pièces coupantes et le graissage
des parties mobiles doivent être réalisées sui-
vants les préconisations contructeur.
Les besoins en puissance pour une faucheuse
à tambours d’une largeur de 3m sont supérieurs
de 4 à 5 ch pour des couteaux émoussés, dont
le tranchant de la lame a entièrement disparu et
les arrêtes sont arrondies en comparaison avec
des couteaux aflés sortie d’usine. Cela repré-
sente 0,6 à 1 litre de carburant /heure.
(Source : rapport Fat).
Adopter ces préconisations relève du «bon
sens» mais pourrait ne pas être sufsant face à
l’augmentation du prix du carburant et à l’intro-
duction de façons culturales mécaniques en
faveur de l’environnement (désherbage méca-
nique en remplacement d’une partie des produits
phytosanitaires, implantation de couverts pièges
à nitrates…) pour maîtriser un niveau de charges
acceptable pour l’exploitation.
Plus que jamais, le choix et le dimension-
nement des matériels, l’organisation
des chantiers et les techniques cultu-
rales doivent être repositionnés comme des le-
viers incontournables de la maîtrise des charges.
5
Préconisations pour économiser du carburant
En référence à la Plaquette «Quelles pistes pour économiser le carburant ?»
Décembre 2007 / Chambres d’Agriculture et CUMA région Centre.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%