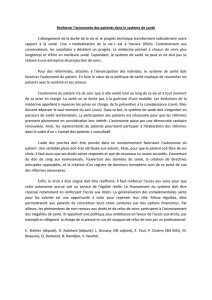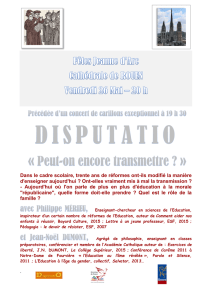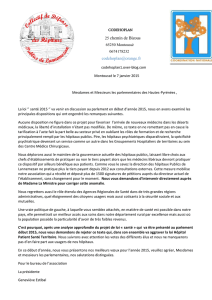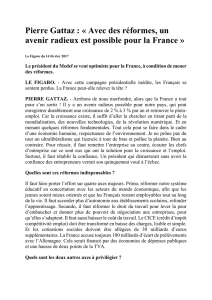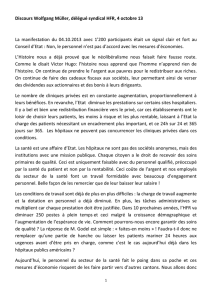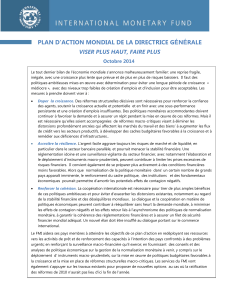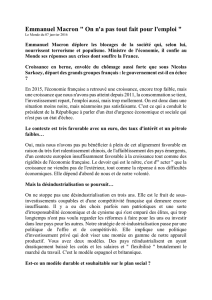Comparatif des systèmes de santé européens: et la Suisse?

Comparatif des systèmes de santé
européens: et la Suisse?
Atouts et faiblesses des systèmes de santé européens et conclusions
possibles pour la politique suisse de santé publique, forum vips 2007
No19
Juin
2007
02 «Une réforme de la santé a plu-
sieurs objectifs principaux: effica-
cité et qualité, accès au système
et satisfaction des clients, rentabi-
lité et capacité financière.»
Marc Neuschwander
03 «L’Etat n’a aucun projet clair en
matière de santé publique. Les
objectifs de santé sont toujours
secondaires.»
Prof. Dr Jürgen Wasem
07 «La France est première au monde
pour la consommation de médica-
ments en volume.»
Prof. Jean de Kervasdoué
09 «Beaucoup de choses fonctionnent
bien, et la concurrence est désor-
mais réellement libre.»
Prof. Frans F.H. Rutten
12 «Il faudrait renforcer la position du
patient par la liberté de choix, l’in-
formation, et des prestations plus
attrayantes.»
Prof. Anders Anell
15 Discussions générales (extraits)
20 «Si nous y sommes toujours intéres-
sés, nous ferons bien d’apprécier les
innovations à leur juste valeur.»
Walter P. Hölzle

02
En 2004 déjà, les ministres de l’OCDE étaient arrivés à la conclusion qu’il ne pouvait y avoir
de recette miracle pour les ministres européens de la santé, chaque pays ayant des valeurs,
des traditions et des institutions différentes.
Les leçons des expériences de l’étranger
Ils estimaient cependant que chaque pays pourrait
tirer parti de l’expérience des autres.
En tant qu’association professionnelle regroupant
notamment des entreprises pharmaceutiques
internationales, nous considérons qu’il est de notre
devoir de verser au débat en cours sur les réformes
les expériences liées à d’autres systèmes de santé
européens. Nous avons donc invité quatre écono-
mistes de la santé venant d’Allemagne, de France,
des Pays-Bas et de Suède, à nous exposer les atouts
et les faiblesses de leur système national ainsi
que les réformes envisagées. S’ensuivra un débat
avec nos politiciens suisses de la santé, débat au
cours duquel on tâchera de tirer les conclusions
des expériences de ces quatre pays dans la perspec-
tive des réformes qui nous attendent.
Il y a quelques mois, l’OCDE et l’OMS ont for-
mulé des pistes pour la Suisse dans leur rapport
sur notre système de santé. Pour notre part, nous
avions traité une recommandation lors de notre
Forum 2005, à savoir le recentrage du système tout
entier, aujourd’hui très fragmenté. Nous n’échap-
perons sans doute pas à la nécessité d’une rationali-
sation générale, probablement assortie d’un trans-
fert de compétences vers des unités plus grandes,
voire vers des acteurs d’envergure nationale.
Mise en œuvre des recommandations
de l’OCDE/OMS
Je signale que la Suisse a d’ores et déjà mis en
œuvre les recommandations de l’OCDE/OMS dans
un domaine: celui des médicaments. Il s’agissait
d’une part d’augmenter les prescriptions de généri-
ques. Cet objectif a été atteint, les chiffres sont
très clairs à ce sujet. Une économie supplémentaire
d’environ 100 millions de francs a par ailleurs
pu être réalisée grâce à un accord qui a généré des
ajustements volontaires du prix des préparations
originales. L’autre recommandation concernait
l’ouverture du marché aux médicaments sans
brevet, et là aussi, c’est chose faite ou presque,
les retards de mise en œuvre étant uniquement dus
au fait que les importateurs parallèles refusent
d’abaisser suffisamment leurs prix par rapport à
ceux des préparations originales.
Marc Neuschwander
Président de vips
Les prix des médicaments suisses au niveau
européen
Le succès de la quote-part différenciée initiée par
le conseiller fédéral Pascal Couchepin montre une
fois de plus qu’au cours des dix dernières années,
la voie pragmatique consistant en des solutions
négociées entre l’industrie et les autorités a bien
plus profité au système de santé suisse que ne
l’auraient fait des réglementations complexes.
L’industrie pharmaceutique a ainsi généré depuis
1996 un volume d’économies de plus d’un milliard
de francs. Ce phénomène s’est dramatiquement
répercuté sur les comparatifs de prix avec l’étran-
ger: le prix moyen des médicaments suisses au
départ de l’usine se situe aujourd’hui dans la
moyenne européenne.
Lorsque nous évoquons différents systèmes de
santé pour les évaluer et pour les comparer à celui
de la Suisse, gardons en mémoire les principaux
objectifs fixés par l’OCDE et l’OMS: efficacité et
qualité, accès au système et satisfaction des clients,
rentabilité et capacité financière. Ces objectifs
devront également guider les débats politiques
autour des réformes en Suisse.

03
Le PIB allemand, qui s’élève à 27 175 euros par
habitant et par an, n’est plus en tête de l’Europe, et
l’écart entre l’Est et l’Ouest continue de se faire
sentir: le PIB par habitant des nouveaux Länder est
inférieur d’au moins 25% à celui des anciens.
Nous dépensons près de 10,6% de notre PIB pour
la santé (chiffres de 2004). Cela nous place dans le
peloton de tête international aux côtés des Etats-
Unis, de la Suisse et du Canada, mais le bas niveau
du PIB fait que les dépenses par habitant ne sont
plus si élevées en comparaison internationale.
Pas d’assurance-maladie obligatoire
A ce jour, et contrairement à la Suisse, il n’existe pas
en Allemagne d’assurance-maladie obligatoire. Nous
sommes en train de «bricoler» une forme de con-
trainte. Quelque 90% de la population sont couverts
par l’assurance-maladie légale. Environ 10% d’entre
eux ont la possibilité d’opter pour une assurance
privée. Il s’agit des fonctionnaires d’Etat, des travail-
leurs indépendants et des employeurs à salaire élevé.
234 milliards d’euros de dépenses de santé
56,3% des dépenses de santé (chiffres de 2004)
sont couverts par l’assurance-maladie légale (Ge-
setzliche Krankenversicherung, GKV). Les deuxièmes
contributeurs sont les ménages, par le biais de
versements supplémentaires ou de contributions
préalables non compris dans les systèmes d’assu-
rance. 10% environ sont couverts par les assureurs
privés, et le reste incombe à l’assurance-dépendan-
ce sociale.
La GKV se finance par des cotisations dépendantes
du revenu, et non par une prime par tête comme
c’est le cas en Suisse. Ce financement est paritaire:
les employés en assument un peu plus de la moitié,
les employeurs un peu moins. Les cotisations dépen-
dantes du revenu posent toujours la question du
plafond du revenu, qui s’élève actuellement à
42 750 euros par an. Jusqu’à cette limite, le taux de
cotisation est fixé librement par chaque caisse-mala-
die. Il est actuellement de 14,4% en moyenne.
Le catalogue des prestations est relativement com-
plet. L’assurance-maladie privée, elle, est financée à
72% par les 10% de la population qui sont totale-
ment assurés à titre privé. Seuls environ 20% des
dépenses sont pris en charge par l’assurance complé-
mentaire.
Prestations de la GKV
Environ 17% des dépenses de la GKV vont aux
médecins ambulatoires, c’est-à-dire aux spécialistes
et aux généralistes installés. 36% servent à couvrir
des frais d’hospitalisation. 19% concernent les
médicaments.
Les médecins installés sont les garants des soins
ambulatoires. Ce sont des petites entreprises
privées. Il existe par ailleurs des centres de soins
aux structures analogues à celle d’une polyclinique,
et ils sont de plus en plus nombreux. La structure
du secteur hospitalier est très complexe. 52% des
lits sont publics, essentiellement dans les com-
munes, 37% sont d’utilité générale, c’est-à-dire
principalement reliés à des structures ecclésiasti-
ques, mais aussi à des institutions telles que la
Croix-Rouge, et 11% sont des lits privés. Cette part
encore modeste est en forte augmentation: il y a
dix ans elle n’était que de 5%. Une privatisation
massive des hôpitaux publics est en cours,
car bon nombre d’entre eux sont déficitaires et
les communes financièrement faibles préfèrent
les vendre.
L’Etat ne participe pas au financement des soins
ambulatoires et des médicaments. Les investisse-
ments des hôpitaux sont financés par les Länder, et
ce de manière très insuffisante. Les éventuels
déficits sont assumés par les responsables des
établissements publics.
Notre système repose formellement sur des con-
trats. Les caisses-maladie signent des contrats avec
les prestataires, généralement selon le vieux princi-
pe de l’obligation de contracter. Chez nous, la
liberté de contracter qui permettrait aux caisses-
A la fin 2005, l’Allemagne comptait 82,4 millions d’habitants. Le vieillissement de la
population va réduire ce chiffre d’une dizaine de millions. D’ici à 2040, la part des plus
de 60–65 ans dans la population va doubler.
Le système de santé allemand: une politique
sans vision claire
Prof. Dr Jürgen Wasem
Chaire de management
médical de la Fondation
Alfried Krupp
von Bohlen und
Halbach,
université de
Duisburg-Essen

maladie ou aux prestataires de choisir librement
leur partenaire contractuel n’en est qu’à ses pre-
miers balbutiements.
Dans le domaine de la médecine ambulatoire et
des hôpitaux, nous avons un mécanisme de plani-
fication avec restrictions d’accès.
Une politique sans vision
L’Etat n’a pas de vision et aucun projet clair en
matière de santé publique. Les objectifs de santé
sont toujours secondaires. A la fin de son mandat,
un ministre allemand de la santé est d’abord jugé
sur sa capacité à avoir pu abaisser le taux de contri-
bution pondéré moyen de la caisse-maladie. S’il a
échoué, son bilan sera négatif. Selon ce critère,
nous n’avons eu jusqu’à présent que de mauvais
ministres de la santé! La réduction des coûts
domine le débat au détriment de tout projet. De
plus, prévention et préservation de la santé sont
jugées négligeables.
Atouts et faiblesses du système de santé
allemand
L’un des atouts du système de santé réside dans
l’implication très large des assurés. Nous avons un
catalogue de prestations relativement complet,
qui assure la solidarité en matière de financement,
face au risque et au revenu. Un autre atout, c’est
que ce sont les mêmes prestataires qui traitent les
patients couverts par l’assurance-maladie légale et
les patients privés. L’instrument de l’assurance
complémentaire permet de se procurer les béné-
fices supplémentaires dont on a besoin.
Parmi les faiblesses du système, il faut citer la
complexité devenue totalement incontrôlable de sa
direction. Depuis 1977, il y a eu douze grandes
réformes de la santé, sans compter les nombreuses
petites. Pendant cette période, nous avons adopté
pas moins de 8 500 amendements, ce qui fait que
règne aujourd’hui un désordre absolu. La vraie
raison de ce désordre, c’est que la politique n’est
guidée par aucun concept. Nous avons une planifi-
cation d’Etat, et nous avons des acteurs politiques
qui veulent continuer de développer cette plani-
fication. Nous avons le coopératisme, les contrats
collectifs et la concurrence. Et la politique, de
réforme de la santé en réforme de la santé, ne fait
qu’empiler les strates de réglementation. Certaines
dispositions d’une réforme ne sont même pas
encore en vigueur qu’elles sont déjà remplacées
par d’autres parfois totalement contraires.
L’assurance-maladie légale accuse une faiblesse de
perception structurelle. Les salaires et les rentes
sont les ressources centrales du financement lié
aux revenus. Or, depuis trente ans, ils ont systéma-
tiquement une longueur de retard sur le PIB. On
en est arrivé à une situation grotesque où les cotisa-
tions liées au revenu augmentent chaque année
alors que les dépenses suivent la croissance du PIB.
Ce phénomène est dû à la faiblesse de perception
structurelle de l’assurance-maladie légale. Nous
avons un système binaire qui distingue l’assurance-
maladie légale de l’assurance privée. Les 10% qui
ont le choix optent systématiquement pour l’assu-
rance-maladie privée dès lors qu’ils ont individu-
ellement intérêt à sortir du système légal. Le dualis-
me pose un vrai problème de solidarité et contribue
aux difficultés de financement.
Où la nécessité d’agir est-elle la plus forte? A mon
avis, il faudrait instaurer un système de direction
cohérent. Personnellement, je pencherais pour un
système fondé sur la concurrence, mais il suffirait
qu’il repose sur une planification solide et logique
pour être plus performant que le chaos actuel,
résultat de trente années de réformes disparates.
Réforme de la santé 2007
La réforme qui est entrée en vigueur le 1er avril
2007 contient des changements importants. Tout
d’abord, les caisses-maladie peuvent désormais
demander une évaluation du rapport coût-efficacité
pour les nouveaux médicaments. Elles peuvent
04

05
aussi fixer un prix maximum pour les nouveaux
produits, alors qu’auparavant il n’y avait aucun
plafond. Seule exception: les médicaments inno-
vants pour lesquels il n’y a pas d’alternative théra-
peutique.
La réforme comprend aussi un nouveau système
de rémunération pour les médecins, avec un
aspect essentiel: désormais le risque de morbidité
devra à nouveau être assumé par les caisses-
maladie. Sous le système précédent, les caisses-
maladie payaient aux collectifs de médecins un
forfait qui ne tenait pas compte de la morbidité. Ce
sont donc les médecins qui devaient assumer le
vieillissement et la détérioration de la santé des
patients. Cette charge va être davantage transférée
aux caisses-maladie.
Il y a aussi une réforme de l’organisation qui n’est
pas du goût des caisses-maladie mais qui a le
mérite de rationaliser les choses. Le système
allemand repose toujours sur les types de caisses
créés par Bismarck il y a 120 ans. Comme les
assurés ont le choix et que la concurrence s’est
accrue, le type de caisse n’a plus vraiment d’impor-
tance. La réforme 2007 corrige donc cet aspect des
choses, et nous allons adopter le modèle de finan-
cement néerlandais. A l’avenir, les assurés ver-
seront leurs cotisations directement à un fonds de
la santé. Ce fonds reversera ensuite l’argent aux
caisses-maladie selon une compensation des
risques axée sur la morbidité. Si cet argent ne
suffit pas aux caisses, les assurés devront le cas
échéant leur verser une cotisation complémentai-
re. C’est à peu près ainsi que fonctionne le modèle
néerlandais dans lequel aujourd’hui les flux de
versements – celui au profit du fonds et les primes
complémentaires au profit des caisses – sont à peu
près équilibrés. Nous démarrons aujourd’hui à un
rapport de 5 à 95% (5% de primes complémentai-
res, et 95% de fonds). L’équilibrage des flux n’est
qu’une question de temps, car les employeurs
participent aux cotisations au profit du fonds, mais
pas aux cotisations complémentaires. Enfin, l’assu-
rance-maladie privée sera obligée de proposer à
partir de 2009 un tarif de base pour les non-
assurés.
Managed Care et disease management
A l’heure actuelle, les caisses-maladie allemandes
sont très concentrées sur certains programmes
de «disease management». En effet, nous avons
créé il y a trois ans dans le cadre de la compen-
sation des risques un groupe spécial pour les
assurés inscrits à un programme de disease mana-
gement. Les caisses-maladie qui inscrivent leurs
assurés perçoivent plus d’argent au titre de la
compensation des risques, elles se sont donc ruées
sur ces programmes dans l’espoir d’améliorer
ainsi leur compétitivité. A partir de 2009, la com-
pensation des risques liée au fonds de la santé
prendra en compte la morbidité. Il y aura alors plus
d’argent pour les malades que pour les personnes
en bonne santé. Nul ne sait quel sera alors l’avenir
du disease management.
Dans un genre différent, le «managed care» com-
mence à se développer. Depuis quelques années,
les caisses-maladie ont le droit de conclure des
contrats sélectifs pour contourner l’obligation de
contracter. Ces contrats ne présentent que peu
d’intérêt pour les prestataires. Pour le moment, ces
modèles de «managed care» représentent environ
1% des contrats.
Autre nouveauté: la notion d’eHealth qui est de
plus en plus répandue. L’échange de supports de
données entre les caisses-maladie et les prestataires
s’est généralisé et fonctionne plutôt bien. Nous
sommes en train d’introduire la carte de santé. La
notion de télémédecine est devenue à la mode en
Allemagne, mais elle n’est pas encore très déve-
loppée.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%