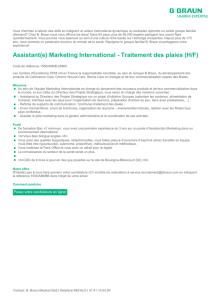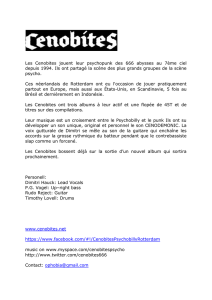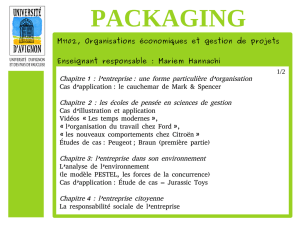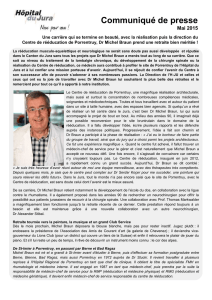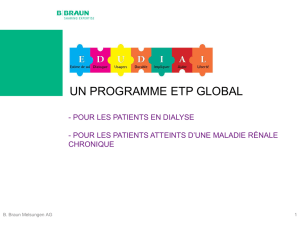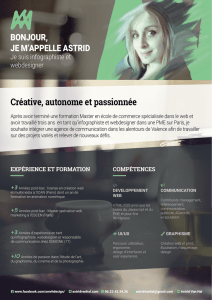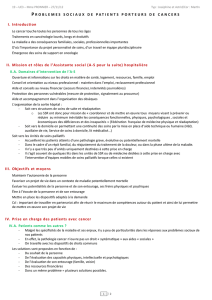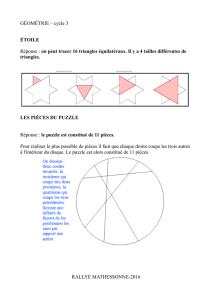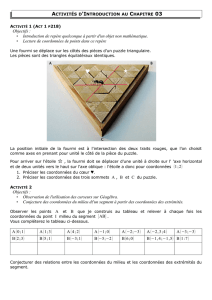Dossier de Presse - dimitri xenakis artiste plasticien


Franc tireur de la création contemporaine
en périphérie, plasticien sniper habitué à l’âp-
reté des territoires de la banlieue parisienne,
Dimitri Xenakis ouvre les portes des anciens
établissements Michel à six artistes aux tempé-
raments différents, dont les créations sont
nettement plus graciles, intimistes voire même
discrètes. L’exposition les place dans le cadre
de l’exploration des stratifications urbaines et
de l’imaginaire de la ville, territoires qu’il
continue d’explorer inlassablement.
Le point commun à ces artistes ? Leur
rencontre au sein d’une association « l’art est
public »[1], Mais surtout leur commune utili-
sation de processus de création communs :
quelque chose qui tourne
autour de la juxtaposition,
l’empilement, la proliféra-
tion bref, autour de
l’accumulation, quoique
leurs médias ou matériaux
de prédilection soient très
diversifiés.
Dimitri Xénakis propose
en compagnie de Maro
Avrabou une installation
qui explore l’histoire
même de leur propre lieu
de travail. Une mise en
abîme du lieu lui-même,
sur lui-même. On connaît
Xénakis pour avoir arpenté
avec la même patience et
la même attention tant les friches et les usines
désaffectées de Montreuil, que les paysages
bucoliques de la campagne anglaise. Le voilà
en son lieu, sur son territoire, l’explorant
comme un archétype de tout ce qui s’est formé
sur ces territoires, le quartier comme la ville,
dans ses plis et replis.
Maryline Beauplet-Dornic a le chic pour
monter en épingle les micro évènements de la
vie courante, qu'elle met en scène astucieu-
sement. Un problème capillaire devient
mémorial de la seconde guerre mondiale, une
peinture ratée mute en strates géologiques,
etc. Chez MBD, rien ne se perd, tout se trans-
forme. Et justement, on la découvre ici
juxtaposant des fragments de peintures sur
une trame imaginaire, comme une sorte de
dialogue entre les minuscules sédimentations
intimistes de ce qu’elle appelle ses empile-
ments (morceaux de peintures découpées et
empilés jusqu'à constituer des volumes) et la
formidable complication urbaine sociale et
historique qui ont conduit à l’empilement bâti,
raccordement de bâtisses approximatives sur
cette parcelle en premier lieu maraîchère, puis
relais de postes, et dernièrement atelier de
mécanique, précisément les établissements
Michel.
Poladjinn, photographe compulsif, prend ici
au pied de la lettre la juxtaposition de ces
éléments, mais applique ce principe constructif
directement à un portrait de chacun des
membres de « l’art est public ». Mêlant instan-
tanés des visages, clichés des habitations ou
ateliers de chacun, il va les juxtaposer comme
autant de parcelles cadas-
trales. Reprenant le fil
d’un projet auquel il a parti-
cipé au sein de « l’art est
public » (les Rencontres à
Domicile), ses assem-
blages constituerons une
sorte de géographie de
l’association.
Hervé Fougeray, choisit
de faire directement réfé-
rence au passé agricole
puis ouvrier du terrain, à
l’histoire d’abord maraî-
chère puis industrielle de
la banlieue nord.
Poursuivant lui aussi un
ancien projet de l’associa-
tion (les arts potagers), il glisse subrepticement
parmi les plantes du 40 bis des végétaux
violemment contre nature, assemblages
d’aciers soudés, fausses imitations de ce qui
a peut-être un jour poussé là, en tout cas
façonnés avec les outils de ceux qui ont un
jour travaillé dans ce qui était ici un atelier de
mécanique de précision.
Astrid Angelsen manie la prolifération de
"blurbs" acidulés. Pièces gonflables tour à tour
gracieux dans les nuages ou oppressants dans
une cabine téléphonique, ses aéronefs savent
donner de belles leçons sur l’ambiguïté de la
matière. Rapprochant ici la stratégie du bâti de
la banlieue quand elle se répand sur le paysage,
et la tendance naturelle de ses formes orga-
niques à prendre possession de l’espace, il va
lui falloir prendre d’assaut sa part de volume
de l’ancien relais de poste, en transformants
ses gonflables en autant de petits soldats.
Marie Hélène Richard mesure quant à elle
l’humeur du quartier. Elle prend la notion de
tension à tous les pieds de la lettre. Prolongeant
le vocabulaire industriel détourné de la maison
du 40 bis, elle superpose aux réseaux de plom-
berie et d’électricité un nouveau réseau de fils
tendus, ne transportant en matière d’électri-
cité que sa propre couleur minium. Tension
électrique, sociale, visuelle, ou tension des
câbles, remploi du vocabulaire déjà là, son
réseau, en toute logique, devrait révéler
l’espace et en souligner les accidents : plom-
beries tentaculaires, appareillages
disproportionnés, autant d’éléments déjà
domestiqués, mais rappelant par leur présence
le passé chargé du bâtiment.
Gaële Braun
choisit, elle, le
contre-pied,
proposant d’ex-
poser une pièce
existante qu’on
a déjà vue en
d’autres occa-
sions,
notamment lors
de l’exposition
Gonflable ! (Lille
capitale euro-
péenne de la
culture). Cette
fois ci elle
propose de le
montrer explici-
tement comme l’étranger qui s’installe ici, y
apportant sa richesse et son altérité, montrant
en quoi il va façonner l’espace du lieu.
Assemblage de matériaux pauvres (sacs plas-
tiques et ruban adhésif) Teddy Bunny va
déteindre sur son environnement, occupant
un mur de l’atelier par une mosaïque des
mêmes matériaux. Après tout, les multiples
vagues d’immigration du quartier n’en ont-elle
pas fait autant ?
Divisant les anciens établissement Michel, en
autant de parcelles qu’il y a d’artistes, l’expo-
sition choisit encore une fois la référence à la
structure du paysage d’ici. À charge, mainte-
nant, pour chacun d’investir ou d’y tisser sa
trame. En somme à y inventer une urbanisation
du lieu d’exposition, même si elle n’est que
temporaire. C.T.
[1] Autour, notamment d’un « annuaire critique » où
sont répertoriés les liens vers leurs sites respectifs
Astrid Angelsen
Maro Avrabou
Maryline Beauplet-Dornic
Gaële Braun
Poladjinn
Hervé Fougeray
Marie-Hélène Richard
Dimitri Xénakis
«l’art est public» expose
rue des postes au

Maryline Beauplet-Dornic : «Puzzle»
2004 col. de l’artiste
Je m'attache à rendre visible
et à étudier l'air et ses mouve-
ments, le rayonnement des
choses entre elles qui nous
interpénètrent et nous consti-
tuent.
Je crée des formes aléatoires,
molles et arrondies, des struc-
tures gonflables en
polyuréthanne ; parfois fragiles
et flottantes, parfois plus
présentes, mises en scène dans
des installations éphémères.
Faire et défaire, gonfler et dégon-
fler, déposer et déplacer, l'œuvre
se fait itinérante et se métamor-
phose sans cesse au grès des
Lieux et Milieux. Le souffle se
déplace et ne se fige jamais.
Tout est à construire et à
repenser à chaque lieu rencontré.
Il est l'élément déterminant et
souvent déclencheur du
processus d'installation.
L'adaptation à l'environnement
et le milieu qui nous entoure
doivent participer à un échange
et une communication pour
donner à voir une perspective
nouvelle, un volume, une géomé-
trie particulière à appréhender
pour le spectateur.
Dans cet atelier, anciennement
usine, en plein coeur de la ville, la
rencontre sera intéressante et
riche à explorer - la question de
l'espace organique métallique à
interroger! A.A.
Astrid
Angelsen
«Aéronefs»
2004 col. de l’artiste
Puzzle est un ensemble de huit toiles ayant des formes et formats qui diffè-
rent. Quatre sont carrées, forme qui m’est familière. Quatre sont rectangulaires,
leurs châssis provenant d’une poubelle de La Courneuve où Gaële Braun,
Astrid Angelsen et moi-même en avons ramassés, le jour de notre première
rencontre au sein de «L’art est public». Les toiles sont présentées côte à côte
ou espacées, laissant alors apparaître le blanc de la cimaise. Pour juxt-
Assemblages et stratifica- pOsitions, Puzzle sera accroché sur un mur de
parpaings, dont la surface irrégulière soumettra les toiles juxtaposées à ses
saillies et ses creux. Une fois accroché, Puzzle occupe une surface plus grande
que celle dont je dispose dans mon atelier. Peindre ses toiles selon le même
agencement que lors de son exposition m’était donc impossible. Il m’a fallu
utiliser comme «matrice» une grille orthogonale formant des carrés de 20 cm
de côté à la surface des toiles, également dessinée à taille réduite, sur une sorte
de plan me permettant de déterminer l’emplacement de chaque toile par
rapport aux autres, de prévoir le débordement du champ d’une peinture hors
de son cadre - d’un support à l’autre, etc. Chaque toile du Puzzle en est une
pièce. Puzzle est une peinture constituée de plusieurs supports physiquement
séparés. Chaque case peut aussi être envisagée comme une peinture à part
entière. Ou encore une peinture peut «déborder» d’un support à l’autre. La
peinture est hors-champ — hors du champ du tableau, dont les limites ne
correspondent plus aux bords du cadre — hors-champ parce que la grille
permet, dans l’absolu, d’étendre la surface du Puzzle à l’infini.

«L'art est public» n'attend pas le public. Elle va le chercher sur ses lieux de vie, de travail... D'esprit natu-
rellement facétieux, j'inverse la proposition et vous donne à voir les membres du collectif. Une honnête
maîtrise technique devrait permettre d'embrasser d'un seul cliché le sujet, son environnement, voire un
peu de sa vie ( cf. les rencontres à domicile par exemple ). J'assume mes limites en la matière.
Je juxtamêle donc les indices subjectifs, à vous de re-construire l'histoire qui va avec. Pourquoi "Mes
lapins..." ? Juste pour rappeler que chez les artistes, du moins ceux de «l'art est public», il y a un coeur qui
bat. Comme chez les lapins. P.
Poladjinn
«Mes lapins...»
2004 col. de l’artiste
Après Brighton puis Colmar et enfin Lille
2004,Teddy-Bunny se pose en banlieue, non
loin de l’atelier où il a pris forme, dans un atelier
d’artiste. Il s’agit d’une exposition du collectif
« l’art est public » chez un particulier, mais
aussi lieu symbolique de la périphérie pari-
sienne. Cet endroit est encore marqué par les
traces de son passé.
L’ancienne existence du mur est reprise par
un marquage au sol de feuilles de plastique
de la même robe que le gonflable.
Parallèlement à cette empreinte matérialisée,
Teddy-Bunny est installé. Cette fois il est
couché, suspendu dans le sens de ces bandes
qui constituaient ce territoire, il fait front à un
autre mur de mitoyenneté, pour l’occasion
habillé d’un grand lé de feuilles de plastique.
Le gonflable ambigramme fait face à ce mur
coloré, et s’y confond pour ceux qui veulent
bien y prêter attention l’espace d’un moment
et d’un endroit.Teddy-Bunny devient ici un
caméléon, essayant de s’adapter à son envi-
ronnement, il participe aussi à son
changement. Demandant au regard de l’autre
de chercher son anamorphose colorée, il fait sa
vie et creuse son nid pour sa descendance
déjà présente en face de lui. Sur le grand lé
de couleur qui lui ressemble, les nouveaux
nés fragilement gonflés occupent le damier
de couleurs. Tantôt s’y confondant, tantôt
sortant du lot, ils racontent leur place dans
cette société, dans cette banlieue à leur image.
G.B.
Gaële Braun
«Teddy-Bunny»
2004 col. de l’artiste

Ça a turbiné, dans la
ville, une ruche
ouvrière! Ça turbine,
dans cette rue, ça turbi-
nera encore, dans cette
baraque ! Maintenant,
dans la rue, ça s’enve-
nime, c’est plus la
même énergie, trafic,
speed speed, k’est s’ta
toi, tire toi ! Alors, tu le
tires ce fil orange ? T’as
un plan ? Des tuyaux,
des réseaux, au plafond,
IPN droits, durs,
oranges, de l’énergie en
puissance, électrique, se
croise, se décroise,
chaud chaud, circulez
circulez ! La lumière, ça
pète de lumière ! Des
fils et des fils et encore
des fils, tirer des traits,
les réseaux se
brouillent, s’em-
brouillent, tous ces fils
là peuvent passer par un
petit trou de souris ? et
oui ils le peuvent ! Ils
vont le faire, y’a qu’a
tasser un peu. De quoi
je me mêle, j’m’em-
mêle. Une araignée au
plafond, excitée, certai-
nement ! De l’orange,
des oranges, mmhhh les
bonnes vitamines. Y’en
a bien’bsoin au mois de
janvier. M-H.R.
Marie
Hélène
Richard
«Orange»
2004 col. de l’artiste
Passer d’un monde à un autre, d’un pays à un autre, d’une culture à une autre, d’une
nature à une autre et l’accepter ? Le jeu des civilisations aujourd’hui n’est-il pas là ? Dans
les grandes zones urbaines où toutes les cultures se côtoient, s’agglutinent et se mélan-
gent, quels sont les niveaux d’acceptations qui régissent la vie de chacun et de tous ?
Pour qui et pourquoi acceptons nous telle ou telle différence et refusons telle autre ?
Par le côtoiement de vraies et fausses plantes, la question peut se poser, lesquelles sont
regardées ? Lesquelles sont contre-nature ?Existe-t-il une différence importante entre
les créations de l’homme et les transplantations de l’homme ? H.F.
Hervé Fougeray
«Autre nature»
2004 col. de l’artiste
 6
6
 7
7
1
/
7
100%