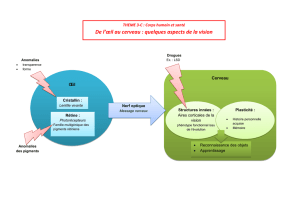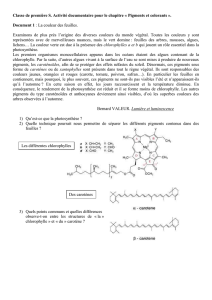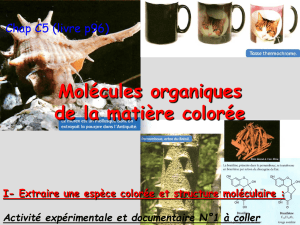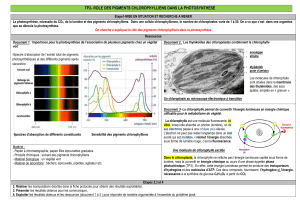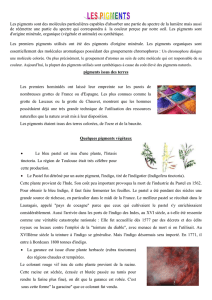Pigments, colorants et utilisations à travers l`histoire.

Chapitre 3. Activité sur document. 1ère L et ES
Pigments, colorants et utilisations à travers l'histoire.
1. Pigments et colorants
On définit le plus souvent une substance colorante par sa capacité à absorber les rayonnements lumineux
dans le spectre visible de la lumière.
Les pigments sont des poudres colorées insolubles qui se fixent à la surface de l’objet. Après les avoir
finement broyés, on les mélange généralement à un liant plus ou moins fluide pour obtenir des fards, peintures,
enduits, encres …
Au contraire des pigments, les colorants sont absorbées par le support et s’unissent chimiquement aux
molécules qu'ils colorent. Ainsi, elles se mélangent à la couleur initiale. Par exemple, un tissu bleu plongé dans
un bain de colorant jaune deviendra vert par combinaison du bleu et du jaune.
La couleur d'un pigment peut varier en fonction de l'environnement. L'ocre jaune et l'ocre rouge sont tous
deux des oxydes de fer mais le jaune est un oxyde de fer hydraté (on passe du jaune au rouge par simple
chauffage).
2. Histoire des pigments :
Il existe deux grandes familles de pigments : les pigments minéraux et les pigments organiques (à base de
carbone, provenant de plantes ou animaux). Certains de ces pigments peuvent être naturels et d'autres
synthétiques.
L’utilisation des pigments remonte à la Préhistoire. Les hommes préhistoriques
possèdent déjà une très grande technique de l'utilisation des ressources naturelles que la
nature a mises à leur disposition en employant des pigments colorés tel que des terres
d'ocres, argiles rouges et jaunes, oxyde de fer, craie. On retrouve également des pigments
organiques à base de carbone, tels que le noir d'os calcinés, et le noir de charbon de bois
ainsi que des pigments végétaux associés à de l'eau ou de la graisse.
Dans l'Antiquité, les pigments sont le plus souvent d'origine minérale, par exemple obtenus par broyage des
pierres dures. Les nuances sont obtenues par chauffage et mélange des différentes teintes. Les lapis-lazuli
(minéraux peu abondant considérés comme des pierres semi-précieuses) servent à faire du bleu. Les peintures
sont plutôt murales mais de nombreux objets parchemins, vêtements sont teintés.
Pour les fresques, les pigments sont dilués dans de l'eau et déposés sur un mortier de chaux éteinte, ils sont
ensuite étendus. Les teintes obtenues sont le résultat de la réaction entre la chaux et les pigments. Le mortier
absorbe et fixe les couleurs.
Le Moyen Âge voit se généraliser l'utilisation des pigments minéraux. Fresques,
peintures religieuses sur bois, enduits, pierres, manuscrits, enluminures… Les pigments se
diversifient. On broie dans les ateliers des carbonates (calcaires), de l'hématite, du minium
pour réaliser des rouges, de la limonite, du sulfure d'arsenic (ou orpiment) pour obtenir des
jaunes et des lapis-lazuli pour faire du bleu. On va parfois les chercher très loin comme les
terres vertes, le jaune Indien (venu des Indes vers l'Europe par le canal des Perses), l'or et
l'argent.
A la fin du XVIème siècle, la pratique dominante est la tempera. Il s'agit d'un mélange de colle ou d'eau et
de pigments. Cette peinture est sensible aux variations de température et d'humidité. L'œuf est rajouté, il donne
l'éclat aux couleurs et à l'émulsion. Les couleurs de la tempera sont mates.
Pour des raisons de coût, le bleu pastel est détrôné par un autre pigment, l'indigo, obtenu par fermentation
des feuilles de l'indigotier provenant de l'Inde.
Au XVIIe siècle apparaît le bleu de Prusse, le jaune de Naples (antimoine de plomb), le vert de Sheelle
(arséniate de cuivre). La peinture à l'huile (faisant intervenir l'œuf, l'huile, le vernis) se généralise.
Au XIXe siècle, l'essor de l'industrie chimique entraîne la création de nouveaux et nombreux pigments de
synthèse : mauvéine (premier colorant industriel est découvert par William Henry Perkin en 1856), jaune de
chrome, vert Véronèse, bleu de cobalt, vert émeraude, bleu outremer, jaune de baryum, bleu céruléum … L'indigo
est synthétisé en 1880, supplante l'indigo naturel et ruine la filière.
La nouveauté à notre époque vient du développement de la chimie organique (chimie des composés du
carbone) qui a permis la création de pigments organiques de synthèse. La chimie du pétrole est la grande
responsable de l'arrivée de fines nuances pigmentaires. De plus, l'utilisation de matières plastiques et la
stabilité des couleurs, permettent une popularisation de la peinture et de diversifier encore plus les supports
picturaux.
1
/
1
100%