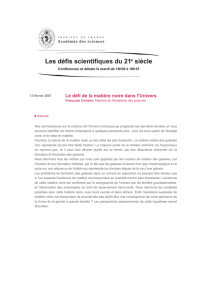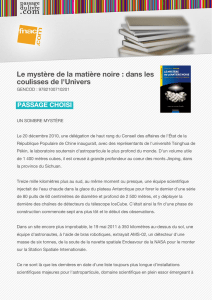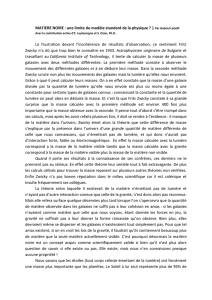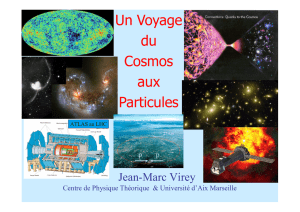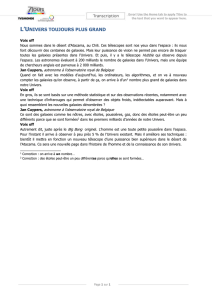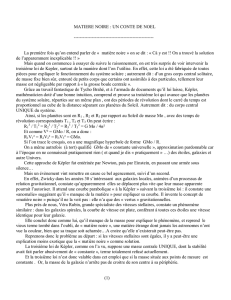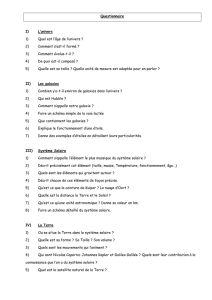02-La_matiere_noire_est_elle_une_illusion

La matière noire est-elle une illusion ?
Le physicien théoricien Erik Verlinde suggère que la
gravité est un phénomène émergent et que la matière noire
n’existe pas. Cette idée vient de passer un premier test
avec succès.
Sean Bailly
S'abonner
Shutterstock.com/Maxim Grek
D’après la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, la force gravitationnelle est une
conséquence de la courbure de l’espace-temps. Malgré les nombreux succès de cette théorie,
les physiciens sont confronté au défi insoluble de la concilier avec la physique quantique. Par
ailleurs, de nombreuses observations en cosmologie, non sans lien avec la gravité, ont conduit
les chercheurs à supposer que l’Univers contient deux composantes dont la nature reste

inconnue, la matière noire et l’énergie sombre. La plupart des physiciens tentent de résoudre
ces énigmes en imaginant ce que peuvent être la matière noire et l'énergie sombre, mais
d'autres ont choisi de repenser les lois de la relativité générale. C'est le cas d’Erik Verlinde,
qui a récemment proposé un changement radical de définition de la force gravitationnelle.
Conséquence spectaculaire : dans sa théorie, la matière noire n’est qu’une illusion, résultant
de la dynamique qui lie l’énergie sombre et la matière ordinaire. Reste à mettre à l’épreuve
cette nouvelle théorie. Pour cela, Margot Browser, de l’université de Leyde, aux Pays-Bas, et
son équipe ont analysé l’effet de « lentille gravitationnelle » lié à près de 30 000 galaxies. Cet
effet est habituellement interprété comme la déformation de l’espace-temps – et donc de la
trajectoire des rayons lumineux émis par les sources d'arrière plan – due à la matière noire
entourant ces galaxies, mais la théorie d’Erik Verlinde semble être en accord avec ces
observations.
Une pionnière ignorée
L’hypothèse de la matière noire a été émise une première fois dans les années 1930 par
l’astronome Fritz Zwicky, puis a été oublié pendant plusieurs décennies avant de revenir sur
le devant de la scène grâce aux travaux menés à la fin des années 1960 par l’astronome Vera
Rubin. Cette chercheuse, disparue en décembre 2016, a mené une carrière exceptionnelle dans
un milieu masculin plutôt hostile (son inscription dans le cursus d’astronomie à Princeton n’a
jamais été considérée, la discipline n’étant pas ouverte aux femmes avant 1975 !). Pour de
nombreux physiciens, elle aurait du recevoir le prix Nobel pour ses travaux pionniers sur le
mouvement de rotation des galaxies spirales, qui ont été à l’origine de l’idée de matière noire.
Alors à l’institut Carnegie de Washington, elle a mesuré la vitesse des étoiles dans des
galaxies spirales en fonction de leur distance au centre de ces galaxies, avec un spectromètre
mis au point par l’astronome Kent Ford. D’après les lois de Newton, cette vitesse devrait
décroître à mesure que l’on s’éloigne du centre, sinon la force centrifuge expulserait les astres
trop rapides. Or les observations de Vera Rubin montrent que, à partir d’une certaine distance,
cette vitesse est relativement constante : les étoiles périphériques tournent plus vite qu'elles ne
devraient ! La force gravitationnelle de la matière visible dans les galaxies semble insuffisante
pour retenir ces étoiles périphériques. James Peebles, de l’université Princeton, et ses
collègues ont alors suggéré que ces galaxies étaient entourées d’un halo sphérique de matière
invisible qui n’interagit pas avec la matière ordinaire, et que l’on a nommé matière noire.
Depuis, la matière noire est devenue un ingrédient omniprésent en astronomie et en
cosmologie. Elle représente 25 % du contenu de l'Univers, soit cinq fois plus que la matière
ordinaire. Elle explique le mouvement de rotation des galaxies spirales mais aussi la
dynamique des amas de galaxies, certains effets de lentille gravitationnelle, la formation des
grandes structures de l’Univers dans lesquelles se regroupent les galaxies, ou encore le spectre
des anisotropies du fond diffus cosmologique, c’est-à-dire la distribution des irrégularités de
température dans le premier rayonnement émis par l’Univers, alors qu'il était âgé de
380 000 ans. Mais si la matière noire semble incontournable pour expliquer toutes ces
observations, sa nature reste inconnue.
Les expériences tenues en échec
Dans la plupart des modèles, la matière noire est formée de particules exotiques, encore
inconnues mais potentiellement observables. Les expériences de détection directe reposent sur
l’idée que ces particules de matière noire peuvent interagir – certes très rarement – avec la
matière ordinaire. Ainsi, avec un détecteur assez grand et beaucoup de patience, il devrait être

possible de voir une particule de matière noire percuter une particule de matière ordinaire.
Plusieurs équipes dans le monde améliorent sans cesse leurs détecteurs. Les expériences
LUX, aux États-Unis, ou PandaX, en Chine, ont permis de poser des contraintes si fortes sur
certains modèles de matière noire, les wimps (Weakly interacting massive particle), que ce
type de candidats est maintenant mis en difficulté.
Aucun signal n’a non plus été observé jusqu'à présent dans les accélérateurs de particules,
notamment au LHC, où on espère créer de la matière noire lors des collisions de protons à très
haute énergie. Ni dans les rayons cosmiques, dont certains pourraient résulter de l'annihilation
de particules de matière noire dans des régions du cosmos où elle est présente en quantité. Les
résultats de l’expérience AMS – installée dans la Station spatiale internationale –, publiés en
décembre 2016 après cinq ans d'observation, pourraient être compatibles avec un wimp d’une
masse d’environ un téraélectronvolt, mais il est encore trop tôt pour écarter la possibilité que
le signal observé proviennent de pulsars, des étoiles denses en rotation rapide qui émettent un
flot de particules.
Bref, aucune expérience n’a pour l’instant livré d'indice solide de l'existence de particules de
matière noire. Les modèles les plus simples semblent exclus, mais les physiciens sont encore
loin d’avoir éliminé toutes les possibilités.
L’hypothèse de la matière noire est confrontée à d’autres difficultés. Si l’idée a émergé de
l'étude des profils de vitesse des galaxies spirales, c’est aussi dans ces structures qu’elle est
mise à mal. Par exemple, d’après les simulations numériques, la matière noire devrait
s’accumuler à l’excès au centre des galaxies, dans des proportions incompatibles avec les
observations. Et, en présence de matière noire, les simulations prévoient la formation de
nombreuses petites galaxies satellites autour des galaxies spirales. Or on n’en connaît une
vingtaine autour de la Voie lactée, au lieu de plusieurs centaines attendues. Certains
physiciens pensent que ce dernier problème est d’ordre observationnel : ces galaxies satellites
très peu lumineuses échapperaient encore au regard des astronomes. Une explication
renforcée par la découverte en 2015 de 11 galaxies naines.
Par ailleurs, en octobre dernier, Stacy McGaugh, de l’université Case Western Reserve, aux
États-Unis, et ses collègue ont comparé, dans 153 galaxies aux caractéristiques très variées,
l'accélération centripète (liée à la force gravitationnelle) déduite du profil de vitesse des
étoiles visibles et correspondant à l'ensemble de la matière ordinaire plus la matière noire, et
la part calculée de l'accélération centripète produite uniquement à partir de la matière
ordinaire seule. Ils ont ainsi mis en évidence que ces deux accélérations sont reliées par une
formule assez simple. Elles ne sont pas égales, ce qui suggère bien qu'il y a besoin de matière
noire pour décrire le profil de vitesse des galaxies spirales. Mais il n'y a pas non plus de raison
évidente pour que ces deux accélérations soient corrélées par une relation simple, sachant
qu'elles ont été calculées dans des galaxies plus ou moins riches en matière noire. Cela
impiquerait un lien entre la distribution de matière ordinaire et celle de matière noire, alors
que ces deux composantes interagissent très faiblement, uniquement par l’interaction
gravitationnelle (et éventuellement par l’interaction faible). Comment l'expliquer ?
Deux équipes ont déjà montré que des simulations avec de la matière noire pouvaient
reproduire la relation mise en évidence par Stacy McGaugh et ses collègues. Elles prennent en
compte des effets de rétroaction (ou feedback) de la matière ordinaire sur la matière noire.
Reste à montrer que leur résultat est universel et s'applique à de vraies galaxies aux propriétés
variées.

Le règne galactique de MOND
En revanche, le résultat de Stacy McGaugh s’accorde parfaitement avec une théorie
concurrente à celle la matière noire, la théorie MOND (MOdified Newtonian Dynamics).
Celle-ci fut proposée par Mordehai Milgrom, de l’institut Weizmann, en Israël, en 1983. Elle
suppose que la deuxième loi de Newton (la somme des forces qui s’applique sur un système
est égale au produit de la masse et de l’accélération) n'est plus valable et doit être
corrigée lorsque les accélérations sont très faibles, en deçà d’un certain seuil plusieurs ordres
de grandeur inférieur à la pesanteur terrestre. Un tel régime serait effectivement en vigueur
dans les parties les plus externes des galaxies spirales, et cette gravité modifiée expliquerait le
profil de vitesse mesuré par Vera Rubin sans avoir besoin de recourir à la matière noire.
Un autre succès de la théorie MOND est qu’elle retrouve naturellement une loi empirique,
dite de Tully-Fisher, qui établit une relation entre la luminosité intrinsèque d’une galaxie
spirale et sa vitesse de rotation. Cette relation s’explique parfaitement avec la modification
des lois de la dynamique newtonienne, alors qu'elle s’accommode mal de l’hypothèse de la
matière noire.
Malheureusement, la théorie MOND (ou ses versions relativistes) n’est pas non plus dénuée
de problèmes. Si elle fonctionne bien à l’échelle des galaxies, elle rencontre des difficultés à
des échelles plus vastes. Elle ne permet pas de reproduire la dynamique des amas de galaxies
sans y ajouter une composante de matière noire. Et il en va de même pour expliquer le spectre
des anisotropies du fond diffus cosmologique.
En partant du constat que MOND fonctionne mieux à l’échelle des galaxies et la matière noire
aux plus grandes échelles, des physiciens ont proposé diverses approches pour concilier ces
théories concurrentes. L’une d’elle a été développée par Justin Khoury, de l’université de
Pennsylvanie, en 2014 : la matière noire superfluide. Les superfluides sont des liquides dont
la viscosité devient nulle une fois refroidis à des températures assez basses, 2 kelvins (-271
°C) pour l’hélium 4 par exemple. Ces liquides ont donc deux comportements différents, une
idée que Justin Khoury a appliqué à la matière noire. Dans son modèle, la matière noire
est superfluide dans les galaxies mais à l’échelle des amas de galaxies, elle est trop chaude et
perdrait ses propriétés superfluides si bien qu'elle retrouve le comportement de la matière
noire classique. D’autres physiciens avaient avancé l’idée de la matière noire superfluide,
mais le modèle de Justin Khoury a l’avantage de reproduire parfaitement les prédictions de
MOND dans les galaxies sans avoir à modifier la gravité. Dans le Système solaire, la force
gravitationnelle est plus intense qu'en moyenne dans la Galaxie, de sorte que la matière noire
n'est pas superfluide et on ne devrait donc pas avoir de déviation aux lois newtoniennes, en
accord avec les observations.
Gravité émergente
D’autres pistes sont encore bien plus radicales, à l’image de la récente proposition d’Erik
Verlinde. Le physicien théoricien de l’université d’Amsterdam n’en est pas à son premier
coup d’éclat. En 2010, il avait émis l’hypothèse que la gravité est un phénomène émergent
relié à l’entropie. La gravité n’est plus une force fondamentale, mais découle d’une autre
structure plus fondamentale de l’Univers. Il y a plusieurs façons d’imaginer une gravité
émergente, mais le rapprochement avec la thermodynamique, et en particulier l’entropie,
remonte aux travaux de Jacob Bekenstein et Stephen Hawking sur les trous noirs, mais surtout
à ceux de Ted Jacobson, qui a montré qu’il était possible de retrouver les lois de la relativité

générale en combinant des considérations générales de la thermodynamique avec le principe
d’équivalence (les effets d'une accélération sont identiques à ceux d'un champ gravitationnel).
Erik Verlinde ajoute à cette idée certains concepts venant de la gravité quantique, tel le
principe holographique.
Au cœur de sa théorie, on trouve des bits quantiques, ou qubits. Contrairement à un bit
classique qui est soit dans l’état « 0 » soit dans l’état « 1 », un qubit est dans une
superposition quantique des états « 0 » et « 1 », pondérés par des coefficients (en termes
mathématiques, on parle de la fonction d’onde du qubit). Lorsque l’on mesure l’état du qubit,
la fonction d’onde est modifiée (ou « réduite »), la superposition d'états disparaît et le qubit
observé prend, de façon aléatoire (avec des probabilités liées aux coefficients de la fonction
d’onde), la valeur « 0 » ou la valeur « 1 », comme on s’y attend pour un objet usuel.
Un élément essentiel de la théorie d'Erik Verlinde est la possibilité que les qubits soient
intriqués. Deux qubits forment un système intriqué lorsque leurs fonctions d’onde sont liées,
et ce même si les qubits sont éloignés l’un de l’autre. Que se passe-t-il lors de la mesure dans
un système intriqué ? Considérons par exemple un système intriqué formé de deux qubits dont
les états sont toujours opposés quand on les mesure (si l’un vaut « 0 », l’autre vaut « 1 »).
Ainsi, si initialement deux qubits intriqués sont des superpositions indéterminées des états
« 0 » et « 1 », et que l’on mesure l’état du premier qubit, sa fonction d’onde est réduite et on
obtient une valeur de façon aléatoire. Instantanément, l'état de l’autre qubit prend l’état
opposé, même si les qubits sont trop éloignés l’un de l’autre pour avoir le temps d’échanger
une quelconque information, même à la vitesse de la lumière. Dans la théorie de Verlinde,
l’intrication de qubits voisins en un réseau donne naissance à un espace plat. La présence de
matière perturbe la structure d’intrication et produit des défauts qui courbent cet espace-
temps. La gravité émerge ainsi et se comporte comme prévu par la théorie de la relativité
générale.
Dans un article paru en 2016, Erik Verlinde reprend ses idées précédentes et explique
comment on obtient une forme d’énergie sombre (la composante qui explique l'expansion
accélérée de l'Univers) et comment cette dernière donne l’illusion de la matière noire.
L’énergie sombre serait une énergie thermique associée aux intrications de qubits à longue
distance. La présence de matière perturberait ces intrications à longue distance, rendant
inopérante l’énergie sombre dans les régions où la matière est présente. En revanche, dans ces
zones, l’énergie sombre essaye de se ré-établir en exerçant une force sur la matière qui serait
équivalente à une force gravitationnelle supplémentaire, celle que l’on attribue à la matière
noire.
Erik Verlinde a calculé que cet effet commencerait à être perceptible à l’échelle des galaxies
et influerait la courbe de rotation des galaxies spirales. Il retrouve ainsi la loi de Tully-Fisher
et de façon plus générale toutes les relations de la théorie MOND introduites de façon ad hoc
par Mordehai Milgrom en 1983. Plus fort encore, il retrouve le coefficient d’accélération de la
théorie MOND à partir duquel le régime newtonien n'est plus valable.
L’idée est séduisante. Il reste cependant beaucoup à faire. L’article d’Erik Verlinde est loin de
proposer une théorie complète et de nombreuses difficultés des modèles de gravité émergente
ne sont pas discutées. Et même certains tests de la théorie de la relativité générale (une théorie
très bien éprouvée par ailleurs) ne sont pas vérifiés.
La théorie de Verlinde face aux observations
 6
6
1
/
6
100%