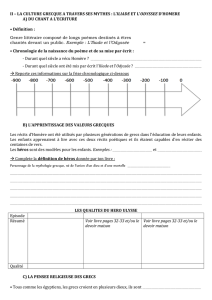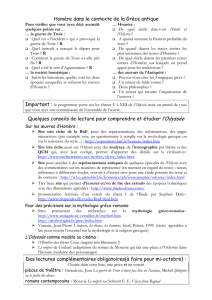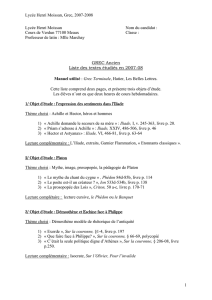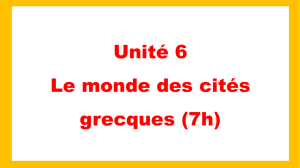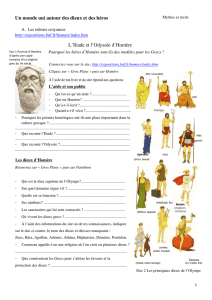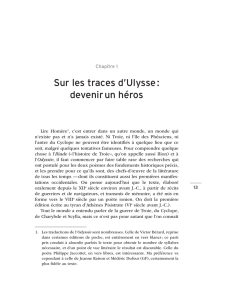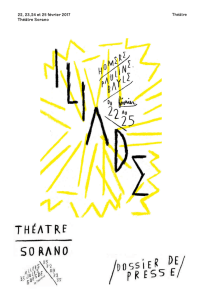Homère et l`Iliade

Homère et l’Iliade
I. Homère, père de la poésie européenne ?
Depuis des siècles, le poète sacré de l’Iliade et de l’Odyssée sert de
référence inévitable, d’assise à notre culture littéraire. Mais que sait-
on exactement de lui ?
! Homère, s’il a bel et bien existé, a vécu entre 800 et 750 avant J.C,
soit 500 ans après les faits relatifs à la guerre de Troie (situés aux
environs de 1250). Sa ville de naissance n’a pu être déterminée :
aux premiers siècles avant notre ère, de nombreuses villes
grecques se disputaient cet honneur, comme Athènes, Chios,
Smyrne…
! Le personnage a, depuis le début du XVIIIe siècle, fait l’objet de
plusieurs enquêtes qui invitent à faire la part du « mythe » Homère,
et celle de la réalité.
! Ainsi la fameuse cécité d’Homère n’est-elle peut-être qu’un mythe.
Elle le rapproche de figures extra-lucides, divinatoires de la
mythologie telles que le devin Tirésias ou le roi Œdipe. Les
nombreuses Vies d’Homère, de l’Antiquité à nos jours, l’expliquent
diversement mais toujours de façon fabuleuse. Selon les uns,
Hélène aurait châtié le poète de lui avoir donné un rôle aussi
néfaste ; selon d’autres, ce sont les armes étincelantes d’Achille qui
l’auraient aveuglé…
! Certains historiens affirment qu’Homère n’a pas existé, qu’il est une
sorte de personnage supplémentaire dans l’œuvre… Les deux
textes eux-mêmes pourraient avoir été composés par deux (ou
plusieurs) mains bien différentes.
II. L’Iliade : un premier poème de genre
« dramatique » ?
! L’Iliade rapporte des faits de la guerre de Troie, bien avant le retour
d’Ulysse. Elle précède donc chronologiquement l’Odyssée. Ces
deux poèmes en 24 chants, écrits en hexamètres dactyliques, se
ressemblent par la forme. En revanche, rien ne permet d’établir que
c’est le même auteur qui les a écrits… Et la lecture laisse apparaître
de nombreuses différences d’une œuvre à l’autre.
! Ainsi, plutôt que comme une épopée, l’Iliade a récemment été
analysée comme une œuvre relevant du genre dramatique
(Jacqueline de Romilly, préface d’Hector, Livre de poche).
! C’est que, loin de raconter toute la guerre de Troie, l’Iliade est
concentrée sur un seul épisode. Cet épisode n’est pas vraiment un
épisode de combat, il ressemble davantage à une « crise
diplomatique » au milieu du camp grec avec la colère d’Achille,
devenue presque proverbiale. Agamemnon lui a en effet spolié sa
captive, Briséis, et Achille refuse de mener combat.
! Ainsi, comme dans le genre dramatique (=théâtre), de nombreuses
scènes dialoguées constituent l’essentiel des chants : conseils des
rois grecs et des Dieux, ambassades auprès d’Achille… Après de
nombreuses négociations, Achille se décidera à revenir au combat.
Et « l’épopée » de l’Iliade prendra fin… non pas avec la victoire des
Grecs mais avec le récit des funérailles d’Hector, tué par Achille aux
pieds des murailles de Troie. La guerre de Troie est alors loin d’être
finie.
! Des passages constituent, dans ce premier volet, des morceaux
d’anthologie qui vont servir de référence à toute la littérature :
- Le catalogue des vaisseaux (chant II) : liste impressionnante qui
servira de modèle à la pratique de l’énumération textuelle –
technique de description très répandue dans toute les œuvres de
la tradition homérique ; puis, ensuite, dans les chansons de geste
et les romans médiévaux (jusqu’aux parodies modernes).
- Le bouclier d’Achille (chant XVIII), prototype de la description
procédurale : cette dernière met sous les yeux du lecteur, avec
une grande vivacité, la fabrication de l’objet jusqu’à son résultat
final.
- Enfin, le véritable héros de l’Iliade est incontestablement le
bouillonnant personnage d’Achille, fils de la déesse Thétis et
champion incontesté des Grecs. Sa fureur, ses exploits ont servi
de modèle au héros, de la chanson de geste aux romans
chevaleresques. Son irascibilité, son hybris (orgueil) sont
contrebalancés par une grande propension à la tendresse et à la
loyauté. Le tandem qu’il forme avec le malheureux Patrocle, tué
au combat (chant XVI), est un modèle de l’amitié dans la culture
occidentale.
III. Ce que ne dit pas l’Iliade : traditions
préhomériques et posthomériques
! Ce que nous connaissons de la guerre de Troie ne provient pas
exclusivement du poème attribué à Homère. En effet, de nombreux
épisodes célèbres du conflit n’y figurent pas. Par exemple : à
l’origine de la guerre, le jugement de Pâris et l’enlèvement
d’Hélène ; l’invention du cheval de Troie qui permet l’assaut des
Grecs ; la chute de la ville à laquelle il est simplement fait allusion
dans l’Odyssée. Ces lacunes attirent l’attention sur l’histoire du
texte, aussi bien sa pré-histoire (ce qui vient avant lui) que sa
postérité (les textes qu’il a inspirés, et qu’on désigne sous le terme
de « tradition posthomérique »).
! Entre les faits et la rédaction des poèmes, 500 ans s’écoulent et
des récits se forgent, transmis oralement par des aèdes. Ces
poètes, tels Démodocos (chez les Phéaciens), sont accompagnés
de cithares ou de lyres et reprennent inlassablement des épisodes
qui deviennent peu à peu connus de leur auditoire – mais chaque
représentation est une improvisation où ils ajoutent leur touche
personnelle.
! En proviennent les deux textes écrits, qui, souvent, se contentent
de faire référence à des épisodes que le public connaît « par
cœur », par le biais de cette poésie « préhomérique ».
! Après Homère, en revanche, le texte sera relayé par des
rhapsodes qui interprétent, de cité en cité, l’œuvre écrite du poète.
Sur l’île de Chios, une confédération de rhapsodes, les Homérides,
se revendiqueront de la filiation directe du poète. Ils jouent un rôle
crucial dans la transmission intacte du texte jusqu’à nos jours.
! Entre le VIIe et le VIe siècle av.J.C., s’est ainsi constitué, à l’écrit,
un ensemble dénommé le « cycle troyen » : 6 épopées qui
racontent tout ce que l’Iliade ne raconte pas de la guerre de Troie.
MemoPage.com SA © / 2010 / Auteur : Joséphine Malara
1
/
1
100%