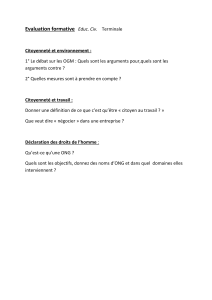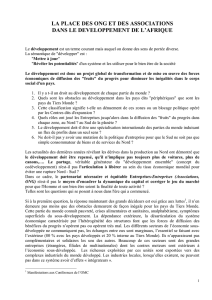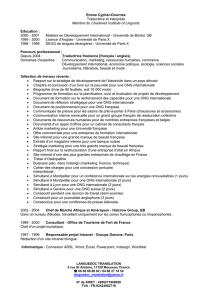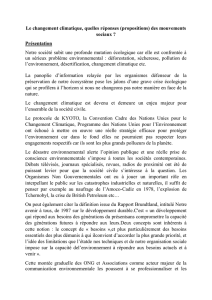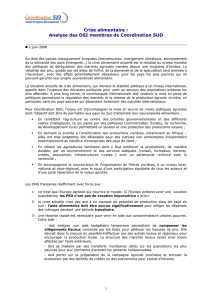La société civile - Centre d`Action pour un Personnalisme Pluraliste

LA SOCIETE CIVILE ET LA CITOYENNETE ACTIVE
DANS L’ETAT DE DROIT DEMOCRATIQUE
par
Paul LÖWENTHAL
Commission des droits économiques et sociaux,
Ligue des droits de l’homme et Amnesty International (B.F.)
« Dans les pays démocratiques, la science de
l’association est la science-mère. »
Alexis de TOCQUEVILLE
De la démocratie en Amérique [25]
« Society has the right and power to make
and unmake political authority, according as
it does so serve of fail to serve. »
Thomas PAINE
I. UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE : LES ENJEUX
Les défis 2
Les dangers 3
II. PHILOSOPHIE POLITIQUE ET DROIT : LES FONDEMENTS
La démocratie
La démocratie représentative 4
La puissance publique 4
« Une personne, une voix » 4
La citoyenneté active
L’évolution des citoyennetés 5
Enjeux juridiques et sanctions sociales 6
La société civile
Une doctrine historiquement située 7
Légitimités d’une société civile 9
Vocation de la société civile 9
La société civile organisée 10
III. INSTITUTIONS : DES MODALITES PRATIQUES
Des critères juridiques
En droit national 13
En droit international 13
Droit positif 14
Quelles ONG ?
Une question non triviale 15
Des critères 16
Exigences pour les ONG 17
Qui décide ? 17
IV. CONCLUSION 17
Bibliographie 18

2
I. UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE : LES ENJEUX
Les défis
Au cours des dernières décennies, les pouvoirs
institués ont été de plus en plus souvent débordés par
des organisations privées :
Au titre d’une démocratie économique censément
distincte de la démocratie politique, syndicats
patronaux et de travailleurs gèrent depuis des
décennies des pans entiers de la politique sociale
en marge des instances politiques. Plus
récemment, la vogue hyper-libérale a conduit à
faire basculer sciemment des pouvoirs – pas
seulement économiques – d’instances publiques
aux compétences et moyens juridiques et
financiers désormais réduits, vers, théoriquement
des auto-régulations de marché, pratiquement des
milieux d’affaires de plus en plus puissants. Il
importe d'y réfléchir, car
- la distinction entre le politique et l’économique
légitime une autonomie de l’économique (lui-
même réduit au financier) au moment même
où nous plaidons l’unicité des droits humains ;
- la distinction entre le politique et l’économique
tend (et vise) à isoler l’économique, domaine
réputé technique, dominé par les choix
individuels et qui aurait sa justification en soi,
de choix politiques qui reçoivent
systématiquement une connotation péjorative –
utopiste ou clientéliste.
Des organisations humanitaires interviennent sans
contrainte diplomatique, sans délai et à bonne
échelle. Il importe d'y réfléchir, car
- l'urgence humanitaire ne peut pas connaître, et
les organisations humanitaires peuvent ne pas
connaître, les contraintes de la diplomatie : un
statut précis assoirait la légitimité des ONG,
mais risquerait de limiter leur liberté de
mouvement ;
- en ex-Yougoslavie, des ONG se sont fait expul-
ser au profit d'entreprises privées sous contrat
gouvernemental (ou même international ?), en
matière de distribution d'eau, notamment : un
statut précis pourrait leur donner voix au
chapitre dans de telles situations ;
- des conflits interviennent entre ONG, et l'on
doit déplorer des carences d'ONG
insuffisamment préparées, voire mal inspirées
(projet idéologique, fausses ONG) : un statut
précis pourrait assurer un minimum de contrôle
sur ou entre ONG.
Des ONG de défense des droits humains ou de
promotion du développement ayant une portée
internationale mènent le combat contre des
politiques privées, nationales ou internationales –
mais jouissent, le cas échéant, d'un statut de
consultant auprès d'institutions internationales. Il
importe d'y réfléchir, car
- si (i) l'on reconnaît le caractère politique des
interventions d'organismes « techniques »
comme le FMI ou l'OMC ou si (ii) l'on
systématise des conditionnalités dans l'ordre
des droits humains ou du social, face à des
Etats et à des institutions internationales
suspects, un recours juridique à la société civile
s'imposera, à la fois avant (concertation),
pendant (négociation) et après (surveillance,
évaluation) la signature de contrats
internationaux de coopération ou d'accords
économiques (Cfr Coordination d’ONG, 2000).
Ce sont des ONG qui ont obtenu qu'il soit mis
fin aux négociations sur l'AMI au sein de l'OCDE.
Mais ce sont des ONG aussi qui ont cautionné
les débordements politiquement ambigus de
Seattle, Washington, Prague ou Göteborg.
- Dans la coopération internationale, des ONG
locales devront être impliquées, dont la
sélection (et le droit de sélection que des
organismes étrangers s'arrogeraient) pose la
question des critères de leur légitimité.
Des ONG revendiquent le droit d'être
systématiquement consultées par des assemblées
dotées d'une légitimité démocratique :
gouvernements et parlements – qui ont beau jeu de
contester la légitimité de soi-disant représentants
de la société civile. Qui choisira celles qui auront
ce privilège, et sur quels critères ?
A l'instar d'associations de consommateurs, les
ONG revendiquent le droit d'ester pour tiers et se
posent ainsi en représentants du bien commun –
sans autre critère que leur réputation et leur
autorité morale.
Il est tactiquement inévitable, mais aussi
légitime en droit et en philosophie politique dans des
démocraties représentatives, que le statut – interne
(représentativité, compétences) et externe (juridique,
politique) – de la société civile soit questionné :
- La légitimité démocratique des élus au suffrage
universel ne doit pas être mise en cause.
(Elle l'est pourtant, chez nous, dans le chef des
syndicats patronaux et ouvriers, au nom d'une
démocratie économique voulue séparée de la
démocratie politique. Et ces syndicats font partie
de la société civile.)
- Les ONG elles-mêmes seraient réticentes à voir
agréer des organisations telles que syndicats
corporatifs ou sectes, ou encore des mouvements
spontanés a-structurés comme la marche blanche
(ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas les
prendre très au sérieux !).

3
Les dangers
Les avancées de la société civile dérangent –
consciemment et volontairement. Son statut juridique
est à tout le moins ambigu. Et la nébuleuse des
groupements plus ou moins informels n’est pas
exempte de dérives : il est des ONG douteuses, il est
des adhésions et des alliances (de fait) douteuses et il
est des débordements comme ceux de Washington,
desquels plusieurs ONG importantes se sont d’ailleurs
désolidarisées. Tout cela fait risquer la mise en cause
globale de la société civile, ONG agréées y compris,
par une alliance de fait des pouvoirs économiques et
des puissances publiques, nationales et internatio-
nales : des banderilles ont été posées
par le monde des affaires : un de ses représentants
a posé la question à Davoz, au lendemain des
manifestations de Seattle et Washington – et
l’ambiguïté de ces manifestations donne sa
légitimité à la question…
(N.B. : on contestera d’emblée la réplique consis-
tant à demander, réciproquement, quelle est la
légitimité des entreprises : dans le modèle libéral,
les légitimités individuelles vont de soi.)
par le Conseil du FMI, sous le coup des
manifestations de Washington ;
par des gouvernements nationaux ; les exemples
sont nombreux ; rappelons :
qu’après avoir en principe accepté de participer
à l’évaluation des programmes d’ajustement
structurels dans le programme SAPRI
1
de la
Banque Mondiale, le Salvador s’est désisté en
arguant du caractère partial (entendez :
critique) des ONG participantes ;
qu’en Bolivie, le FMI a conditionné son pro-
gramme de réduction de la dette extérieure
2
à
une consultation de la société civile sur l’usage
– voulu social – des marges financières déga-
gées, mais n’a pas régi le choix des organisa-
tions consultées. Et que le gouvernement a
refusé de prendre en considération le rapport
émis par diverses ONG sous le patronage de
l’Eglise catholique ;
qu’en Belgique, des ministres ont pris le pli de
distinguer
- « bonnes » et « mauvaises » ONG, sans four-
nir de critères, a fortiori les avoir discutés,
- l’information à laquelle la société à droit de
la décision qui est réservée au politique –
sans envisager, entre les deux, aucune
possibilité de consultation, concertation ou
participation ;
1
Structural Adjustment Programms Review Initiative, réunissant
Banque Mondiale, gouvernements du Tiers-Monde et ONG locales.
2
Programme HIPC2 : Highly Indebted Poor Countries.
par les industriels et financiers réunis à Davoz et
par un nombre croissant de responsables politi-
ques, suite aux violences qui ont accompagné les
manifestations de Göteborg et de Gênes.
Si les ONG sociales, de développement ou de défense
des droits humains ne veulent pas perdre leurs acquis,
notamment leur agréation comme consultants
d’organismes gouvernementaux ou internationaux ; a
fortiori si elles veulent élargir leur action comme
représentants de la société civile dans des dialogues
politiques, – alors il est tactiquement opportun, sinon
urgent, que les ONG se préoccupent de définir, en
concertation internationale, les bases de leur
légitimité et les critères d'éligibilité d'organisations
prétendant représenter la société civile.
Il ne s’agit pas seulement – c’est le plus urgent – de
répondre aux mises en question dont elles font et
continueront de faire l’objet. Il s’agit
- d’asseoir les bases de leur intervention dans le
decision-making, voire -taking : une intervention
citoyenne et transnationale dans des régimes
représentatifs nationaux : c’est l’objet de la
deuxième partie ;
- de définir les critères et les procédures de sélec-
tion, puis d’intervention, évaluation et sanction,
des ONG que l’on pourra effectivement jugées
légitimes : ce sera l’objet de la troisième partie.

II. PHILOSOPHIE POLITIQUE ET DROIT : LES FONDEMENTS
La démocratie
La démocratie représentative
« Le pouvoir des citoyens d’épuise dans leur
vote »
3
: même si cette position extrême ne fait pas
l’unanimité des jurisconsultes, elle résume bien l’idée
centrale de la démocratie représentative, qui offre un
compromis entre l’impératif d’une compétence
(technique ou stratégique : le sens de l’Etat) et la
souveraineté populaire. Et celle-ci est basée sur le
principe du suffrage universel : « une personne, un
vote » dans un système donné, qui est historiquement
celui de l’Etat-nation à base territoriale.
La réalité est en retrait sur ce modèle, et pas
seulement en raison d’imperfections de fait : nous en
tirerons argument. Mais c’est un fait nouveau que
l’irruption d’une « citoyenneté active » qui prétend,
non seulement exercer des pressions toujours
légitimes, mais participer à l’exercice du pouvoir.
Nous commencerons donc – c’est l’objet de
cette section – par un inventaire des objections de
principe qui peuvent être opposées à une intervention
directe de la société civile dans un Etat de droit
démocratique de régime représentatif. Plus
positivement nous demanderons-nous sous quelles
limites, à quelles conditions et suivant quelles
procédures elle pourrait y intervenir, et comment les
inévitables conflits pourront être résolus
- dans le respect d’une primauté de principe des
pouvoirs politiques institués (si la société civile a
le droit d’être reconnue par la puissance publique,
celle-ci conserve son propre droit à régir l’espace
public – qui comprend la société civile…), mais
aussi
- dans le respect – nullement assuré – d’une
primauté de la philosophie sociale (la
démocratie), du droit des gens et des pactes
internationaux sur les législations, les
réglementations et les pratiques nationales.
La puissance publique
Première objection : dans un Etat de droit
démocratique, ce sont les instances légitimement
élues qui détiennent toute la légitimité politique. En
particulier l’Etat a-t-il le monopole de l’exercice de la
force : c’est ce qui différencie le public du collectif.
Des pouvoirs privés existent pourtant, soit
qu’ils aient été concédés par la puissance publique et
il ne s’agit alors que d’une délégation, soit qu’ils
3
Pouvoir, et non liberté ou droit : on vise ici un pouvoir politique,
soit la faculté ou capacité à faire mouvoir autrui.
soient limités à une population précise : règlements
d’atelier ou d’école, ordre des professions libérales.
Au mieux, (i) ces règlements sont régis par les
populations concernées, qui négocient ou votent les
statuts, ont la faculté de les amender et élisent leurs
dirigeants, (ii) moyennant le respect des lois et une
éventuelle agréation publique.
Au pis, dirigeants et règlements sont imposés à
une population censée y adhérer (règlements
d’établissement).
Si une association embrassait potentiellement
toute la population d’un Etat, nous aurions affaire à un
contre-Etat privé. Tout théorique qu’elle soit,
l’hypothèse suffit à justifier une préséance des
instances politiques publiques, avec leurs garanties
juridiques. Sans arriver à ce cas-limite, les tensions
entre gouvernement et interlocuteurs sociaux, ceux-ci
plaidant la séparation entre démocraties politique et
économique, illustre le propos.
4
Introduire la société civile comme un acteur de
la décision impose qu’on balise, sinon canalise, un
pouvoir direct du citoyen dans un régime
essentiellement représentatif. Avec les responsabilités,
donc les redditions de compte, correspondantes : si
l’on reste dans l’optique classique où « le pouvoir du
citoyen s’épuise dans son vote », les mouvements
spontanés ou informels ne jouissent en effet que de
libertés, pas de pouvoirs. Mais ici encore, l’expérience
des interlocuteurs sociaux montre qu’un système
politique et juridique peut absorber la réalité de
pouvoirs privés : si on a pu le consentir aux uns dans
l’ordre économique, on ne pourra en refuser le
principe à d’autres, en d’autres matières.
« Une personne, une voix »
Cela conduit à cette deuxième objection :
accorder un pouvoir politique à des ONG revient –
implicitement et sans transparence – à accorder un
droit de vote censitaire à leurs membres, voire, dans le
cas d’ONG internationales, un droit à des non-citoyens.
Aura le plus voix au chapitre celui qui militera dans le
plus grand nombre d’organisations.
Que vaut le principe « une personne, une
voix » ?
1. Le principe a d’évidents relents
individualistes. Sa seule concession au collectif est
dans les règles de décision : des règles de majorité par
lesquelles on pallie l’impossibilité d’un consensus.
4
Il est bien sûr des ONG qui ne visent pas la population où elles
recrutent, mais des populations tierces (Tiers-Monde) ou débordant
la population nationale (associations internationales). Leur rapport à
l’autorité publique d’un Etat où elles opèrent s’en trouvera
compliqué.

5
Il s’agit bien d’une résignation, car la
démocratie ne saurait se réduire à une dictature de la
majorité. Cette résignation est éventuellement
tempérée par l’édiction de règles de majorité plus ou
moins exigeantes : deux-tiers, double majorité, bi-
caméralisme fédéral dont les deux chambres n’ont pas
la même composition,… Au demeurant, même le
droit américain, le plus individualiste qui soit, rejette
la pure liberté individuelle dans certains cas : pour la
non-discrimination raciale ou les contrats de travail,
notamment (C.R.Sunstein 1991).
Si l’on admet (i) l’idéal du consensus, (ii) la
légitimité corollaire d’une participation aussi large
que possible (fût-ce sans pouvoir de décision) et (iii)
l’opportunité du croisement d’instances différentes
pour élargir les majorités, – il devient possible
d’intégrer des organisations privées, jugées
représentatives, dans ce qu’à ce stade on appellera de
façon volontairement vague le processus de décision.
La relative spécialisation des ONG constitue un
facteur d’élucidation, à côté de votes politiques qui
sont tout globaux : on vote en effet pour des
personnes ou des partis, pas sur les éléments de leur
programme – et celui-ci ne couvre pas tous les enjeux
possibles. Il est raisonnable, au sens précis de ce
terme, que ces options générales (une confiance sur
une orientation d’ensemble) se voient complétées par
des adhésions plus spécifiques. Et l’attribution d’un
rôle politique à la société civile permettrait
d’institutionnaliser leur complémentarité par rapport
aux parlements. Comme tout consultant, comme tout
groupe de pression, des ONG peuvent être, et même se
voir reconnaître le droit d’être des decision-makers,
même si cela ne justifie pas encore qu’elles puissent
être des decision-takers.
2. Le principe « une personne, une voix »
implique (R.A.Dahl 1979) (i) que des prétentions
(claims) également valides justifient de mêmes droits
de vote, (ii) que les prétentions des divers membres
sont a priori également valides : c’est ce dernier
postulat qui sous-tend un principe qui vise, certes, à
reconnaître la pleine valeur de toute personne, mais
qui cherche aussi, sinon surtout, à s’arc-bouter sur la
personne pour échapper à la tâche impossible de
devoir juger des intensités ou des légitimités plus ou
moins égoïstes de leurs préférences.
On en jugera par les limites, au demeurant
incontestées, qui sont mises au principe du suffrage
dit universel : personne ne songe à l’étendre aux
mineurs d’âge, aux déments ou à des étrangers de
passage. Et – sauf à corriger d’éventuels excès – les
défenseurs des droits des criminels emprisonnés ne
prétendront pas qu’on leur conserve leurs droits
politiques. Le statut de ces personnes comme êtres
humains n’est pas en cause, mais leur capacité ou
légitimité à faire jouer leurs préférences politiques.
A la lumière de ces considérations, un droit de
participation de la société civile aux décisions
politiques signifierait l’attribution à leurs militants
d’un droit, non pas supplémentaire mais
complémentaire : un vote « complet » n’irait qu’à
celui qui est citoyen « complet », à la fois par son vote
et par ses engagements – ou à celui qui se préoccupe
de donner une voix à ceux qui n’en n’ont pas ou guère
: l’illettré, le faible, l’opprimé – que celui-ci soit, au
demeurant, citoyen électeur ou non, et qu’il soit chez
nous ou ailleurs. Suivant cette logique, qui rejoint
celle qui justifie l’action collective syndicale dans
l’entreprise individuelle, donner une voix aux ONG
compense le manque de voix (autre qu’électorale) de
leurs protégés. A moins d’y voir le passage de
l’« individualisme » du libéralisme des Lumières au
« personnalisme » de l’être humain socialisé – à
défaut de pouvoir requérir de chaque électeur qu’il
lève son « voile d’ignorance » (J.Rawls) et procède à
une « réduction » qui le transforme en observateur et
juge objectif de la vie sociale à de laquelle il
participe…
Cette logique est-elle tenable ? En simple
opposition à la logique représentative traditionnelle,
elle soulève d’évidentes objections. Le principe « une
personne, une voix » n’est pas seulement une
commodité pratique, il répond à une intuition
foncière. Toutes les ONG ne protègent pas des faibles :
songeons aux ordres professionnels, aux fédérations
sectorielles ou aux syndicats de cadres. Toute
transparence arithmétique étant perdue, c’est la
représentativité démocratique elle-même qui se
trouverait mise en question. Cela dit, les dérives du
régime représentatif, par le jeu à la fois des partis et
des lobbies et, en certains lieux, par les carences du
monde politique, a fait poser à nouveaux frais les
questions de la société civile et de la citoyenneté
active.
La citoyenneté active
L’évolution des citoyennetés
L’éveil récent d’une citoyenneté « active » est
une réalité aussi ambiguë qu’universelle. Une réalité,
d’abord : on ne saurait plus faire comme si elle n’exis-
tait pas et n’avait pris la place que, par démission ou
désintérêt, les pouvoirs politiques lui ont abandonnée.
Parmi les facteurs, surtout négatifs, qui expliquent son
avènement, il en est de bons, qui nous fondent à pous-
ser l’avantage, mais il en est de moins convaincantes,
ou qui appelleraient d’autres correctifs, notamment
dans le fonctionnement politique lui-même.
Une insatisfaction à l’égard des mécanismes
politiques
- parce qu’un manque de transparence (dossiers
complexes, négociations secrètes, engagements
non tenus) brouille l’image de la démocratie ;
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%