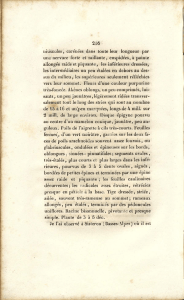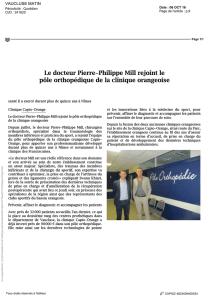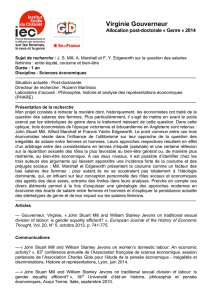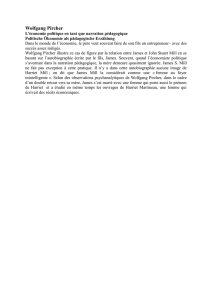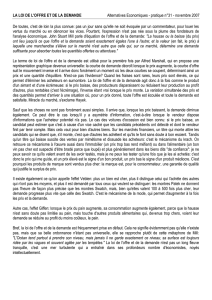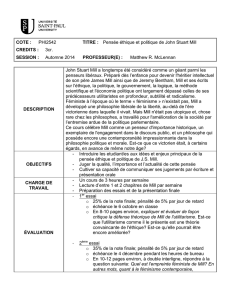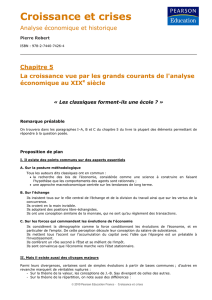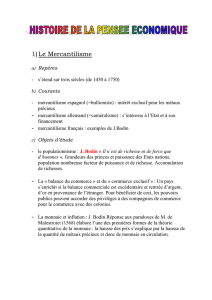John Stuart Mill et la loi des débouchés - Alain Béraud

Influences, critiques et postérité de l’œuvre du J.-B. Say au XIXème siècle
Lyon, les 12 et 13 janvier 2007
JOHN STUART MILL ET LA LOI DES DÉBOUCHÉS
ALAIN BÉRAUD1
Résumé : Cet article analyse les présentations que John Stuart Mill fit de la loi des débouchés.
On a souvent considéré que ses analyses avaient profondément évolué depuis le texte des
Essais jusqu’à celui des Principes. La thèse, ici défendue, est, qu’en dépit des nuances et des
précisions qui furent progressivement introduites, la position de Mill est restée
fondamentalement la même. Il s’agit pour lui d’élaborer une théorie des crises commerciales
tout en écartant les idées qu’avaient soutenues Malthus et Sismondi. L’origine des crises ne
doit pas être cherchée dans une accumulation trop rapide du capital mais dans le
développement d’un mouvement spéculatif qu’alimente le crédit.
Mots Clefs : Mill, Say, Malthus, Crises, Loi des débouchés.
Classification JEL : B12, E32
1 Théma, UMR CNRS 8184, Université de Cergy-Pontoise, 33 boulevard du Port, 95 011 Cergy-Pontoise Cedex,
beraud@u-cergy.fr

2
L’interprétation que John Stuart Mill donna de la loi des débouchés2 est importante et
ambiguë. Elle est importante parce que, jusqu’à la publication de la Théorie Générale, de
nombreux économistes fidèles à la tradition classique s’appuyèrent sur elle pour développer
leurs analyses. Elle proposait, en effet, une réponse qui, après la controverse entre Sismondi et
Malthus d’une part, Say et Ricardo d’autre part, apparaissait comme centrale : la loi des
débouchés implique-t-elle la négation même des crises commerciales ? Si la loi des débouchés
n’implique pas une telle négation, comment peut-on concilier l’existence d’un excès d’offre
globale de biens avec l’idée que l’offre crée sa propre demande ? Ricardo et Say avaient,
certes, répondu sur ce point aux arguments de Malthus et de Sismondi mais d’une façon qui
apparaissait à beaucoup comme insatisfaisante. Ricardo avançait l’idée que les crises sont les
effets de « brusques changements dans les voies du commerce » (1819 : 280). Il expliquait
que la crise que connaissait l’Angleterre à cette époque était, paradoxalement, l’effet de la fin
de la guerre avec la France. La paix avait brusquement modifié la structure de la demande de
biens. La production ne s’était pas instantanément adaptée à ces circonstances nouvelles et,
durant la période d’ajustement, une large fraction du capital restait inutilisée et pouvait être
considérée comme perdue tandis qu’un grand nombre de travailleurs restaient sans emploi.
Mais, cette description de la crise semblait accréditer la critique que les adversaires de la loi
des débouchés adressaient à Ricardo. Le texte des Principes suggérait, en effet, l’idée que la
crise n’était pas générale et que la surproduction de certaines marchandises avait pour
contrepartie une production insuffisante d’autres biens. Il semblait donc nier, comme lui
reprochait Sismondi (1824 : 340), la possibilité même d'un encombrement général des
marchés alors même qu’il semblait difficile de trouver, à cette époque, une industrie dont
l’offre était insuffisante. Say encourait la même critique quand il affirmait que « si certaines
marchandises ne se vendent pas, c’est parce que d’autres ne se produisent pas. » (1820 : 225)
Mill, en développant son analyse des crises commerciales, cherchait une solution à ce
problème en suggérant que l’apparition d’un excès d’offre de biens ne résulte pas d’une
production excessive de marchandises mais de la résorption de ce qu’il appelait, après Smith,
un over-trading, en d’autres termes une spéculation malheureuse sur le marché des biens.
Mais, alors que Say soutenait dans son Cours complet d’économie politique pratique (1828-
1829 : 474-475) que les crises commerciales avaient leur origine dans une émission excessive
de billets, Mill, qui était très hostile à une réglementation de l’activité bancaire, pensait que
l’origine des crises se trouve dans les erreurs que peuvent commettre les négociants quand ils
anticipent l’évolution future du prix des biens.
Mill développa son analyse de la loi des débouchés, d’abord, dans un texte intitulé
« De l’influence de la consommation sur la production » qu’il rédigea en 1829-1830 mais
qu’il publia seulement en 1844 dans ses Essais sur quelques questions non résolues en
économie politique. Il revint sur ce problème en 1848 dans les Principes d’économie
politique, en particulier, dans le chapitre V du livre 1 où il traite des propositions
fondamentales qui concernent le capital et dans le chapitre XIV du livre 3 où il analyse les
excès d’offre. La comparaison des Principes et des Essais a suscité l’embarras de nombreux
lecteurs de Mill. Même si les conclusions sont similaires — il ne peut exister un excès
permanent de la production (Mill, 1844 : 174) ; la théorie de la surproduction générale
implique une absurdité (Id., 1848, t. 2 : 574) — le ton des deux textes est bien différent. En
1844, Mill admet que, dans une économie où la monnaie est moyen de paiement, l’achat et la
vente sont temporellement séparés. Dans ces conditions, il se peut qu’à certains moments les
2 À ma connaissance, l’expression « loi de Say » n’apparaît pas dans l’œuvre de Mill.

3
vendeurs soient pressés de vendre alors que les acheteurs sont disposés à différer leurs achats.
Il ne lui paraît pas impropre de caractériser de telles situations en parlant d’une surabondance
de toutes ou de la plupart des marchandises (Id., 1844 : 72).
Les Principes d’économie politique semblent marquer un retour à l’orthodoxie et Mill
y apparaît comme un partisan pur et dur de la loi des débouchés. On peut s’en tenir aux
symboles et à l’hommage appuyé qu’il y rend aux deux économistes « éminents » — Jean-
Baptiste Say et James Mill — qui ont eu le mérite de mettre en lumière le point essentiel : la
production n’est pas limitée par les capacités du marché (Id., 1848, t. 2 : 576). Plus
fondamentalement, on peut souligner l’importance que Mill (Ibid., t. 1 : 78) prête à l’idée que
« la demande de marchandises n’est pas la demande de travail ». Même si Ricardo et Say
avaient, déjà, évoqué ce point, ce n’est pas par hasard que la postérité associe le nom de Mill à
cet adage car, mieux que ses prédécesseurs, il a su montrer qu’il découle logiquement de la
conception du capital qui était celle des classiques.
L’objet de cette communication est l’analyse de l’évolution de la pensée de John
Stuart Mill sur la question des débouchés. Cet objet incite à suivre l’ordre chronologique.
Mais, avant de comparer les Essais aux Principes, il convient d’étudier les premiers textes de
Mill. Les historiens y font plus rarement référence mais Samuel Hollander (1985, t. 2 : 487)
attire, à juste titre, notre attention sur eux. C’est, en effet, dans un article intitulé « Paper
Currency and Commercial Distress » publié en 1826 que Mill, pour la première fois, formula
son analyse des crises commerciales qui joue, dans la conception qu’il se fait de la loi des
débouchés, un rôle crucial.
1. Les crises, la monnaie et le crédit
En 1824, Mill avait critiqué un pamphlet que William Blake venait de publier. Blake
soutenait que la hausse des prix qui avait eu lieu durant la guerre était l’effet de
l’augmentation de la demande de biens qui résultait des dépenses du gouvernement, dépenses
qui avaient été financées par emprunt. Quand la paix avait été conclue, ces dépenses avaient
cessé entraînant une baisse de la demande, une chute des prix et une diminution de l’activité
économique. Mill (1824 : 13) soutenait que ce raisonnement reposait sur deux erreurs. Blake
admettait que les dépenses — par opposition à l’épargne — constituaient une source
additionnelle de demande. De plus, il prétendait que le capital emprunté par le gouvernement
devenait, alors, une source de demande ce qu’il n’était pas tant qu’il demeurait dans les mains
de ceux qui avaient souscrits aux emprunts de l’État.
Pour réfuter ces propositions, John Stuart Mill reprenait explicitement à son compte
les arguments qu’avait avancés son père. « La demande d’un pays est constituée de la
demande de tous les individus de ce pays. L’offre d’un pays est la somme de l’offre de chaque
individu. Si, donc, on peut prouver que la demande de chaque personne est exactement égale
à son offre, il sera établi que la demande de tout le pays et son offre s’équilibrent exactement
l’une l’autre. » (J. S. Mill, 1824 : 16)
Selon Mill, l’erreur de Blake tient à ceci : il pense que l’individu qui épargne ne veut
pas consommer. Mais, cette assertion est mal fondée : celui qui épargne, loin de montrer ainsi
une répugnance à consommer, démontre qu’il souhaite consommer non seulement son revenu
actuel mais plus encore. S’il ne voulait pas consommer, il n’aurait pas produit. Décidément,
l’épargne est une dépense. Dès lors, quand le gouvernement emprunte pour financer ses

4
dépenses, la demande globale n’est pas affectée. Pour reprendre la terminologie de Say, une
consommation improductive se substitue à une consommation productive.
1.1. Les effets d’un négoce immodéré
Cependant, dans « Paper Currency and Commercial Distress » (1826), le ton change
radicalement. Alors qu’en 1825, Mill reprenait à son compte l’adage de McCulloch (1824 :
277) selon lequel si une marchandise est en excès, une autre doit manquer, il ne met pas en
doute, en 1826, le caractère général de la crise commerciale qui affecte alors la Grande-
Bretagne. Le problème est de comprendre l’origine de crises de ce type et le rôle qui jouent le
crédit et le papier-monnaie.
Mill considère que la spéculation est la cause du retournement de la conjoncture. Il ne
s’agit pas, dans le cas des crises que la Grande-Bretagne a connues en 1810-1811, en 1814-
1815, en 1819 puis en 1825, de bulles : la spéculation sur le prix des actifs financiers n’a
concerné que peu de négociants et de commerçants. Pour Mill, le problème est sur le marché
des biens. Des négociants qui surestimaient l’insuffisance de l’offre de marchandises ont
développé leurs échanges de façon imprudente. Reprenant le terme qu’utilisait Adam Smith,
Mill considère que l’on peut parler d’over-trading.
Smith, discutant du bien-fondé du système mercantile, se demandait si la pénurie d’or
et d’argent pouvait constituer pour une économie un danger effectif qui justifierait une
intervention gouvernementale visant à préserver ou mieux à augmenter le stock de métaux
précieux. Il soutient que c’est à tort que le gouvernement se charge d’un tel souci car, si
l’argent vient à manquer, l’émission de billets ou la vente à crédit y suppléera non seulement
sans incommodités mais, dans certains cas, avec avantages.
Il est cependant, admet-il, des circonstances où l’on peut, avec raison, se plaindre de la
rareté de l’argent. « Un négoce immodéré3 en est la cause courante. Des hommes sobres, dont
les projets ont été disproportionnés à leurs capitaux risquent autant que les prodigues dont la
dépense est disproportionnée à leur revenu de n’avoir ni les moyens d’acheter de l’argent, ni
le crédit pour en acheter… Lorsque les profits du commerce sont plus grands que de coutume,
le négoce immodéré devient une erreur générale… Ce n’est pas toujours que [les négociants]
envoient à l’étranger plus d’argent que de coutume, mais c’est qu’ils achètent à crédit, une
quantité inhabituelle de marchandises qu’ils expédient dans quelques marchés lointains, avec
l’espoir que les recettes rentreront avant qu’on ne leur demande paiement. La demande de
paiement arrive avant les recettes et ils n’ont rien en mains qui leur permette d’acheter de
l’argent, ou de fournir quelque solide garantie pour emprunter. Ce n’est point une rareté d’or
et d’argent, qui occasionne la plainte générale que l’argent est rare, mais la difficulté qu’ont
de tels négociants à emprunter et leurs créanciers à se faire payer. » (Smith, 1776 : 491-492)
C’est ce schéma que Mill reprend et développe. Les négociants surveillent de façon
permanente les marchés de façon à détecter toute augmentation de la demande ou toute
réduction de l’offre qui laisse présager une hausse du prix du produit. Quand ils détectent un
tel signal, ils se portent acheteurs de façon à profiter de la hausse anticipée des prix. Ce
comportement entraîne une hausse des prix qui vient conforter les anticipations des agents et
le processus s’amplifie. Si cette augmentation est modérée, elle sera, sans doute, suffisante
3 C’est ainsi que Paulette Taïeb traduit l’expression over-trading.

5
pour que l’augmentation de la production qu’elle suscite satisfasse la demande. Mais, si
l’augmentation est rapide, les achats spéculatifs se multiplient et les prix s’accroissent bien
au-delà de ce qui serait nécessaire. Quand certains négociants décident, prudemment, de
réaliser leurs gains, les cours chutent brusquement et atteignent un niveau bien inférieur à
celui à partir duquel la hausse spéculative s’était déclenchée. Les négociants qui avaient
acheté quand les prix étaient élevés sont ruinés. Ceux qui avaient passé des contrats avec des
producteurs ne peuvent pas tenir leurs engagements. Les stocks d’invendus s’accumulent. Une
panique générale s’en suit et, pour un temps, les négociants sont dans l’impossibilité d’obtenir
des crédits.
1.2. Le rôle des billets et du crédit dans les crises commerciales
Le point crucial est de comprendre le rôle que jouent les émissions de billets de
banque et le crédit dans les crises commerciales. L’article que Mill rédigea en 1826 est
explicitement dirigé contre la politique du gouvernement anglais de l’époque qui voyait dans
ces crises un effet d’une émission excessive de billets et qui entendait modifier l’organisation
du système bancaire pour éviter que de telles situations puissent se reproduire. Mill lui
reproche, notamment, d’avoir fait adopter deux lois dont la première interdit l’émission de
billets de moins de cinq livres et dont la seconde limite les privilèges dont bénéficiait la
Banque d’Angleterre en autorisant la création à proximité de Londres de banques regroupant
un nombre illimité d’associés.
On peut noter que Say partageait le point de vue du gouvernement anglais. Dans le
Cours complet d’économie politique pratique (t. 1 : 474-475) qu’il publia en 1829-1830,
c’est-à-dire après la parution de l’article de Mill, Say analyse les causes de la crise
commerciale qui s’était développée en Angleterre en 1824. Il soutient que les banques ont
abusé de la faculté qui leur avait été accordée d’émettre des billets contre l’escompte d’effets
de commerce. Il voit dans cette émission l’origine de la crise car elle a permis à certains
entrepreneurs de donner à leurs affaires une extension disproportionnée avec leurs capitaux.
L’émission de monnaie a suscité une hausse générale des prix et a fait tomber la monnaie
anglaise en-dessous de la parité théorique. Les détenteurs de billets demandèrent à être payé
en espèces et, sitôt que le point de sortie d’or fut atteint, les exportations de métaux précieux
devinrent considérables. La Banque d’Angleterre, légalement tenue de payer en espèces les
billets qu’elle avait émis, fut obligée de racheter de l’or. Pour éviter d’accroître ses pertes, elle
cessa d’escompter des effets de commerce. Les négociants furent ainsi privés des avances sur
lesquelles ils comptaient pour financer leurs affaires. C’est, dans cette situation, que se trouve,
selon Say, l’origine de la crise. Il n’est donc pas surprenant qu’il admette que l’on puisse
mettre « quelque restriction à la faculté qu’ont les particuliers ou les entreprises d’émettre des
billets au porteur » (Ibid., t. 1 : 476) En particulier, il approuve la décision du gouvernement
anglais d’interdire l’émission de petites coupures.
Mill soutient, au contraire, que les crises ne sont pas les conséquences d’une émission
excessive de monnaie. Certes, la hausse des prix, qui est, selon lui, le reflet des anticipations
des négociants, ne peut se généraliser que si les moyens de paiement se multiplient ; mais,
dans ce processus, les billets de banque ne jouent qu’un rôle secondaire, c’est la
multiplication des effets privés, l’extension du crédit qui alimentent la hausse des prix.
Réciproquement, quand la conjoncture se retourne, quand les prix baissent, l’évolution de la
quantité de monnaie n’apparaît ni comme la cause, ni même comme un élément essentiel du
processus. Si les négociants sont en difficulté, si la pénurie de liquidités les oblige à vendre,
même à perte, c’est que le crédit vient à manquer. La contrepartie de l’offre excédentaire de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%