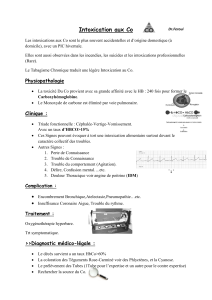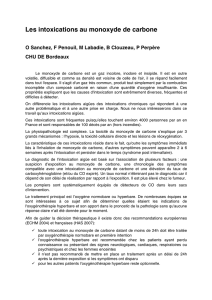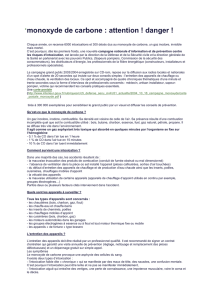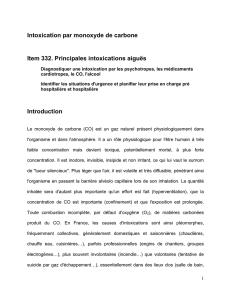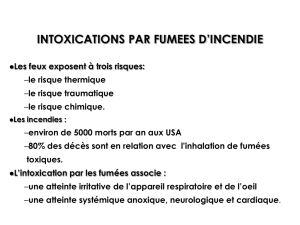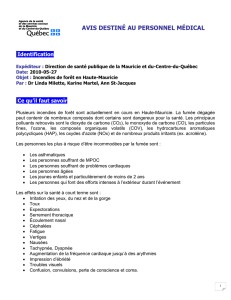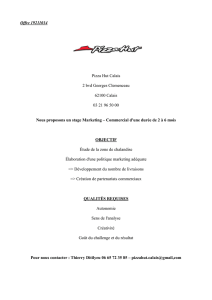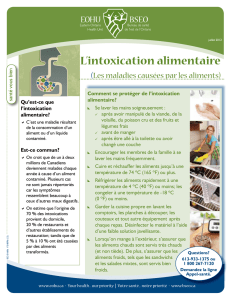Rapport monoxyde de carbone 1996 SOMMAIRE Remerciement

Rapport monoxyde de carbone 1996
SOMMAIRE
Remerciement
INTRODUCTION
RESULTATS DE L’ENQUETE MEDICALE
I- REPARTITION DES PATIENTS VICTIMES D’UNE INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
II- CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION DES PATIENTS INTOXIQUES PAR LE MONOXYDE DE CARBONE DANS LA REGION NORD -
PAS DE CALAIS - PICARDIE
III- REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES INTOXIQUES
IV- ETUDE CLINIQUE DES PATIENTS INTOXIQUES
V- MODALITES DE PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT DES INTOXIQUES
VI- EVOLUTION
VII- DUREE D’HOSPITALISATION
VIII- CIRCONSTANCES DE L’INTOXICATION
RESULTATS DE L’ENQUETE TECHNIQUE
I- ETUDE DU LOGEMENT
II- LE COMBUSTIBLE
III- L’APPAREIL
COMMENTAIRES
REMERCIEMENTS
A tous les acteurs du réseau de surveillance des intoxications par le monoxyde de carbone dans la région,
A tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette étude et la rédaction de ce rapport,
les Médecins et l’équipe du Service d’Urgences Respiratoires, Réanimation Médicale et du Centre d’Oxygénothérapie
Hyperbare de l’Hôpital Calmette du Centre Hospitalier Régional de Lille,
les Médecins du Service de réanimation Pédiatrique du Centre Hospitalier Régional de Lille,
les Médecins du SAMU-SMUR du Centre Hospitalier Régional de Lille,
les Médecins sapeurs-pompiers,
les Médecins et la Secrétaire du Centre Anti-Poisons de la région Nord-Picardie,
les Médecins des Services d’Urgence et de Réanimation et des Services de Pédiatrie du Centre Hospitalier Régional d’Amiens
et des Hôpitaux Généraux et Cliniques d’Armentières, d’Arras, d’Avesnes sur Helpe, de Bailleul, de Berck, de Béthune, de
Boulogne sur Mer, de Bruay, de Bully les Mines, de Calais, de Cambrai, de Campagne les Hesdin, de Chauny, de Compiègne,
de Denain, de Douai, de Doullens, de Dunkerque, de Fourmies, d’Hazebrouck, d’Hénin Beaumont, de Lens, de Le Quesnoy, de
Lille, de Maubeuge, de Montdidier, de Montreuil sur mer, de Noyon, de Péronne, de Roubaix, de St Amand les Eaux, de Saint
André, de St Omer, de St Pol sur Ternoise, de St Quentin, de Seclin, de Soissons, de Somain, de Tourcoing.
les Ingénieurs sanitaires et Inspecteurs sanitaires des DRASS et DDASS et les bureaux municipaux d’Hygiène,
l’équipe des Informaticiens du Centre Régional d’Informatique et Télécommunications du Centre Hospitalier de Lille,
l’INSEE
INTRODUCTION
Les intoxications par monoxyde de carbone restent encore actuellement un problème grave non seulement par leur mortalité,
mais aussi par leurs séquelles à moyen ou à long terme, tant au plan national que régional.
1) Sur un plan national, cette intoxication est un sujet de préoccupation des Pouvoirs Publics depuis de nombreuses années
(Ministère de la Santé et Ministère de l'Economie et des Finances et de leurs services déconcentrés) et de nombreuses actions
ont déjà été menées.
Une priorité a été accordée à la surveillance des intoxications par le monoxyde de carbone dans le cadre de l'expérimentation
de réseaux interrégionaux de Toxicovigilance au plan national dès 1992

Ceci a abouti à la mise en place du réseau interrégional "GRAND NORD" incluant les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
Haute Normandie, Basse Normandie et Champagne-Ardenne, associant les partenaires Centres Anti-Poisons de Lille,
Reims et Rouen.
Organisation du Réseau "Grand-Nord"
Cette mise en place officielle a abouti à une organisation concrète de fonctionnement d'un réseau articulé sur les trois Centres
Anti-Poisons, jouant chacun un rôle d'antenne de coordination de la Toxicovigilance dans leur région, chaque Antenne
Régionale constituant un réseau hospitalier au sein de sa région : le Centre Anti-Poisons de REIMS est l’antenne régionale de
la région CHAMPAGNE - ARDENNE, celui de ROUEN est l’antenne régionale des régions HAUTE NORMANDIE et BASSE
NORMANDIE et celui de LILLE qui est l’antenne régionale des régions NORD - PAS-DE-CALAIS et PICARDIE.
La coordination de ce réseau interrégional est assurée par le Centre Anti-Poisons du CHRU de Lille qui regroupe les cas
provenant des antennes régionales constituant le réseau et de tous leurs partenaires, et assure l’analyse des données de
l’interrégion.
Chaque antenne régionale du réseau interrégional de Toxicovigilance a pour mission d’organiser la surveillance des risques
toxiques dans la zone géographique qu'elle couvre. Pour être efficace, ce système de surveillance doit être basé sur un recueil
des cas représentatif de la situation réelle au plan local. Ceci nécessite la mise en place d’une activité de recueil continu
systématique appuyée sur un réseau de partenaires jouant le rôle de "sentinelles" au plan local. Ceux-ci diffèrent d’un
risque toxique à l’autre.
Définition de la stratégie des actions interrégionales basée sur la coopération :
- mettre en commun les cas et pour cela homogénéiser les modalités de recueil,
- sélectionner les sujets d'étude prioritaires,
- identifier et sensibiliser d'une manière homogène les partenaires "sentinelles",
- élaborer une procédure de validation et d'alerte au sein du réseau,
- constituer une base documentaire pouvant être mise en commun à l'échelle de l'interrégion,
- développer à court terme les communications au sein du réseau,
- favoriser les échanges d’information entre tous les partenaires du réseau dans le domaine de la prise en charge des
intoxications et de la Toxicovigilance.
Les actions menées par le réseau "Grand Nord"
Elles se sont concentrées sur deux thèmes prioritaires :
- surveillance des intoxications par le monoxyde de carbone
- surveillance des intoxications graves
2) Au plan régional, et en particulier dans la région Nord - Pas de Calais depuis de nombreuses années, cette intoxication
revêt un caractère particulièrement préoccupant et des spécificités régionales, comme le montre l'analyse des données
régionales recueillies par le Centre Anti-Poisons de Lille : 80 cas recensés en 1979, 350 cas en 1983, 1034 cas en 1993, 776
cas en 1994 et 968 cas en 1995.
De plus, cette situation endémique est encore aggravée par la survenue d'épidémies, l'une de 136 cas qui s'est produite entre
le 18 et le 21 septembre 1988, une autre d'une ampleur jamais connue jusqu'à présent, faisant 365 victimes du 3 au 5
novembre 1993, saturant les services d'Urgences des hôpitaux de la région. Ces deux épidémies ont fait l'objet d'une alerte des
Pouvoirs Publics et d'enquêtes de Toxicovigilance, mettant en évidence en outre, le défaut de ramonage, le défaut d'entretien,
le calfeutrage, la mauvaise conception des installations (cf. rapport 1988 et rapport 1993).
Dès 1986, alertés par le nombre croissant des intoxications et le taux important de victimes, le Centre Anti-Poisons de Lille et le
Centre d'Oxygénothérapie Hyperbare du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille, ont initialisé une démarche, en
collaboration avec les D.D.A.S.S., les Bureaux Municipaux d'Hygiène, tous les acteurs concernés, qui a été étendue à
l'ensemble du réseau interrégional de Toxicovigilance, ayant comme préoccupation :
- à court terme, d'améliorer la connaissance de l'intoxication et sa prise en charge précoce pour éviter la survenue de séquelles,
en sensibilisant le corps médical sur les modalités du traitement ;
- à moyen terme, d'éviter la récidive par la visite la plus précoce possible d'un inspecteur des D.D.A.S.S. ou Bureaux
Municipaux d'Hygiène au domicile du patient après avoir sollicité son accord ;
- à long terme, de dégager les éléments pouvant servir de base à des actions de prévention par la collecte systématique des
données à la fois médicales et techniques.
Nous présentons dans ce rapport les résultats de l'étude de Toxicovigilance réalisée à partir des données de l'enquête médicale
et technique recueillies au cours de l'année 1995 dans le réseau de surveillance des intoxications par le monoxyde de carbone,
mise en place en collaboration avec les services hospitaliers et les services d'Hygiène du Milieu, des D.D.A.S.S. dans les
régions Nord - Pas de Calais et Picardie.
Ce rapport fait suite aux rapports de l'année 1993 et de l'année 1994.
RESULTATS DE L'ENQUETE MEDICALE

Entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, 1093 patients ont été hospitalisés pour une intoxication au monoxyde de
carbone dans les hôpitaux de la région.
I - REPARTITION MENSUELLE DES PATIENTS VICTIMES D'UNE INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Les patients se répartissent de la façon suivante :
JANVIER 137
FEVRIER 209
MARS 78
AVRIL 15
MAI 64
JUIN 10
JUILLET 3
AOUT 37
SEPTEMBRE 72
OCTOBRE 157
NOVEMBRE 135
DECEMBRE 176
TOTAL connu 1093
On peut remarquer, comme le montre la figure 1 suivante, que la plupart des intoxications surviennent dès la fin de l'été
jusqu'au début du printemps, avec 979 patients entre septembre et avril. Contrairement aux autres années, le mois le plus
touché n'est plus le mois de novembre, mais le mois de février.
FIGURE 1
II - CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION DES PATIENTS INTOXIQUES PAR LE MONOXYDE DE CARBONE DANS
LA REGION NORD - PAS DE CALAIS - PICARDIE
II.1 - Sexe des intoxiqués
Sexe masculin 442, soit 42,75 %
Sexe féminin 592, soit 57,25 %, dont 44 femmes enceintes
Total connu 1034
II.2 - AGE DES INTOXIQUES
II.2.A - Age moyen
L'âge moyen était de 30,48 ans, la médiane étant située à 28 ans (un patient sur deux avait moins de 28 ans).
2 patients avaient entre 1 et 2 mois.
74 patients avaient entre 2 mois et 3 ans.

II.2.B - Répartition Adultes - Enfants
Adultes 742, soit 70,87 %
Enfants 305, soit 29,13 %, dont 22 enfants de moins de 12 mois
Total connu 1047
II.2.C - Répartition par tranche d'âge de 10 ans
Les patients tous sexes confondus se répartissent de la façon suivante (tableau ci-dessous et figure 2)
AGE
(en années)
NOMBRE DE
PATIENTS %
0 - 9 189 18,32
10-19 204 19,77
20-29 192 18,60
30-39 163 15,79
40-49 118 11,44
50-59 45 4,36
60-69 54 5,23
70-79 44 4,26
80-89 20 1,94
> ou = à 90 3 0,29
Total connu 1032 100
FIGURE 2

II.2.D - Répartition des intoxiqués en fonction de l'âge et du
sexe
Les patients se répartissent de la façon suivante :
AGE
(en années)
HOMMES FEMMES
Nombre % Nombre %
0-9 88 20,18 98 16,69
10-19 76 17,43 127 21,63
20-29 86 19,73 105 17,89
30-39 62 14,23 100 17,04
40-49 57 13,07 60 10,23
50-59 24 5,50 21 3,58
60-69 21 4,82 31 5,28
70-79 15 3,44 29 4,94
80-89 7 1,60 13 2,21
> ou = à 90 0 0 3 0,51
Total connu 436 100 587 100
Il est à noter que parmi les 587 femmes, 44 femmes étaient enceintes.
FIGURE 3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%