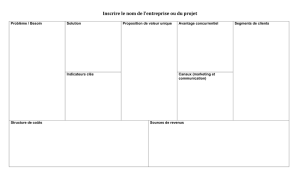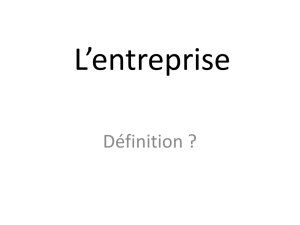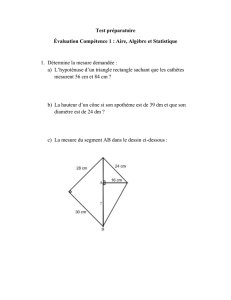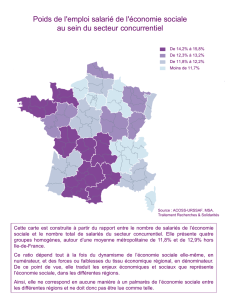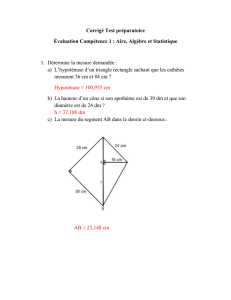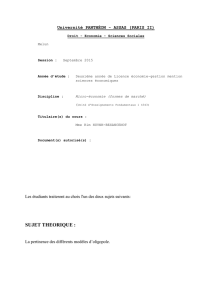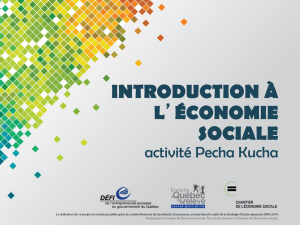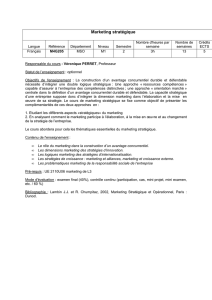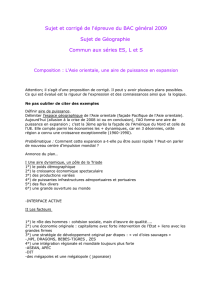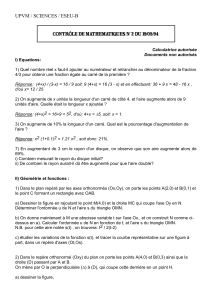Chapitre 2 : Fondements de l`analyse économique

Chapitre 3 : Fonctionnement d’un marché concurrentiel
1
3.B2. ALTERATIONS DE L’EQUILIBRE DU MARCHE CONCURRENTIEL
a/ Altérations exogènes du jeu du marché
L’efficacité du libre jeu du marché en situation de concurrence peut être montrée, a contrario,
à travers quelques exemples d’altérations exogènes de ses mécanismes. On analyse ici les
conséquences de dispositifs de réglementation des prix qui ont pour principe d’interdire les
ajustements de prix. Deux cas symétriques se présentent selon que l’on instaure un prix
plafond ou un prix plancher. Nous les étudions successivement en supposant que les autres
caractéristiques du marché sont conformes au cas usuel d’un marché concurrentiel.
Dans le cas d’un plafonnement du prix, la réglementation interdit purement et simplement
tout possibilité d’échange à un prix supérieur à un seuil prédéterminé (pMax). Bien
évidemment, cette réglementation n’a d’effet spécifique que si le prix plafond est inférieur
aux prix d’équilibre qui aurait prévalu autrement sur le marché (p*). Si tel n’était pas le cas, le
plafond de prix serait inopérant, l’échange se faisant librement à un prix plus faible.
Supposons un plafond contraignant. A ce prix,
inférieur au prix d’équilibre, la quantité globale
demandée est supérieure à l’offre globale. Il y
a pénurie d’offre. Puisque la réglementation
interdit toute transaction à un prix supérieur à
pMax, le mécanisme de hausse des prix induit
par la demande excédentaire ne peut jouer. Il y
a un rationnement du marché avec des
procédures diverses qui peuvent se mettre en
place pour organiser ce rationnement. Mais
dans tous les cas la quantité effectivement
échangée sur le marché au prix plafond ne
pourra excéder la quantité offerte (QS).
Il est possible d’étudier les conséquences de
cette entrave au jeu du marché sur les surplus.
Du côté de l’offre, le surplus des producteurs
est diminué par rapport à la situation de libre
jeu du marché. En effet, il y a à la fois baisse
du prix (de p* à pMax) et baisse des quantités vendues (de Q* à QS). En appliquant la
définition du surplus des producteurs (aire au-dessus de la courbe d’offre et délimitée par le
prix et la quantité échangée), on enregistre une baisse de l’aire bce à l’aire c, soit une perte de
l’aire be. Du côté de la demande, les consommateurs bénéficient certes d’un prix plus
avantageux (pMax inférieur à p*), mais cet avantage est contrebalancé par le rationnement qui
interdit de satisfaire l’intégralité de la demande. Le surplus des consommateurs (aire au-
dessous de la courbe de demande et délimitée par le prix et la quantité échangée) passe de
l’aire ad lorsque le marché est libre de toute entrave à l’aire ab lorsque le prix est plafonné.
L’effet net sur le bien-être des consommateurs (b-d) est a priori indéterminé, mais même s’il
est positif, il ne suffit pas à compenser la perte subie par les producteurs. Si l’on agrège les
deux surplus pour donner une mesure globale, on observe une baisse de l’aire abcde à l’aire
abc, soit la perte nette de l’aire de.
p*
pMax
Prix
Quantité
Demande de
marché
Offre de
marché
QS
QD
Q*
Pénurie d’offre
Instauration d’un prix plafond
sur le marché
a
d
b
e
c

Chapitre 3 : Fonctionnement d’un marché concurrentiel
2
Envisageons le cas symétrique de l’instauration d’un prix plancher, c’est-à-dire d’une valeur
seuil au-dessous de laquelle il est interdit de conclure des transactions. Comme précédemment
seul est pertinent le cas d’une réglementation contraignante par rapport au libre jeu du
marché. Nous faisons donc l’hypothèse d’un prix plancher (pmin) supérieur au prix d’équilibre
(p*).
Ce niveau relativement élevé du prix minimum
imposé incite les producteurs à développer leur
offre, mais il dissuade dans le même temps les
consommateurs d’acquérir le bien. Il y a donc
un excès d’offre. Les quantités excédentaires
doivent être neutralisées et l’échange sur le
marché ne pourra dépasser la quantité QD
correspondant à la demande au prix
réglementé. On notera que, dans le cas du prix
plancher comme dans celui du prix plafond, la
réglementation qui entrave le libre jeu du
marché conduit à une réduction des échanges.
C’est un résultat général : chaque fois qu’une
entrave crée un déséquilibre entre offre et
demande sur le marché, l’ajustement par les
quantités se fait toujours sur le côté « court »
du marché. Entre l’offre et la demande, c’est
toujours le « moins disant » en quantité qui
détermine les quantités effectivement échangées, du moins tant que l’on exclut la possibilité
de forcer les individus à réaliser un échange contre leur gré.
Les conséquences en termes de bien-être sont à nouveau illustrées à travers la comparaison
des surplus des producteurs et des consommateurs en situation de libre jeu du marché et en
situation de prix réglementé. L’augmentation du prix à payer signifie une perte de bien-être,
pour les consommateurs. Leur surplus, égal à l’aire abd en l’absence de réglementation, se
limite à l’aire a lorsque le prix plancher est instauré. Du côté de l’offre, l’effet est plus
ambigu. Les producteurs bénéficient de la hausse de prix induite par la réglementation, mais
ils subissent aussi une diminution du volume de leurs ventes. Au total, leur surplus passe de
l’aire ce à l’aire bc. Quel que soit l’effet net sur le surplus des producteurs, on peut, comme
dans le cas du prix plafond, conclure à une perte nette en surplus collectif. Le gain net
éventuel des producteurs ne suffit pas à compenser la perte subie par les consommateurs. En
termes de surplus collectif, la contrainte de prix plancher est à l’origine d’une perte nette
correspondant à l’aire de (passage de abcde à abc).
Au total, les deux exemples ci-dessus montrent comment l’altération du libre jeu d’un marché
concurrentiel implique une moindre efficacité dans l’affectation des ressources. D’autres
situations pourraient être analysées qui conduiraient à des conclusions similaires.
Cela ne signifie pas qu’il faille condamner définitivement toute forme de réglementation du
jeu de marché. Les effets recherchés par ce type d’intervention peuvent se situer en dehors de
la sphère du marché considéré et une évaluation limitée à la mesure du surplus sur ce marché
est alors incomplète. Si ce marché est par nature concurrentiel, il convient de garder à l’esprit
les effets négatifs potentiels d’une entrave au libre jeu du marché pour les comparer aux effets
positifs attendus en dehors du marché et évaluer les avantages et coûts relatifs de modalités
alternatives d’intervention.
p*
pmin
Prix
Quantité
Demande de
marché
Offre de
marché
QD
QS
Q*
Excès d’offre
Instauration d’un prix plancher
sur le marché
a
b
c
d
e

Chapitre 3 : Fonctionnement d’un marché concurrentiel
3
b/ Imperfections de concurrence
En terminant ce chapitre, nous évoquerons assez brièvement les configurations
d’environnement de concurrence imparfaite. Ces configurations sont multiples et leur analyse
peut devenir relativement complexe. Nous nous limiterons ici à définir les principales
situations de référence et à en donner les caractéristiques essentielles.
Jusqu’ici, nous avons raisonné sur le cadre de concurrence pure et parfaite, dont nous avons
dit qu’il était un cadre théorique idéalisé. L’une des caractéristiques importantes de cette
configuration de référence est l’hypothèse d’atomicité : aucun individu ne peut seul avoir une
influence quelconque sur l’équilibre. Cela revient à supposer que, tant du côté de l’offre que
du côté de la demande, il existe un grand nombre d’agents économiques.
A l’opposé, il existe des situations où un agent unique est seul décideur pour tout un côté du
marché. C’est la situation du monopole lorsqu’il n’y a qu’un seul offreur sur le marché, face à
une multitude de demandeurs. C’est la situation du monopsone lorsque, de façon symétrique,
il n’y a qu’un demandeur face à une multitude d’offreurs.
Dans l’un et l’autre cas, l’agent qui accapare seul tout un côté du marché ne considère plus le
prix comme une donnée. Notons que l’exploitation de cette position dominante suppose
l’existence d’une forme de barrière à l’entrée sur le marché. Dans ce cas, l’agent sait que, à
travers son contrôle total de l’une des courbes du marché, il peut choisir le prix d’équilibre.
La seule contrainte qui s’impose à lui, c’est la relation entre prix et quantité échangée telle
qu’elle est définie par la courbe de ses partenaires. Ainsi en situation de monopole, l’offreur
unique choisit sur la courbe de demande de marché la combinaison lui permettant de
maximiser son profit. Par rapport à une situation concurrentielle, le monopoleur tend alors à
réduire l’offre de produit pour faire monter le prix le long de la courbe de demande. De façon
symétrique, en situation de monopsone, le demandeur unique agit de façon à faire baisser le
prix le long de la courbe d’offre, ce qui implique également une baisse de la quantité
échangée par rapport à l’équilibre concurrentiel.
Dans les deux cas, l’équilibre non concurrentiel implique une répartition plus inégalitaire des
gains de l’échange, au bénéfice de l’agent doté d’un pouvoir de marché. Mais ce gain est
obtenu aux dépens des partenaires sur le marché et, en termes de surplus, la collectivité subit
une perte directement liée à la diminution des quantités échangées.
Le monopole et le monopsone fournissent des configurations de référence à l’opposé de la
concurrence parfaite. Comme elle, elles constituent néanmoins des situations plus théoriques
que réelles. Là encore, leur intérêt est plutôt de permettre la mise en évidence de mécanismes
types. Les cas qui sont peut-être les plus riches et les plus pertinents pour appréhender la
réalité du côté de l’offre et des comportements des firmes sont sans doute ceux qui
correspondent à des configurations intermédiaires entre concurrence parfaite et monopole.
Parmi celles-ci, deux types méritent d’être brièvement présentés : l’oligopole et la
concurrence monopolistique.
La situation d’oligopole est celle où quelques d’offreurs se partagent le marché (on parle de
duopole, lorsqu’ils ne sont que deux). Dans ce cas chacun sait qu’il a la capacité d’influencer
l’équilibre du marché, mais que ses concurrents ont un pouvoir équivalent. Les résultats des
choix de l’un dépendent des choix des autres. Les situations d’oligopole posent alors un

Chapitre 3 : Fonctionnement d’un marché concurrentiel
4
problème général d’interactions stratégiques entre les offreurs. L’analyse pour en traiter fait
alors souvent appel à des cadres formalisés qui s’inscrivent dans la théorie des jeux.
En situation de concurrence monopolistique, chaque offreur est capable de différencier son
produit par rapport à ceux de ses concurrents et cette différenciation permet de répondre à une
demande de diversité de la part des consommateurs. Les différentes variétés du bien
demeurent cependant substituables. Ainsi, sur le créneau de marché correspondant à chaque
variété, le comportement de chaque producteur peut être comparé à celui d’un monopoleur.
Mais la substituabilité et la libre entrée sur le marché conserve un caractère concurrentiel à la
configuration.
1
/
4
100%