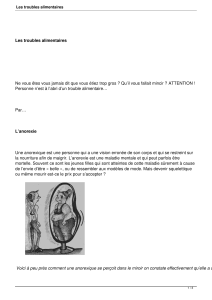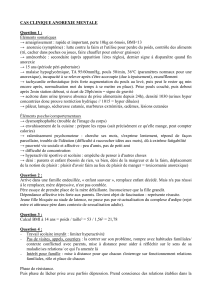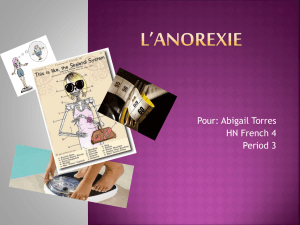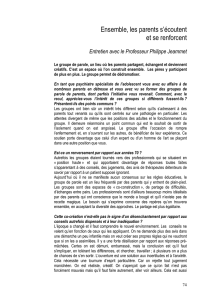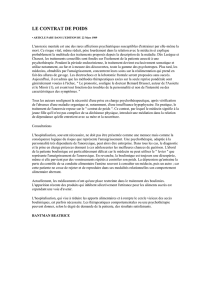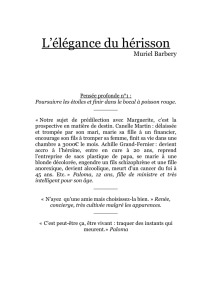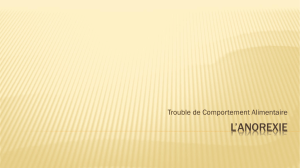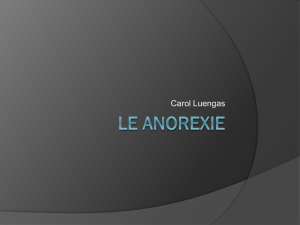Devenir des anorexie de l adolescence à l âge adulte

112
Le Courrier des addictions (2), n° 3, septembre 2000
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
Il n’est pas rare que, venant en consultation
pour des raisons diverses, des patientes, au
cours de l’entretien, évoquent un passé
d’anorexique. Ce symptôme est en quelque
sorte mentionné pour mémoire, car les
patientes ne s’en plaignent pas. Elles jugent
simplement utile d’en informer le clinicien.
Cependant, si on les interroge un peu en
détail sur ce point, on s’aperçoit souvent
que les troubles du comportement alimen-
taire persistent mais paraissent en quelque
sorte intégrés au quotidien, comme quelque
chose de naturel. Arrivée à un certain âge,
il est extrêmement rare qu’une femme
souffre d’anorexie “pure” et consulte un
psychiatre, à moins d’y être obligée. Les
patientes dont il est question ne mangent
pas comme tout le monde mais plus, moins,
ou autrement que tout le monde.
Il s’agit donc d’anorexie, mais aussi de
boulimie, la même personne adoptant les
deux comportements, souvent associés,
successivement ou simultanément, un peu
comme manie et mélancolie sont les deux
facettes d’une même entité : la psychose
maniaco-dépressive. Au cours des lignes
qui vont suivre, c’est volontairement que le
terme d’“anorexie” s’appliquera d’une
façon habituelle aux deux aspects princeps
(restriction/augmentation) des troubles du
comportement alimentaire, sauf indication
contextuelle évidente. De même utiliserai-
je toujours “anorexique” au féminin.
Certes, il existe une anorexie masculine (5 à
10 % des cas, paraît-il), mais je n’entrerai
pas dans les détails propres à cette forme
clinique considérée classiquement comme
plus grave que la féminine.
Entre lutte contre la faim
et appétit de bœuf !
Du point de vue des termes employés, il
convient de s’arrêter un instant sur celui
d’“anorexie”, pour remarquer qu’il est
impropre à représenter ce qui se trouve au
fondement du symptôme majeur : la lutte
contre la faim, consciente et active.
“Anorexie” ne rend compte que de l’appa-
rence. Quant au terme de “boulimie”,
signalons au passage qu’il signifie, étymo-
logiquement, “faim de bœuf” – étant
entendu que c’est le bœuf qui a faim !
Il ne s’agit pas ici de faire une étude
exhaustive de la clinique, de la psychopa-
thologie et du traitement des troubles du
comportement alimentaire. D’autres, plus
spécialisés en ce domaine, l’ont déjà fait (je
pense à Jeammet, Bruch et Kestemberg,
mais aussi à Selvini et Minuchin, pour ne
citer qu’eux) de manière remarquable, et
leurs écrits font référence. Je vais plutôt
m’attacher à pointer certains aspects de ces
troubles auxquels on peut être confronté en
milieu “tout-venant”, comme, par exemple,
dans une consultation de secteur, lieu de psy-
chiatrie généraliste. Lorsque l’on se trouve
face à de telles pathologies à l’âge adulte, on
pourra alors noter les différences, mais aussi
les similitudes, par rapport à la clinique de
l’adolescent. Ainsi, une anorexique adulte est
une anorexique qui n’est ni guérie ni morte.
Cela implique une certaine adaptation à un
environnement qui s’est forcément modifié
avec le temps, tout en restant sous le primat
du symptôme, qui garde son rôle d’organisa-
teur et de définisseur des modalités relation-
nelles affectives et sociales. On peut noter en
conséquence :
– la continuation des conduites de restric-
tion alimentaire, avec sélection, selon des
critères qui se veulent rationnels, de cer-
tains aliments. L’amaigrissement demeure
important, avec atteintes physiques plus ou
moins marquées (œdèmes, chute des dents,
etc.) ; l’aménorrhée est installée depuis des
lustres, rarement interrompue par des
règles sporadiques ;
– ce que j’appellerai la convivialité paradoxa-
le (on parle aussi d’altruisme alimentaire),
qui consiste à préparer avec soin et attention
des repas pour les autres, repas auxquels
l’anorexique ne participera pas. Ce comporte-
ment, initialement en direction de la famille
d’origine, se poursuit avec la nouvelle famille
nucléaire si l’anorexique est mariée ;
– une attitude d’évitement de la sexualité,
voire de refus, laissant juste place à la pro-
création. Il est toutefois intéressant de noter
l’aspect “antidépresseur” de la grossesse :
l’anorexique enceinte devient parfois radieu-
se, s’alimente à nouveau et ne se désole nulle-
ment de ses rondeurs retrouvées. Mais cela ne
dure que jusqu’à l’accouchement ;
– le recours fréquent à des toxiques (alcool,
tranquillisants, etc.) destinés à pallier les
sentiments de solitude, de non-congruité
par rapport à l’environnement et à la société,
les affects dépressifs. L’anorexique adulte
n’est plus “speed” comme elle pouvait
l’être à l’adolescence. Elle est au contraire
régulièrement déprimée ;
– l’appauvrissement global des investisse-
ments et des centres d’intérêt, avec un fonc-
tionnement de surface rigide d’allure
obsessionnelle. La sphère intellectuelle
peut paraître très investie mais aura ten-
dance à tourner à vide, sans efficience réelle.
Ce mode de vieillissement de l’anorexique
peut inclure, à une fréquence variable dans le
Devenir des anorexies
de l’adolescence
à l’âge adulte
Daniel Chardin*
Le vieillissement des anorexiques, qui se présentent rarement en
consultation pour leurs conduites alimentaires, pose le problème
de l’abord thérapeutique des personnes dont les manifestations
sont déjà “fixées”, et souvent projetées en partie sur d’autres
conduites addictives. Quatre vignettes cliniques :
*Association audoise sociale et médicale,
Carcassonne.

113
temps, des comportements boulimiques. Cela
peut sensiblement modifier le tableau clinique
quant au poids, qui peut être voisin de la nor-
male. Par ailleurs, cela inclut fréquemment des
vomissements provoqués après les boulimies.
La substitution par d’autres
conduites addictives
Quand apparaît l’angoisse, décrite comme
le sentiment insupportable d’être vide,
celle-ci pousse à l’incorporation de nourri-
ture jusqu’à un sentiment de réplétion qui
apporte l’apaisement. Mais la vraie satis-
faction ne survient qu’après le vomisse-
ment, qui procure une sensation de nettoya-
ge, d’expulsion de choses sales, littérale-
ment “dégueulasses”. D’une façon quasi
constante, la crise de boulimie est un acte
solitaire et secret, l’intrusion imprévue
d’un tiers y mettant fin instantanément.
Toutefois, les perturbations alimentaires
s’amendent fréquemment et se voient substi-
tuer – ou coexistent avec – des conduites
addictives, entre autres en direction de l’alcool
et de toutes sortes de médicaments, et aussi de
toxiques illégaux. La conduite addictive est,
dans son déroulement, très superposable à la
crise de boulimie : là encore, il s’agit de mettre
fin à l’angoisse, et la substance sera ingérée
ou injectée avec la même compulsivité.
On voit que la clinique de l’adulte aux prises
avec des troubles du comportement alimen-
taire n’est pas fondamentalement différente
de ce qu’elle est à l’adolescence. Elle en dif-
fère un peu selon les nécessaires adaptations
à un environnement qui s’est plus ou moins
modifié et va plutôt dans le sens d’une rigi-
dification des conduites et d’un appauvrisse-
ment global de la personnalité.
Rien d’étonnant, dans ces conditions, à ce
que l’on retrouve, d’un point de vue psy-
chopathologique, une configuration et un
aménagement structurels identiques à ceux
déjà connus. Faisons un rappel des diffé-
rents éléments qui se “nouent” lorsque
commencent les conduites anorexiques.
La tentation de la maîtrise
du corps
Dans le domaine intrapsychique, les
notions de fixation et de régression per-
mettent de situer le fonctionnement écono-
mique. En quelques mots, il est postulé
que, devant l’angoisse œdipienne réactivée
par la puberté, la libido régresse aux stades
anal et oral, et organise les échanges rela-
tionnels et le comportement en les modulant
selon les caractéristiques propres à ces
stades. Ainsi, on range au registre de l’anali-
té : les formations réactionnelles, notamment
concernant l’agressivité, les rites, les vérifi-
cations, le souci de pureté et de propreté,
l’idéalisation de l’intellect, le surinvestisse-
ment de la maîtrise. Et, au registre de l’orali-
té : la réactivation des mécanismes d’incor-
poration (et donc aussi de leur inhibition),
l’envie, l’avidité, l’insatiabilité, le “tout ou
rien”, la peur d’être “bouffée” par l’entoura-
ge et aussi la personnalité “bouffante”.
Cependant, le conflit essentiel de l’ano-
rexique se situe au niveau de son corps,
exprimant par là une incapacité à assumer
le passage à la génitalité avec les transfor-
mations corporelles que cela implique.
Dans ce contexte, ce sont les fonctions ali-
mentaires qui sont sexuellement investies.
Les perturbations anciennes du maternage,
amenant des sentiments d’impuissance,
d’inefficacité et de dépendance vont se
trouver objets d’une tentative contre-
dépressive par la mise en acte de la néga-
tion des besoins élémentaires du corps, se
traduisant par des comportements de maî-
trise et de contrôle. Quant au plaisir,
puisque toute satisfaction pulsionnelle
directe est inacceptable, il va trouver deux
voies d’expression : l’une, masochiste, de
refus de la satisfaction, et l’autre, désincar-
née, de l’hyperinvestissement intellectuel.
C’est, tragiquement, au moment où l’ano-
rexique réalise son fantasme de pur esprit
triomphant définitivement de la matière
qu’elle meurt. Il est capital de comprendre
qu’il ne s’agit pas là d’un suicide, et qu’a
contrario, il sera nécessaire de passer par la
dépression – avec d’éventuelles tentatives
de suicide, cette fois – pour que l’ano-
rexique réintègre son corps.
Une famille matriarcale,
presque lisse...
Quittons le niveau intrapsychique pour pas-
ser à la relation aux autres, et avant tout à
l’entourage familial. L’étude de celui-ci a
permis d’accroître la compréhension de ce
qui est en jeu et de développer des abords
thérapeutiques qui ont augmenté l’efficacité
des “prises en charge”.
La mère est décrite comme le personnage
“fort” de la famille, dominante, rigide, peu
chaleureuse, contrôlant ses manifestations
émotionnelles et affectives. Mais elle est
aussi décrite comme une personnalité
dépressive, qui lutte contre cette dépression
par la rigidité et la maîtrise.
L’image du père est souvent ainsi connotée :
de caractère effacé, soumis à sa femme,
manquant d’autorité et de décision. Mais il
peut présenter, avec un profil obsessionnel
ou sensitif, des manifestations sadiques ou
tyranniques.
La place dans la fratrie ne paraît pas déter-
minante, pas plus que la composition de
celle-ci. Il semble que soit plus importante
la place prise par l’anorexique dans la
manière dont ses parents l’investissent fan-
tasmatiquement. Du côté de la mère : être
narcissiquement confortée par les perfor-
mances sociales et cognitives de sa fille, au
détriment de ce qui ressortit au pulsionnel,
ce qui explique les habituels bons résultats
scolaires de l’anorexique. L’accent a été
mis, à propos de la satisfaction de la mère,
sur l’importance de la relation de celle-ci à
sa propre mère, relation à la fois idéalisée
et ambivalente : la grand-mère maternelle
est ainsi considérée comme un personnage
clé dans la famille de l’anorexique. Du côté
du père : lui éviter d’être pris dans des atti-
tudes contre-œdipiennes, c’est-à-dire la
tentation de l’inceste, dont l’anorexique se
protègera par son corps “indésirable”.
À côté de cette typologie des personnages
principaux, il est intéressant de considérer
l’ensemble du fonctionnement familial.
L’apparence est habituellement celle-ci :
une famille conventionnelle, fermée sur
elle-même, avec la volonté d’éviter les
conflits internes et de s’afficher unie et har-
monieuse. Le fonctionnement proprement
dit présente les caractéristiques suivantes :
enchevêtrement des membres, c’est-à-dire
manque de limites et de frontières entre les
individus et les générations, intensité des
interactions ; surprotection ; rigidité ; into-
lérance aux conflits, qui sont évités et non
résolus (ceux-ci agissent dans les compor-
tements, les tensions corporelles). Il faut y
ajouter la notion de conflit conjugal nié et
non traité, dans lequel l’anorexique va se
trouver impliquée, transformant ce conflit
conjugal en conflit parental. L’anorexique
fait alliance avec la mère contre le père,
mais alliance et hostilité sont ambivalentes.
Enfin, d’une façon générale, la famille met
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t

114
Le Courrier des addictions (2), n° 3, septembre 2000
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
en avant, au chapitre des “problèmes”, des
dysfonctions corporelles diverses, d’ordre
psychosomatique, qui sont l’expression
somatique des conflits.
Celles qui ont fait de la
résistance pour conserver
leur symptôme
La psychopathologie des anorexiques à la
postadolescence et à l’âge adulte ne néces-
site pas de modifier de manière significative
ce qui vient d’être exposé. Ce qui paraît le
plus important à noter, c’est la persistance de
l’attachement de l’anorexique à sa famille
d’origine et la distance à laquelle est tenu le
conjoint, lorsqu’il y en a un. Si c’est le cas,
celui-ci occupe avant tout une place de
géniteur, assurant la procréation et l’entre-
tien matériel de la famille. Souvent, l’ano-
rexique restera célibataire, ou pourra être
considérée comme telle, dans l’orbite de sa
famille d’origine, et parfois même s’enkys-
tera dans une modalité psychotique défici-
taire, qui donnera sens et utilité à la fin de
vie de sa mère.
J’ai fait le choix de ce détour un peu long par
la psychopathologie pour mieux mettre en
évidence ce qui, au-delà du symptôme, doit à
mon avis mobiliser l’action du thérapeute.
Les anorexiques, ou anorexo-boulimiques
que nous voyons en dispensaire à l’âge
adulte, sont celles qui ont “résisté”, ainsi
que leur famille, à l’action thérapeutique et
qui n’ont pas renoncé à leur symptôme.
Plusieurs “ingrédients” entrent dans la
composition de cette résistance. Ainsi, on
peut mettre en évidence, parmi eux, cer-
taines attitudes thérapeutiques ne prenant
pas suffisamment en compte l’entourage
familial, ses attentes, ses inquiétudes et ses
exigences. La mise à l’écart des parents, la
priorité donnée à la médicalisation du
symptôme sont probablement cause d’échec
à terme des “prises en charge” d’ano-
rexiques. Entre l’individuation forcée et la
loyauté au groupe familial, le choix de
l’anorexique est prévisible. Celle-ci se
sacrifie au nom de l’intérêt des siens, et
mettra en échec tout thérapeute qui ne pren-
dra pas en compte la souffrance de l’en-
semble du groupe. On peut aussi noter, parmi
les autres raisons de l’échec, le fait que le
comportement n’a jamais été suffisamment
inquiétant pour le reste de la famille pour que
celle-ci se décide à agir, ou bien l’existence
d’une entité famille-patiente tellement soli-
daire autour des bénéfices secondaires de ce
comportement, qu’aucune action thérapeu-
tique n’a pu modifier l’organisation générale
du fonctionnement et la symptomatologie
anorexique.
L’ anorexique adulte qui se présente à nous,
ne vient habituellement pas consulter pour
ses troubles de l’appétit et pour sa mai-
greur. En fait, il s’agit souvent d’une
femme qui a des compulsions boulimiques
et cherche à retrouver le contrôle de son ali-
mentation. Ou bien encore d’une patiente
dont le symptôme alimentaire n’est pas
parlé, alors qu’est mise en avant une pro-
blématique dépressive d’alcoolisation ou
d’addiction.
Quatre vignettes cliniques
Quelques vignettes pour illustrer cette cli-
nique du devenir des anorexiques lorsqu’on
les voit à l’âge adulte :
S. a 37 ans. Elle fait une formation profes-
sionnelle dans un centre de réadaptation,
formation qu’elle néglige d’une façon telle
que l’échec à terme est programmé. Il faut
dire qu’elle a deux priorités dans la vie :
contrôler son alimentation et faire disparaître
les douleurs alléguées, siégeant désormais
dans toute la jambe, dont l’articulation du
genou a fait l’objet d’une arthrodèse en posi-
tion de rectitude il y a à peu près huit ans.
Cette articulation a subi jusqu’à présent dix-
sept interventions chirurgicales (? !). S. sait
très bien qu’elle ne récupérera jamais la
fonction de sa jambe. Ce qu’elle veut, c’est ne
plus souffrir. Elle se rend régulièrement à la
consultation antidouleur d’un CHU parisien
mais n’est jamais satisfaite des prescriptions
et essaie toujours de se faire donner des antal-
giques supplémentaires. Si elle est venue me
voir, c’est parce qu’on lui aurait dit qu’une
psychothérapie aurait un effet favorable sur
ses douleurs. Elle essaie surtout de m’ex-
torquer des médicaments. Le contrôle sur
son alimentation, franchement restrictif sur
les aliments solides, est heureusement
compensé par l’ingestion au quotidien de
grandes quantités de Coca-Cola, dont la
concentration en sucre lui permet d’être
seulement mince. Elle n’a aucune demande
dans ce domaine. Elle présente, par
ailleurs, un tabagisme impressionnant
(deux à trois paquets de cigarettes par jour),
et – on l’aura compris – une addiction aux
médicaments, spécialement aux benzodiazé-
pines et aux antalgiques. Il apparaît petit à
petit que S. manipule subtilement les soi-
gnants et surtout son entourage (ses condis-
ciples en formation). C’est lorsque l’on
commence à prendre la mesure de ce qui
apparaît pour partie comme un syndrome
de Münchhausen, que S. fait une tentative
de suicide. Au décours de celle-ci, on
découvre dans sa chambre une impression-
nante pharmacie avec, entre autres, des
antalgiques de type trois.
V. est une femme de 30 ans, particulière-
ment intelligente, pleine d’humour (sou-
vent noir), dont l’existence est déjà
dévastée par plusieurs tentatives de sui-
cide et des échecs professionnels répétés.
Elle a un ami, qui est en fait une femme
transsexuelle. La description de ses parents
est décapante. La relation à ceux-ci est
manifestement ambivalente mais reste enco-
re très proche, avec tous les conflits que cela
implique. Elle vient consulter d’abord pour
des troubles du sommeil. Quelque temps
après, elle se présente comme cyclothy-
mique et n’aborde ses compulsions alimen-
taires qu’à la deuxième consultation. Elle est
un peu maigre, mais ses crises de boulimie
lui apportent un minimum de calories. Sa
demande évolue : elle voudrait en finir avec
les compulsions. En finir, parce que celles-
ci la contraignent à se faire vomir, et que
c’est en grande partie à cause d’elles qu’elle
a tant de mal à dormir. On note que les alter-
nances entre boulimie et contrôle recoupent
l’évolution des troubles de l’humeur : dépri-
mée si elle cède, exaltée si elle jeûne. Elle a
aussi tendance à consommer des benzodia-
zépines, qui colmatent habituellement ses
angoisses, à condition, bien sûr, d’y mettre
la dose…
C. a 25 ans, et cela ne fait que deux ans
qu’elle n’est plus squelettique : elle est
seulement très maigre. Elle se trouve
cependant trop grosse et surveille son poids
avec l’attention que l’on peut imaginer.
Elle suit un régime particulièrement aber-
rant du point de vue de la diététique, mais
auquel elle tient. Elle souffre beaucoup, par
intermittence, de compulsions boulimiques
suivies de vomissements “féroces”. Elle
vient d’un milieu social particulièrement
défavorisé. Sa mère est obèse et dépressive,

115
et leur relation est le plus souvent mauvai-
se, avec des attentes irréalistes suivies de
rejets réciproques. Son père, avec lequel
elle vivait depuis le divorce de ses parents,
est mort il y a neuf ans. Il était alcoolique,
couchait parfois dans le même lit que C.,
qui assure cependant qu’il ne s’est jamais
rien passé, enfin presque, pour autant
qu’elle s’en souvienne… Elle a des amis-
amants à profil borderline, toxicomanes, qui
profitent d’elle, la squattent et lui laissent des
dettes qu’elle éponge comme elle peut, avec
ses faibles ressources. Altruiste impénitente,
elle trouve toujours quelqu’un à aider, qui
sera diabolisé un peu plus tard. Experte en
masochisme, elle sait remarquablement faire
s’écrouler toutes les constructions, psycho-
thérapiques, professionnelles ou sociales, qui
allaient enfin déboucher sur un changement.
D. est aussi en formation professionnelle
quand je fais sa connaissance. Elle a 27 ans.
Elle présente un profil borderline dépressif,
avec une souffrance intense. Elle se
“speede” à coups de restrictions de sommeil
et de privations alimentaires. Elle a beaucoup
de mal à s’exprimer, mais son corps parle
pour elle. En effet, elle est toujours assise tor-
due et dans des positions inconfortables. Lui
en faire la remarque n’amène qu’une ébauche
d’ajustement, vite oubliée dès qu’elle évoque
quelque épisode douloureux de sa vie. Et
celle-ci n’en manque pas : père alcoolique
violent ayant terrorisé toute la famille, frère
plus âgé au chômage, séropositif (a été toxi-
comane), mère dépressive. Elle a une liaison
déjà ancienne avec un garçon alcoolique et
aboulique qu’elle ne peut quitter, redoutant
qu’il se suicide. Sa vie intime est aussi dou-
loureuse : elle n’a jamais connu de plaisir (les
relations sexuelles avec son ami lui répu-
gnent), et elle a fréquemment des symptômes
algiques de la sphère génito-urinaire. Sa
demande est de soigner sa dépression. Elle est
“remplie” d’affects violents, mais n’arrive
jamais à exprimer sa colère de façon appro-
priée. À plusieurs reprises, elle aura des accès
de rage suivis de comportements proches de
l’automutilation, tel que donner un violent
coup de poing dans un mur, se blessant sérieu-
sement. Elle se “sacrifie” aussi pour tous ceux
qui lui semblent présenter des “problèmes”.
Elle arrive cependant à garder un poids conve-
nable, grâce, avant tout, à ses accès de bouli-
mie, d’autant plus que le fait de se faire vomir
lui est la plupart du temps insupportable.
La difficulté à contrer ces
manifestations déjà fixées
Les possibilités thérapeutiques sont, on s’en
doute, assez modestes concernant des person-
nalités comme celles-ci. Mais, même lorsque
la souffrance est moindre, les manifestations
pathologiques sont assez fixées et ont évolué
pour leur propre compte. Il ne faut donc pas
s’attendre à des avancées décisives, d’autant
plus que la demande porte souvent sur un
aspect marginal ou beaucoup trop vague du
problème et, ce faisant, irréaliste.
À ce stade, la famille d’origine n’est plus
directement, immédiatement, partie pre-
nante. De plus, elle peut être éloignée géo-
graphiquement. C’est donc à un travail
avant tout individuel que nous allons devoir
nous atteler – avec toutefois la prise en
compte, loin d’être négligeable, du conjoint
et du ou des enfants, lorsqu’ils existent. Ce
travail individuel pourra rester sur un plan
strictement cognitif, si l’on craint les réac-
tions thérapeutiques négatives. Il pourra, a
contrario, s’enrichir d’une mobilisation
émotionnelle (entre autres l’hypnose) chez
les personnes plus motivées, ou encore
d’un abord psycho-corporel chez les dépri-
més. La partie du travail faite d’investiga-
tion de la dimension intrapsychique va
mettre en évidence les modalités particu-
lières à la personne dans ses relations à ses
imagos. Or celles-ci sont évidemment por-
teuses de comportements acquis et fixés,
car anciens, et il y aura tout intérêt à les
confronter, autant que possible, à la famille
actuelle. Il me paraît particulièrement
important de donner à la consultante des
tâches qui peuvent, le cas échéant, s’effec-
tuer par lettre ou par téléphone, visant à
mobiliser ses relations avec sa famille dans
leurs dimensions actuelles. De cette façon,
on peut associer à distance l’entourage
familial et initier des amorces de change-
ments relationnels, lesquels viendront en
retour “nourrir” le travail psychothérapique
et modifier petit à petit la relation aux ima-
gos. Il s’agit là d’un travail d’autonomisa-
tion et de différenciation de longue haleine,
dont, il faut en être bien conscient, les
retombées pour la personne demeureront
modestes dans la majorité des cas. Comme
toute pathologie de la relation où l’entoura-
ge est très partie prenante et impliqué,
l’anorexie bénéficie des meilleures chances
thérapeutiques en fonction de la précocité
de la demande par rapport à l’émergence
du symptôme. C’est dire si les demandes
tardives, souvent larvées, incitent à la pru-
dence quant à leurs possibilités évolutives.
L’aspect chimiothérapique ne doit pas être
négligé, en prenant bien entendu garde à ne
pas susciter ou entretenir d’addiction.
L’ e xpérience semble montrer que la com-
posante dépressive bénéficie d’un anti-
dépresseur, et ce au long cours, venant sou-
tenir l’effort psychothérapique, puisque ce
type de molécule est souvent bien supporté
et réputé peu addictogène.
Une entité polysymptomatique
spécifique
Que dire en guise de conclusion, sinon qu’il
ne s’agit là que d’un survol des dimensions
clinique, psychopathologique et thérapeu-
tique d’une entité polysymptomatique, que
j’ai avant tout essayé d’éclairer à partir d’une
expérience de secteur, où l’intervention se
situe presque toujours des années après le
début des troubles ? J’ajouterai que ces
pathologies me semblent promises, si j’ose
m’exprimer ainsi, à un bel avenir. En effet, je
ne suis pas entré dans le détail des implica-
tions sociales et culturelles de l’acte de se
nourrir et de la confection des repas, mais il
est bien certain que nous touchons là à
quelque chose d’à la fois intime et universel
pour l’être humain. Inscrit dans des rites, des
règles, des mythes, le fait de se nourrir véhi-
cule une polysémie relationnelle à soi, aux
proches et à la société en général. La modifi-
cation et le bouleversement actuels des
règles, des codes, des rites, dus à l’accéléra-
tion de la transformation des sociétés, l’avè-
nement des modes (la minceur, l’aérobic,
etc.) ne peuvent que tendre à favoriser l’aug-
mentation de ce type de pathologies.
Je terminerai en évoquant la place particu-
lière qu’occupe à mon avis l’anorexie dans
le champ nosologique : celle d’un fonction-
nement de type psychotique sans que l’on
puisse véritablement parler de psychose
avérée, car intéressant le seul registre du
corps tout en épargnant – jusqu’à un certain
point – les processus de la pensée. On peut
la considérer comme une entité spécifique,
au carrefour de la dépression, des troubles
schizoïdes et de la psychosomatique.
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
1
/
4
100%