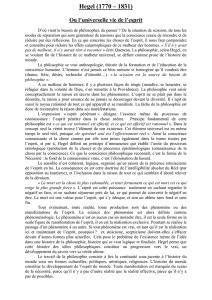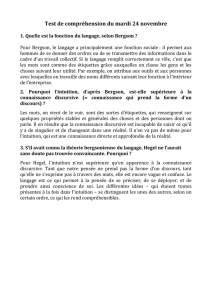pouvoir des mots

«!Le Pouvoir des mots!»
Conférence donnée par Sylvie Birnbaum-Truffet, professeur agrégé de philosophie,
Docteur en philosophie pour FLC le samedi 14 mars 2015
!
Introduction et présentation par Yvonne Cottaz-Palançon et Robert Artis.
***
Ce que parler veut dire … ne pas dire un mot de trop
Les mots créent notre pensée!: pouvoir de création des mots.
Se poser la question du pouvoir des mots, c’est aussi se demander ce que disent les mots.
Référence à la chanson de Souchon/Voulzy (que l’on écoute avant de commencer la
conférence) … Derrière les mots sous les mots, entre les lignes … Ne pas prendre les choses
au pied de la lettre.
L’esprit borné s’attache trop aux mots!: il faut aller au-delà.
En fait, on est toujours dans un geste d’exclusion du mot pour aller «!en dehors!».
Voir ce que le mot dit …
SM nous explique qu’à ses étudiants, elle recommandait toujours d’être soucieux du mot,
car dans le mot il y a l’idée. Un mot, on le tient pour dit.
Le mot, c’est subtil, abstrait, ce n’est pas concret. Pourtant, les mots détiennent un
pouvoir énorme et magique. Ils instituent du sens. Le signe fait sens!: ou alors, il n’est que
bruit chaotique, simple son.
On déplore qu’un élève se contente de répéter la phrase d’un auteur [ Car on craint que la
phrase ne soit vidée pour lui de son sens, réduite à un alignement de phonèmes].
Car le mot a une invisibilité, il doit être déchiffré. Si le sens se tient dans le mot, cette
TENUE, c’est aussi avoir de la RETENUE.
Or, dans notre civilisation pressée, on surfe sur la toile, on juge les mots impuissants à
faire quoi que ce soit.
Le mot - c’est un lieu commun - paraphrase seulement la réalité. Cependant, on attend
autre chose des mots!: on veut des preuves, des actes, un engagement.
Le silence, parfois les actes parlent.
Ils semblent avoir plus de pouvoir que les mots.
Si on creuse trop les mots, on les expurge de leur signification. Les mots sont finalement
des PROMESSES. Ils sont sans AVENIR.
Ce jugement pose la question du «!pourquoi cette maltraitance à l’égard des mots!»!?

On peut l’analyser comme une stratégie de défiance, de défense à l’égard précisément du
pouvoir TERRIFIANT des mots.
On peut dire que les mots sont inoffensifs. Ne s’attacher qu’à leur charme, leur
musicalité, leur sonorité, au plaisir qu’ils procurent. C’est l’attitude des bavards et des
beaux parleurs.
Avant même d’être entendu, le bavard est d’emblée condamné à «!baver!» des mots, et le
beau-parleur, lui, ne fait que parler.
Que font donc les mots en parlant!? Si les mots agacent parfois, particulièrement ceux du
bavard, en fait, ils en disent long sur la détresse du bavard. Le bavard éprouve la solitude
de l’être. Cette solitude inhérente à tout être, la solitude «!ontologique!».
Car le mot tisse des liens là où originellement il n’y en a pas. Le mot sauve l’individu de la
solitude.
Le mot crée l’espace humain de la communication. Les mots nous arrachent à l’absurdité
de l’existence en mettant du sens là où il n’y en a pas.
« Au commencement était le Verbe!» (cf. la Bible)!: on peut même dire qu’au
commencement, se trouve toujours le verbe.
La figure du bavard est donc tragique car il ne cesse de recommencer toujours mais il
échoue à s’inscrire dans le réel, il n’arrive pas à faire des mots un usage QUALITATIF, mais
seulement quantitatif.
Cela met en évidence le pouvoir socialisant, la capacité intersubjective des mots.
Quand on parle de quelque chose à quelqu’un, il faut que l’autre compte.
Rompre le silence, prendre la parole!: c’est s’engager dans le monde de la communication.
Le mot a le pouvoir de réaliser notre condition humaine. Il permet de tisser avec autrui
des liens.
Aristote, dans son livre «!la politique!» - au sens grec «!polis «!de société, socialité - notait
que «!seul l’homme possède la parole!».
En parlant, on s’engage dans l’espace communautaire où l’on a à vivre.
Exemple!: l’enfant.
Vient du latin in- fans. In, privatif, et fans!: du verbe for, fari : parler, dire.
L’enfant est celui qui est privé de parole, qui ne sait pas parler.
[Philosophie hégélienne, pas du tout romantique] L’enfant est narcissique, ne voit que lui,
s’admire, il ne voit pas autrui. L’enfant se considère comme seul au monde, il peut être
comparé à un perroquet dans sa cage.
Ce que l’apprentissage du langage enseigne à l’enfant, c’est de lui permettre de pénétrer
dans le monde symbolique.
Cf la phénoménologie ; Merleau-Ponty dit que «!l’enfant ne parle pas car il n’a pas la
science des points de vue!», ie la capacité d’échange, de partage avec autrui. L’enfant est

un roi despote qui ne partage rien. Et s’il ne partage pas ses idées, c’est simplement parce
qu’il n’en a pas!! [on est toujours dans Hegel]
La parole est un acte rationnel qui s’apprend des autres.
Le pouvoir des mots est DÉMOCRATIQUE, puisqu’il permet l’échange, il constitue la réalité
sociale de partage.
Ainsi se construit par le dialogue un monde «!entre-deux!».
Si l’on considère que c’est l’ensemble des normes et des valeurs qui constitue l’humanité,
la société humaine, le mot y est une preuve de reconnaissance par delà notre solitude
ontologique, par delà nos différences.
Maintenant, si le mot est une idée, pourquoi s’interroger sur son pouvoir!?
Le mot est dévoilant. Toujours Hegel!: «!C’est DANS les mots que nous pensons.
Le mot est la forme aboutie de la pensée. Quand on ne trouve pas ses mots, que l’on
bafouille, est-ce une défaillance linguistique!? Hegel est radical!: il dit en substance!: si tu
n’as pas le mot, tu n’as pas la pensée.
L’idée non verbalisée est vague, elle est [comme si elle flottait dans l’air, dans une sorte
d’espace immatériel entre les êtres humains, j’essaye de traduire en mots le geste de la
main qui volette avec les doigts qui s’agitent…]
[Ce lien du mot issu d’un apprentissage au sein d’une communauté humaine met en
évidence que] le mot est un héritage.
Même si on invente des mots, après, on les transmet. L’idée est une intuition, un feeling,
mais le mot, lui, instaure la pensée à son niveau le plus noble qui est celui de sa
consécration.
En parlant, j’expose ma pensée.
Hegel renverse le rapport des mots et de la pensée. [Le mot n’est jamais défaillant!:] c’est
la pensée qui n’est pas assez déterminée pour être dite par les mots justes.
Appel aux auditeurs pour rappeler la citation de Boileau!: «!ce qui se pense bien s’énonce
clairement!».
Evidemment, le mot est un élément du langage.
Exemple!: la peur de page blanche (ou de la toile blanche pour un peintre).
Il y a dans cette peur le fait qu’on reconnait que le mot est épiphanique de soi-même.
Quand on ne trouve pas les mots, cela peut relever de plusieurs causes!: soit on n’a rien à
dire, soit on ne sait pas quoi dire, et cela rejoint le fait [angoissant] qu’on n’est rien.
Le mot ne nous confronte pas à un médium, bien qu’il puisse être assimilé, en apparence,
à un outil!: le mot, c’est moi.
Les mots sont révélateurs de ce qu’on est.

Au lieu d’avouer un manque de pensée, on accuse le mot d’être incapable d’exprimer la
pensée. Le mot est accusé d’être en-dessous de sa pensée. «!Ce n’est pas ce que je voulais
dire!»… Oui, mais, en attendant, le mot a été dit, et il a été réceptionné.
[D’où l’on voit bien que] parler est une prise de risque.
On peut mal dire, ou bien être de mauvaise foi!: il n’en reste pas moins que les mots font
accéder notre pensée à une vérité publique.
L’esprit ne se trouve pas derrière la lettre, ou au-dessus, ou en-dessous, à côté, etc!:
l’esprit est dans la lettre.
[Peut-on se retrancher derrière les concepts ] l’éloge de l’ineffable, de l’indicible!? –
plutôt que de dire qu’on n’a rien à dire!?
A la pensée, [on peut opposer] la non-pensée, la pensée non-pertinente, la pensée folle,
ou mesquine…
Reste que le mot est un entre-deux dans lequel on veut vivre!: les mots ne sont pas
seulement redondants d’une réalité qui est déjà là…
Autre exemple!:
Quand je dis «!je t’aime!», j’emprunte au dictionnaire, mais surtout, j’instaure une
relation.
On peut argumenter, dire que la situation était là avant, les protagonistes, les sentiments.
Qu’est-ce que le «!je t’aime!» change donc à la situation!? Car la situation a changé, avant
et après le «!je t’aime!»!: l’amour est DÉCLARÉ
C’est une déclaration en droit d’une situation officielle, officialisée. C’est un engagement
à caractère officiel.
On ne découvre pas tout-à-coup qu’on aime quelqu’un quand on lui dit «!je t’aime!»!: on
place cet amour dans un autre registre, celui de l’officiel.
Le mot fait basculer dans un nouveau monde. «!C’est dit!».
Il est difficile d’assumer ses mots. L’importance du mot est la mienne. «!Je suis tout entier
dans ce que je dis!». «!Je suis ce que je dis!».
Il y a un caractère exhibitionniste du langage, car on s’expose au jugement de l’autre.
Si le mot engage, c’est que le mot agit.
Une dernière figure du mot!: «!le porte-parole!».
Le porte-parole est investi du pouvoir de parler au nom de – une personne, un groupe -
Bourdieu!: «!le mot dit, et l’action se fait pendant qu’il dit. Chaque mot est un mot
d’ordre.
Cf les appels à la grève, à la manif, …
Où l’on accède au pouvoir performatif des mots.

Austin, linguiste, a étudié par exemple ce qui se dit dans les tribunaux. «!Je jure!», «!je
promets!», «!je vous condamne!»…
Il s’agit d’énoncés performatifs et non descriptifs.
Le mot ne doit rien au locuteur. Il a un pouvoir intrinsèque, indépendant du locuteur et de
l’interlocuteur. Le mot devient un acte, il soumet à l’obéissance.
«!Prendre la parole!»!: c’est faire acte d’autorité. En prenant la parole devant un
auditoire, il y a une forme de récupération de la force collective. En prenant la parole… on
réduit les autres au silence!!
Bourdieu!: le mot s’impose légalement.
On me donne la parole, je la prends.
Sylvie Truffet!ajoute «!je parle ici en tant que professeur de philo, en parlant en tant que
professeur de philo, je parle en mon nom, au nom de la fonction que j’ai choisie!».
Il faut savoir être soi à travers les mots.
Mais il faut aussi s’avoir s’arrêter!! Place donc aux questions et au débat.
Questions.
1 «!Je ne dis rien, mais ça ne m’empêche pourtant pas de penser!!!»
Quelques éléments de réponse
-on pense avec des mots.
-pb non abordés par Mme Truffet, car ne relèvent pas de ses compétences, les pb
pathologiques. Timidité, autisme.
-Bergson, lui, ne va pas dans le sens de Hegel. Il trouve que la pensée est
incommensurable avec le langage. Se réfère à cette situation commune où l’on a des
idées, mais on a l’impression qu’on va dégrader, escamoter sa pensée en la disant.
2 Quid de la poésie!? Michel Onfray qui cite René Char à l’émission de télé La
grande Librairie!: «!La lucidité est la blessure la plus proche du soleil!»
Eléments de réponse!:
«!Poesis" signifie précisément en grec «!faire!». La poésie, les livres, ouvrent l’entrée dans
un nouveau monde. Dans le système des beaux arts, la poésie est au 5ème degré, car le plus
proche de l’esprit.
L’homme est jeté dans un monde où sens et mots se donnent en échange permanent.
Wittgenstein!: la signification est dans l’usage. Le sens est dans l’usage. D’où l’apparition
de nouveaux mots car nouvelles pratiques.
On dit bien «!jouer sur les mots!», ça consiste en fait à travailler sur les idées.
3 Que les mots véhiculent des sens, ok, mais que tout sens soit véhiculé par les
mots, c’est moins clair. Exemple du code des lois, qui, par leur inadéquation aux faits
 6
6
 7
7
1
/
7
100%

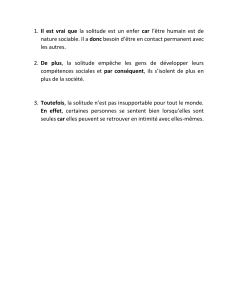
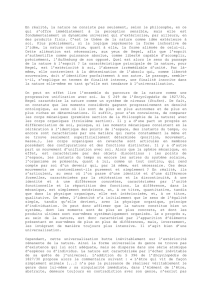

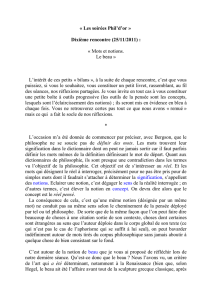
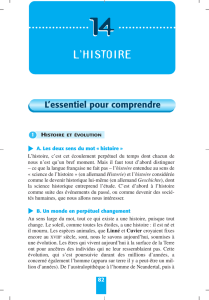
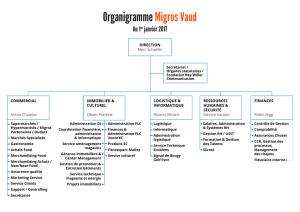
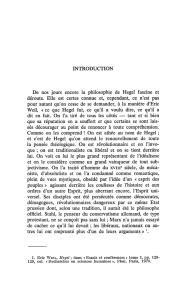
![Hegel « Le 14 Novembre [1831] mourut à Berlin le célèbre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001023432_1-a9b6716e401d92cc3aee9aa9973a15fa-300x300.png)