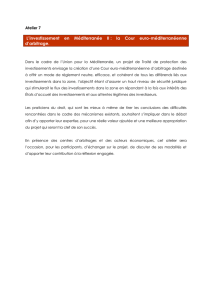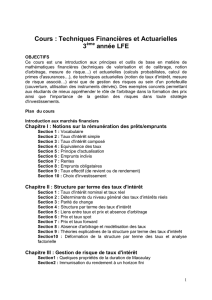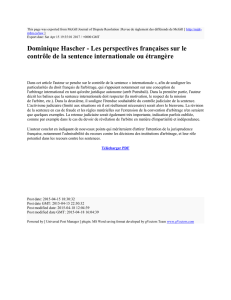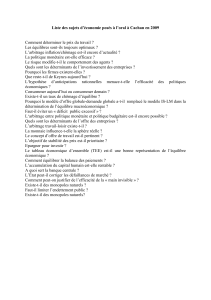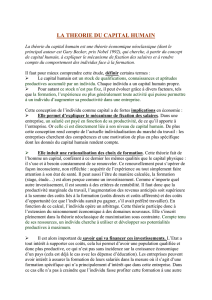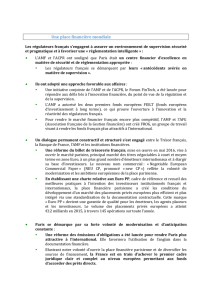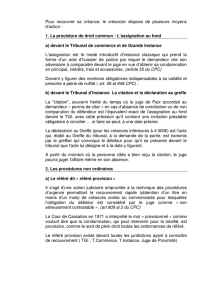LA NAISSANCE D`UN NOUVEAU DROIT DE L`ARBITRAGE EN

Ohadata D-08-42
[Revue camerounaise de l’arbitrage - Numéro Spécial – Octobre 2001 – p. 52]
DEBATS SUR LE THEME :
LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU DROIT DE L’ARBITRAGE
EN AFRIQUE REPRESENTE-T-ELLE DES OPPORTUNITES
DE DEVELOPPEMENT ?
Animés par :
Monsieur Thierry LAURIOL
Président de la Commission Afrique du Barreau de Paris
Avec la participation de
Monsieur Philippe BOTHA
Avocat au Barreau d’Afrique du Sud
Monsieur Karim DIABY
Avocat au Barreau de Guinée
Monsieur Amadou DIENG
Secrétaire du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Dakar
Monsieur Philippe FOUCHARD
Professeur à l’Université de Panthéon-Assas (Paris II)
Monsieur le Professeur Joseph ISSA-SAYEGH
Professeur aux Universités de Nice Sophia-Antipolis et Abidjan
Monsieur Gaston KENFACK-DOUAJNI Magistrat, membre de la Cour Internationale
d'Arbitrage de la CCI
Monsieur Jacques M’BOSSO
Premier vice-Président de la CCJA
Monsieur Mamadou SAVADOGO

Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso
Monsieur Mario STASI
Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris

Mot introductif
Par
Francis TEITGEN
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Paris
[Revue camerounaise de l’arbitrage - Numéro Spécial – Octobre 2001 – p. 53]
Messieurs les Bâtonniers, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers Confrères, chers
amis :
Imaginez un instant, comme il est compliqué d’être Bâtonnier de Paris ! Un discours
d’accueil doit évidemment être à la fois un discours, accueillir, et peut-être également dire
deux ou trois choses intelligentes sur le thème de l’événement. Mais dès lors que l’on regarde
le programme de cette journée, dès lors que l’on analyse la qualité de ceux qui vont intervenir,
on se sent nécessairement extraordinairement léger. Tout d’abord, rappeler que je suis
particulièrement heureux que ce soit le Barreau de Paris qui accueille ce colloque. Cela
démontre une chose, ancienne, connue, vitale, essentielle pour chacun de nous, c’est
l’authenticité des liens qui unissent l’Afrique et le Barreau de Paris. La chose a été souvent
dite et Mario Stasi est là, donc cela suffit pour que je n’insiste pas sur ce sujet.
Je voudrais néanmoins insister sur la constance des relations entre les barreaux africains
et le Barreau de Paris s’agissant de la question de l’OHADA C’est-à-dire cette idée qui
consiste à cesser les grands-messes, pour simplement travailler ensemble en nous apportant
mutuellement notre appréhension des choses, nos compétences, nos capacités d’analyse bref,
en nous enrichissant mutuellement. Et je préfère infiniment voir des avocats, des
universitaires, des magistrats qui travaillent ensemble plutôt que ces réunions qui font
essentiellement plaisir à ceux qui les animent, parfois à ceux qui les écoutent, mais qui dans le
fond n’apportent pas la valeur espérée. Comme je vous le disais à l’instant, je vais vous
préciser ce que je crois être l’OHADA. Je ne suis évidemment pas un spécialiste en la
matière, mais je réfléchis et travaille de temps en temps sur ce sujet. Ainsi, à mes yeux,
l’OHADA a de très nombreuses qualités et quelques défauts. Nous savons sans doute gérer
les défauts et nous restons très admiratifs sur les qualités.
Le traité de l’OHADA, c’est d’abord un traité structurant d’un point de vue politique.
Pour ceux qui connaissent bien l’Afrique, ce n’est pas exactement rien. Il s’agit également
d’un instrument juridique qui, pour une fois, au lieu d’affirmer des souverainetés internes
jalousement conservées, affirme d’abord les solidarités très fortes à l’intérieur de l’Afrique et
dans les relations entre les pays concernés et l’extérieur, ce qui n’est pas rien non plus. C’est
donc une construction juridique qui a d’abord pour vocation, de rassembler ce continent.
Pour tous ceux qui veulent bien l’observer, cet apport-là des juristes est un apport tout à
fait fondamental. Or, il est un peu éloigné des données idéologiques réelles ou supposées. On
a ainsi pu rompre avec un certain nombre de pratiques qui étaient très profondément

dévastatrices, pour créer enfin un instrument qui se révèle être une source d’unité et
d’intelligence.
L’OHADA, c’est juridiquement structurant, à une époque de développement de cette
planète où, en effet, nous avons tous besoin de structuration régionale.
Je crois enfin qu’est permise la création d’un vrai rapport égalitaire. Sur ces rapports
égalitaires nous avons, nous qui avons peut-être une pratique plus ancienne du commerce
interrégional et du commerce international, de l’arbitrage, des tas de leçons à apprendre.
L’OHADA, un extraordinaire pari, celui « qui consiste à dire : fabriquons une structuration
juridique sans doute imparfaite, mais fabriquons-la ». Vous l’eussiez espérée parfaite qu’elle
n’aurait jamais vu le jour, vous avez donc gagné le défi. Nous avons sur ce sujet-là, des leçons
à apprendre. Si je compare aujourd’hui la pénibilité de l’avancée de la structuration
européenne par rapport à l’incroyable défi de l’OHADA, je me dis que vous avez gagné et
que nous sommes en train de perdre. Et vous gagnerez aussi parce que, ensemble, nous avons
suffisamment d’humilité réciproque pour comprendre les imperfections de ce système et pour
pouvoir en parler ensemble. C’est peut-être le but de cette journée. Le défi politique et
continental que vous avez relevé avec un incroyable courage et avec une certaine audace,
vous le gagnerez parce que je crois qu’ensemble, en échangeant nos expériences, avec ce sens
de l’humilité réciproque, nous pouvons le relever. C’est extraordinairement intéressant.
Et enfin, pourquoi ne pas le dire, l’OHADA, c’est la sécurité juridique, la prévisibilité,
la discussion intercontinentale sur des normes qui se ressemblent avec des méthodes
d’analyse qui sont fondamentalement les mêmes. C’est donc enfin, d’une certaine manière, le
couronnement des travaux de tout ce qui unissait les juristes francophones à travers les
continents. Je dis enfin, qu’un tout petit peu au-delà de ce qu’étaient nos souhaits amicaux,
nos souhaits de solidarité, nos souhaits de pacifier un peu le monde et de participer à la
régulation sociale, nous avons ici et maintenant, heureusement, un sujet de discussion
technique et de progrès par le droit qui doit vous mobiliser très fortement.
Je suis de plus en plus convaincu que le XXI
e
siècle sera celui du droit et que nous
avons nous, juristes, un défi extraordinaire à relever, qui est à la fois le défi de notre rôle dans
la société, de la place que nous y prendrons, mais aussi probablement le défi que nous aurons
par l’utilisation de notre culture de juriste, de notre militantisme technique, un défi qui sera un
défi de régulation sociale. Si nous échouons sur ce défi du XXI
e
siècle, nous aurons, à l’égard
de tous ceux qui vivent sur notre planète, une responsabilité absolument considérable. Alors
je crois qu’il faut que l’on soit tous conscients de ce rôle qui est le nôtre : nous sommes des
fabricants de sociétés, nous sommes des fabricants de paix sociale, nous sommes des
fabricants de paix intercontinentale. Après tout, ce n’est pas plus mal que d’être simplement
des “moneymakers”.
Je crois que l’on doit absolument tous être habités par cette idée-là. En tous cas, moi
c’est l’idée qui, à l’aube de ce siècle et de ce millénaire, m’intéresse le plus. C’est pour cela
que ce discours peut vous paraître un peu « comme ça », oui, je vais vous le dire, c’est un
discours dans lequel je voudrais que l’on arrive ensemble à être fiers de ce que l’on fait, moi
je suis fier que le Barreau de Paris soit le Barreau d’accueil, je suis extrêmement fier que vous
soyez là, que vous attendiez et que nous attendions ensemble cette journée pour nous
mobiliser aussi fortement. Je suis fier qu’il y ait tellement d’intelligences réunies au même
moment, au même endroit, sur un sujet aussi déterminant. Je suis extrêmement fier que nous
arrivions à partager, comme juristes de différents continents et d’une culture essentiellement
identique, cet objectif-là qui est d’améliorer un tout petit peu les choses à la place qui est la

nôtre. Alors, merci d’aider ma fierté à s’exprimer comme ça, avec, vous vous en rendez bien
compte, une vraie amitié et une vraie simplicité. Oui, je suis fier de ce Barreau, oui, je suis
fier que l’on soit juristes, et oui, je suis fier que l’on essaye ensemble de construire un monde
qui soit un peu meilleur.
Merci à tous d’être ici.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%