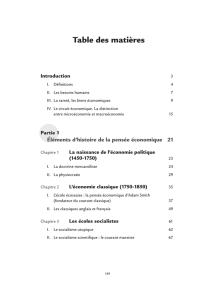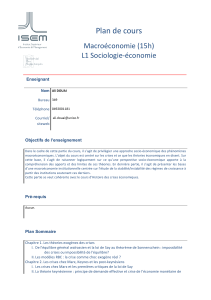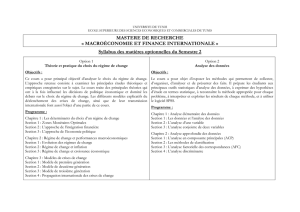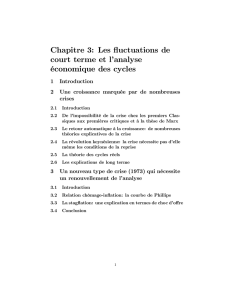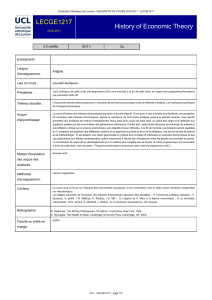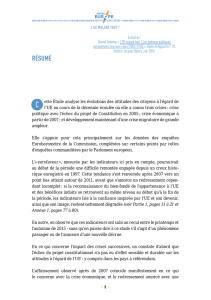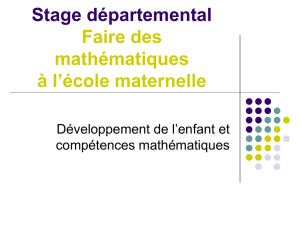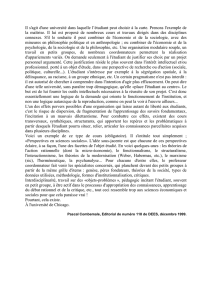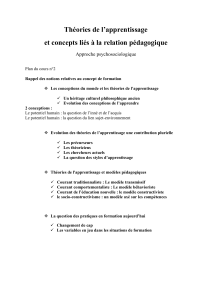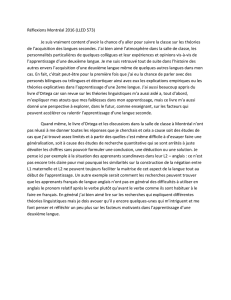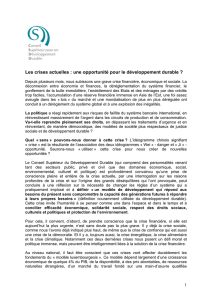les théories économiques et la crise de 1973

83
Vingtième Sièc
l
e. Revue
d’h
istoire, 8
4
,
octobre-décembre 2004, p. 83-92.
LES THÉORIES ÉCONOMIQUES
ET LA CRISE DE 1973
Lucette Le Van Lemesle
Depuis le 18
e
siècle, les économistes ont
cherché à comprendre les crises, pour
mieux prévenir leur réédition. Par-delà
l’originalité des théories qui s’efforcèrent
d’expliquer le bouleversement induit par le
choc pétrolier de 1973, force est, une fois
encore, de revenir à l’histoire pour saisir
l’importance des substrats qui nourrirent la
réflexion des économistes et des historiens
confrontés à un phénomène dont les consé-
quences se font, aujourd’hui encore, res-
sentir.
n attend souvent des écono-
mistes, que tel un bon médecin,
ils soient capables de fournir les
remèdes prêts à guérir ces maladies socio-
économiques que le 20
e
siècle a dénoncées
sous le nom de crise. La réalité est moins
simple et de façon générale, c’est souvent
après l’échec des remèdes jusqu’alors effi-
caces, que lentement s’élabore une typo-
logie d’interventions, parfois contradic-
toires, mais peu à peu expérimentées
jusqu’à ce que des résultats soient jugés
suffisants.
L’arsenal anti-crise n’est pourtant jamais
dépourvu d’armes. Les grandes théories
explicatives existent parfois depuis plus
d’un siècle, offrant des conseils conjonctu-
rels qu’elles justifient. Nous examinerons
d’abord ces héritages théoriques, toujours
revendiqués, puis les mutations marquant
les remèdes proposés face aux grandes
ruptures économiques, avant d’évoquer les
tâtonnements (mot cher aux économistes
néoclassiques mais employé ici dans son
sens littéral) qui président à la découverte
de solutions qu’on espère enfin efficaces.
HÉRITAGES HISTORIQUES
Depuis le 19
e
siècle, la récurrence des
crises économiques a suscité des réflexions
contradictoires. Dès le milieu du siècle
elles ne paraissent plus liées à la seule pé-
nurie des subsistances, aux conséquences
des mauvaises récoltes de céréales. Elles
naissent désormais dans le secteur des
échanges et de leurs outils : monnaie, cré-
dit, bourse. Répétées et quasiment pério-
diques, ces crises commerciales, parce
qu’elles marquent essentiellement la sphère
de la circulation, intéressent et inquiètent
particulièrement les économistes libéraux,
fervents partisans de la liberté des échanges.
Sont-elles caractéristiques du progrès éco-
nomique ? Leur périodicité dans un cycle
court d’une dizaine d’années ne contribue-
t-elle pas à assainir le monde de l’éco-
nomie en éliminant, par un darwinisme
qu’il faut accepter, les entreprises inadap-
tées, les « canards boiteux
1
» ? Dans cette
optique, elles corrigeraient les surproduc-
tions relatives des cycles intra-décennaux.
Ces recherches conjoncturelles s’inscri-
vent sur un fonds, celui des grandes théo-
ries de l’École classique puis de leur
contestation qui ont accompagné la pre-
mière révolution industrielle en Grande-
Bretagne et en France.
Outre la description des mécanismes de
fonctionnement du monde économique,
Ricardo et Malthus ont présenté, au début
du 19
e
siècle, des analyses centrées sur une
représentation des classes sociales en pré-
1. Clément Juglar,
Des crises commerciale et de leur retour
périodique en France, en Angleterre et aux États-Unis
, Paris,
Guillaumin, 1862.
O
VS84-83-92 Page 83 Mardi, 25. octobre 2005 1:34 13

Lucette Le Van Lemesle
84
sence. Pour Ricardo, à l’occasion du pro-
cessus normal de production des surplus
(ce qui dépasse le nécessaire pour sur-
vivre), trois groupes sociaux sont en
présence : les capitalistes, les propriétaires
fonciers et les travailleurs salariés produc-
tifs. Des rapports de force se nouent alors
entre eux dans le mécanisme de produc-
tion et la répartition de ce surplus. Les ca-
pitalistes détiennent les machines nou-
velles, les propriétaires possèdent la terre.
Les travailleurs salariés quant à eux, ser-
vent à produire et sont dominés. Légitime,
la recherche du profit aboutit cependant à
une accumulation du capital qui favorise
les détenteurs de machines plus que les
propriétaires fonciers. Malgré ces intérêts
contradictoires en matière de répartition,
les crises ne sont que des accidents : en
effet l’équilibre est naturel, puisque, pour
Ricardo, la production crée sa demande.
Plus sensible aux intérêts des propriétaires
fonciers, Malthus raisonne différemment
en soulignant que l’équilibre n’est plus
automatique. Une régulation reste toute-
fois possible grâce au contrôle de la nata-
lité.
Une trentaine d’années plus tard, Marx
dont la pensée est nourrie par les clas-
siques, s’en différencie sur deux points
essentiels : d’une part il se place du point
de vue des dominés, et d’autre part il intro-
duit l’histoire et de ce fait relativise le
mode de fonctionnement du monde éco-
nomique. Le système de production capita-
liste n’est qu’un système de fonctionne-
ment économique, qui succède – mais
peut précéder – d’autres systèmes pos-
sibles. Daté, l’ordre actuel peut et doit être
dépassé. Lors du procès de production il
prélève en effet sur les travailleurs salariés
productifs une partie de la valeur qu’ils ont
été seuls à créer, la plus-value, et ce sans la
rémunérer, au profit exclusif de ceux qui
détiennent les capitaux. Dans un tel sys-
tème économique, caractérisé par le rap-
port salarial, jamais le salaire ne paie la
valeur du travail produit. L’antagonisme est
donc inévitable. Des crises sectorielles
peuvent donc se produire quand la concur-
rence s’approfondit entre deux fractions
du capital. Une crise globale, surtout, se
profile quand les forces de production
appelées à se développer entrent en contra-
diction avec le rapport salarial. La produc-
tion ne peut plus être absorbée, achetée par
un monde salarial qui s’appauvrit. Les inté-
rêts sont toujours contradictoires, puisque
même les innovations sont triées, choisies
exclusivement en fonction des besoins sol-
vables. Une crise générale du système est
donc normale et prévisible. Son issue dé-
pendra non des seules relations écono-
miques, mais du rapport de force politique
des adversaires sociaux en présence.
Face à ces visions du monde accompa-
gnant la première révolution industrielle se
produit une rupture au début des années
1870. En Grande-Bretagne avec Stanley Je-
vons, en Autriche avec Karl Menger et en
France avec Léon Walras, trois publications
indépendantes
1
mais concomitantes fon-
dent une tout autre représentation du
monde de l’économie, intitulée, de façon
discutable d’ailleurs, l’École néo-classique.
Plus éloigné du concret, ce nouvel
ensemble doctrinal rompt avec l’approche
en terme de groupes sociaux antagonistes
et s’efforce de construire un schéma abs-
trait du fonctionnement théorique de l’éco-
nomie. Même si leur démarche est diffé-
rente, ces trois œuvres convergent pour
proposer une vision fonctionnaliste des ac-
teurs sociaux. Les détenteurs de capital
fournissent les services du capital, les dé-
tenteurs de terre celui du service de la
terre, les travailleurs productifs celui des
services du travail. Ce schéma abstrait
exclut ainsi les contradictions d’intérêts. La
société se résume à un système d’échange
qui, toujours théoriquement, fonctionne
sur la base d’une concurrence pure et par-
faite et dans ces conditions parvient né-
1. William Stanley Jevons,
The Theory of Political Eco-
nomy
, London, Macmillan, 1871 ; Carl Menger,
Grundsätze
der Volkswirthschafslehre, Vienne, Wilhelm Braumüller
,
1874, et Léon Walras,
Éléments d’économie politique pure
,
1874 et 1877, Lausanne, Corbaz.
VS84-83-92 Page 84 Mardi, 25. octobre 2005 1:34 13

Les théories économiques et la crise de 1973
85
cessairement à l’équilibre. Pour que ce sys-
tème soit efficace, il faut et il suffit que
chaque « agent économique », quelle que
soit sa place dans la société, recherche lu-
cidement son véritable intérêt et soit par-
faitement informé des conditions réelles
du marché qui lui permettent de l’obtenir.
L’homo économicus, rationnel et conscient
de son intérêt, capable d’obtenir une satis-
faction maximale au moindre coût, était
né. De façon plus générale, les agents éco-
nomiques sans influence mutuelle, se ren-
contrent sur le marché et, par le jeu de
l’offre et de la demande, produisent,
comme face à un commissaire priseur, un
système de prix d’équilibre. Globalement
l’offre et la demande s’équilibrent et pro-
voquent la meilleure utilisation des res-
sources, ce qui réalise ainsi l’équilibre gé-
néral, que le Français Walras surtout
s’efforce de mathématiser. Dans cette lo-
gique, l’équilibre général est naturel, à
condition, bien sûr, que l’information soit
complète, qu’il n’y ait pas de rapport de
forces entre les acteurs, et que l’État s’abs-
tienne d’intervenir intempestivement. La
somme des intérêts individuels aboutit et à
l’équilibre global, et à l’intérêt général. Une
économie de marché, dans un contexte de
concurrence parfaite, ignore par consé-
quent les crises.
Soulignons qu’à cette même époque,
l’économie politique en France est perçue
comme le support ou la justification des
politiques économiques. À de rares excep-
tions près, les économistes militent pour le
libre-échange. Longtemps refoulés des ins-
titutions publiques à prétention acadé-
mique ou réfugiés dans des positions mar-
ginales, ils n’obtiennent qu’à partir du
décret de 1877, une place de discipline
obligatoire dans les facultés de droit, qui
forment encore la majorité du personnel
politique et de la haute administration. On
comprend alors que l’économie pure de
Walras ait été rejetée. D’autant plus abs-
traite qu’elle se présente sous la forme
mathématique d’un jeu de fonctions et
de dérivées, elle n’offre même pas aux
contemporains le mérite de justifier le libre
échange. Sur le plan de l’économie appli-
quée, Walras n’envisage-t-il d’ailleurs pas
la nécessité de nationaliser les terres ? En
revanche, les hommes qui veulent inter-
venir dans le contexte de longue dé-
pression la perçoivent comme une apo-
logie sans nuance du simple jeu de l’offre
et de la demande. Walras sera ainsi évincé
du système d’enseignement français, n’ob-
tenant une chaire qu’à Lausanne. Son ex-
clusion découle ainsi de ce double refus.
Les libéraux récusent l’économie appli-
quée de Walras et les protectionnistes s’op-
posent à son schéma théorique.
En offrant une véritable place à l’éco-
nomie politique – discipline jusqu’alors
peu reconnue – les facultés de droit orga-
nisent une formation spécifique. Pour re-
cruter les nouveaux professeurs d’éco-
nomie dans les facultés de droit, une
agrégation d’économie politique est insti-
tuée en 1896. Les nouveaux agrégés (de
deux à cinq tous les deux ans), acceptent
de collaborer avec leurs collègues juristes à
la grande œuvre réformiste et républicaine
de rénovation du droit
1
. La création de
bonnes lois doit permettre à la société fran-
çaise d’affronter les conséquences sociales
et politiques du retournement de conjonc-
ture : la longue dépression s’achève et une
augmentation des prix accompagne la re-
prise et les débuts de la deuxième révolu-
tion industrielle.
De la fin du 19
e
siècle à la crise de 1929,
on admet désormais que de graves crises
de surproduction peuvent se produire,
contrairement à ce qu’affirment, de façon
bien optimiste, certains libéraux. La reprise
de la croissance qui accompagne l’œuvre
de rénovation républicaine suscite des
recherches neuves. Dès 1909, le jeune
agrégé d’économie politique Albert Afta-
lion étudie, statistiques à l’appui, l’opposi-
tion entre le temps nécessaire à la produc-
tion des biens de production – ceux qui
1. André Topalov,
La nébuleuse réformiste
, Paris, École
des hautes études, 2000.
VS84-83-92 Page 85 Mardi, 25. octobre 2005 1:34 13

Lucette Le Van Lemesle
86
servent à produire outillage et machines –
et le temps beaucoup plus court de la pro-
duction des biens de consommation
1
.
Quand la demande fluctue, les temps de
réaction de ces deux secteurs varient de
façon telle qu’ils expliquent une partie des
crises de surproduction, parfois accompa-
gnées de surinvestissement. Un autre jeune
économiste, Jean Lescure, avant même de
passer l’agrégation d’économie politique,
propose dès 1906 une thèse (suivie de
nombreuses rééditions et mises à jour) sur
« Les crises générales et périodiques de
surproduction
2
». Il situe pour sa part la
source des crises dans la sphère du profit.
D’autres noms pourraient également être
cités – Charles Rist ou Gaêtan. Pirou par
exemple. À l’abri des facultés de droit, une
autre méthode d’analyse des crises s’éla-
bore, en associant l’histoire et la statistique.
Les résultats visent à trouver des solutions
concrètes aux problèmes réels. Émerge
une génération de nouveaux « intellec-
tuels » républicains. Pour la plupart jeunes
professeurs issus de la nouvelle agrégation
d’économie politique, ils reconnaissent
avoir été marqués par l’Affaire Dreyfus.
Après la guerre de 1914-1918 et durant les
années 1920, ces travaux commencent à
leur valoir une reconnaissance sociale qui
dépasse les limites de l’Université. Les di-
verses théories des cycles longs, qui indui-
sent l’idée de crises révélatrices du passage
de la croissance lente au ralentissement ou
l’inverse, complètent ces travaux
3
. D’une
part la crise correspond à un retournement
des courbes de croissance ou de dé-
pression. D’autre part elle se manifeste par
des diminutions de production, des
hausses ou des baisses brutales de prix,
des faillites, du chômage, des difficultés
dans le domaine du crédit.
À la fin des années 1920, on dispose
donc, sur les crises, à la fois de théories
globales et d’études concrètes. Le concept
de crise existe et on sait utiliser des outils
statistiques permettant d’en mesurer cer-
taines manifestations.
À NOUVELLE CRISE, NOUVELLES THÉORIES ?
Pourtant la grande dépression des
années 1930 va, dans une large mesure,
mettre en accusation cet héritage, dès lors
que les remèdes proposés se révèlent inef-
ficaces. Il est vrai que quelles que soient
ses interprétations, cette crise ne se carac-
térise plus seulement par ses symptômes.
« Par son ampleur sans égale, par l’impor-
tance de ses effets immédiats – chômage
massif, effondrement de la production et
des prix dans les principaux pays occiden-
taux – et de ses effets indirects à moyen
terme – le nazisme et la seconde guerre
mondiale –, la grande crise de 1929 et la
grande dépression de près de dix ans qui
la suit font problème tant du point de vue
de leur statut théorique que de l’explica-
tion que l’on peut tenter d’y apporter
4
. »
La victoire de la théorie keynésienne ap-
paraît après coup comme une évidence.
Mais les débats ont, en réalité, été violents.
Chaque famille de pensée économique a
tenté d’imposer ses interprétations.
Pour les marxistes, il s’agit non d’une
simple crise de surproduction, mais d’une
crise normale issue de la contradiction
entre les forces de production et l’état des
relations sociales. La puissante capacité de
production moderne contraste avec les
faibles capacités de consommation dans la
mesure où les revenus du travail sont
restés modestes durant la phase de recons-
truction. L’existence de l’URSS où la
conjoncture économique, telle qu’on la
perçoit, semble très différente, confirme,
du moins en apparence, que cette crise
« inéluctable » révèle les contradictions
1. Albert Aftalion, « La réalité des crises de surproduction
générales »,
Revue d‘économie politique
, 1909 et « Les trois
notions de productivité et les revenus »,
Revue d’économie
politique
, 1911.
2. Jean Lescure,
Des crises générales et périodiques de sur-
production,
Paris, Domat-Montchrétien, 1906. 5
e
édition en
1938.
3. Simiand et Kondratiev. Schumpeter.
4. Bernard Rozier,
Les théories des crises économiques
,
Paris, La Découverte, 1988, 1991, 1993, 2000.
VS84-83-92 Page 86 Mardi, 25. octobre 2005 1:34 13

Les théories économiques et la crise de 1973
87
spécifiques du capitalisme et annonce sa
fin.
Pour les théoriciens des cycles longs, la
crise annonce un retournement normal de
conjoncture après la lente croissance ébau-
chée à partie de 1896. Un cycle court et un
cycle long se superposent et les nécessités
de la reconstruction amplifient leur effet.
Les théoriciens néo-classiques ortho-
doxes (Lionel Robbins ou Jacques Rueff)
analysent le phénomène comme une crise
classique, plus forte parce qu’elle suit la
période de rattrapage qui succède à la
grande guerre. Mais si les mécanismes
d’ajustement de l’offre et de la demande ne
peuvent plus jouer, et empêcher la crise,
c’est surtout à cause de la force des mou-
vements ouvriers et des syndicats. En par-
venant à empêcher la baisse des salaires,
ils ont provoqué « une rigidité des taux de
salaires à la baisse ». En fait à condition de
rétablir les équilibres budgétaires, de li-
bérer les marchés et de laisser baisser les
salaires jusqu’au point où les détenteurs de
capitaux auront intérêt à réembaucher, la
crise ne peut être qu’assainissante et la re-
prise s’effectuera d’elle-même.
En fait, on le sait ex post, les politiques
d’équilibre budgétaire des années 1930 ont
accentué la déflation. La reprise ne s’opère
pas et la crise, loin d’assainir la vie écono-
mique, s’approfondit. Ses conséquences
politiques, bien connues (fascismes, crises
des démocraties, seconde guerre mon-
diale) débordent notre sujet et ne seront
pas traitées.
Si les solutions keynésiennes nous sem-
blent familières, voire évidentes, force est
cependant de souligner le temps, ou plutôt
les temps longs nécessaires à leur accepta-
tion. De l’expérience du New Deal aux
États-Unis à la politique économique qui a
suivi la Libération en France, le chemine-
ment de cette théorie n’a pas eu pour les
contemporains l’évidence qu’elle a eue en-
suite. En France, tout particulièrement,
Keynes est moins perçu comme le profes-
seur de Cambridge, expert reconnu que
comme l’homme qui après 1918 avait dé-
noncé le leurre et les dangers des répara-
tions. Il est ainsi plutôt perçu comme un
polémiste anti-français. Parue en 1936, la
Théorie générale
n’est traduite en français
qu’en 1941 et connaît jusqu’en 1945 une
diffusion très restreinte. Par ailleurs, après
un léger recul à la fin du 19
e
siècle, les li-
béraux comme le professeur Germain-
Martin reconquièrent des positions de pou-
voir dans l’Université comme dans la vie
publique. Plusieurs fois ministre, Germain-
Martin devient l’incarnation de la politique
de déflation. Il espère que la baisse des
charges comme celle des prix « libérera les
entreprises » et relancera le marché.
Or, la première originalité de la théorie
keynésienne, consiste à refuser l’idée que
les équilibres économiques se rétablissent
d’eux-mêmes, ou grâce aux seules théra-
peutiques libérales. Keynes ne méconnaît
pourtant ni la nécessité de l’accumulation
du capital, ni celle de la reconstitution des
profits. Il propose une politique d’incita-
tion par l’État, qui à terme restaure la pos-
sibilité réelle d’acheter les biens produits,
donc la demande effective. En finançant de
grands travaux, au prix de déficits budgé-
taires, l’État fournit des capitaux pour la
production et distribue des salaires re-
créant ainsi du pouvoir d’achat. Il s’agit
d’abord de « relancer » la machine écono-
mique
1
. Cette relance, très annoncée, mé-
diatisée, table également sur les anticipa-
tions des acteurs économiques. L’équilibre
entre l’offre et la demande n’est possible
qu’à condition que la production de masse
soit absorbée par une consommation de
masse. L’intervention de l’État doit ainsi fa-
voriser tant cette consommation que cette
production. C’est cette relation nouvelle
qui a pris, après les études de Gramsci, le
nom de fordisme social. La protection des
salaires permet d’absorber la production et
de reconstituer le capital. C’est cet en-
semble d’interventions de l’État sur plu-
sieurs secteurs associés qui permet une ré-
1. John Maynard Keynes,
Théorie générale, de l’emploi et
de la monnaie
, London, Macmillan, 1936.
VS84-83-92 Page 87 Mardi, 25. octobre 2005 1:34 13
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%