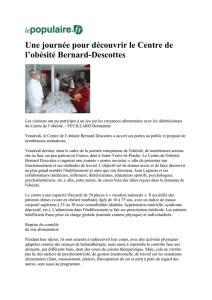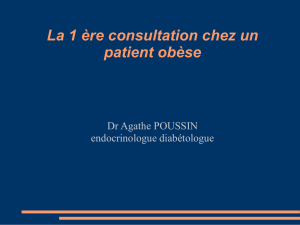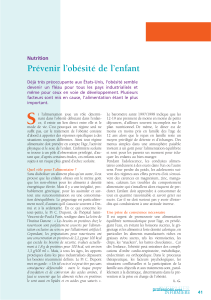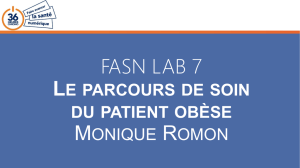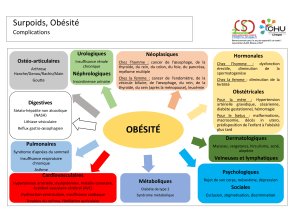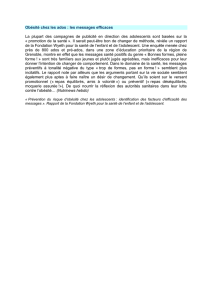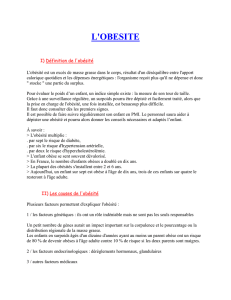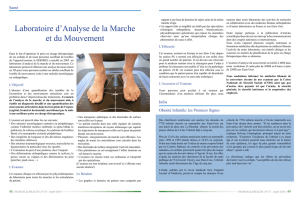Morbi-mortalité associée à l`obésité

MÉTABOLISME
La Lettre du Cardiologue - n° 364 - avril 2003
50
obésité touche actuellement environ 10 % de la
population adulte française et elle est en forte aug-
mentation chez les enfants. Cette pathologie nutri-
tionnelle n’est pas seulement un problème d’esthétique : c’est une
réelle maladie qui diminue l’espérance de vie et les capacités des
patients qui en sont atteints, de même qu’elle les expose à un
risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète, de dysli-
pidémies, de complications respiratoires et rhumatologiques, ainsi
qu’à l’augmentation de la fréquence de certains cancers. Cette
pathologie nécessite donc une prise en charge efficace, associant
le plus souvent plusieurs spécialistes, au premier rang desquels
se placent le cardiologue et l’endocrinologue-nutritionniste, mais
aussi le rhumatologue, le kinésithérapeute, le diététicien et, sou-
vent, le psychiatre. La prévention et le traitement de l’obésité
constituent un enjeu de santé publique majeur, qui reste néan-
moins encore difficile à contrôler.
RAPPEL DES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Définition de l’obésité
L’obésité est un excès de masse grasse entraînant des inconvé-
nients pour la santé. Les méthodes permettant de mesurer
précisément la masse grasse (densité corporelle, résonance
magnétique, etc.) n’étant pas de pratique aisée, les études épidé-
miologiques et la pratique clinique utilisent la définition de l’obé-
sité chez l’adulte en fonction de l’indice de masse corporelle
(IMC, ou body mass index, BMI). Celui-ci se calcule comme le
ratio du poids (en kilos) sur la taille (en mètres) élevée au carré :
Ces valeurs seuils de BMI ont été déterminées par l’analyse de
l’augmentation du risque de mortalité lors d’études épidémiolo-
giques d’observation. À BMI égal, il existe un paramètre de plus
en plus pris en considération pour le calcul du risque cardiovas-
culaire : la répartition androïde ou gynoïde de la masse grasse.
Si le tour de taille excède 102 cm chez l’homme ou 88 cm chez
la femme, on parle de répartition androïde ; celle-ci augmente le
risque cardiovasculaire.
Chez l’enfant, le BMI n’est pas validé ; l’obésité est plus souvent
définie par un poids supérieur au 97epercentile de la classe d’âge.
Poser le diagnostic d’obésité chez l’enfant nécessite donc d’avoir
à sa disposition la courbe de poids-taille, au mieux celle du car-
net de santé.
Épidémiologie de l’obésité
Une augmentation nette de la prévalence chez l’adulte et l’enfant
D’après l’enquête épidémiologique OBEPI disponible sur le site
de l’ANAES, l’obésité concernait, en 1998, 8 à 9 % de la popu-
lation adulte, et la surcharge pondérale 28,5 % (1). En 2003,
compte tenu de l’augmentation de la prévalence de l’obésité, on
peut estimer, respectivement, à 10 % et 30 % ces deux catégories
; pour comparaison, on compte environ 15 % d’obèses en Grande-
Bretagne, 20 % en Allemagne et plus de 30 % aux États-Unis. En
France, 12,7 % des enfants de 10 ans seraient obèses. Néanmoins,
l’obésité reste encore majoritairement une pathologie de l’adulte
après 50 ans : 62 % des hommes obèses et 75 % des femmes
obèses ont plus de 50 ans. L’obésité est plus fréquente chez la
femme que chez l’homme, dans les régions du Nord et de l’Est
de la France par rapport aux autres régions, et dans les milieux
défavorisés. En 1992, le coût des dépenses de santé imputables à
l’obésité a été évalué à 1,81 milliard d’euros, soit 2 % des
dépenses totales de santé. Environ un tiers des dépenses consé-
cutives à l’obésité concernait la prise en charge de l’hypertension
artérielle.
Épidémiologie des complications de l’obésité
Les pathologies associées à l’obésité se manifestent diversement
chez chaque patient (tableau I) ; elles nécessitent donc leur
recherche systématique pour une prise en charge adaptée à chaque
individu. Au mieux, cette prise en charge sera effectuée en col-
laboration entre les différents spécialistes et le médecin traitant
référent, qui centralisera les différentes approches thérapeutiques.
Des complications touchant tous les appareils
Complications cardiovasculaires. L’hypertension artérielle
(HTA) est plus fréquente chez le sujet obèse ; elle ne peut être éva-
luée qu’avec un brassard de taille adaptée, car un brassard de taille
Morbi-mortalité associée à l’obésité
●S. Gonbert*, P. Henry (coordonnateur)**
*Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.
** Hôpital Lariboisière, Paris.
L
‘
✓BMI = poids en kg/(taille en m)2.
✓Un BMI normal est compris entre 20 et 24,9 kg/m2.
✓Un BMI compris entre 25 et 29,9 kg/m2définit une sur-
charge pondérale.
✓Un BMI supérieur ou égal à 30 kg/m2définit l’obésité.

La Lettre du Cardiologue - n° 364 - avril 2003
51
MÉTABOLISME
normale risque de surévaluer les chiffres de pression. Une perte
de poids, même modérée de l’ordre de 5 à 10 %, peut normaliser
les chiffres de pression artérielle. Néanmoins, tous les hyperten-
dus obèses ne sont pas normalisés par la perte de poids, et il ne
faut donc pas hésiter à les mettre sous traitement médicamenteux
avec les mêmes objectifs que chez un sujet de poids normal. L’obé-
sité est un facteur de risque indépendant de coronaropathies dans
la majorité des études épidémiologiques, mais il est clair que son
effet délétère est accru quand elle s’accompagne de dyslipidémie,
d’HTA ou de diabète (2).La répartition androïde de la masse grasse
est particulièrement dangereuse au plan coronaire, probablement
parce qu’elle signe souvent l’association à d’autres perturbations
métaboliques, notamment le diabète de type 2 dans le cadre du
syndrome plurimétabolique. Une publication récente issue de la
cohorte de Framingham a montré, dans un groupe de 5 881 patients
suivis en moyenne 14 ans, que l’obésité était aussi un facteur de
risque indépendant d’insuffisance cardiaque (3):après ajustement
sur les facteurs de risque traditionnels, chaque augmentation
d’un point du BMI était associée à une augmentation du risque
d’insuffisance cardiaque de 5 % chez les hommes et de 7 %
chez les femmes. La limite de cette étude tient au fait que le dia-
gnostic d’insuffisance cardiaque était porté sur des critères peu
spécifiques, comme la dyspnée et les œdèmes des membres infé-
rieurs, et non sur des critères échographiques. L’insuffisance car-
diaque de l’obèse peut être hypertensive et/ou ischémique ; l’aug-
mentation du tissu adipeux en périphérie augmente la précharge
et elle est à l’origine de perturbations hémodynamiques. L’obé-
sité est également un facteur de risque d’accident vasculaire
ischémique, même après ajustement sur les valeurs de pression
artérielle. Pour ce qui est des complications thromboemboliques,
elles sont nettement augmentées en cas d’obésité, en raison de la
gêne au retour veineux.
Complications respiratoires. L’obésité expose à un risque de
dyspnée chronique qui peut impliquer, de manière séparée ou
intriquée, l’insuffisance cardiaque gauche, un syndrome d’hypo-
ventilation alvéolaire et un syndrome restrictif. Moins connu et
plus grave à court terme, le syndrome d’apnées du sommeil (SAS)
doit être recherché systématiquement, car il concerne environ
10 % des obèses, quel que soit leur BMI. Il faut rechercher les
classiques ronflements nocturnes et les pauses observées par le
conjoint, mais il faut aussi rechercher des levers nocturnes fré-
quents avec émission d’urines, des céphalées matinales et des
endormissements impromptus dans la journée. Le SAS expose à
un risque élevé de mort subite ; il augmente fortement le risque
d’HTA, de troubles du rythme et d’hypertension artérielle pul-
monaire. Il doit être dépisté par une oxymétrie nocturne ainsi
qu’authentifié et quantifié par l’enregistrement polysomnogra-
phique du sommeil en centre spécialisé. Le SAS est traité par le
port d’un masque en pression positive continue, prescrit par le
pneumologue. L’effet de la perte de poids sur le SAS est variable
d’un patient à l’autre.
Complications métaboliques. L’obésité multiplie le risque de
diabète de type 2 environ par trois, et le risque de dyslipidémie
environ par six : 30 % des obèses sont diabétiques, et 50 % des
diabétiques sont obèses. Donc, toute consultation médicale d’un
obèse doit donner lieu à la prescription d’un bilan glycémique et
lipidique si le statut métabolique du patient n’est pas connu. Cette
augmentation du risque métabolique, qui est connue de longue
date chez l’adulte obèse, a récemment été mise en évidence chez
l’enfant et l’adolescent (4). Les anomalies lipidiques sont le plus
souvent une hypertriglycéridémie avec HDL-C bas, mais des ano-
malies qualitatives et quantitatives des LDL peuvent s’y ajouter.
Ces anomalies métaboliques sont d’autant plus fréquentes que le
patient a une répartition androïde de sa masse grasse. Là encore,
une perte de poids, même modérée, peut normaliser les chiffres
glycémiques et lipidiques. Les patients obèses ont aussi un risque
augmenté d’hyperuricémie et de goutte.
Complications endocriniennes. En dehors des complications
métaboliques, l’obésité expose à d’autres complications endo-
criniennes, comme une diminution de la fertilité, des troubles des
règles, une hyperandrogénie avec acné et hirsutisme chez la
femme, le plus souvent dus à un syndrome des ovaires polykys-
tiques. L’homme porteur d’une obésité massive peut être atteint
d’hypogonadisme.
Complications ostéoarticulaires. Les atteintes arthrosiques des
articulations porteuses (vertèbres, hanches, genoux, chevilles)
sont favorisées par l’obésité, ainsi que la nécrose aseptique de la
tête fémorale. Le conseil de réduction pondérale ne doit pas faire
retarder la prise en charge thérapeutique classique, avec antal-
giques, anti-inflammatoires et, éventuellement, chirurgie.
Complications gastroentérologiques. Les lithiases biliaires et
le reflux gastro-œsophagien sont des complications classiques de
l’obésité. L’atteinte hépatique sous forme de stéatose est moins
bénigne qu’on ne le pensait par le passé : elle expose en effet au
risque de NASH (non alcoholic steatosic hepatitis), dont un cer-
tain nombre évoluent vers la fibrose, la cirrhose et le cancer hépa-
tocellulaire, en l’absence d’éthylisme ou d’hépatite virale asso-
ciés. Une augmentation persistante des transaminases et/ou des
gamma GT doit donc donner lieu, chez l’obèse, comme chez tout
autre patient, à une exploration spécialisée.
Complications dermatologiques et infectieuses. Les mycoses
et les furoncles sont particulièrement plus fréquents chez les
obèses.
Tableau I. Données OMS, 1998.
Prévalence (en pourcentages) des complications
attribuables à l’obésité
Hypertension artérielle 17 %
Coronaropathies 17 %
Diabète de type 2 61 %
Arthrose 24 %
Pathologie biliaire 30 %
Cancer de l’utérus 34 %
Cancer du sein 11 %
Cancer du côlon 11 %

La Lettre du Cardiologue - n° 364 - avril 2003
52
MÉTABOLISME
Complications néphrologiques. Des atteintes glomérulaires à
type de glomérulosclérose segmentaire et focale peuvent être
révélées chez l’obèse par une protéinurie, et ce, indépendamment
de l’existence d’un diabète ou d’une HTA.
Complications iatrogènes, risque opératoire. Un surcroît de
mortalité et de morbidité est associé à l’obésité massive, en rai-
son du terrain à risque cardiovasculaire, des atteintes respiratoires
et du risque thromboembolique postopératoire. Une chirurgie
chez l’obèse nécessite une bilan préopératoire multidisciplinaire.
Cancers. Certains cancers sont plus fréquents chez les obèses,
comme le cancer du côlon, du pancréas, du foie ou des cancers
hormonodépendants, tels les cancers du sein, de l’utérus ou de la
prostate.
ÉTIOLOGIES ET MÉCANISMES PHYSIOPATHO-
LOGIQUES
Génétique, environnement et psychologie intriqués
dans la genèse de l’obésité
À l’exception des rares obésités secondaires à une endocrinopa-
thie, qu’il convient d’éliminer au début de la prise en charge (hypo-
thyroïdie ou hypercorticisme), et des rarissimes obésités monogé-
niques familiales ou sporadiques, dans l’écrasante majorité des cas,
l’obésité est une maladie du tissu adipeux due à la collaboration
de mécanismes métaboliques sur un fond génétique prédisposé,
dans un environnement qui favorise l’accès continuel à une nour-
riture variée et riche et une diminution de l’exercice physique.
Mécanismes moléculaires : génétique et régulation poids/
appétit. La distinction de mécanismes de transmission génétique
est rendue difficile dans l’obésité humaine par le fait que les
membres d’une même famille partagent les mêmes modes d’ali-
mentation, d’activité physique et les mêmes conditions socio-
économiques. Il n’en reste pas moins qu’il existe des familles
d’obèses : 70 % des obèses ont au moins un parent obèse. Cette
agrégation familiale est un facteur prédictif négatif de guérison,
notamment chez l’enfant, dont les chances de retour à un poids
normal sont très diminuées quand l’un des parents est obèse. La
prise en charge de l’obésité doit donc être, au mieux, familiale.
Certaines formes exceptionnelles d’obésité sont dues à des
atteintes d’un seul gène, comme celui de la leptine ou de son
récepteur, de la POMC (pro-opio-mélanocortine), des récepteurs
de type 4 de la mélanocortine (MC4R) ou de la ghréline dans le
cadre du syndrome hyperphagique de Prader-Willy (5, 6). Les
obésités classiques sont probablement associées à une sélection,
lors de l’évolution des sujets porteurs, de “gènes d’épargne”
capables de les rendre résistants aux périodes de disette (par
exemple en temps de guerre). En présence d’une nourriture abon-
dante, ces sujets deviennent alors exposés au risque d’obésité.
Mécanismes environnementaux. L’accès facilité à la nourriture,
l’augmentation de la densité calorique des aliments, plus gras et
plus sucrés, la consommation accrue de boissons sucrées et/ou
alcoolisées, les sollicitations répétées de la publicité, la diminu-
tion de l’exercice physique et, grâce au chauf
fage et à la climati-
sation,
la diminution de la dépense énergétique pour faire face
aux variations climatiques
sont autant de facteurs environnemen-
taux
qui favorisent l’apparition de l’obésité.
Mécanismes psychologiques. L’obésité peut avoir comme
cause une pathologie psychiatrique, comme la dépression ou
un trouble du comportement alimentaire ; mais, même en l’ab-
sence de pathologie psychiatrique sous-jacente, l’obésité peut
aussi avoir des conséquences sur l’humeur du patient ou engen-
drer des troubles névrotiques, comme l’agoraphobie. Il a éga-
lement été bien montré que l’obèse avait un trouble de son
image corporelle l’amenant à négliger son corps. Dans tous les
cas, l’évaluation psychologique et psychiatrique fait partie de
la prise en charge du patient obèse, avec, dans le meilleur des
cas, des consultations de soutien par un psychiatre ou un psy-
chologue.
Savoir dépister les troubles du comportement alimentaire
En allant du moins au plus sévère, ces troubles peuvent se mani-
fester sous la forme de polyphagie pendant les repas (ingestion
de quantités importantes, mais limitées aux repas), de grigno-
tages (prise répétée, en dehors des repas, de petites quantités
d’aliments variés), de compulsions alimentaires (besoin irré-
pressible de consommation immédiate d’un seul aliment, en
dehors des repas), de levers nocturnes pour s’alimenter et, enfin,
de crises de boulimie avec ingestion, le plus souvent dans un
contexte d’anxiété, de grandes quantités d’aliments, suivie ou
non de vomissements.
Savoir dépister les troubles de l’humeur ou les troubles
anxieux sous-jacents
Un syndrome dépressif ou anxieux peut engendrer des modifi-
cations du comportement alimentaire et conduire à une obésité.
Il convient donc de ne pas le méconnaître ou de ne pas l’attribuer
trop rapidement aux conséquences de l’obésité.
Il est important de mettre à jour les circonstances qui ont pu favo-
riser l’apparition ou l’accentuation de l’obésité, telles qu’un deuil,
un licenciement, un divorce, etc.
IMPLICATION DES DIFFÉRENTS SPÉCIALISTES
Comme cela a déjà été indiqué précédemment, la prise en
charge de l’obésité nécessite la collaboration de plusieurs spé-
cialistes, tout en veillant à maintenir le rôle primordial du
médecin traitant, qui peut coordonner les différentes approches
thérapeutiques et être le premier interlocuteur du patient au
jour le jour, afin d’éviter un émiettement de la prise en charge.
Les spécialistes qui seront impliqués dans le suivi d’un obèse
seront variables en fonction des complications dont sera por-
teur le patient. Néanmoins, il est sûr que le cardiologue et l’en-
docrinologue seront le plus souvent sollicités, de même que le
psychiatre.

La Lettre du Cardiologue - n° 364 - avril 2003
53
MÉTABOLISME
La prise en charge endocrinologique
Elle aura pour but d’éliminer, au début de la prise en charge, une
obésité secondaire à un hypercorticisme ou à une hypothyroïdie
par l’examen clinique et quelques dosages hormonologiques
simples. D’autre part, l’endocrinologue dépistera le diabète, les
dyslipidémies et l’hyperuricémie, et mettra en place la prise en
charge nutritionnelle.
La prise en charge cardiologique
Elle s’attachera à traiter l’hypertension, les coronaropathies, l’in-
suffisance cardiaque et, éventuellement, les troubles du rythme
cardiaque. Le cardiologue pourra aussi être consulté pour savoir
si l’état cardiovasculaire du patient est compatible avec certaines
approches thérapeutiques de l’obésité, comme la chirurgie ou cer-
tains traitements médicamenteux, ou pour conseiller le patient
obèse quant à l’intensité et à la fréquence de l’exercice physique
qui lui est recommandé. Dans tous les cas, la consultation auprès
du cardiologue est un moment important dans la vie de l’obèse
pour l’informer des risques de complications cardiovasculaires,
afin de l’aider à ne pas considérer son obésité sous le(s) seul(s)
aspect(s) esthétique et/ou social.
Dans tous les cas, la prise en charge d’une pathologie aussi pluri-
factorielle que l’obésité et touchant autant d’organes cibles ne
pourra se faire que de manière pluridisciplinaire. Un des
exemples
en est le “bilan pré-gastroplastie” : il nécessite les avis
de l’endocrinologue pour déterminer l’absence d’endocrinopa-
thie sous-jacente et pour équilibrer un éventuel diabète avant
l’anesthésie, du cardiologue et du pneumologue pour optimiser
le traitement de la coronaropathie et du SAS, du psychiatre pour
éliminer un trouble du comportement alimentaire ou bien un
trouble anxieux ou dépressif qui contre-indiqueraient la gastro-
plastie, de l’équipe de diététicien(ne)s afin d’éduquer le patient
au fractionnement des repas après la gastroplastie et, bien sûr, de
l’anesthésiste et du chirurgien pour réaliser la procédure dans les
meilleures conditions.
Bibliographie
1.Charles M, Basdevant A, Eschwege E. Prévalence de l’obésité chez l’adulte en
France : résultats de l’étude OBEPI. Ann Endocrinol 2002 ; 63 : 154-8.
2. Jonsson S, Heldblad B, Engstrom G, Nilsson P, Berglund G, Janzon L.
Influence of obesity on cardiovascular risk. Int J Obes 2002 ; 26 : 1046-53.
3.Kenchaiah S, Evans J, Levy D, Wilson P, Benjamin E, Vasan R. Obesity and the
risk of heart failure. N Engl J Med 2002 ; 347 : 305-13.
4. Sinha R, Fisch G, Teague B, Barbetta G, Sherwin R, Caprio S. Prevalence of
impaired glucose tolerance among children and adolescents with marked obesity.
N Engl J Med 2002 ; 346 : 802-10.
5. Clement K. Formes monogéniques d’obésité ; de la souris à l’homme. Ann
Endocrinol 2000 ; 61 (suppl. 6) : 39-49.
6. Delparigi A, Tschop M, Heiman M, Salbe A, Tataranni P. High circulating
ghreline : a potential cause for hyperphagia and obesity in Prader-Willy syn-
drome. J Clin Endocrinol Metab 2002 ; 87 : 5461-4.
Les articles publiés dans “La Lettre du Cardiologue”
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de reproduction, d'adaptation
et de traduction par tous procédés
réservés pour tous pays.
ALJAC SA, locataire-gérant d’EDIMARK SA © mai 1983
Imprimé en France - Differdange SA - 95110 Sannois
Dépôt légal : à parution
✓Ce numéro comporte un encart 4 pages “Sanofi-Synthelabo” inséré entre les pages 30 et 31.
✓Un supplément Infos-Sympo intitulé : “Stent au sirolimus : une nouvelle thérapeutique dans le traitement
de la maladie coronarienne” (laboratoires Cordis) est routé avec ce numéro.
1
/
4
100%