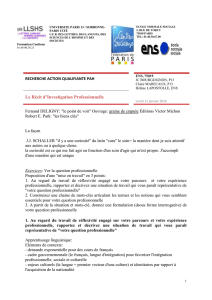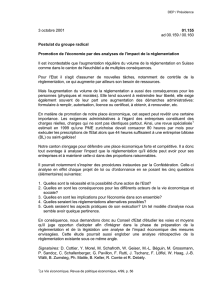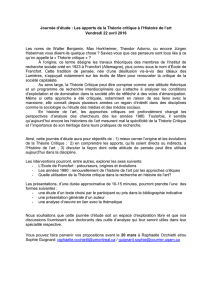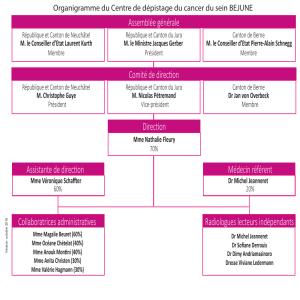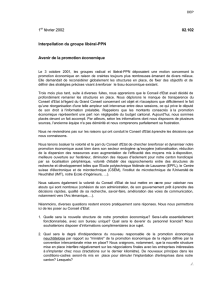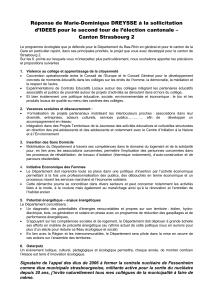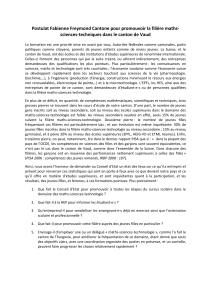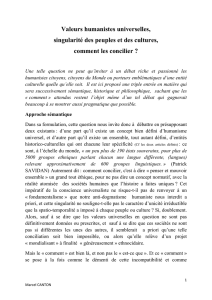Théorie critique ( Horkheimer )

Marcel CANTON Page 1
L’œuvre de Max HORKHEIMER
La Philosophie comme creuset pluridisciplinaire et révolutionnaire
En brève introduction, on peut estimer qu’en pleine période des
« années folles », son projet pluridisciplinaire dit de la « Théorie
Critique » fut une contribution décisive à l’avènement sociopolitique
de la Raison postmoderne ; en effet, cette théorie se pensait elle-
même comme générateur révolutionnaire et permanent d’un réel
Progrès sociétal.
Si l’on se met en tête de rédiger une note sur un tel sujet, c’est que Maximum
HORKHEIMER est bien l’un de ces architectes du rationalisme avec lesquels
un Humaniste s’endort inlassablement ; ce penseur fut un acteur incontournable
dans l’arène idéologique de l’entre-deux guerre, une période que je perçois
comme « folle » effectivement et trouble intensément ; une période couveuse
d’excès et de contraires exacerbés, une période aussi déconcertante que
finalement abominable et qui fut, dans les faits, un effroyable « trou d’air
européen » de l’histoire du monde ; un drame en un acte et tant de scènes, sur
lequel il ne sera jamais superflu de revenir.
Y revenir non pas pour se lamenter inlassablement en décomptant les victimes,
tels de zélés accusateurs et en oubliant tout le reste, mais bien plutôt pour bâtir
une compréhension globale et surtout enseignable de cette spirale
apocalyptique ; pour la penser objectivement, historiquement, c'est-à-dire la
restituer, intelligiblement et utilement, en termes de causalité. Raison oblige. Je
pense donc que l’œuvre, le destin et le parcours de Horkheimer pourront guider
en ce sens quiconque souhaitera en approfondir l’étude rationnelle, et j’espère
sincèrement que ces quelques lignes en seront incitatrices.

Marcel CANTON Page 2
Qui était-il ? De quelle synchronie conceptuelle fut-il l’auteur ? Et dans
quelle diachronie idéologique cette contribution s’inscrivait-elle peut-être ?
Qui était-il ? La quasi-totalité des manuels de philosophie de Terminale ne
convoque pas ses écrits. Cela est dû à la pluridisciplinarité et à la nature même
de son projet, souvent mal identifié et sous-exposé, mais dû en outre, au grand
nombre de philosophes aussi brillants que prodigues qui, comme lui, sont nés à
l’aube du dix-neuvième siècle : BERGSON et son « évolution créatrice »,
BACHELARD et son « rationalisme appliqué », ARENDT et sa « modernité »,
MARKUSE et son « unidimensionnalité » de l’homme, MAUSS et son
invention de l’anthropologie. Et cela fut dû, plus encore , à l’étonnante éclosion
de ceux qui sont nés tout juste après lui, dans les années 1910-1920 : POPPER,
JANKELEVITCH, LEVINAS, LEVI-STRAUSS, SARTRE, MOUNIER,
MERLEAU-PONTY, MONOD, MORIN, GENET, DELEUZE, FOUCAULT,
HABERMAS, tous issus d’une génération « début de siècle » dont la culture et
le génie visionnaire n’ont pas ( ?) été égalés depuis et dont les œuvres
cathédrales ont pu logiquement occulter celle de Max HORKHEIMER,… ce
que 1968 n’a pas fait.
Il est né en 1895 à Stuttgart d’une famille juive pratiquante et d’un père qui était
un puissant baron de l’industrie textile. Au terme d’études classiques et
bourgeoises, il devient, durant la première guerre mondiale, jeune directeur des
écoles des Beaux Arts de Munich et il écrit une étude sur les « lois élémentaires
de la peinture ». Il s’intéresse alors à la psychologie, et donc, bien logiquement,
à la Théorie de la Gestalt (forme) ; puis il vient à la philosophie par l’étude de
SCHOPPENHAUER qui l’influence beaucoup. Il soutient en 1922 une thèse
dirigée par Hans CORNELIUS qui porte sur l’œuvre de KANT ; cela montre
d’emblée son intérêt pour ce que « Raison » veut dire. Sa thèse s’intitule
« Contribution à l’antinomie de la faculté de juger téléologique » (par
« téléologie » entendons rapidement « finalisme »).

Marcel CANTON Page 3
Presque dans le même temps, en 1924, il fonde avec Friedrich POLLOCK,
étudiant en finances puis en sociologie, l’Institut de Recherche Sociale à
Francfort ; et dès 1926 il cumule enseignement et fréquentation du mouvement
ouvrier d’essence marxiste, tout en faisant écho aux recherches
psychanalytiques. A 35 ans, en 1930, il est nommé à l’Université de Francfort
pour y enseigner la « philosophie sociale », domaine pluridisciplinaire s’il en
est, tout en devenant directeur de l’Institut qu’il avait cofondé. Fort de son étude
sur (je cite) "les débuts de la philosophie bourgeoise de l'Histoire", il dote
l’Institut, en 1932, d’une revue de recherche sociale, la « Zeitschrift für
Sozialforschung ».
C’est d’abord en cela qu’il innove radicalement, car il crée ainsi les conditions
toutes nouvelles qui permettent la collaboration interactive des différentes
sciences humaines jusqu’alors cloisonnées. Cette implication d’intellectuel
engagé et oeuvrant dans son siècle lui vaut d’être révoqué en 1933 dès l’amorce
de la vague brune. Sa revue étant éditée à Paris jusqu’en 1940 par l’éditeur
Alcan, puis Zurich, HORKHEIMER dirige l’annexe de l’Institut en exil sous le
pseudonyme de Heinrich REGIUS, d’abord depuis Genève puis New-York
jusqu’en 48.
Ce déracinement ne l’empêche pas de poursuivre ses travaux, notamment
- sur l’Autorité et la Famille, ce moule familial dont il est lui-même parvenu à
s’extraire psychologiquement, socialement et intellectuellement,
- sur les prédispositions au fascisme de la société américaine,
- et sur le symptôme sociétal que constitue alors l’antisémitisme. Ces textes sont
publiés entre 1949 et 1950 et titrés « Etudes en préjudices ».

Marcel CANTON Page 4
De retour à Francfort en 1949, il met à profit le rétablissement de sa chaire de
philosophie sociale pour relancer les travaux de l’Institut. Il prend sa retraite en
1958, non sans avoir été doyen, recteur et titulaire du prix GOETHE.
Il meurt en 1973 en offrant au public ses fameuses « notes critiques » qui
constituent un journal analytique du quotidien, avec des bilans critiques
emblématiques, et surtout la concrétisation personnelle de sa théorie, même si
leur radicalité originelle est désormais atténuée.
Quel est son apport conceptuel à ce moment charnière et synchronique ?
La pensée et le travail catalyseur de Max HORKHEIMER expriment pour
l’essentiel un humanisme pacifique, internationaliste et antidogmatique. Avec
les ADORNO, POLLOCK et WEIL entre autres, il incarne une jeunesse
étudiante brillante qui, parce qu’elle est spécifiquement d’origine bourgeoise,
semble être la seule à pouvoir analyser et comprendre la déchéance d’un
capitalisme bourgeois qui, selon elle, et sur fond de faillite weimarienne, ne
pouvait que conduire au fascisme… cela, avant de renaître dans le
productivisme de masse américain. Pas de jugement de valeur sur les
protagonistes de cette logique historique, plutôt une prise de recul objectivante
et méthodiquement distanciée.
On peut affirmer sans exagérer, ni trop extrapoler pour l’instant, que ce que
HORKHEIMER nomme la « Théorie critique » s’est greffé sur les principes de
« l’empirio-criticisme » ; il s’agit d’un système déjà psycho-socio-philosophique
qui a été développé juste avant lui au 19° siècle par Richard AVENARIUS, fils
de l’éditeur allemand du même nom et de Cécile Wagner, la plus jeune sœur de
Richard WAGNER qui était son parrain.
La théorie empirio-criticiste se voulait épistémologique, c’est à dire qu’elle
s’appliquait aux processus cognitifs d’appréhension du monde et d’élaboration

Marcel CANTON Page 5
des connaissances ; tout en se démarquant aussi bien du matérialisme aliénant
que de la métaphysique - souvent « de combat » fin 19°, elle convoquait les
acquis croisés des sciences physiques, psychologiques et biologiques.
Elle entendait ainsi mettre en lumière le fait que seule une expérience dite
« pure », synthèse de l’expérience extérieure et du travail cognitif intérieur est à
même de permettre une juste compréhension, fonctionnelle, conceptuelle, et
citoyenne du monde réel. A cette fin, AVENARIUS a théorisé le fameux
concept d’ « introjection » comme étant le processus « d’intégration », en et par
l’individu, des réalités qu’il a choisi d’appréhender pour les assimiler.
On parlerait aujourd’hui de « construction » et de maîtrise des
« représentations », à ceci près qu’alors l’impératif critique n’était pas
optionnel mais principe premier, et qu’à cette intégration du réel correspond de
fait une partie idéelle, constitutive de la pensée elle-même. C’est là une vision
du « cogito » qui, privilégiant l’expérience personnelle du sujet, émancipe
l’homme, à la fois par rapport aux impératifs moralistes du moment, par rapport
au programmatisme positiviste et par rapport au surdéterminisme hégélien de
l’absolu Savoir collectif.
Tout comme les théories d’AVENARIUS ont influencé directement les
intellectuels et les étudiants russes impliqués dans la révolution d’octobre, la
« théorie critique » développée par HORKHEIMER et consorts viendra, on le
sait peut-être trop peu, nourrir l’esprit qui « renversa les tables » en Mai 1968.
C’est l’intensité et la sémantique de ces évènements qui traduisent
l’authenticité et le bien-fondé des aspirations portées par cette théorie.
Si l’Ecole de Francfort, qui était moins une « école » qu’un mouvement de
pensée de libération des groupes et d’émancipation des consciences, a ralenti
son activité dans les années 1960, il n’empêche, donc, qu’elle a eu une
influence sur les soubresauts et les innovations salutaires qui, lorsque cela
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%