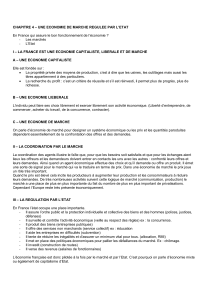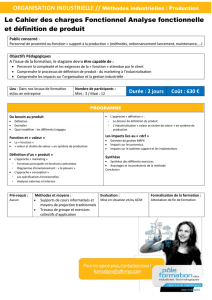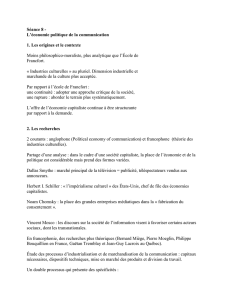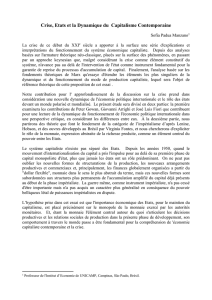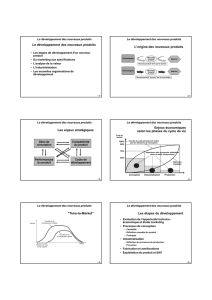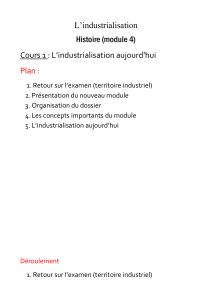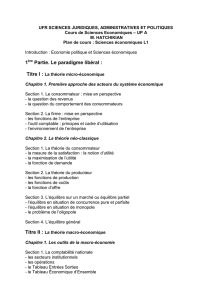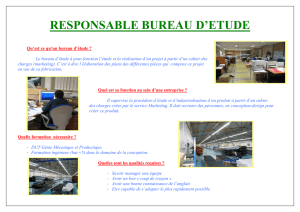Industrialisation du Tiers-Monde et

1. Article paru dans The Journal of Social Studies, Bangladesh, Avril 1992.
Alternatives Sud, Vol. I (1994) 1
Cahiers édités par le Centre Tricontinental, Louvain-la-Neuve
Autorisation de reproduction ou traduction à demander à cetri@cetri.be
Industrialisation du Tiers Monde et mondialisation
Synthèse des essais théoriques1
(Décennies 1950 à 1980)
A.M. Quamrul Alam
Les nouveaux pays industrialisés (NPI) d’Asie du Sud-Est (Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong) ont
atteint une croissance industrielle importante en l’espace de trois décennies. Ce succès industriel des NPI
asiatiques, ainsi que de certains pays latino-américains, succès basé sur une exportation souple de produits
manufacturés, a souvent servi de justificatif aux partisans des théories néoclassiques du développement, théories
qui se caractérisent par une croyance dans les bénéfices économiques de la libéralisation du commerce, de
l’entreprise privée de même que par une intervention étatique minimale. Cependant, de récentes études ont
montré que l’Etat ainsi que la structure socio-économique domestique ont joué un rôle crucial, tant au niveau des
relations économiques internationales qu’à celui des affaires économiques internes. Ce succès des NPI asiatiques
pose dès lors des questions sur ce rôle qu’ont joué, dans les pays du Tiers Monde, les facteurs politiques,
économiques et sociaux. Cet article va tenter d’examiner différentes théories concernant l’industrialisation des
pays du Sud dans le but d’étudier l’incidence de la mutation économique internationale actuelle sur cette dernière
et d’examiner le rôle qu’y jouent les éléments sociaux, politiques et économiques internes des sociétés.
La controverse concernant l’industrialisation des pays du Tiers Monde a conduit à des
interrogations sur l’étendue et la nature de la formation du capital et sur la croissance capitaliste dans le
secteur industriel, cela à l’intérieur d’un environnement économiqu e international en pleine mutation.
L’accroissement, par le biais des sociétés multinationales, d es mouvements internationaux de capitaux,
du commerce mondial ainsi que de la circulation des biens a créé une situation nouvelle où l’on assiste,
d’une part, à une réorientation des investissements internationaux des pays à facilités productives vers
les pays moins développés et, d’autre part, au développement d’un nouveau système de circulation du
capital financier et du capital productif. Dans cette économie mondiale en pleine mutation, la distribution
des activités économiques s’est donc accomplie en fonction d’une nouvelle division internationale du
travail et de l’internationalisation du capital productif.
Dans les années 50, et au début des années 60, les théoriciens du développement ont centré leur
attention sur le problème du sous-développement ainsi que sur celui de l’incapacité du capitalisme à
développer des forces productives dans les pays du Sud du fait des relations de dépendance établies par
le système impérialiste. Le socialisme était à cette époque présenté comme l’unique système capable de
libérer les forces productives et de permettre l’industrialisation de ces pays.
Durant les trois dernières décennies, un certain nombre d e pays ont pu effectivement atteindre un
niveau significatif de développement industriel et, dès lors, ont pu modifier de manière drastique leurs
structures socio-économiques. De tels changements dans le système économique mondial sont considérés
par certains auteurs comme faisant partie d’une transformation structurelle et comme caractéristiques
d’une nouvelle division internationale du travail [H. Markussen et E. Torp, 1982 et F. Frobel, J. Heinrichs

2
et O. Kreye, 1980]. La principale manifestation de ce processus est le développemen t des nouveaux pays
industrialisés (NPI). Ces derniers ont atteint des niveaux de performance importants et soutenus de la
croissance économique sous la pression d’une expansion de la production de biens manufacturés et des
exportations. La crise économique des années 70 ne semble pas avoir trop secoué ces économies.
Le succès des NPI a généré un débat sur le rapport entre le développement capitaliste et
l’industrialisation du Tiers Monde. Ce débat peut être scindé en quatre positions distinctes: la théorie
néoclassique; la théorie de la dépendance et celle du système-monde; la théorie de l’industrialisation et
la théorie de l’internationalisation du capital.
Dans la partie qui suit, ces différentes théories vont être discutées de manière critique afin
d’analyser les fondements du succès des NPI en pointant les différents facteurs responsables de ce succès.
I. La théorie néoclassique
Le modèle économique néoclassique prôné par les théoriciens de la modernisation a, comme
fondem ent, l’idée selon laquelle il est fallacieux de prétendre qu’un développement capitaliste soit
impossible dans les pays du Tiers Monde. Ils affirment que le succès des NPI peut être perçu comme
résultant d’un processus naturel provoqué par l’application de politiques de développement
intransigeantes. Le principal argument des théoriciens de la modernisation est que la croissance
économique ainsi que le développement des NPI ont été rendus possibles grâce à une politique
d’envergure concernant les mesures d’incitation à la croissance. Par incitation à la croissance, il faut
entendre les domaines du capital, de la technologie, des institutions ainsi que la mise sur pied d’un
système monétaire approprié.
1. Un retard à combler
Cette théorie conceptualise en fait le développement en tant que mouvement partant d’un stade
arriéré et se dirigeant vers un stade développé, ceci le long d’un «continuum» de modifications
historiques. Ce dernier est censé décrire une trajectoire d’évolution sociale universelle, trajectoire suivie
par les nations modernes développées [T.F. Fitzgerald, 1983, 3]. Une telle théorie insiste sur le fait que
le dualisme peut être éradiqué de manière à combler le fossé entre tradition et modernité. Ce qui est
explicite, c’est que le Tiers Monde peut imiter le processus historique des nations occidentales
industrialisées afin d’achever son développement économique. Si l’on suit ce point de vue, il semblerait
donc que le modèle des NPI puisse être égalé par d’autres pays du Sud, sous certaines conditions
spécifiques toutefois.
Les théoriciens de la modernisation affirment que pour atteindre un stade de croissance industrielle,
il est nécessaire qu’une allocation efficace des ressources soit entreprise. Selon eux, ceci ne peut se
produire que dans un contexte de libéralisation des mécanismes du marché, comme par exemple la
formation du prix. Ils affirment encore que du fait du mécanisme des avantages com paratifs, le capital
répondra logiquement aux signaux des prix et, dans un contexte de m arché libre, les prix serviront une
distribution efficace et automatique des ressources [M . Bienefeld, 1982, 48-50].
Ils considèrent en outre que l’inéfficacité, le gaspillage et la mauvaise distribution de ces ressources
sont provoqués par une intervention publique excessive, des politiques économiques et sociales
inappropriées et par la non-utilisation d es principes de l’avantage comparatif. La prescription politique
centrale de cette école se base sur deux stratégies. La première d’entre elles consiste en une intervention
minimale de l’Etat.
L’Etat devrait se confiner dans un rôle d’institutionalisation des ajustements appropriés aux
politiques économiques domestiques et au gel des forces du marché. Ceci devrait permettre à ces
dernières de déterminer le prix des revenus du travail et d’éliminer la discrimination entre la production
pour la consommation domestique et la production pour l’exportation. La seconde de ces stratégie est que
l’Etat devrait op érer d’une man ière aussi proche que possible de celle du régime commercial [L.E.
Wesphal, 1978, 347-382]. Ce qui implique dès lors la libéralisation du commerce, la dévaluation des taux

3
de change et la réduction des contrôles comm erciaux par l’élimination des restrictions à l’importation,
ainsi que le blocage des taux tarifaires à un bas niveau.
2. Une politique libérale
Selon cette perspective, l’objectif principal doit être d’encourager le développement d’une
industrialisation à vocation exportatrice et compétitive au niveau international. Les économistes de cette
école suggèrent que si ces étapes sont franchies, une utilisation optimale tant du capital que du travail
encouragera le développement de la production conformément au mécanisme de l’avan tage comparatif.
Ils affirment que le lien de causalité est double: de la libéralisation du commerce vers l’orientation
exportatrice et du libre jeu des forces domestiques du marché vers des incitants à l’exportation. De ces
deux liens résulteraient une augmentation du niveau d’ind ustrialisation, des exportations ainsi que de la
croissance économique.
L’argument principal de cette théorie est que la confiance dans le laissez-faire, dans l’avantage
comparatif et dans les politiques de détermination du juste prix est la clé du succès des NPI asiatiques.
Selon la Banque Mondiale, ces derniers doivent leur réussite à des politiques orientées vers les marchés
extérieurs ainsi qu’à une utilisation efficace de politiques de prix et de marché pour assurer le
développement économique.
Les économistes de la Banque Mondiale affirment également que ces économies orientées vers
l’extérieur ainsi qu’une distribution efficace des ressources ont aidé les NPI à surmonter les difficiles
conditions dans lesquelles se trouvait leur balance des paiements, conditions dues aux chocs des
récessions économiques des années 1974-76 et d’après 1979 [World Bank, 1983, 24-26].
Toutefois, la théorie néoclassique ne parvient pas à expliquer pourquoi les autres pays du Sud
s’avèrent incapables à égaler ce modèle de développement économique. Elle explique comment les forces
du marché mènent à une certaine efficacité dans le cadre d’une économie parfaite, mais cela ne fonctionne
pas dans des cas économiquement imparfaits tel le Bangladesh.
3. La critique de la théorie
En fait, le problème majeur de cette théorie est que, lorsque ses tenants tentent d’analyser le
développement économique des NPI, ils n e tiennent aucun compte du fonctionnement du système
capitaliste mondial, du colonialisme, de l’impérialisme, du rôle de l’Etat et de la lutte des classes dans
les pays du Tiers M onde. Ils proposent ainsi une analyse incomplète des raisons de la récente croissance
économique des NPI et ignorent la différence de contexte entre, d’une part, les pays développés lorsqu’ils
entamèrent leur processus de développem ent et, d’autre part, les pays du Tiers M onde aujourd’hui.
Cette théorie se focalise largement sur l’Etat-nation perçu de manière indépendante et, de la sorte,
ignore les relations politiques et économiques qui opèren t au niveau du système intern ational.
Qui plus est, l’Etat a joué un rôle important dans le développement historique des NPI en stimulant
l’épargne interne ainsi qu’en orientant ces fonds vers des investissements productifs [C.A. Barone, 1983,
41-67 et R. Leudde-Neurath, 1980, 48-53]. En outre, et contrairement aux affirmations néoclassiques,
l’intervention de l’Etat fut souveraine en matière de régulation des activités économiques par le biais de
politiques taxatoires corporatistes, de l’utilisation de barrières de protection tarifaires, ainsi que
d’autorisations d’arrangement et de fixation des prix au niveau du marché domestique.
En Corée du Sud et à Taïwan, l’Etat contrôlait également les principaux leviers de commande de
l’économie nationale, en ce y compris le secteur bancaire. Au début des années 70, douze des seize
principales industries appartenaient au secteur public, qui contrôlait deux-tiers des ressources investies
dans l’économie sud -coréenne. A Ta ïwan, le secteur public détenait plus de la moitié du capital fixe des
entreprises étrangères [M.K. Datta-Chaudhuri, 1981, 56; R. Wade, 1983, 11-28]. Suite à cela, on peut dès
lors en conclure que l’insistance des partisans de la thèse néoclassique sur les politiques économiques
libres et sur un moindre contrôle des pouvoirs publics n’est pas la meilleure des prescriptions politiques.

1. Un grand nombre de théoriciens du marxisme classique affirment que l’industrialisation est impossible dans les pays du Tiers Monde.
4
II. Les théories de la dépendance et du système-monde
Les théoriciens de la dépendance et du système-monde tel que Paul Baran, André Gunder Frank,
Samir Amin ou Immanuel W allerstein articulent leur pensée autour du processus global d’accumulation
en tant que déterm inant principal du retard d’industrialisation des pays du Sud [S. Amin, 1976; P. Baran,
1957; A. Gunder Frank, 1967 et 1981; I. Wallerstein, 1974, 1979 et 1984]. Ils expriment ainsi un thème
explicitement alternatif, tant de la théorie de la modernisation que de la théorie marxiste classique de
l’impérialisme [G. Kay, 1975; P. Sweezy, 1942; E. Mandel, 1976]1. Ils affirment, en fonction du principe
de la dépendance et des échanges inégaux, que le développement capitaliste des pays développés est basé
sur un processus continu et nécessaire de maintien du sous-développement dans les pays du Tiers Monde.
1. Une nouvelle division internationale du travail
Le point le plus fondamental de leurs théories, et sur lequel ils in sistent plus particulièrement, est
que le système capitaliste international a créé une division internationale du travail au sein de laquelle les
pays du Sud produisent des matières premières pour les centres développés tout en remplissant le rôle de
marchés pour les produits manufacturés originaires de ces cen tres développés. Ils affirment que le surplus
créé dans les sociétés périphériques en est arraché par le biais du mécanisme du rapatriement des
bénéfices. Ainsi, les pays périphériques se trouvent coincés dans le piège du développement. Ils réfutent
en outre les performances des NPI comme étant équivalant à un processus de développement.
Paul Baran défend, par ailleurs de manière éloquente, l’idée selon laquelle le lien, solide, qui relie
les pays capitalistes et les pays du Tiers Monde a engendré de sérieux obstacles à une croissance
industrielle effective et rationnelle. En continuité avec P. Baran, A. Gunder Frank insiste sur le fait que
le sous-développement du Sud est la cause du développement capitaliste des pays du Nord. Il soutient
l’idée que les sociétés périphériques ne pourront mener à bien un processus de développement interne
autonome et indépendant, et décrit les NPI comme des Etats clients ou appendices des pays développ és.
En ignorant le rôle progressiste du capitalisme, A. Gunder Frank tente, en outre, de défendre l’analyse
selon laquelle le capitalisme va toujours essayer d’accentuer les différentiels existants entre le noyau et
les périphéries, et insiste sur le fait que les sociétés périphériques resteront de manière permanente sous-
développées.
Il s’agit en fait d’une théorie de la stagnation qui ne donne aucune indication du pourquoi d’une
industrialisation capitaliste dans certains pays du Tiers Monde et pas dans d’autres. Cette argumentation
ignore les spécificités historiques des nations particulières, minimise l’importance des relations internes
de classes et ne prend pas en compte les nouvelles forces capitalistes et les nouveaux intérêts tant dans
les pays développés que dans ceux du Tiers Monde [J. Petras, 1984, 182-203].
Cette école ne reconnaît pas non plus le fait que chaqu e société s’érige sur un produit sociétal,
institutionnel et culturel h érité du passé, et que l’intégration dans le système capitaliste mondial n’efface
pas entièrement ceux-ci en leur substituant de nouvelles institutions sociales. La vision de A. Gunder
Frank selon laquelle il existe un manque structurel de dynamisme dans les pays du Sud, est également
sujette à caution. Il s’agit, en effet, d’une mauvaise interprétation des formes actuelles de l’impérialisme
économique qui conduit à une analyse politique imprécise de cette situation. La théorie de la dépendance
décrit la manière dont les pays capitalistes développés exploitent le Tiers Monde par le biais des activités
de commerce, mais n’explique pas le rôle joué par les dynamiques sociales internes des pays du Sud dans
cette relation de dépendance.
2. Des relations inégales
Selon la théorie du système-monde développée par I. Wallerstein, les Etats périphériques localisés
à l’intérieur du systèm e mond ial ne peuvent se transformer d u fait des relations inégales au niveau des
échanges. Il affirme que le comm erce induit par la division internationale du travail donne naissance à

5
une structure internationale d’Etats-nations au pouvoir inégal et permet un processus d’accumulation
accéléré dans les pays du centre. Ces relations économiques inégales renforcent le cycle d’arriération dans
les Etats périphériques. Cet argument met en lumière la raison pour laquelle les écon omies du Tiers
Monde sont également capitalistes, parce que le système-monde est capitaliste. Les problèmes
économiques et politiques du Sud sont perçu comme pointant les contradictions structurelles de
l’économie capitaliste [I. Wallerstein, 19 75].
Selon cette théorie, des forces externes déterminent la structure de classes et la lutte de classes dans
les pays périphériques. I. Wallerstein insiste sur le fait que les pays périphériques sont connectés au
marché mondial par des relations d’échange parce que les économies périphériques sont en fait les sous-
systèmes du système mondial. Selon sa théorie du système-monde, les relations d’échange sont les
facteurs déterminants pour la production capitaliste et le profit est le résultat de l’échange inégal entre
sous-systèmes et système. Le système-monde se définit donc par la circulation du capital et les catégories
de production et de circulation sont vue s comme des moments différents d’un tou t organique au sein
duquel la production est déterminée par la circulation sur le marché mondial [I. Wallerstein, 1974, 399;
1977, 1O4].
Ce n’est pourtant pas le cas. Production et circulation sont deux aspects importants d’un tout
organique, ou d’un mode de production, mais ceci ne veut pas dire qu’ils soient tous les deux aussi
importants dans la détermination du mode de production d’une économie. Marx affirme que c’est le
système de production, et non les échanges, qui détermine le mode de production. Il déclare de manière
spécifique qu’à l’intérieur du même mode de production le marché (la sphère des échanges) peut, dans
certains cas, déterminer le type de production [K. M arx, 1957 , 77-99].
Cela veut dire que lorsque le marché grandit, le volu me de production augm ente également. I.
Wallerstein utilise ce dern ier poin t de la théorie de Marx pour appu yer sa position sur la circulation. Il
commet cependant une erreur dans le sens où la circulation du capital des pays développés vers les pays
du Sud ne signifie pas que les économies du Sud aient forcément été changées en économies capitalistes.
Le caractère de la production de type capitaliste est déterminé par l’auto-exp ansion d e la valeur d u capital,
soit la production d’un surplus. De manière plus spécifique, l’argent ou les prod uits qui arrivent dans le
Tiers Monde devraient se retrouver à l’intérieur du système de production du capital et devraient
transformer la valeur ajoutée en capital.
3. La priorité aux rapports d’échange
La théorie du système-monde tente d’expliquer le problème du développemen t capitaliste sur la
base de rapports d’échange. I. Wallerstein considère que les Etats-nations, dans le monde moderne, ne
sont pas fermés. Ils sont ouverts et dépendants des échanges économiques avec les autres pour un
approvisionnement continu et sans heurts de leurs besoins individuels. Il fait dès lors une simple équation
entre le capitalisme et l’économie mondiale, comme les deux côtés d’un même angle, une seule division
du travail mais de multiples politiques. Il s’agit d’un problème ambigu dans le sens où le système mondial
est constitué de relations d’échange plutôt que constituant un mode de production unitaire. I. Wallerstein
insiste sur les relations inégales entre Etats-nations pour affermir sa position. Mais en faisant cela, il se
contredit et affirme que des changements dans les pays du centre provoqueront des modifications
ultérieures dans les pays périphériques.
La principale limite de cette théorie est donc de définir le capitalisme comme l’unique mode de
production du monde contemporain, et comme déterminant chaque aspect de l’économie et de la politique
des pays du Sud. Il s’agit d’une généralisation quelque peu excessive parce que la domination du
capitalisme mondial ne signifie pas que d’autres élém ents n’existent pas. Dans nombre de pays, y compris
le Bangladesh, il est évident que le capitalisme n’est pas dominant dans sa forme de compétition et de
monopole. On a donc affaire à une production tant de biens de base que de produits manufacturés, ainsi
qu’à des relations de production précapitalistes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%