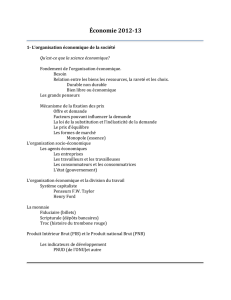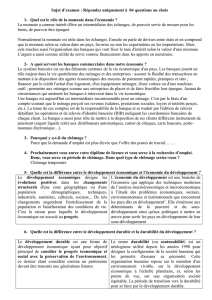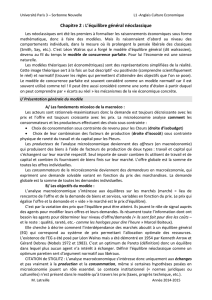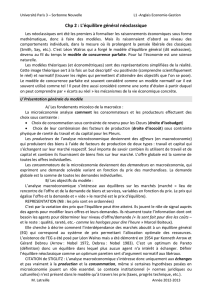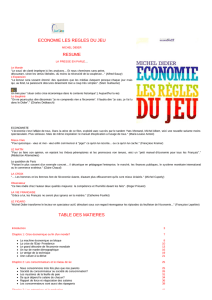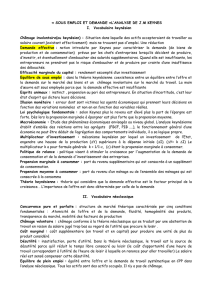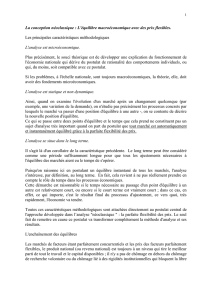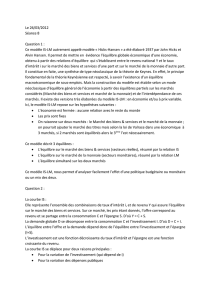Équilibre Général Néoclassique : Cours d'Économie

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle L1 -Anglais Economie-Gestion
M. Latreille Année 2012-2013
Chapitre 2 : L’équilibre général néoclassique
Les néoclassiques ont été les premiers à formaliser les raisonnements économiques sous forme
mathématique, donc à faire des modèles. Mais ils raisonnaient d’abord au niveau des
comportements individuels, dans la mesure où ils prolongent la pensée libérale des classiques
(Smith, Say, etc.). C’est Léon Walras qui a forgé le modèle d’équilibre général (dit walrassien),
devenu au fil du temps le modèle de concurrence parfaite. Pour lui l’économie est une science
naturelle.
Les modèles théoriques (et économétriques) sont des représentations simplifiées de la réalité.
Cette image théorique sert à la fois un but descriptif -ou positiviste (comprendre scientifiquement
le réel) et normatif (trouver les règles qui permettent d’atteindre des objectifs que l’on se pose).
Le modèle de concurrence parfaite est souvent considéré comme un modèle normatif car il est
souvent utilisé comme tel ! Il peut être aussi considéré comme une sorte d’étalon à partir duquel
on peut comprendre par « écarts au réel » les mécanismes de la vie économique concrète.
I/ Présentation générale du modèle
A/ Les fondements micoéco de la macroéco :
La microéconomie analyse comment les consommateurs et les producteurs effectuent des
choix sous contrainte :
Choix de consommation sous contrainte de revenu pour les Cteurs (droite d’isobudget)
Choix de leur combinaison des facteurs de production (droite d’isocoût) sous contrainte
physique de rareté du travail et du capital pour les Pteurs.
Les producteurs de l’analyse microéconomique deviennent des offreurs (en macroéconomie)
qui produisent des biens à l’aide de facteurs de production de deux types : travail et capital qui
s’échangent sur leur marché respectif. Seul importe de savoir combien ils utilisent de travail et de
capital et combien ils fournissent de biens finis sur leur marché. L’offre globale est la somme de
toutes les offres individuelles.
Les consommateurs de la microéconomie deviennent des demandeurs en macroéconomie, qui
expriment une demande solvable variant en fonction du prix des marchandises. La demande
globale est la somme de toutes les demandes individuelles.
B/ Les objectifs du modèle :
L’analyse macroéconomique s’intéresse aux équilibres sur les marchés (marché = lieu de
rencontre de l’offre et de la demande de biens et services, variables en fonction du prix. Le prix qui
égalise l’offre et la demande et « vide » le marché est le prix d’équilibre).
REPRESENTATION (NB : les prix sont en ordonnées)
C’est par la variation des prix que l’équilibre peut être atteint. Ils jouent le rôle de signal auprès
des agents pour modifier leurs offres et leurs demandes. Ils résument toute l’information dont ont
besoin les agents pour déterminer leur niveau d’offre/demande (« ils sont fait pour dire les coûts –
et le reste : qualité, rareté, etc.- comme les horloges pour dire l’heure » Marcel Boiteux).
Elle cherche à décrire comment l’interdépendance des marchés aboutit à un équilibre général
(EG) qui correspond au système de prix permettant l’allocation optimale des ressources.
L’existence de l’EG a été posé par Léon Walras mais a été démontré en 1954 par Kenneth Arrow et
Gérard Debreu (Arrow : Nobel 1972, Debreu : Nobel 1983). C’est un optimum de Pareto
(définition) donc un équilibre dans lequel plus aucun agent n’a intérêt à échanger. Définir
l’équilibre néoclassique comme un optimum paretien sert d’argument normatif aux libéraux.
CITATION de STIGLITZ : L’analyse macroéconomique s’intéresse donc uniquement aux échanges
et pas vraiment à la production et la consommation, même si certaines hypothèses posées en
microéconomie jouent un rôle essentiel. Le contexte institutionnel (= normes juridiques ou
culturelles) n’est présent dans le modèle qu’à travers les prix (taxes, progrès technique, etc.).

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle L1 -Anglais Economie-Gestion
M. Latreille Année 2012-2013
II/ Principes de construction du modèle néoclassique
Les acteurs sont rationnels-maximisateurs donc la demande est toujours décroissante avec les
prix et l’offre est toujours croissante avec les prix.
A/ Les « conditions de la concurrence parfaite ».
ATOMICITE / La concurrence se définie comme la rencontre sur un marché d’une multitude
d’offreurs et de demandeurs. En macroéconomie cette hypothèse ne sert à rien puisqu’on a une
demande globale pour chaque bien et une offre globale. En revanche, ce qui importe est que les
quantités offertes et demandées s’ajustent en fonction des prix, donc que les agents soient « price
takers ». Or, la situation réelle qui assure que les agents ne peuvent influencer les prix est celle où
leur petite taille leur interdit d’influencer le marché (d’avoir un pouvoir de marché).
HOMOGENEITE / Pour qu’un agent n’influence pas le prix, il ne doit pas pouvoir modifier le
produit. Tous les produits échangés sur un marché sont donc considérés comme strictement
identiques. Sur certains marchés (du travail, du logement,…) on sait que chaque bien est unique.
LIBRE ENTREE + MOBILITE des facteurs de production / Pour que les ressources soient allouées de
la meilleure façon possible, il faut que les facteurs de production puissent se déplacer librement,
sans délai et sans coût.
TRANSPARENCE / L’information de tous les agents est parfaite. Ils doivent tout savoir sur la qualité
des biens échangés mais aussi sur l’existence et sur la situation sur tous les marchés. Par exemple,
sur le marché du travail, dès que le prix diminue, les contrats doivent être renégociés
instantanément.
On voit que toutes ces conditions sont idéal-typiques, qu’elles ne sont que des représentations
simplifiées de la réalité. Mais leur côté « approximation » de la réalité n’invalide pas le modèle. En
revanche, il faudra avoir en tête que les différences entre les résultats du modèle et la réalité
viennent sans doute en grande partie du caractère « approximatif » de ces hypothèses.
B/ La loi des débouchés
C’est une hypothèse essentielle. Les mécanismes de marché assurent un débouché à toutes les
productions (quitte à le faire à des prix très faibles…). Tous les facteurs de production sont tous
employés à des prix déterminés par le modèle. On doit à Jean-Baptiste SAY l’énoncé de cette loi.
(PPT) Elle repose sur l’idée que tout le revenu créé par la production est utilisé pour demander ces
mêmes produits. Il n’y a pas de fuite dans le circuit, pas d’argent non utilisé. Si les agents
épargnent, cette épargne servira aux entreprises à acheter des biens de production qui forment
une partie de l’offre des biens. L’épargne sera égale à l’investissement.
Ainsi, la demande globale DOIT être égale à l’offre globale, et une surproduction généralisée est
inconcevable. On va donc vers un équilibre.
CONSEQUENCE 1 : Il ne peut pas y avoir de surproduction et plus on produit plus on gagne.
Logique de croissance extensive (« travailler plus pour gagner plus »)
CONSEQUENCE 2 : La monnaie est un simple intermédiaire des échanges, un bien qui n’est pas
demandé pour lui-même puisque toute l’épargne est nécessairement dépensée. Le modèle
néoclassique est bien un modèle de troc (type Robinson sur une île).
CONSEQUENCE 3 : Les théoriciens classiques et néoclassiques sont des économistes de l’OFFRE.
Le niveau de production global dépend forcément des quantités de facteurs de production
disponibles sur le marché : il détermine le niveau de revenus et le niveau des prix. Comme le
modèle néoclassique raisonne à court terme, c’est en particulier l’offre de travail qui déterminera
le niveau de production global (le niveau de capital est donné à court terme).

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle L1 -Anglais Economie-Gestion
M. Latreille Année 2012-2013
C/ La loi des rendements décroissants
C’est une hypothèse forte du modèle néoclassique. Elle énonce que la productivité décroit
quand les facteurs de production augmentent. Or les rendements peuvent être constants ou
même croissants, ce qu’on nomme économie d’échelle.
Les rendements doivent être posés comme décroissants, pour qu’une entreprise ne monopolise
pas toute la production en baissant des coûts avant les autres et pour que les courbes de demande
de travail soient décroissantes. En effet, l’utilité marginale du loisir est également décroissante ce
qui fait qu’on demande un plus grand salaire quand on travaille plus (car on sacrifie plus de loisirs
dont le coût d’opportunité augmente).
EN RESUME : Les prix sont exogènes aux agents (ils s’imposent à eux, tout le monde est price
taker) mais sont endogènes au modèle (car déterminé par le modèle, par les rencontres entre
offres et demandes) mais. C’est pour ça qu’on les met en ordonnée. Les quantités et les revenus
sont également endogènes et découleront des équilibres qui s’établiront sur les marchés.
Les vraies variables exogènes sont les dotations initiales des offreurs et des demandeurs, la
technologie et les goûts des consommateurs (qui vont permettre de définir leurs offres et leurs
demandes).
III/ Les propriétés de l’équilibre général walrassien
A/ L’équilibre sur le marché des biens et services
Nous allons montrer que l’équilibre général aboutit à la meilleure efficacité et à la meilleure
efficience des marchés. La productivité est le produit de l’efficacité et de l’efficience (pas la
somme, car si l’efficacité est nulle, l’efficience ne sert à rien)
1°) Principe de l’efficacité (=efficiency) des marchés concurrentiels
Les marchés concurrentiels sont efficaces car ils satisfont les consommateurs, non seulement
parce qu’ils trouvent à acheter tout ce qu’ils veulent au prix du marché, mais parce que certains
d’entre eux étaient prêts à payer plus pour le même bien. Cette idée s’observe dans l’étude du
« surplus du consommateur » (qui devrait être au pluriel mais c’est LE consommateur au sens
générique). C’est l’hypothèse de décroissance de l’utilité marginale qui permet de comprendre
pourquoi les consommateurs étaient prêts à payer plus les premières unités consommées. Le(s)
producteur(s) retirent aussi un surplus de la détermination du prix d’équilibre dans la mesure où
ils étaient à vendre moins cher une plus petite quantité de biens (leurs rendements décroissants
leur assuraient quand même des profits élevés).
On constate que le surplus total augmente quand les courbe d’offre (ou de demande) se
déplacent vers la droite. Le surplus est donc un bon indicateur de « bien-être » social puisque sa
hausse accompagne la hausse des quantités échangées.
Une conséquence : l’intervention de l’Etat réduit l’efficacité des marchés. La preuve par le
contrôle des loyers. On voit que le surplus global diminue. Seuls ceux qui ont déjà un logement
sont gagnants : les propriétaires et tous les demandeurs qui ne trouvent pas de logement sont
pénalisés. Comme le plafonnement rend moins rentable l’offre de logements, elle va diminuer.
L’Etat peut aider les locataires en redistribuant les revenus en leur faveur, mais sans toucher au
prix d’équilibre sur le marché. Stiglitz : « On ne peut pas faire comme si les lois de l’offre et de la
demande n’existaient pas » ;
Conclusion : Sur un marché concurrentiel, le prix et la quantité d’équilibre correspondent au
surplus total le plus élevé possible. (Smith : 1° citation)

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle L1 -Anglais Economie-Gestion
M. Latreille Année 2012-2013
2°) Conditions de l’efficacité (ou de l’efficience) « au sens de Pareto »
Une économie est Pareto efficace à trois conditions : que les échanges soient efficaces, que la
production le soit et que la combinaison des biens produits le soit aussi.
Echanges efficaces : quand chacun reçoit les biens qu’il aime. A la fin de l’échange, les individus
n’ont plus de raisons d’échanger. Chaque consommateur, par ses actions individuelles, contribue à
assurer l’efficacité de l’échange. Personne ne peut savoir mieux que lui ce dont il a besoin (Smith :
2° citation).
Production efficace : il n’est pas possible d’accroitre la production d’un bien sans réduire la
production d’au moins un autre bien. L’économie doit se situer sur sa frontière des possibilités de
production. En passant de P1 à P2 on améliore le bien-être de la société. Mais comment choisir
entre P2 et P’2 ?
Efficacité de la combinaison des biens produits : c’est le système de prix qui va orienter vers la
production du bien A ou du bien B. Si la demande de A augmente relativement à son offre, le prix
va augmenter et va attirer des offreurs sur ce marché.
La concurrence peut donner lieu à une économie très efficace mais dont la répartition des
ressources (même optimale) est très inégalitaire. L’efficacité au sens de Pareto ne veut pas dire
qu’il n’existe aucun moyen d’améliorer le sort d’une ou de plusieurs personnes. Il est toujours
possible de retirer des ressources aux uns pour les donner aux autres, et d’améliorer ainsi le bien-
être de ces derniers. Pour redistribuer les revenus, la société n’est pas obligée de supprimer les
marchés concurrentiels. Il lui suffit de redistribuer les richesses détenues par les individus, SAUF
QUE presque toutes les mesures que prend l’Etat en matière de redistribution interfèrent avec le
fonctionnement de l’économie de marché. Citation de Stiglitz sur l’éducation, AVEC UNE LIMITE :
en produisant trop de diplômés l’Etat modifiera la valeur des diplômes…
B/ L’équilibre sur le marché du travail
La demande de travail dépend d’abord de la productivité marginale du travail : un salarié ne
peut pas être payé en dessous de sa productivité marginale. Ex : Si un apprenti boulanger
permet pendant 30 jours de faire 50 baguettes de plus par jour à 0,5 € de bénéfice unitaire, il
sera embauché si son salaire ne dépasse pas 50 x 0,5 x 30 = 750 €.
Comme la productivité marginale du travail est décroissante (en raison de la loi des rendements
décroissants) la demande de travail est décroissante en fonction du niveau moyen de salaire. En
effet, on suppose qu’au départ les employeurs embauchent les salariés les plus productifs à un
niveau de salaire égal à leur productivité marginale (donc élevé). Si les employeurs embauchent
plus de salariés, ils vont les choisir de moins en moins productifs et vont donc baisser le niveau
moyen de salaire en conséquence. Les payer autant que les premiers embauchés, plus productifs,
ne serait simplement pas rationnel, ni concurrentiel : un employeur « altruiste » qui s’y risquerait
aurait des coûts de production supérieurs à ses concurrents et ne serait pas compétitif.
La demande de travail dépend aussi du niveau des prix des biens vendus : si le prix des
baguettes augmente de 0,10 €, on embauchera des apprentis boulangers jusqu’à 900 €/mois.
Donc, la demande de travail dépend exactement du niveau moyen des salaires réels. Le salaire
réel est le salaire nominal divisé par le niveau des prix.
Puisque les salariés arbitrent entre le loisir et le travail, leur offre de travail est croissante avec
le salaire proposé. En effet, plus on travaille, plus le coût d’opportunité du loisir augmente,
c’est-à-dire que la valeur du temps de loisir sacrifié augmente (puisqu’il se fait rare). Seul un
salaire plus élevé peut donc justifier que le salarié se prive d’une heure supplémentaire de
loisirs. : l’effet de substitution joue dans un premier temps.

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle L1 -Anglais Economie-Gestion
M. Latreille Année 2012-2013
A un certain niveau d’heures travaillées (correspondant au revenu maximum souhaité par le
salarié), la hausse du salaire peut avoir un effet inverse et justifier que le salarié n’offre pas plus de
travail mais moins, dans la mesure où la hausse de salaire lui permet d’atteindre son niveau de
revenu souhaité en moins de temps, et donc de libérer du temps de loisirs. Cela se traduit
graphiquement par une offre de travail « coudée », que l’on n’utilise pas en théorie dans la
mesure où à une certaine quantité de travail correspondrait à deux niveaux de salaires possibles,
ce qui empêche de déterminer un prix unique d’équilibre.
La courbe d’offre de travail peut se déplacer vers la droite ou la gauche en raison de nombreux
facteurs démographiques :
Les variations de la population active :
• Arrivée/départ de main d’œuvre immigrée
• Décalage générationnel entre nombre d’actifs entrants et nombre de sortants
• Modification des taux d’activité féminins
Les modifications des conditions d’embauche
• Développement des emplois flexibles, temps partiels, etc.
• Développement des contrats aidés (emploi d’avenir, etc.)
Les modifications de la protection sociale
• Modifications des allocations (familiales, chômage, etc.)
• Modifications des minima sociaux (SMIC, etc.)
Les modifications des modes de vie
• Durée des études, natalité et émancipation féminine, etc.
L’équilibre sur le marché du travail :
Pour les néoclassiques, le marché du travail doit s’équilibrer au niveau qui utilise toutes les
capacités de production. En effet, s’il existe de la main d’œuvre inutile et prête à se « louer », son
prix va baisser jusqu’à sa totale utilisation. Il ne peut rester que du chômage volontaire : chômage
de ceux qui ne travaillent pas en raison du trop faible niveau du salaire du marché. En revanche,
en présence de flexibilité des prix, il n’existe pas de chômage involontaire. Pour les monétaristes,
comme Milton Friedman (1912-2006) Nobel 1976, c’est le niveau de chômage naturel.
Les entreprises sont-elles responsables du chômage ? Les entreprises ne manquent pas de
débouchés (-> SAY’s Law) MAIS elles manquent de salariés pour produire autant qu’elles
voudraient. Les entreprises ne peuvent rationnellement pas embaucher à ce niveau de
(sur)salaire. Ce chômage qui n’est pas dû à une insuffisance de la demande de travail mais aux
salaires rigides qui empêchent l’embauche est nommé chômage classique (par opposition au
chômage keynésien).
En théorie, le niveau de salaire d’équilibre est celui qui supprime(rait) le chômage
volontaire. Il n’y a(aurait) ni chômage volontaire, ni chômage involontaire possible si les prix sont
(étaient) parfaitement flexibles.
En réalité, il peut rester du chômage frictionnel, ou chômage d’ajustement, lié aux
passages des actifs d’un marché du travail à l’autre. Il peut également exister un chômage
structurel lié aux mutations sectorielles. Enfin, les entreprises peuvent surpayer leurs salariés pour
garantir un bon niveau de productivité (salaire d’efficience –Voir TD sur le SMIC).
 6
6
 7
7
1
/
7
100%