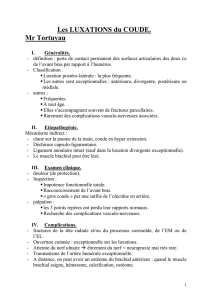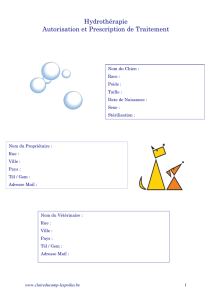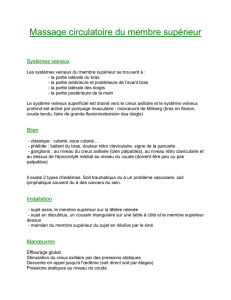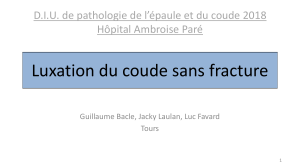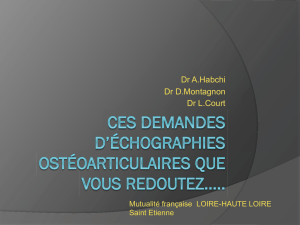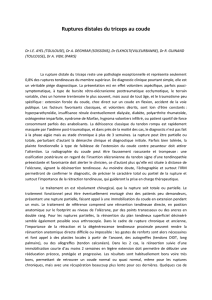Le coude du sportif - Faculté de Médecine de Montpellier

L’OBSERVATOIRE
DU MOUVEMENT
LA LETTRE
LETTRE D’INFORMATION Décembre 2012
n° 46
Le coude est très sollicité dans la plupart des activités
sportives et professionnelles. Les lésions rencontrées
sont très diverses, directement dépendantes du geste
sportif et professionnel.
La gymnastique est plus fréquemment responsable
de pathologie intra-articulaire, le tennis d’une
pathologie mixte du compartiment latéral, les sports
de lancer d’une pathologie mixte tendino-musculaire
et capsulo-ligamentaire du compartiment médial
(compression latérale et distraction médiale).
Le bilan clinique et l’imagerie doivent orienter vers
un diagnostic précis. Le traitement médical et la
physiokinésithérapie occupent une large place (inl-
tration, prévention antalgique, repos, rééducation).
Ce n’est qu’en cas d’échec que le traitement chirurgical
doit être envisagé.
Nous tenons à remercier les auteurs de ces diérents
chapitres du coude du sportif. Le Pr F. Bonnel et le Pr
P. Mansat par leur analyse biomécanique du coude,
le Dr H. Chiavassa-Gandois toujours disponible,
comme l’ensemble de l’équipe du Pr J.J. Railhac pour
ses conseils concernant l’imagerie du coude, le Dr D.
Gasq et O. Ucay concernant les nouveautés dans le
domaine médical dans les tendinopathies et enn le
Pr P. Mansat pour avoir accepté de prendre en charge
cette Lettre sur le coude du sportif avec l’appoint chez
le jeune sportif du Pr F. Accabled.
Pr. Michel Mansat
LE COUDE DU SPORTIF
Éditorial : M. Mansat 1
Anatomie et cinématique du coude :
F. Bonnel, P. Mansat 1
Imagerie du coude du sportif : H. Chiavassa-Gandois 4
Lésions tendino-musculaires et articulaires
du coude du sportif : P. Mansat 6
Nouvelles approches thérapeutiques médicales de la
tendinopathie des épicondyliens : D. Gasq, O. Ucay 9
Luxation du coude et instabilité : P. Mansat 10
Le coude du vieux sportif : P. Mansat 12
Le coude douloureux du jeune sportif :
F. Accadbled 13
Opinion : Ch. Mansat 14
Éditorial
Anatomie et cinématique du coude
Le complexe articulaire du coude a un programme mécanique double: d’une part, d’al-
longement-raccourcissement lors de la préhension nécessitant une grande mobilité et,
d’autre part, de stabilité dans les transmissions des pressions. Ce module mécanique
oriente, dirige et positionne l’organe terminal de la préhension avec mise en jeu syner-
gique des articulations sus- et sous-jacentes.
Eléments de la stabilité
du coude
La stabilité du coude dépend de facteurs
statiques, et de facteurs dynamiques. Les
éléments statiques sont représentés par
l’ensemble des structures articulaires et cap-
sulo-ligamentaires, et les éléments dyna-
miques, par les muscles péri-articulaires.
Stabilité statique
Elle résulte de la congruence articulaire hu-
méro-ulnaire et huméro-radiale, et de la ten-
sion des éléments capsulo-ligamentaires.
Les ligaments assurent 50 % de la stabilité en
varus-valgus, l’articulation assurant les 50 %
restants. Ce n’est que lorsque le coude est
en extension que la totalité de la stabilité est
assurée par l’articulation huméro-ulnaire et la
capsule antérieure quel que soit l’état des liga-
ments collatéraux.
L’articulation huméro-ulnaire
L’articulation du coude est une des plus
contraintes du squelette en raison de la forte
congruence entre la trochlée humérale, et
l’incisure trochléaire de l’ulna. Une résec-
tion intéressant plus de 50% de l’olécrâne,
entraîne une instabilité du coude aussi bien
rotatoire que latérale. En varus, et à 90 degrés
de exion, la congruence articulaire assure 75
à 85 % de la stabilité. Le processus coronoïde
représente également un élément important
pour préserver la congruence articulaire. Il
s’oppose aux contraintes antéro-postérieures
au niveau de l’articulation et se comporte
comme une butée antérieure s’opposant au
déplacement postérieur de l’avant-bras. Au
moins 50% du processus coronoïde doivent
être présents pour que l’articulation humé-
ro-ulnaire reste stable.
L’articulation huméro-radiale
La tête radiale intervient dans la résistance à la
compression à partir de 90 degrés de exion.
Son rôle dans la résistance en valgus est forte-
ment lié à l’état du complexe ligamentaire col-
latéral médial. Lorsque la résection de la tête
radiale est associée à une section du ligament
collatéral médial, le coude devient instable et
se subluxe. En cas de lésion du ligament colla-
téral médial, la présence de la tête radiale
va entraîner une résistance
susante lors du valgus pour
prévenir une subluxation.

N° 46 - Pag e 2 - La L e t t r e d e L’ObservatOire du MouveMent
La tête radiale a également un rôle de cale li-
mitant l’ascension du radius par rapport à l’ul-
na notamment lors des lésions associées de la
membrane interosseuse. Sa conservation est
importante lors du syndrome d’Essex-Lopresti,
qui associe une lésion des ligaments radio-ul-
naires distaux et de la membrane inter-os-
seuse, pour éviter une déstabilisation de l’arti-
culation radio-ulnaire distale.
La capsule articulaire
Le rôle de la capsule antérieure dans la stabi-
lité du coude est prépondérant en extension.
La capsule s’oppose à l’eort d’étirement assu-
mant 70 % de la tension des parties molles et
ceci d’autant plus que les ligaments collaté-
raux sont lésés.
Le ligament collatéral ulnaire
Le ligament collatéral ulnaire (LCU) est com-
posé de 3 faisceaux tendus de l’épicondyle
médial à l’extrémité proximale de l’ulna. Le
faisceau antérieur est le plus volumineux et le
plus résistant, et s’étend de la face inférieure
de l’épicondyle médial à la face médiale du
processus coronoïde. Le faisceau postérieur,
plus n, s’étale en éventail depuis la face in-
férieure de l’épicondyle médial jusqu’à la face
médiale de l’olécrâne. Entre les 2, se situe le
faisceau transverse. Le LCU est un élément
primordial de la stabilité statique du coude en
valgus notamment son faisceau antérieur. Il
assure près de 78 % de la stabilité antéro-pos-
térieure. A 90 degrés de exion, même en
l’absence de la moitié de l’olécrâne, le coude
reste stable si le LCU est intact. S’il est rompu,
l’instabilité antéro-postérieure est majeure.
Les fractures de la facette antéro-médiale du
processus coronoïde intéressent l’insertion de
ce faisceau antérieur compromettant la stabi-
lité en valgus du coude.
Le complexe ligamentaire radial
Le complexe ligamentaire latéral est formé du
ligament collatéral latéral (LCR) et du ligament
annulaire. Le LCR est composé de 3 faisceaux:
un faisceau antérieur tendu entre la partie
antéro-inférieure de l’épicondyle latéral et le
ligament annulaire, un faisceau moyen hu-
méro-ulnaire ou faisceau ulnaire du ligament
collatéral latéral d’origine identique, mais qui
se termine sur la crête supinatrice de l’ulna, et
un faisceau postérieur représentant un simple
épaississement de la capsule. L’origine du LCR
se situe au niveau du centre de exion-exten-
sion du coude, ce qui explique son isométrie
tout au long de la exion du coude. Le fais-
ceau ulnaire du LCR va participer à la stabili-
té latérale de l’articulation huméro-ulnaire,
à la stabilité en rotation, et résister au varus.
O’Driscoll a démontré qu’une instabilité rota-
toire du coude n’était possible que si le fais-
ceau ulnaire du LCR était sectionné; lorsqu’il
est réparé, l’instabilité disparait.
Stabilité dynamique
Il existe peu de données biomécaniques cla-
riant le rôle des stabilisateurs dynamiques.
Stabilisateurs
principaux
Théorie de la stabilité du coude selon Morrey.
Stabilisateurs
secondaires
LC
RL
CU
Articulation huméro-ulnaire
Tête radiale
Capsule Muscles

N° 46 - Pag e 3 - La L e t t r e d e L’ObservatOire du MouveMent
Les échisseurs du coude (biceps brachial et
brachial antérieur) et les extenseurs (triceps
brachial) assurent la coaptation du coude
pour augmenter la congruence de l’articula-
tion huméro-ulnaire. Le groupe des échis-
seurs-pronateurs participe à la stabilisation
en valgus du coude. L’anconé pour sa part,
exerce une action stabilisatrice en varus. Les
muscles épicondyliens latéraux avec leur fas-
cia et le septum inter-musculaire participent à
un moindre degré à la stabilité postéro-laté-
rale en s’opposant aux déplacements posté-
rieurs de l’avant-bras.
La stabilité du coude va reposer sur l’intégri-
té du trépied principal représentant les élé-
ments essentiels de la stabilité: le processus
coronoïde, le LCR et le LCU. Lorsqu’un de ces
éléments est lésé, il peut être compensé par
les éléments du trépied secondaire compre-
nant la tête radiale, la capsule articulaire et les
muscles.
Cinématique et sport
Le coude en position intermédiaire va, par
son positionnement, augmenter ou diminuer
le rendement du geste. Il est sollicité dans de
manière diérente en fonction du sport pra-
tiqué.
Dans les sports de lancer (baseball, javelot),
les contraintes au niveau du coude sont maxi-
males pendant la phase d’accélération et la
n du geste. Pendant la phase d’accélération
se produit une augmentation importante des
contraintes en extension et en valgus entraî-
nant une hypersollicitation des structures sta-
bilisatrices médiales et postérieures du coude.
Pendant la n du geste, il existe une forte dé-
célération au niveau du coude contrôlée par
le tonus musculaire. En cas d’incompétence
musculaire, la vitesse du coude n’est plus limi-
tée que par les structures ligamentaires mé-
diales, et notamment le faisceau antérieur du
LCU. Ces forces peuvent excéder la force de
résistance du LCU entraînant des microlésions
ligamentaires. La poursuite ou la répétition
des lancés vont entraîner l’aaiblissement et/
ou la rupture du ligament. Ces contraintes en
valgus au niveau du coude vont entraîner, une
tension excessive sur l’ensemble des struc-
tures du compartiment médial du coude, un
syndrome de conit au niveau du comparti-
ment postérieur du coude et une compres-
sion au niveau des structures latérales.
Dans la pratique plus spécique du tennis, la
répartition des lésions se fait en premier lieu
sur les insertions des muscles épicondyliens
latéraux (revers), puis sur les muscles épi-
condyliens médiaux (service ; revers), enn
avec une fréquence moindre dans le délé
du nerf ulnaire, dans la fosse olécrânienne et à
l’insertion terminale du biceps.
Chez le golfeur, le coude est essentiellement
sollicité lors de l’impact sur la balle puisque
plus de 50% des lésions surviennent pendant
cette phase. Les douleurs latérales sont plus
fréquentes que les douleurs médiales avec un
ratio de 5:1. L’épicondylite latérale est plus fré-
quente au niveau du coude gauche chez un
droitier, alors que l’épicondylite médiale est
plus fréquente sur le coude droit. L’épicondy-
lite latérale intéresse le bras moteur, et l’épi-
condylite médiale le bras accompagnateur.
Au cours de la natation et plus spécialement
dans le crawl, la position du coude demeure
un sujet de controverse. Pour certains, la
force de propulsion est maximale avec le
coude en extension. Pour d’autres, c’est avec
le coude à 120° de exion que le rendement
est le meilleur.
Enn, au cours du lancer du poids, dans la
phase préparatoire d’élan, le coude est en po-
sition de exion maximale avec le poids pla-
cé au contact de la région cervicale. Dans la
phase du lancer proprement dit, le coude doit
passer de la position de exion à celle d’exten-
sion. Pour obtenir le meilleur rendement, la
vitesse de déplacement angulaire du coude
doit être la plus rapide possible avec un angle
de 45°. La même gestuelle peut être visualisé
chez l’haltérophile, avec un passage brutal de
la exion à l’extension du coude.
Pr. François Bonnel, Pr. Pierre Mansat
Aspect schématique de l’articulation du coude

N° 46 - Pag e 4 - La L e t t r e d e L’ObservatOire du MouveMent
Imagerie du coude du sportif
Modalités d’imagerie
Les radiographies standard doivent être réali-
sées en première intention après un examen
clinique précis an d’orienter ou de poser un
diagnostic. Elles comprennent une incidence
de face et une incidence de prol. Des inci-
dences obliques peuvent compléter le bilan.
L’échographie permet d’explorer les parties
molles périarticulaires, particulièrement les
lésions tendineuses et ligamentaires. Bien
qu’opérateur dépendant, c’est un examen
rapide, peu couteux, et dynamique. La to-
modensitométrie (TDM) n’a d’intérêt que
pour la recherche de lésions osseuses dans le
cadre du coude traumatique, en précisant le
nombre de fragments, leur déplacement et
leur rapport avec les surfaces articulaires. L’ar-
thro-TDM permet d’analyser le cartilage et les
surfaces osseuses, et détecte des corps étran-
gers. L’IRM permet l’analyse de l’ensemble
des éléments constitutifs du coude : muscles,
structures tendino-ligamentaires, structures
osseuses et cartilagineuses. L’injection intra-
veineuse de gadolinium avec saturation des
graisses s’avère parfois nécessaire dans cer-
tains contextes de traumatismes chroniques,
à la recherche de processus inammatoires
tendineux, synoviaux… L’artro-IRM a un in-
térêt dans les pathologies ligamentaires,
notamment dans les bilans d’instabilité du
coude, dans la recherche d’ostéochondroma-
tose et dans les bilans d’ostéochondrites.
La pathologie épicondylienne
Radiographies standard : Leur intérêt est li-
mité, car elles sont le plus souvent normales.
Les calcications des parties molles épicondy-
liennes sont rares. Il existe parfois voir des irré-
gularités corticales du condyle huméral, voir
des signes d’arthrose huméro-radiale.
Echographie : Elle conrme le diagnostic dans
les cas douteux, précise la sévérité des lésions
et permet de suivre la réponse sous traite-
ment : épaississement hypoéchogène du
tendon en regard de son insertion, perte de
l’aspect brillaire, zones de clivage en rapport
avec la rupture partielle ou totale, épaississe-
ment des parties molles péri-tendineuse, et
ne lame liquidienne supercielle à l’origine
du tendon. En phase chronique, il existe des
irrégularités corticales, des productions os-
seuses sur l’épicondyle latéral.
L’IRM permet de quantier la dégénérescence
tendineuse, le degré de rupture, l’évaluation
des structures adjacentes, et particulièrement
l’état du tendon court extenseur radial du
carpe et du ligament collatéral latéral. Elle per-
met la détection d’anomalies de l’interligne hu-
méro-radial et du cartilage. La présence d’une
image méniscoïde de l’interligne radio-humé-
ral appelé « ménisque » n’est pas rare. Elle se
présente sous la forme d’une petite formation
triangulaire en hyposignal en T1, et en signal
intermédiaire ou en hypersignal en T2.
Pathologies traumatiques du
tendon distal du biceps brachial
Échographie : En cas de rupture complète
elle montre l’absence du tendon du biceps
qui apparaît rétracté et la présence de liquide
hypoéchogène dans le lit tendineux en rap-
port avec l’hématome. Les ruptures partielles
sont moins fréquentes que les ruptures to-
tales. Elles apparaissent sous la forme d’un
épaississement ou un amincissement hypoé-
chogène tendineux, aux contours irréguliers
sans discontinuité.
L’IRM : Les signes de ruptures complètes sont :
une discontinuité tendineuse, un épanche-
ment liquidien dans la gaine bicipitale distale,
une rétraction tendino-musculaire et l’exis-
tence d’une masse mal dénie au niveau de
la distalité tendineuse. Les ruptures partielles
se situent le plus souvent au niveau de l’inser-
tion tendineuse ; elles seront évoquées devant
un amincissement tendineux, un hypersignal
intratendineux en séquence pondérée T2 et
la présence de liquide péritendineux. Le dia-
gnostic diérentiel de la tendinopathie du
biceps brachial est la bursite radiale bicipitale.
Pathologies du tendon du triceps
brachial
Echographie : Le tendon rompu est irrégu-
lier, rétracté et entouré par du liquide. L’écho-
graphie dénit le degré de rétraction tendi-
neuse et aide au diagnostic de lésion partielle.
Une bursite olécranienne est retrouvée, par-
ticulièrement dans le cadre de microtrauma-
tismes répétés.
IRM : Conrme la rupture et précise les lé-
sions partielles. Les tendinopathies tricipitales
se révèlent en IRM par un épaississement
tendineux et des modications du signal in-
tra-tendineux.
Pathologie ligamentaire et
instabilité du coude
Echographie : Elle permet d’étudier le liga-
ment collatéral ulnaire. L’analyse est bilatérale
et comparative, en position neutre et en val-
gus forcé. Une lésion ligamentaire se traduit
par un aspect hypoéchogène avec interrup-
tion de la continuité des bres. L’étude en val-
gus forcé permet de mesurer l’ouverture de
l’interligne articulaire huméro-ulnaire et de la
comparer à l’ouverture mesurée en position
neutre.
L’IRM : En aiguë, l’IRM visualise une contusion
osseuse sur le compartiment latéral associée
à l’atteinte ligamentaire ; une atteinte des
tendons échisseurs est fréquente. La majo-
rité des lésions (90 %) se localise au niveau
des bres moyennes et proximales du fais-
ceau antérieur du ligament collatéral ulnaire.
Dans 10 % des cas, l’atteinte est distale. Lors
de ruptures complètes, il existe une solution
de continuité ligamentaire. Les lésions chro-
niques liées à des microtraumatismes répé-
tés se caractérisent par un épaississement
ligamentaire. Le ligament peut contenir des
calcications voire parfois une ossication
notamment au niveau de son insertion sur
l’apophyse coronoïde. L’arthro-IRM permet
dans ces cas de mieux localiser les éléments
ossiés au sein de la distension liquidienne
articulaire et permet de distinguer les lésions
ligamentaires complètes des lésions par-
tielles. Les examens sont identiques pour les
instabilités postéro-latérales du coude par
incompétence du ligament collatéral radial.
L’arthro-IRM semble l’examen le plus sensible
pour montrer la distension ligamentaire et/ou
la rupture.
Ostéochondrite disséquante
Radiographies standard : elles permettent
de visualiser les remaniements osseux le plus
souvent localisés au niveau du capitulum : dé-
minéralisation osseuse, kyste sous chondral
entouré d’un liseré osseux, fragmentation
et décrochage articulaire, voire corps étran-
gers intra-articulaires. L’arthro-TDM, l’IRM ou
l’arthro-IRM permettent de mieux préciser
ces lésions. L’IRM permet d’analyser le signal
du cartilage et l’interface entre la lésion os-
téochondrale et l’os natif ; La présence de li-
quide articulaire ou d’un tissu de granulation
en hypersignal sur les séquences sensibles
à l’œdème au niveau de cette interface té-
moigne d’une lésion instable. L’arthro-IRM a
pour avantages de faciliter la détection des
corps étrangers et d’établir la communication
entre le fragment osseux sous chondral et
l’articulation en suivant le trajet du produit de
contraste, confortant le diagnostic de lésion
instable.
Atteinte nerveuse
L’échographie permet de bien analyser les
structures nerveuses du coude, de préciser
une anomalie de calibre, d’échostructure ou
mettre en évidence une compression extrin-
sèque voire une instabilité dynamique du
nerf.
L’IRM fait aussi partie des techniques d’image-
rie dans les neuropathies du coude, en com-
plément de l’échographie.
Dr Chiavassa-Gandois Hélène, Service d’Imagerie
Médicale. CHU Purpan Toulouse

N° 46 - Pag e 5 - La L e t t r e d e L’ObservatOire du MouveMent
Lésions tendino-musculaires et articulaires
du coude du sportif
Le coude est sollicité dans de nombreux sports comportant des activités diverses comme,
lancer, rattraper, pousser, tirer ou maintenir le manche d’une raquette ou un club de golf.
Ces activités vont entrainer des lésions capsulo-ligamentaires, tendino-musculaires, ou
articulaires qui sont essentiellement liées à des sollicitations chroniques ou microtrauma-
tismes répétés.
Lésions au niveau du
compartiment médial
Le syndrome d’hypersollicitation
Il se rencontre chez les lanceurs, en relation
avec la présence de micro-lésions au niveau
du groupe musculaire des échisseurs-pro-
nateurs qui aboutissent à une contracture.
Ces lésions sont liées au rôle majeur de ces
muscles pour assurer la stabilité dynamique
en valgus du coude, ainsi qu’à la fatigue mus-
culaire apparaissant avec la répétition des
contractions lors des lancers. Les symptômes
sont caractérisés par la douleur et l’apparition
d’un oedème en regard du groupe musculaire
à l’eort. Il s’y associe un décit d’extension.
Le traitement est essentiellement médical et
basé sur le repos et la récupération.
Le syndrome de compression
fascial de Bennett
Il est lié à une hypertrophie de ce même
groupe musculaire qui vient se comprimer
contre le fascia, réalisant une forme de syn-
drome de loge. Cette compression se traduit
par une douleur médiale à l’eort ou après l’ef-
fort, obligeant le lanceur à arrêter ces activités
après quelques lancers. Le traitement repose
sur le repos, et un échauement adéquat. La
nécessité d’une fasciotomie chirurgicale est
exceptionnelle, et est réalisée en cas d’échec
du traitement conservateur.
L’épicondylite médiale ou
épitrochléalgie
Moins fréquente que les épicondylalgies laté-
rales (1:5), elle se rencontre assez spécique-
ment dans la pratique du golf qui nécessite
des mouvements répétés de exion et pro-
nation du poignet, main en prise de force sur
le club. La douleur, de type mécanique, se lo-
calise au niveau de l’insertion épicondylienne
de la masse des échisseurs-pronateurs, avec
diminution de la force de serrage. Elle pos-
sède souvent une irradiation descendante.
Les symptômes peuvent être aggravés ou
augmentés par la exion et la pronation du
poignet contre-résistance, doigts échis, en
inclinaison cubitale. Le traitement est avant
tout préventif : bonne hydratation, correc-
tion des mauvais gestes techniques, et choix
d’un matériel adapté. Le traitement curatif est
essentiellement conservateur, et repose sur
le soulagement de la douleur et le contrôle
de l’inammation, mais également sur des
exercices visant à favoriser la cicatrisation et
la régénération tendineuse. Le taux d’échec
du traitement conservateur varie de 5 à
15 %. Même chez les travailleurs manuels, le
pronostic est bon avec un taux de guérison
à 3 ans de 81 %. De plus, le retentissement
fonctionnel des épicondylites médiales est
moins important que celui des épicondy-
lites latérales tant en termes de douleur que
de fonction musculaire. Ainsi la chirurgie de
l’épicondylalgie médiale d’origine tendineuse
reste exceptionnelle. Elle consiste à désinsérer
les échisseurs-pronateurs, puis à les réinsérer
avec une eet d’allongement, régulariser l’épi-
condyle médial, ouvrir l’arcade du échisseur
ulnaire du carpe, et neurolyser le nerf ulnaire.
Atteinte du nerf ulnaire
Elle est soit isolée, soit associée à une autre lé-
sion du compartiment médial. Elle résulte d’un
traumatisme direct, d’un phénomène de trac-
tion, de compression ou de friction. Les lésions
par traction sont liées aux contraintes exercées
sur le nerf en cas d’instabilité en valgus du
coude. Les irritations du nerf par friction sont
en relation avec l’existence d’une subluxation
du nerf dans sa gouttière et éventuellement à
l’existence d’ostéophytes au niveau des bords
de cette gouttière. Enn l’hypertrophie mus-
culaire va entraîner une compression du nerf
ulnaire au niveau de l’arcade du échisseur ul-
naire du carpe. Le diagnostic d’atteinte du nerf
ulnaire repose sur l’existence d’un signe de Ti-
nel au niveau de la gouttière épitrochléo-olé-
cranienne, et la présence de paresthésies digi-
tales au niveau du territoire neurologique du
nerf ulnaire. La réalisation d’une électromyo-
graphie après épreuve d’eort conrme le dia-
gnostic, et permet d’évaluer la sévérité de l’at-
teinte et le pronostic. Cette pathologie répond
le plus souvent au traitement conservateur.
En cas d’échec, une neurolyse du nerf ulnaire
dans sa gouttière avec ou sans transposition
antérieure du nerf est réalisée.
Pathologie du ligament collatéral
ulnaire (LCU)
Les lésions du LCU résultent de contraintes
répétitives en valgus, qui vont entraîner des
microlésions intra-ligamentaires qui vont pro-
gressivement aaiblir le ligament, jusqu’à la
survenue d’une éventuelle rupture. Une rup-
ture brutale de ce ligament peut également
être rencontrée. Le diagnostic repose sur
l’existence d’une douleur localisée au niveau
du bord médial du coude lors de la phase
d’armer et d’accélération. L’examen retrouve
cette douleur en dessous de l’épicondyle
médial au niveau de l’articulation huméro-ul-
naire. La stabilité du coude en valgus est tes-
tée et peut mettre en évidence une instabilité.
Des examens complémentaires tels que des
radiographies en stress, un arthro-scanner ou
une arthro-IRM peuvent aider au diagnos-
tic. Le traitement est dans un premier temps
conservateur. Une rééducation spécique
du groupe des muscles échisseurs-prona-
teurs est préconisée. Le traitement chirurgical
n’est réservé qu’aux échecs des traitements
conservateurs. Il comprend la réparation ou la
reconstruction du faisceau antérieur du LCU
à l’aide d’un greon tendineux. Dans les rup-
tures aiguës, la réparation du ligament repré-
sente le traitement de choix.
Lésions au niveau du
compartiment latéral
Epicondylalgie latérale ou « Tennis
elbow »
Il s’agit d’une tendinopathie aiguë ou chro-
nique en relation avec une hypersollicitation
des muscles et tendons épicondyliens laté-
raux survenant chez le sportif entre 35 et 50
ans. Ce surmenage va entraîner une tendi-
nopathie dégénérative d’insertion au niveau
du cône tendineux des épicondyliens. Ces
lésions vont prédominer au niveau du ten-
don du court extenseur radial du carpe. C’est
la tendinopathie du coude la plus fréquente.
Elle peut être associée à une arthropathie hu-
méro-radiale par hyperpression et/ou à une
Compressions possibles du nerf ulnaire au
coude :
1 - aponévrose profonde du FCU
2 - sous l’arcade breuse entre les 2
chefs du FCU (arcadre d’Osborne)
3 - gouttière
épitrochléo-olécranienne
4 - au niveau de l’arcade
de Stuthers
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%