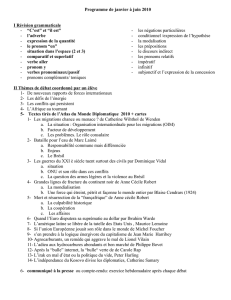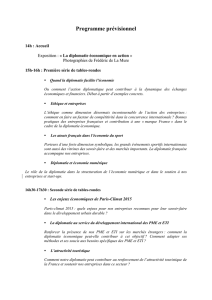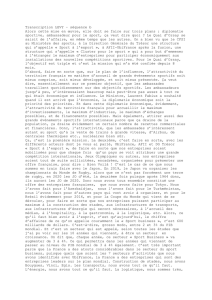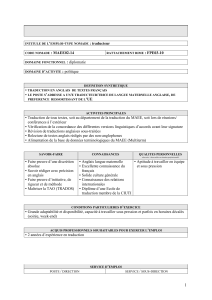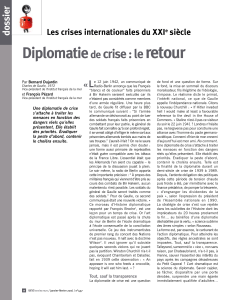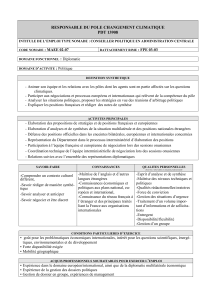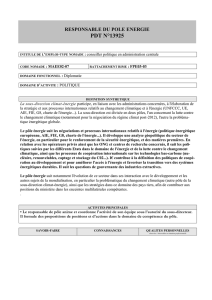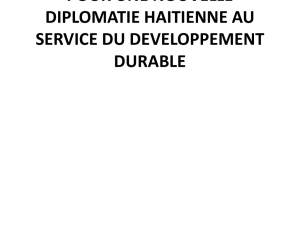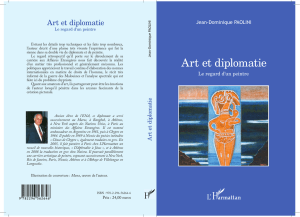quel apport de la diplomatie économique

Annexe technique_Développement international des entreprises_
Quel apport de la diplomatie économique ? Prise de position de la CCIP, 15 novembre 2012
1
Annexe technique
1 – Définition de la notion de diplomatie économique
La notion de diplomatie économique est difficile à définir : d'une part, parce qu'elle a des acceptions
différentes selon les acteurs et selon les pays et les gouvernements et, d'autre part, parce qu'elle se
définit "non par ses instruments, mais par les problèmes économiques qui lui donnent son contenu" 1.
On le voit aujourd'hui avec la question des investissements étrangers qui trouve sa place dans le
récent plan d'action du ministre des Affaires Étrangères (Cf. Tableau 1) 2.
En France, la notion de diplomatie économique "renvoie essentiellement au domaine des négociations
commerciales internationales, (…) et au développement de la diplomatie économique multilatérale" 3
avec le GATT à partir de 1945, puis avec l'OMC à partir de 1994.
Ramenée à l'échelle d'une entreprise, "tout l'enjeu de la diplomatie économique consiste à trouver les
bons « leviers d'action », à identifier les bons décideurs et à les influencer dans un sens favorable aux
intérêts de cette entreprise, tout en restant dans un cadre conforme aux valeurs éthiques
généralement admises" 4.
Certains parlent, enfin, de Business Diplomacy
5 pour qualifier le développement par les grandes
entreprises de leurs propres initiatives au travers de plusieurs canaux.
PLUSIEURS DEFINITIONS POUR UNE MEME EXPRESSION
"L’ensemble des mécanismes et pratiques adoptés par des individus ou groupes, étatique ou non étatique dans
le but de réaliser les objectifs économiques d’un État par le recours à des moyens politiques, ou de réaliser les
objectifs politiques par le recours à des moyens économiques" 6.
"La mise en œuvre par une autorité publique, d'une politique à finalité commerciale et financière, destinée à
assurer la prospérité économique du pays à travers les intérêts de ses entreprises, de ses groupes socio-
professionnels, de ses citoyens" 7.
"La recherche d'objectifs économiques par des moyens diplomatiques, qu'ils s'appuient ou non sur des
instruments économiques pour y parvenir" 8.
2. – Les enseignements des pratiques étrangères
"Le recentrage de l’activité diplomatique des États sur leurs fonctions régaliennes est l’un des traits les
plus marquants au tournant des XXe-XXIe siècles" 9 : la représentation, la négociation (négociations
commerciales multilatérales ou bilatérales), l'élaboration de l'information économique, la défense des
biens physiques des opérateurs économiques sur les territoires étrangers, etc.
S'agissant de la France, "l'originalité de la diplomatie économique (…) a résidé ainsi longtemps dans
l'exercice conjoint de ces deux fonctions, régalienne et commerciale" 10. Par fonction commerciale, on
entend plus précisément l'appui aux entreprises. Depuis les années 1980, la question de la
dissociation ou, au contraire, de l'exercice conjoint de ces deux fonctions a fait l'objet de débats au
ministère de l'Économie et des Finances. Depuis 1996, on va dans le sens d'une dissociation avec
une externalisation progressive auprès d'Ubifrance des fonctions commerciales.
Au-delà de cette évolution, il faut aussi noter que les dispositifs étrangers se sont aussi orientés, pour
une grande partie d'entre eux, vers le principe du réseau unique mais il est difficile de parler de
modèle et force est de reconnaître aujourd'hui qu'aucun d'entre eux n'a réellement fait la preuve réelle
de son efficacité face aux nouvelles conditions de la mondialisation.
Le système français dispose, depuis plusieurs années, de réseaux économiques, financiers et
commerciaux longtemps rattachés au ministère de l'Économie et des Finances mais dont les
personnels expatriés bénéficient de liens spécifiques avec les ambassadeurs (Loi de 1979) ; plus
récemment, avec la création d'Ubifrance, les personnels à l'étranger ne bénéficient plus du même

Annexe technique_Développement international des entreprises_
Quel apport de la diplomatie économique ? Prise de position de la CCIP, 15 novembre 2012
2
statut de rattachement. En 2010, toutes les activités commerciales des Missions économiques ont été
transférées à Ubifrance.
LES GRANDES LIGNES DES DISPOSITIFS ETRANGERS
Le système américain repose davantage sur les fondations et institutions privées ou plus récemment des
agences autonomes par rapport aux départements ministériels avec des formes juridiques très diverses. Au
demeurant, ce système, prévalent au 20ème siècle, s'est quelque peu inspirée de la pratique française avec des
sections commerciales dans les ambassades mais dont la compétence se limite à l'appui aux entreprises 11.
Le système britannique s'appuie sur l'UK Trade and Investment, créé en 2003 ; placé sous la tutelle du ministère
du Commerce et de l'Investissement, il soutient l’expansion des entreprises à l'étranger mais aussi les
investissements étrangers au Royaume-Uni et l'image des produits britanniques sur les marchés étrangers. On
observe ce même mouvement de fusion des équipes au sein des ambassades. Les Britanniques pratiquent ainsi
la délégation de la gestion de l’action extérieure. En 2008, le Premier Ministre britannique a créé le Business
Ambassadors Network dont l'objectif est d'aider les PME non pas tant à remporter des opportunités commerciales
qu'à accéder aux marchés.
Le système allemand est très différent puisqu'il repose, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, sur les
chambres de commerce avec l'appui des Länder. La présence de l'État est limitée aux initiatives consulaires ou
professionnelles en faveur des entreprises.
Le système italien repose sur un centre national du commerce extérieur comprenant des guichets régionaux
tournés vers les PME et des guichets uniques à l'étranger reliés au réseau diplomatique.
Le système japonais repose essentiellement sur le Miti, Ministère de l'économie, mis en place au lendemain de la
seconde guerre mondiale mais la diplomatie économique japonaise (keizai gaikou) a largement souffert de la
faiblesse des ambitions politiques du pays sur la scène extérieure. Ce faisant, ce sont les multinationales
japonaises qui ont largement développé une business diplomacy.
Le système chinois procède, quant à lui, d'une autre logique. Si la diplomatie chinoise a pour objectif, comme les
diplomaties occidentales, de soutenir le développement économique du pays, elle doit aussi accompagner le
processus d'émergence politique de la Chine sur la scène internationale. Mais la diplomatie chinoise est surtout
largement dédiée à la sécurité des approvisionnements en matières premières énergétiques et minérales, d'où
l'importance de la diplomatie pétrolière 12.
C'est avec les systèmes britannique et italien que le dispositif français a le plus de traits communs
(organismes parapublics de soutien au commerce extérieur). La France s'est aussi inspirée, à partir
des années 1990, du modèle américain en créant des agences comme, dans le champ économique,
l'AFD, l'AFII ou encore Ubifrance. "Par conséquent, si la France n’a pas de tradition assumée de
délégation du service public dans le domaine de l’action extérieure, elle n’en a pas moins connu dans
le passé des formes d’« externalisation »" 13.
3 – L'histoire de la diplomatie économique française
L'histoire de la diplomatie économique française au cours du 20ème siècle montre qu'il n'y a pas unité
d'action en la matière depuis la fin de la première guerre mondiale même s'il n'y a jamais eu non plus
d'hégémonie parfaite du ministère des Affaires Étrangères (MAE) sur les affaires extérieures 14.
L'exercice de la diplomatie économique est, depuis 1918, date à laquelle les premiers conseillers
commerciaux ont été rattachés au ministère du Commerce et de l'Industrie, l'objet d'une pomme de
discorde entre le MAE et le ministère des Finances et de l'Économie. Pour autant, cette discorde n'a
jamais dégénéré en un quelconque conflit ouvert. La diplomatie commerciale française s'est déployée
"dans cette tension non résolue entre la volonté réelle d’intégration des forces économiques et
techniciennes de la société et l’incapacité à la réaliser selon des formes qui ne [soient] pas
étatiques" 15.
De surcroît, même en se voyant perdre la tutelle du réseau de conseillers, le ministère des Affaires
Étrangères ne s'est pas éloigné des considérations économiques. Loin s'en faut : on en veut pour
prendre les relations très intenses entretenues, pendant des années, entre la Direction des affaires
économiques et financières (DAEF) du MAE et les entreprises. La porte du Quai d'Orsay a été
largement ouverte aux grandes entreprises ou aux grandes banques des années 1950 à 1980. Et de
nombreux patrons rencontraient régulièrement les responsables de zones du MAE.
Durant les années 1950-1980, la diplomatie économique s'est donc trouvée exercée par le "triumvirat"
DREE-Entreprises-DAEF. Ce comportement ouvert aux entreprises a permis d'accompagner les

Annexe technique_Développement international des entreprises_
Quel apport de la diplomatie économique ? Prise de position de la CCIP, 15 novembre 2012
3
grandes entreprises dans leur internationalisation en leur fournissant de l'information sur les marchés
extérieurs, en les associant aux visites ministérielles à l'étranger – avec la finalisation de grands
contrats – et avec l'engagement de la garantie publique sur les crédits à long terme.
Mais, à partir des années 1980, cette architecture n'a pas résisté à la mondialisation, les structures
étatiques devenant de plus en plus marginalisées (Voir Tableau 2). Les inflexions apportées au
système français puis son démantèlement partiel ne seront pas, pour autant, satisfaisants. Les
entrepreneurs français "tenus pour les plus dynamiques" [se montrent] dubitatifs vis-à-vis des services
rendus en 2007-2008 par les Missions économiques et Ubifrance" 16. Les finalités du dispositif sont
progressivement remises en cause avec l'aggravation du déficit commercial de la France. Certains
observateurs vont jusqu'à désigner la responsabilité de la puissance publique dans l’entretien d’une
certaine inertie des entreprises face à la conquête des marchés extérieurs.
Dans le même temps, les entreprises – essentiellement les grands groupes – se sont progressivement
émancipé des circuits étatiques de l'information et des canaux diplomatiques publics en pratiquant
eux-mêmes une diplomatie d'affaires en faveur de leurs intérêts. On parle aujourd'hui de plus en plus,
notamment dans les grands groupes, de diplomates d'entreprises 17 actifs sur le terrain du lobbying,
de l'influence et de la diplomatie. Certes, cette diversification des acteurs n'est pas nouvelle mais ces
nouveaux canaux diplomatiques sont, désormais, indépendants des canaux étatiques. L'exemple
français n'est pas exceptionnel. En Turquie, le secteur privé turc devient ainsi un acteur central du
rapprochement économique avec l'Afrique et exerce "de plus en plus d'influence dans le processus de
prises de décision et prépare (…) actuellement toutes les visites du président et du ministre du
commerce extérieur turcs" 18.
LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE SOUS LA FORME D'UN NOUVEAU TRIANGLE RELATIONNEL
États- États
Enjeu de souveraineté et capacité de réaction
face à la montée en puissance des acteurs privés
États-firmes
Enjeu de compétitivité des territoires et
contrôle de l'activité de l'entreprise
Firmes -Firmes
Enjeu de globalisation (commerce intra-firmes
et chaînes de valeur mondiales)
Source : Christian Chavagneux, "La diplomatie économique : plus seulement une affaire d'États" in : La politique
étrangère aujourd'hui, Pouvoirs, n° 88, janvier 1999, pp. 37-38.
Surtout, si les grandes entreprises n'ont plus les mêmes besoins vis-à-vis de cette diplomatie
économique, on constate que cette dernière ne bénéficie pas non plus aux PME, le réseau des
Missions économiques étant peu enraciné dans la réalité économique française. Il en est résulté une
difficulté croissante à "définir une relation, à la fois saine et efficace, entre la puissance publique et les
entreprises travaillant à l'étranger" 19.

Annexe technique_Développement international des entreprises_
Quel apport de la diplomatie économique ? Prise de position de la CCIP, 15 novembre 2012
4
TABLEAU 1 –
PLAN D'ACTION EN NEUF POINTS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES
EN FAVEUR DE LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE
1. Faire du soutien de nos entreprises à l'international, en particulier les PME et ETI, de la promotion de la
"destination France" pour les investissements étrangers, une instruction prioritaire et permanente de notre réseau
diplomatique.
2. Créer au Quai d'Orsay une Direction spécifiquement dédiée au soutien aux entreprises (grands groupes mais
aussi PME et ETI) et aux affaires économiques.
3. Positionner l'ambassadeur à la tête de l'"Équipe de France de l'export", en rassemblant sous sa tutelle
l'ensemble des structures publiques d'appui aux entreprises à l'international, et en les simplifiant (…).
4. Mettre en place, au sein de chaque poste diplomatique traitant d'enjeux réglementaires ou normatifs des
procédures simples permettant aux entreprises d'exposer en amont et dans le cours des négociations, leurs
attentes, leurs préoccupations et leurs attentes. Dans les négociations internationales, le principe de réciprocité
sera systématiquement défendu.
5. Renforcer la dimension économique dans les visites et entretiens ministériels.
6. Développer les liens entre nos outils d'influence (formation des étudiants étrangers, bourses, réseau scolaire à
l'étranger, Institut français, etc.) et la promotion de nos intérêts économiques.
7. Désigner, pour quelques pays, des personnalités de stature internationale afin d'y accompagner notre
diplomatie.
8. Renforcer la dimension économique de nos diplomates et encourager les profils disposant d'une compétence
économique, notamment dans les domaines de l'export, des problèmes spécifiques aux PME, de l'innovation.
9. Ouvrir davantage le Quai d'Orsay aux entreprises et développer le dialogue régulier avec les partenaires
économiques et sociaux (journée annuelle "portes ouvertes du Quai d'Orsay", messages aux entreprises dans le
cadre des points de presse, diffusion des informations économiques sur les sites Internet et les réseaux sociaux
du ministère…).
Source : Correspondance économique, 24 août 2012, pp. 10-11.

Annexe technique_Développement international des entreprises_
Quel apport de la diplomatie économique ? Prise de position de la CCIP, 15 novembre 2012
5
TABLEAU 2 –
LES GRANDES DATES LIEES AUX REFORMES DE LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE
1918 Rattachement des premiers attachés et conseillers commerciaux au ministère du Commerce et de
l'Industrie.
1943 Centre français du commerce extérieur (CFCE) recréé.
1944 Création de la Direction des relations économiques extérieures (DREE).
1945 Création de la Direction des affaires économiques et financières (DAEF) au Quai d'Orsay.
1950 Décret fondateur du corps de l'Expansion économique à l'étranger, ce qui n’a pas été le cas des autres
attachés spécialisés des ambassades ; ses fonctionnaires relèvent du Ministère des affaires économiques
(selon l'art. 1er qui fonde le statut des attachés et conseillers commerciaux).
Ils exercent des fonctions régaliennes, de représentation, d’information et de négociation, et
commerciales, de promotion et d’appui aux entreprises.
1962 Rattachement de la DREE au ministère de l'Économie et des Finances.
1979 Loi qui soumet le conseiller économique à l'autorité de l'ambassadeur.
1994 Rapport Picq "L’État en France. Servir une nation ouverte sur le monde " au gouvernement Balladur sur
les axes qui doivent structurer, à terme, la relation avec les entreprises : il s'agit de "délester" l'État de sa
mission de soutien et de substituer une entité unique à la multiplicité des intervenants.
1997 Première fusion du Comité français des manifestations économiques (CFME) et de l'Agence pour la
coopération technique, industrielle et économique (ACTIM) pour donner naissance au CFME-ACTIM.
1998 Création de la Mission Entreprises au Quai d'Orsay par le ministre des Affaires Étrangères,
Hubert Védrine ; elle s'adresse plus particulièrement aux grandes entreprises.
2001 Création de l'agence française pour le développement international des entreprises
(premier Ubifrance).
2003 Fusion d'Ubifrance avec le CFCE (deuxième Ubifrance).
2004 Fusion du Trésor avec la direction de la Prévision et la DREE pour donner naissance à la direction
générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE) selon le Décret n° 2004-1203 du
15 novembre 2004 avec un réseau unifié d'attachés économiques.
2004 Trois décrets disposent que le nouveau conseiller commercial est recruté, nommé et payé par Bercy ; il
ne reçoit plus les entreprises.
2008 Resserrement des liens entre Ubifrance et les Missions économiques ; les bureaux à l'étranger
dénommés "ME-Ubifrance" font partie des missions diplomatiques.
2009 Disparition de la DAEF au sein de la Direction de la mondialisation, du développement et des partenariats
(DGM) du MAE ; la DGM est l'intermédiaire direct entre le Cabinet du ministre, le Secrétariat général du
Quai d'Orsay et les grandes entreprises.
2010 Transfert de toutes les activités commerciales des ME à Ubifrance.
2010 La DGTPE devient la direction générale du Trésor ; selon le Décret n° 2010-291 du 18 mars 2010,
elle est notamment "chargée des questions économiques, financières et commerciales internationales
sur le plan multilatéral et bilatéral, et contribue à la détermination et à la mise en œuvre de la politique
d'aide au développement" ; de même, "elle soutient le développement international des entreprises".
Source : réalisé grâce à l'article de Laurence Badel, "Diplomatie et entreprises en France au XXème siècle",
Les Cahiers IRICE, n° 3, 2009
 6
6
1
/
6
100%