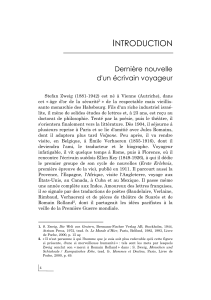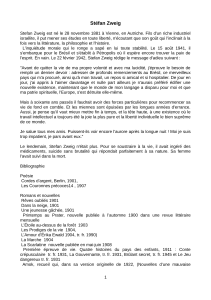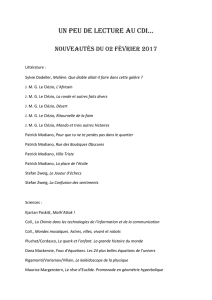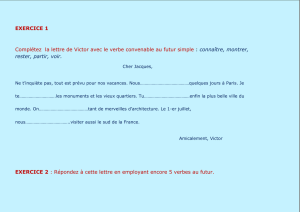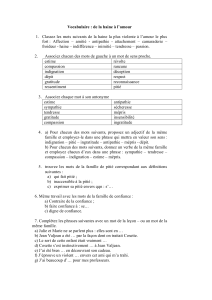La Pitié dangereuse

Contacts presse
Isabelle Martin 04 72 07 32 90
i.martin@croix-rousse.com
Audrey Vega 04 72 07 49 54
a.vega@croix-rousse.com
La Pitié dangereuse
ZWEIG.FAURE
Du mardi 7 au samedi 18 novembre 06
Direction Philippe Faure
Place Joannès Ambre 69317 Lyon Cedex 04 - Adm. 04 72 07 49 50 - Loc. 04 72 07 49 49 - Fax 04 72 07 49 51 - infos@croix-rousse.com
www.croix-rousse.com
L’Association Compagnie de la Goutte, gestionnaire du Théâtre de la Croix-Rousse, est conventionnée et subventionnée par la Ville de Lyon,
la Région Rhône-Alpes, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Conseil Général du Rhône.
Licences d’entrepreneur de spectacles 1-135013, 2-135016, 3-135020. Siret n° 313 915 019 00050. APE 923 A.
Reprise à Lyon et en tournée

En septembre dernier, la nouvelle création et adaptation de Philippe Faure célébrait
le retour de Sylvie Testud sur les planches. Le drame poignant de Stefan Zweig est
repris cette saison (à La Croix-Rousse et en tournée), prêt à nous faire (re)plonger
dans la Vienne tourmentée des années vingt, celle qui voit, à son image, deux jeunes
gens s’égarer, se perdre...
La Pitié dangereuse,
ou comment une innocente invitation
à danser devient le tournant tragique de deux vies.
La Pitié dangereuse
ZWEIG.FAURE
(Aimer) à en perdre la raison...
Une valse. Le lieutenant Hofmiller se propose d’être le cavalier de la fascinante Édith
Kekesfalva… Et ce soir-là, la jeune fille, clouée sur son fauteuil de paraplégique, assiste
à la gêne insondable du maladroit comme à la fin de sa liberté de jeune homme. Elle
devient l’objet quotidien de ses attentions, chaque visite apaisant la conscience du lieute-
nant mais nourrissant aussi son désir secret de femme. Être aimé malgré soi, tragédie de
Hofmiller. Se découvrir indigne d’être aimée dans le regard de l’autre, tragédie d’Édith…
Zweig, l’écrivain viennois, biographe, traducteur polyglotte, amoureux de l’Europe, rédige
La Pitié dangereuse
meurtri par les démons de la guerre et de 1933. Dans cette civilisation
décadente, le roman prend toute son ampleur, son sens du déchirement et de l’abandon,
basculement des âmes magnifiquement rendu par l’adaptation de Philippe Faure. Au plus
près de ces instants de glissements irréversibles, dans un espace étourdissant qui cache
tant d’autres non-dits, le drame se joue, imperceptible, bientôt inexorable, toujours ardent.
Une passion, une fuite, comme un feu de paille…
Texte
Stefan Zweig
Adaptation
mise en scène
Philippe Faure
Assisté de
Emmanuel Robin
Editions
L'avant-scène Théâtre
septembre 2005
Scénographie
costumes
Alain Batifoulier
Construction des décors
Ateliers du Théâtre
Vidy-Lausanne E.T.E
Direction technique
Michel Beuchat
Chef constructeur
Thomas Beimowski
Peintre
Christophe Ryser
Réalisation des
costumes
Ateliers Caraco
Lumière
André Diot
Musique
Christian Boissel
Interprétée par
Bruno Sansalone
(Clarinette)
Nadia Kuentz (Violon)
Bernard Guay
(Contrebasse)
Soléa Garcia-fons (Voix)
Patrick Gabard
(Violoncelle)
Étienne Canavesio (Cor)
Christian Boissel (Piano)
Prise de son
Laurent Lechenault
Coiffure, maquillage
Stéphane Malheu
Avec
Estelle Bealem
Albert Delpy
Mathieu Loth
Bruno Sermonne
Sylvie Testud
Direction technique
Gilles Vernay
Equipe technique de
création :
Régie son
Laurent Lechenault
Régie lumière
Christophe Renon
Jean-philippe Pozzi
Jean-michel Dailloux
Régie plateau
Gilles Rissons
Vincent Perreux
Equipe technique en
tournée :
Théâtre Vidy-Lausanne
E.T.E/ Suisse
Coproduction
Théâtre de La Croix-
Rousse/Lyon, Théâtre
Vidy-Lausanne E.T.E/
Suisse
Coréalisation
MC2/Maison de la culture
de Grenoble
Avec le soutien
du Réseau des Villes
Rhône-Alpes
Avec la participation
artistique
de L’ensatt
En partenariat avec
France-inter, L’express,
La Fnac, L’avant-scène
Théâtre, La Spedidam
Durée
1h30
Du mardi 7 au samedi 18 novembre 06
TARIFS LOCATION
24 E
20 E
Etudiants - 28 ans, CE, + 65 ans,
famille 4 et +
17 E
Demandeurs d’emploi, - 20 ans
M'ra, Pass’Culture. Tarifs groupes :
renseignez-vous
DATES DES REPRÉSENTATIONS
Ma 7 nov 20h30
Me 8 nov 19h30
Je 9 nov 19h30
Ve 10 nov 20h30
Sa 11 nov 20h30
Ma 14 nov 20h30
Me 15 nov 19h30
Je 16 nov 19h30
Ve 17 nov 20h30
Sa 18 nov 20h30
© Bruno Amsellem/Editing

La Pitié dangereuse
Au cœur de
La Pitié dangereuse
, il y a l'infirmité d'Edith, l'héroïne du roman. Pour Anton,
le jeune lieutenant, les jambes paralysées de la jeune femme sont une sorte de cas de
conscience. Tant qu'il considère Edith comme une camarade asexuée, il parvient à être
naturel. Ses gestes et ses paroles sont affectueux. Mais lorsqu'il comprend qu'elle le
désire charnellement, il est terrifié, dégoûté. Jamais il n'avait imaginé que les gens laids,
estropiés ou malades pussent éprouver et manifester le besoin d'un amour physique.
Cette découverte le rebute, l'atterre. Quand Edith se colle à lui pour lui donner des
baisers passionnés, il cherche uniquement à l'apaiser afin de l'éloigner de lui. « Et avant
que j'eusse pu détourner la tête, deux crochets me prirent par les tempes et attirèrent ma
bouche du front jusqu'à ses lèvres. La pression fut si ardente, la succion si avide que ses
dents rencontrèrent les miennes… » Mais la vision de la silhouette de la jeune fille vacillant
sur ses béquilles et s'affalant sur le plancher le fera fuir définitivement.
Stefan Zweig s'est passionné pour tous ses héros toujours torturés, en proie à une
« possibilité de basculement ». Et c'est dans cette possibilité que se dévoilent les
mystères de l'âme humaine. Alors, des zones de l'univers intérieur peuvent être percées
par quelques rais de lumière ; les zones les plus secrètes, où rôdent la mélancolie et de
sombres inquiétudes. « Ouvre-toi, monde souterrain des passions ! », dit le début de l'un
de ses poèmes.
Étrangement, la forme des récits est classique. Certains n'ont-ils pas prétendu qu'elle était
désuète ? Un portrait de Leo Feld décrit ainsi Stefan Zweig : « Cet élégant jeune homme
au visage fin et nerveux dont on ne sait pas s'il est celui d'un poète ou d'un employé de
banque… » Tout est là, dans ce malentendu, dans cette frontière, dans ce glissement
imperceptible.
Chez les Zweig, on parle allemand, italien, anglais et français. Ida, la mère, joue du piano
et est assez snob. Ils vivent dans les beaux quartiers à Vienne. C'est « l'âge d'or de la
sécurité », comme l'écrira plus tard Stefan Zweig. Il ajoutera : « Tout dans ce vaste empire
demeurait stable et inébranlable… à sa place. » Son père Moritz, malgré sa fortune, ne
vit pas comme un nouveau riche. Il était l'un des banquiers du Vatican. Là encore, entre
le père et la mère, les caractères sont assez dissemblables, même s'ils se rejoignent
sur la volonté de donner à leurs deux fils un cadre de règles bourgeoises et de strictes
convenances.
La guerre de 1914 est déclarée. Stefan Zweig se porte volontaire. Il est vite horrifié
par l'ampleur de la catastrophe. « Une dangereuse psychose collective », dira-t-il. L'on
découvre malgré tout que la notion d'engagement lui est étrangère.
Zweig est un homme fragile. Les événements entrent en lui sans rencontrer de résistance.
C'est ainsi que le 22 février 1942, il se donnera la mort en compagnie de sa femme. Il
laissera ces mots : « je salue tous mes amis ! Puissent-ils voir encore les lueurs de l'aube
après la longue nuit ! Moi je suis trop impatient, je les précède. »
Zweig n'avait-il pas l'âme trop européenne pour accepter une telle folie ? Il y a quelque
chose de théâtral dans cette catastrophe historique. Le théâtre, justement ! Jamais Zweig
n'y trouvera son bonheur. Le théâtre lui sera comme maudit. Et la nuit tombe dans toute
l'Europe, mais avant la nuit, il y eut l'ombre. L'ombre fut sa complice. Toujours cette idée
que c'est quand il fait sombre que la vérité des âmes peut surgir. Alors seulement, dans le
secret du soir qui tombe, vient le temps des confessions. Vient cette puissante impulsion
vers l'intérieur de nous-mêmes. Vient même la tentation du suicide. Décidément, affronter
le réel est trop difficile, trop injuste. Seul le vertige peut nous sauver.
Zweig ou l'homme éveillé

La Pitié dangereuse
Zweig n'est pas un sentimental. Il parle lui-même, en se le reprochant, de sa froideur. Il est
simplement à l'affût de ce moment où chacun peut décider de sa vie. Ce moment crucial
où la lucidité est aveuglante, impitoyable. Comme cela arrive dans
La Pitié dangereuse
.
Anton le lieutenant, Edith la paralytique, seront l'un et l'autre face à leur destin, face à leur
vérité. L'une décidera de mourir, l'autre de fuir.
Zweig traque le mensonge, la tricherie, la complaisance. Avec une infinie délicatesse, il met
chacun face à un choix et peu importe la brutalité des conséquences. Dans son monde,
on ne fait jamais l'impasse sur une prise de conscience. On prend toujours conscience de
ce que l'on est. De ce que l'on se doit d'être pour être digne de la nature humaine. Ce
qui est fascinant justement dans le personnage d'Edith, c'est qu'elle ne pleure pas sur son
sort. Elle se bat de façon souvent cinglante, insolente. Elle n'a pas peur de ses sentiments.
Elle les vit intensément et elle place chacun face à ses responsabilités. Le père, Kekesfalva,
est prêt à tout, le médecin ne renonce pas, le lieutenant fuit. Et elle espère, avec une
énergie folle. Elle provoque les événements, même si plane sur cette histoire, comme sur
toute l'œuvre de Zweig, un pessimisme terrible. Mais est-ce une raison pour ne pas tenter
l'impossible ? Zweig nous dit que seul l'impossible vaut la peine et que si l'on échoue, il
n'y a pas de honte à avoir. La honte est un sentiment inconnu chez Zweig. De ne pas avoir
tenté d'aimer Edith, Anton sera poursuivi par le remords, ce qui est la plus terrible des
punitions. Zweig ou l'homme qui raconte que dans chaque âme existe un impossible rêve.
Zweig ou l'homme éveillé. Et comme lorsqu'on est vraiment éveillé, tout vous arrive… Tout
peut arriver. Chez Zweig, c'est dans la nuit, dans le secret des murs, dans l'entrebâillement
des portes, dans la peur de l'avenir, qu'étrangement, simplement, silencieusement, tout se
décide.
Philippe Faure
.../...

La Pitié dangereuse
A travers cette histoire d’amour déchirante comme une tragédie antique, où la fatalité
aveugle ceux qu’elle veut perdre, Anton, Edith, M. de Kekesfalva et le docteur Condor
sont les symboles d’une civilisation sur le point de mourir, le temps d’une valse viennoise.
En 1913, dans une petite ville de garnison autrichienne, Anton Hofmiller, jeune officier de
cavalerie, est invité dans le château du riche Kekesfalva.
Au cours de la soirée, il invite la fille de son hôte à danser, ignorant qu’elle est paralysée.
Désireux de réparer sa «gaffe», Anton, pris de pitié pour l’infirme, multiplie bientôt ses
visites. Edith de Kekesfalva cache de plus en plus mal l’amour que lui inspire le bel offi-
cier, qui lui ne s’aperçoit de rien, jusqu’au moment où il sera trop tard. De cette histoire
d’amour impossible naîtra chez l’un, une amitié nourrie d’une pitié inavouable, chez l’autre,
une passion douloureuse et sincère. Dangereuse est la pitié...
Une valse viennoise
Dans la salle impressionnante avec ses hautes boiseries d'acajou sombre et ses murs rouge
puissant comme dans le tableau Nabis de Félix Valotton,
Chambre rouge avec femme
et enfant
ou le fond du
Portrait assis de Fritza Riedler
par Gustav Klimt, des pans entiers
vont s'ouvrir sur des peintures aux aplats presque schématiques, aux couleurs fortes et
contrastées, figurant des lieux.
La grande culture picturale viennoise est démasquée dans
l'abstraction et l'insolite des décors que l'on découvre dans des envers
de la coulisse.
Ce sont des ambiances, des intérieurs style Biedermeier comme dans les peintures de
Walter Hampel ou de Carl Moll, des paysages recomposés pour une stimulation visuelle
ouvrant une multitude d'interprétations.
Ce sont des peintures pleines de nostalgie, de désordre mais d'une modernité optimiste
dans la couleur, une voie ouverte vers l'abstraction.
C'est le grand salon et son paysage qui s'étale au-dessus de boiseries vert sombre, un bois
touffu, des collines, un ciel gris vert embrasé de jaune.
C'est la chambre d'Edith, une peinture qui s'ouvre à la lumière à travers les rideaux orange
de la fenêtre, les panneaux décoratifs violet sur des fonds fuchsia, des impressions de
fleurs dans le style de Josef Hoffmann grand décorateur viennois.
C'est une allée d'arbres pour la promenade en perspective plongeante sous des frondai-
sons vert acide comme dans les peintures de l'autrichien Richard Gersti qui rejoint dans
son style le français Félix Valotton.
C'est la sobriété presque abstraite de la chambre du lieutenant drapée dans des aplats
orange, vert jaune et brun comme ceux vus dans les fonds des peintures de Gustav Klimt
ou chez le français Paul Sérusier.
Un univers d'artistes précurseurs, à la fois pré et post moderne, enveloppe le récit de La
Pitié dangereuse.
Alain Batifoulier
Ambiances
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%