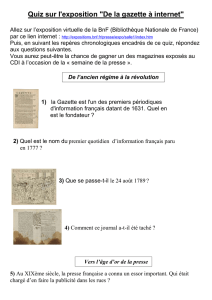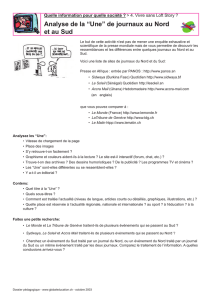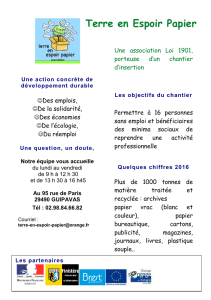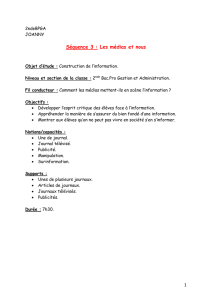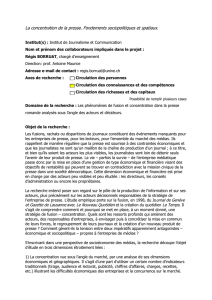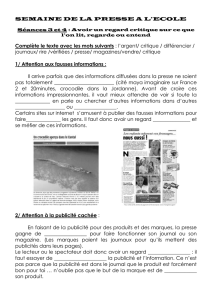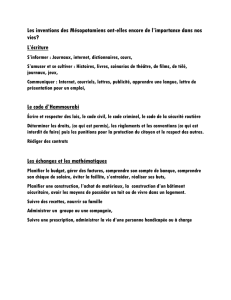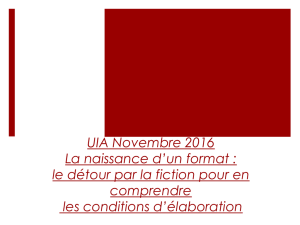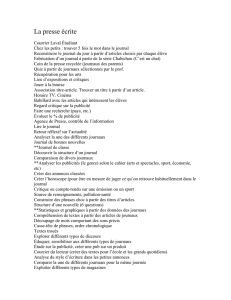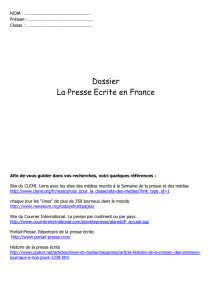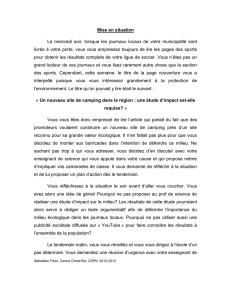Liste non exhaustive de la presse résistante et de la presse

LE LIEN
53
La presse de la collaboration
JOURNAUX DE PARIS
Lorsque les Alliés prennent pied sur les plages de Normandie, le 6 juin 1944, les journaux
parisiens connaissent leurs derniers beaux jours. D’ailleurs faut-il parler de journaux ou de
feuilles lorsqu’on évoque la presse de cette époque ? Le terme de « feuilles » est celui qui
convient le mieux.
En effet, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres de l’activité française, les
restrictions se sont fait sentir dès la première année de l’occupation : le tout puissant service
des papiers de presse, que dirige à l’hôtel Majestic, à Paris, le Docteur Klecker, a d’abord
réduit les attributions de 15 % en octobre 1941, puis deux ans plus tard, la pénurie s’étant
aggravée, la diminution a été portée à 35 %. En 1943 comme en 1941, les autorités
allemandes ont favorisé la presse des territoires occupés. Celle-ci a droit à la plus grande part
du gâteau : 75 % du contingent de papier, mais c’était encore insuffisant pour garder le même
nombre de pages qu’à la fin de 1940. D’année en année, les journaux se sont réduits comme
la peau de chagrin. Le Matin, qui paraissait depuis le 17 février 1942 sur deux pages, trois
jours sur six, et quatre pages les trois autres jours, ne « sortit » plus quotidiennement que sur
deux pages à partir du mois de mai 1944. Il en était de même pour son confrère du soir « Les
Nouveaux Temps » : lui aussi avait dû se restreindre et, depuis février, il n’offrait plus à ses
lecteurs que quatre pages une fois par semaine.
Encore ces journaux étaient-ils privilégiés, parce que leurs dirigeants avaient toujours la
possibilité de recourir soit aux achats au « marché noir » - aussi actif pour le papier journal
que pour l’alimentation ou pour les tissus – soit de faire appel à des livraisons que les
Allemands ne rechignaient pas de faire aux organes de presse qui se montraient dociles.
Les difficultés étaient plus grandes au niveau de la presse hebdomadaire ou bihebdomadaire
des petites villes de province, qui n’en continuaient pas moins de paraître en réduisant pages
ou surface. Parce qu’ils renseignaient leur clientèle sur le ravitaillement, sur les nouvelles
régionales et locales et parce qu’ils publiaient les avis de naissance, mariage et décès, ces
journaux, qu’ils fussent quotidiens ou non, gardaient leurs fidèles et avaient même mordu sur
le domaine de la presse parisienne : avant la guerre, celle-ci comptait quatre lecteurs
provinciaux sur cent habitants ; au début de 1943 elle n’en avait plus que deux.
À quoi bon d’ailleurs lire un journal de Paris quand on habitait Bolbec ou Saulieu, puisque,
en définitive, ceux de Rouen ou de Dijon donnaient les mêmes informations générales et
publiaient des articles dont l’inspiration était voisine ? Aussi les grands régionaux et les
quotidiens départementaux, loin de perdre des clients, en gagnaient et Le Progrès de la
Somme, qui n’avait réalisé que 722 000 francs de l’époque en 1939, en totalisait 4 millions
en 1944 !
Trois grands qui ont la part du lion
Bien que son audience fût moins grande hors de la région parisienne qu’avant la guerre, la
presse de Paris gardait toujours un certain éclat dans ces derniers mois de l’occupation. Elle
le devait d’abord à la personnalité de ses dirigeants.
Directeur politique de L’Œeuvre, Marcel Déat avait été en février 1941 le fondateur d’un
des grands mouvements de collaboration, le Rassemblement national populaire (RNP), avant
de devenir tardivement ministre du Travail et de la Solidarité nationale, le 16 mars 1944, à la
grande colère du maréchal.
Son confrère et ami Jean Luchaire, le « patron » des Nouveaux Temps occupait les fonctions
de président de la Corporation nationale de la presse française depuis trois ans : sa

LE LIEN
54
physionomie d’adolescent monté en graine était familière aux lecteurs de magazines qui
donnaient volontiers ses photographies officielles.
La physionomie du directeur chenu et barbu de La Gerbe, Alphonse de Châteaubriant,
n’était pas moins connue des habitués des vernissages et des premières.
Mais le renom des journaux parisiens tenait aussi à des titres qui s’étaient imposés au public.
Aux kiosques des boulevards, les caractères gothiques du Matin avoisinaient ceux plus
stylisés du Cri du peuple ou d’Aujourd’hui . Le vendeur des « Nouveaux Temps » offrait
les numéros du journal à la porte de la Bibliothèque nationale, à la même place où il « criait »
autrefois « Le Temps ».
Privée de Candide et de Gringoire qui paraissaient en zone sud, leur ancienne clientèle
s’était reportée sur l’hebdomadaire La Gerbe dont la présentation n’était pas sans rappeler
celle de ses confrères repliés au-delà de l’ancienne ligne de démarcation.
En fait, le tableau qu’offrait la presse parisienne de juin 1944 ne différait guère de ce qu’elle
était au début de 1944. Neuf quotidiens subsistaient dont trois occupaient le peloton de tête.
À eux seuls, Le Matin, Le Petit Parisien, Paris-Soir, les trois « anciens » - entendez par là
antérieurs à l’occupation – totalisaient des tirages de 1 100 000 exemplaires pour un nombre
d’acheteurs qu’au début de 1943 le docteur Eich, le maître incontesté des services de censure
allemande, évaluait au total à plus de 1 600 000 pour la zone nord (Alsace-Lorraine, Nord et
Pas-de-Calais exclus).
Même si l’on tient compte de l’exagération toujours possible des tirages – et du pourcentage
possible des tirages – et du pourcentage des invendus, faible pour ces trois « grands » - on
doit reconnaître que Le Matin, Le Petit Parisien et Paris-Soir s’arrogeaient la part du lion.
Devaient-ils cette situation privilégiée au fait que, dès leur reparution, rien ne fut négligé
pour que la clientèle retrouvât ce qu’elle aimait en eux, c’est à dire le journal d’information
qu’on lit, le matin, dans le métro ou, le soir, les pantoufles aux pieds ? C’est fort probable. Le
Petit Parisien tirait, en 1944, à 470 000 exemplaires. En 1943, Paris Soir avait un tirage de 430 000
exemplaires et le Matin de 200 000.
Le PPF est entré au Petit Parisien
Paris-Soir consacra une part aussi grande que les restrictions le permettaient aux
photographies. Le Matin et le Petit Parisien, gardèrent la même présentation qu’avant le
« désastre », comme on disait encore. L’esprit de ces journaux, en revanche, avait beaucoup
changé. Le Matin des Bunau-Varilla faisait déjà profession d’anticommunisme et avait
parfois des accents xénophobes avant 1939 : sous la houlette de son rédacteur en chef, Pierre
Harel-Darc, et avec l’appui d’éditorialistes comme Stéphane Lauzanne, Robert de Beauplan
et J. Ménard, il se lança dans un antibolchevisme viscéral qui ne le cédait qu’à un
antisémitisme foncier. Ce quotidien, qui était resté jusqu’à la guerre l’organe de la petite
bourgeoisie israélite, mangeait du juif à chaque page.
De même le public populaire du « Petit Parisien » » - 60% d’ouvriers et de petits
commerçants – avait dû se rendre à l’évidence : surtout depuis l’arrivée en février 1941 de
Jacques Roujon au fauteuil directorial, les beaux faits divers gardaient toujours la vedette,
mais le lecteur devait ingurgiter en même temps des articles dont l’inspiration était proche de
celle du Parti populaire français (PPF) de Jacques Doriot. Comme l’a écrit Jean Queval,
« l’homme-au-couteau-entre-les-dents, le sauvage d’outre-Oural, le nez crochu du banquier
de Londres, le soudard de l’Arizona » étaient les figures de la mythologie obstinément
proposée jour après jour aux petites gens de France.
Une clientèle abusée par les titres
Le banlieusard qui rentrait chez lui, la journée terminée, en achetant Paris-Soir savait bien
que de fâcheux bruits couraient sur la façon dont les Allemands avaient confié la direction à
d’obscurs personnages en l’absence de son légitime propriétaire, M. Jean Prouvost, mais il

LE LIEN
55
avait assez de bon sens pour deviner que les photographies et les titres parlants, que les échos
tendancieux signifiaient autre chose que le désir de l’informer et de le distraire.
À côté de ces « mammouths » de la presse, le choix ne manquait pas. S’il n’était ni industriel,
ni commerçant, ni sportif, le Parisien de 1944 n’avait que faire de La Vie industrielle ou de
l’édition de zone nord de L’Auto, qui tirait alors à 80 000 exemplaires. En revanche, il
pouvait se rabattre sur des quotidiens plus engagés politiquement. Encore que les notions de
« droite » et de « gauche » ne signifiaient plus grand-chose à une époque où Déat, Luchaire
et Darnand avaient apposé leurs signatures sur le même Plan de redressement français (17
septembre 1943) dirigé contre Laval, l’éventail des journaux était encore largement ouvert.
La presse de droite était représentée par Aujourd’hui, qui avait cessé depuis longtemps
d’être un journal non-conformiste, du jour où Georges Suarès en avait pris la direction en
novembre 1940, mais qui gardait une bonne équipe (85 000 exemplaires en novembre 1944).
Le Cri du peuple « organe de doctrine, de combat, d’information » était l’organe du PPF ; sa
clientèle l’apparentait à celle du Petit Parisien avec près de 40% d’ouvriers, 12% d’artisans
et 12% de commerçant.
La France socialiste et L’Œuvre, qu’une polémique avait opposées quelques mois plus tôt,
se partageaient la clientèle de ceux qui restaient fidèles à des titres de gauche. Par son
attachement au syndicalisme et par l’intérêt qu’elle portait aux revendications ouvrières et
aux problèmes de ravitaillement, La France socialiste, que dirigeait l’ancien ministre de
Vichy, Hubert Lagardelle, depuis fin janvier 1944, s’était attaché un public « ouvriériste »
nombreux et son tirage atteignait quelque 100 000 exemplaires.
Les milieux intellectuels gardaient leur faveur à L’Œuvre, qui tirait à la fin de 1943 à près de
129 000 exemplaires ; bien que son ton se soit considérablement durci depuis l’automne
dernier, ils aimaient retrouver chaque jour l’article de fond que Déat rédigeait en dépit de ses
occupations officielles. Les options politiques de l’Œuvre n’étaient pas très éloignées de
celle de son confrère du soir Les Nouveaux Temps de Jean Luchaire : en dépit des efforts de
son « patron », ce quotidien n’était pas parvenu à combler le vide laissé par Le Temps, son
quasi-homonyme ; plus mondain que le journal de Déat, il fut de ceux qui eurent le plus
faible tirage (80 000 en mai 1944).
« Je suis partout », le mieux fait, le plus lu
Le foisonnement était encore plus grand pour les hebdomadaires. À côté de feuilles
politiques dont le rayonnement ne dépassait pas un public restreint de militants et de
sympathisants, de partis de collaboration – Le Franciste, Le Pays libre (national
collectiviste), L’Appel, organe de la Ligue française – en paraissaient d’autres qui se
voulaient à la fois politiques, littéraires et artistiques. Le courant socialiste était représenté
par l’Atelier, très proche de La France socialiste et de Déat, et par Germinal, un nouveau
venu qui soutenait la politique « française » d’Otto Abetz. Au Pilori cultivait la veine
antisémite et antimaçonnique et poussait la délation si loin qu’elle inquiéta à plusieurs
reprises l’administration française. Il tranchait avec le ton mesuré de La Gerbe, qui était
devenue, grâce à son maître A. de Châteaubriant, le porte-parole du groupe
« Collaboration ».
Les plus lus se situaient à l’extrême droite avec Je suis partout et La Révolution nationale.
Les discussions Laval-Sauckel et l’armistice italien, en juillet-septembre 1943, avaient eu
raison de la cohésion de l’équipe Lesca-Brasillach : celui-ci avait abandonné la rédaction en
chef de Je suis partout et avait porté sa plume à l’ancien hebdomadaire du Mouvement
social révolutionnaire de Deloncle, devenu à son tour « politique et littéraire », où il retrouva
Drieu La Rochelle et Henri Poulain.
On lisait aussi en juin 1944 beaucoup de magazines illustrés qui donnaient à la fois des
images de la guerre et des instantanés du Tout-Paris. Déjà l’Ilustration faisait figure d’aïeule
un peu solennelle comme la prose de son rédacteur J. de Lesdain.

LE LIEN
56
Le public préférait feuilleter La Semaine, Actu, (480 000 exemplaires) et Toute la vie
(270 000) qui alliaient curieusement les anecdotes croustillantes et les échos des spectacles
aux photographies les plus réalistes des combats et des bombardements.
Tous ces journaux n’obéissaient-ils en fait qu’à un seul directeur, le docteur Eich, chef du
groupe Presse de la « Propaganda Abteilung », comme le prétendait un tract du Comité
national des journalistes de zone nord à la fin de 1943 (Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (Nanterre) A33, réserve A6). Sans verser dans le culte de la
personnalité, on doit reconnaître que le contrôle allemand continuait à s’exercer aussi
sévèrement sur la presse française que par le passé.
Les services de l’hôtel Majestic ne se contentaient pas de censurer les journaux. Les
directeurs de journaux ou leurs représentants devaient assister obligatoirement à des
conférences hebdomadaires où des officiers de la Propaganda Abteilung ou des
fonctionnaires de l’ambassade allemande leur apportaient la bonne parole – c’est là que
furent adoptés les termes restés célèbres de « front élastique » de « raccourcissement du
front ». Ils distribuaient louanges et critiques et devaient parfois modérer le zèle des
journalistes qu’ils invitaient à célébrer l’anniversaire du Führer avec tact et réserve pour ne
pas « heurter l’opinion publique » (16 avril 1943) !
De son côté, l’ambassadeur Abetz agissait de façon moins brutale : ses réceptions du
mercredi après-midi rue de Lille étaient d’autant plus suivies que le buffet y était abondant et
qu’on pouvait y glaner pour son journal des subventions – 300 millions de francs avaient été
dépensés à la fin de novembre 1943 – et des fonds dits de « publicité ». C’était, dira-t-il plus
tard, du « travail en douceur ».
Le groupement financier du docteur Hibbelen.
En ce printemps de pré-Libération, la propagande allemande s’infiltrait partout, jusque dans
les publications les plus anodines : La Mode du jour, Les Ondes, Le Film complet,
Sciences et voyages appartenaient au groupement financier que le docteur Hibbelen, chargé
des « éditions contrôlées » à l’ambassade, avait discrètement constitué dès 1941 et qui ne
comptait pas moins de vingt-trois sociétés françaises contrôlant la publication de quarante
journaux et périodiques !
Parisiens et provinciaux avaient beau refuser d’acheter un quotidien d’information ou un
hebdomadaire politique, la revue de cinéma ou de vulgarisation scientifique qu’ils lisaient
leur tenait insidieusement le même langage, un langage qu’ils entendaient depuis quatre ans.
Avec le débarquement de Normandie, la presse de la collaboration lançait son chant du
cygne, mais elle savait que désormais elle avait moins de chance encore d’être écoutée que
par le passé. Encore quelques semaines, ce serait l’écroulement des rêves qu’elle avait bercés
et, pour certains le départ en Allemagne au milieu de convois couverts de feuillages…
Claude LÉVY
(Ancien des « Amitiés de la Résistance »)

LE LIEN
57
Une des premières feuilles clandestines :
Dans ses « Conseils à l’occupé » (12 juillet 1940), Jean TEXCIER écrit :
« Trop de passivité dans Paris retrouvé… Devant l’atroce spectacle de cette lâcheté et de cet
égarement qui rejoignaient la misérable attitude de cette petite ville que je venais de quitter, je décidai
de publier sous le manteau un petit manuel de dignité : ce furent les Conseils à l’occupé, qui, écrits
vers le 14 juillet 1940, parurent en août. Ils furent édités, sous forme d’une brochure à la typographie
élégante, grâce à mes amis le poète Guy Robert du Costal (déporté en 1944 et mort à la Salpêtrière en
mai 1945) et le dessinateur Robert BONFILS, qui me mirent en rapport avec le directeur de
l’imprimerie Keller, rue Rochechouart. Ce fut, je crois bien, la première brochure clandestine, et deux
mois plus tard j’eus l’heureuse surprise d’entendre Maurice SCHUMANN en citer des extraits à la
B.B.C. ».
En septembre 1940, après Mers el-Kébir, il publie une seconde brochure qu’il intitule « Notre
Combat » « le combat que mène l’Angleterre contre l’Allemagne, c’est notre combat, c’est encore,
c’est toujours celui pour lequel nous nous sommes dressés à ses côtés en septembre 1939 et la
dernière phrase est un appel direct à son lecteur inconnu : « Puisque tu aimes la liberté, arme-toi donc
et combats avec tes défenseurs».
LES JOURNAUX CLANDESTINS DE LA RESISTANCE
Dès le début de l’occupation, des Français voulurent exprimer par écrit leur peine, leur espoir, leur
volonté de résistance et les faire partager au plus grand nombre possible de leurs compatriotes. La
défaite les avait frappés de stupeur. Ils en recherchaient les causes et, comme il arrive après tout
événement traumatisant, ils remettaient tout en question : le régime antérieur et le régime présent, les
structures sociales et surtout politiques, les idéaux nationalistes et internationalistes ; ils évoquaient le
glorieux passé militaire de la France et aussi la supériorité intellectuelle, l’ingéniosité des Français,
devant lesquelles les occupants s’inclinaient et qui devraient finalement les vaincre ; ils
s’interrogeaient sur les moyens de surmonter la défaite et donnaient des consignes de dignité, de
réarmement moral, de résistance.
Pour s’exprimer, ces hommes avaient rarement recours à des imprimeurs. Le plus souvent, ils ne
pouvaient que multigraphier ou simplement dactylographier leurs textes ou même les recopier à la
plume ; certains utilisaient des imprimeries d’enfants, du papier d’écolier et jusqu’à du buvard. Ils
envoyaient ces feuilles par la poste, les glissaient sous les portes, les remettaient de la main à la main.
Tout ceux qui ont vécu cette époque se souviennent d’avoir reçu quelques-unes de ces feuilles
égayantes, réconfortantes ou émouvantes : des prophéties de Nostradamus, la prière à Saint Odile, des
« tours d’horizons », des calendriers datant à l’avance les victoires anglaises et françaises, des poésies
vengeresses ou humoristiques, des chansons patriotiques ou des parodies, des charades, des
caricatures, des montages illustrés.
On vit surtout se multiplier les « chaînes » - L’Appel du Gaulois, Français voici un référendum,
La Chaîne de la liberté – inspirées des chaînes de la fortune de 1937, que chaque destinataire était
invité à recopier cinq fois et à adresser à cinq personnes susceptibles de les diffuser à nouveau.
Certains de ces textes – tel La France a de nouveau repris les armes, inspiré d’un communiqué de
la radio de Londres – fréquemment recopiés, se modifiaient peu à peu par erreurs successives ou par
corrections conscientes et devenaient méconnaissables, transformant les raids de la RAF en
interventions célestes surnaturelles.
Des feuilles et des brochures avaient une tout autre portée et sont sorties de l’anonymat : les Conseils
à l’occupé que Jean Texcier avait fait imprimer à Paris dès juillet 1940, ses Propos à l’occupé, ses
Lettres à François, la Lettre à la jeunesse, Eclairs dans la nuit, le Sens de la honte que Robert
d’Harcourt signait H.B (Harcourt-Beuvron), les Tours d’horizon que ne craignait pas de signer de
son nom, en zone sud, le général Gabriel-Roger Cochet.
Une nouvelle génération politique est née en 40
Mais il ne s’agissait là que de réactions individuelles ou de très petits groupes, et dès les tout débuts
de l’occupation des équipes un peu plus nombreuses avaient recherché une action plus durable, un
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%