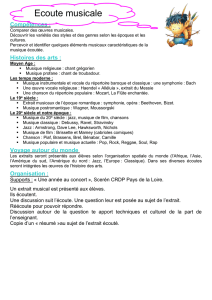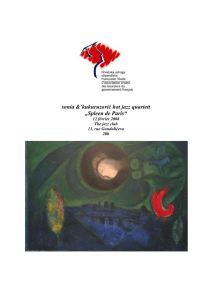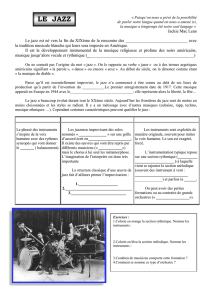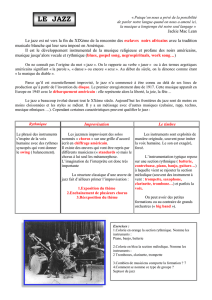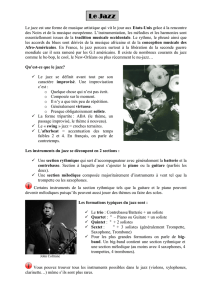Philojazz

Jean-Marie Parent
Philojazz
Petites ritournelles entre souffl e et pensée Jean-Marie Parent
ISBN : 978-2-336-00635-2
23 €
Comment le souffl e vint aux penseurs… et comment la philosophie
vint aux jazzmen ? Question double qui nous renvoie au vertige de
toute origine. Et appelle un défi : peut-on transmettre dans le silence
et la solitude de l’écriture les turbulences propres à une musique
dont la source plonge au cœur des passions humaines ?
Apprendre à l’endroit et à l’envers, penser le pour et le contre,
telles sont les singularités que l’on retrouve chez nombre de
musiciens… et de philosophes. Là où le jazz, solide centenaire,
pense et énonce un récit qui bruisse de mille mesures générées
depuis le lieu de ses origines, la philosophie questionne le monde
et jase en émettant sa petite musique dialectique bimillénaire.
Jazz et philosophie savent croiser des forces complices dans leur
démarche commune d’appréhension du monde. Quand l’un nous
donne à entendre la richesse singulière d’un univers sonore d’une
incroyable diversité, l’autre nous propose de prendre part aux petites
ritournelles de la pensée. À la musique afro-américaine de nous
exprimer sans retenue le « verbe » de ses passions. À la philosophie,
en « basse obstinée » de la pensée, de nous fi xer ce point de neutralité
à partir duquel méditer hors des passions.
Quant à l’auteur de ce livre, en passeur concerné, il ose ce pari :
imaginer ses lecteurs se muer en amateurs éclairés de nouveaux
mondes.
Jean-Marie Parent, ancien journaliste et professeur
des écoles à Loches (37), est membre de l’Association
des auteurs et éditeurs de Touraine. Philojazz est son
troisième ouvrage.
Philojazz
Petites ritournelles entre souffl e et pensée
Philojazz
Petites ritournelles entre souffl e et pensée

PHILOJAZZ
Petites ritournelles entre souffle et pensée


Jean-Marie Parent
PHILOJAZZ
Petites ritournelles entre souffle et pensée

Du même auteur
Passions à l’œuvre, Éditions Praelego, 2010.
Une Kumpania, photographies de Jean Luneau, Éditions
Photo en Touraine, 2011.
Esprits voyageurs, Éditions L’Harmattan, 2011.
Blog de l’auteur : « LEGOBALADIN »
Illustration de couverture : photographie de Jean-Marie Parent.
© L'Harmattan, 2012
5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmatt[email protected]
ISBN : 978-2-336-00635-2
EAN : 9782336006352
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%