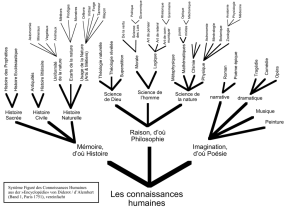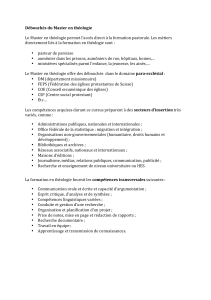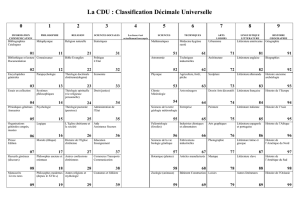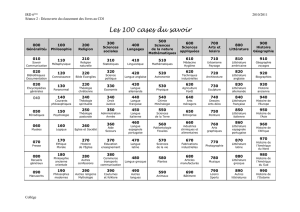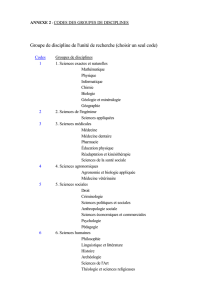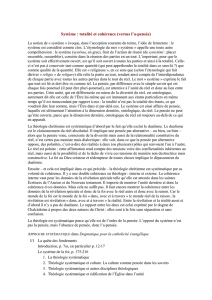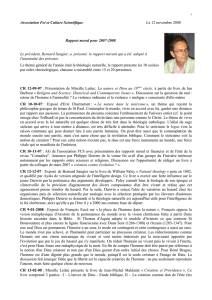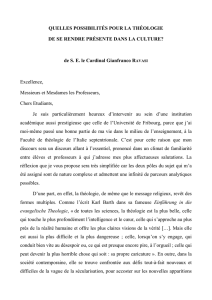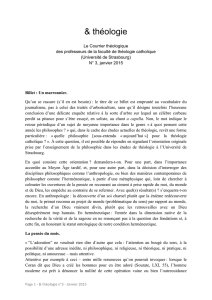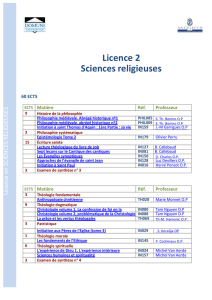La théologie aux marges et aux carrefours - Lirias

doi: 10.2143/RTL.44.3.2988836
Revue théologique de Louvain, 44, 2013, 388-412.
L. BOEVE
La théologie aux marges et aux carrefours
Théologie, Église, université, société
INTRODUCTION
Dans cet article1, je souhaite approfondir la question suivante:
quels sont, dans une culture et une société profondément transfor-
mées, la place et le statut de la théologie dans les domaines dont elle
s’occupe traditionnellement, à savoir l’université, l’Église et la
société? Dans cette optique, je ferai d’abord le constat que la théolo-
gie, dans ces trois domaines, ne remplit plus de rôle qui va de soi;
elle semble renvoyée à la marge de ce qui se passe dans ces domaines.
Ensuite, je développerai la thèse selon laquelle la théologie ne peut
remplir correctement sa tâche aujourd’hui que si elle ne fuit pas cette
marginalisation (en se retirant par exemple dans un des trois domaines),
mais accepte de subir celle-ci consciemment et volontairement. Mieux
encore: la théologie peut être crédible et pertinente aujourd’hui surtout
lorsque, précisément à partir de la marge, elle prend place au carre-
four de l’université, de l’Église et de la société.
Au carrefour où ces trois domaines se touchent, la théologie peut
donc, à de nouvelles conditions, fournir un apport authentique à cha-
cun d’eux. À cet effet, elle doit s’adonner pleinement au dialogue
avec ce dont il est question et ce qui est en jeu dans les trois domaines.
Le dialogue avec la philosophie contemporaine, principalement
la philosophie de la différence, peut être particulièrement utile à la
théologie. Elle peut apprendre à la théologie à développer des schémas
de pensée qui lui permettent de revoir sa tâche dans le contexte
contemporain à partir de la marge.
La présente contribution comporte trois parties. Dans la première
partie, je discuterai de la place modifiée de la théologie à l’université,
dans l’Église et dans la société, et je développerai ma thèse selon
1 Cet article reprend une conférence donnée dans le cadre du colloque La théolo-
gie au sein des rationalités contemporaines, à Louvain-la-Neuve, le 23 janvier 2013.
Il sera également repris dans les Actes de ce colloque qui seront publiés prochaine-
ment, sous la direction d’Olivier Riaudel.
96500_RTL_2013/3_03_Boeve.indd 38896500_RTL_2013/3_03_Boeve.indd 388 3/09/13 15:543/09/13 15:54

THÉOLOGIE, ÉGLISE, UNIVERSITÉ, SOCIÉTÉ 389
laquelle la théologie doit aujourd’hui retrouver sa place à partir de la
marge et au carrefour. Dans la deuxième partie, je montrerai comment
– dans une utilisation renouvelée de l’adage traditionnel philosophia
ancilla theologiae – le dialogue critico-productif avec la pensée
philosophique de la différence peut aider la théologie. Dans la troi-
sième partie, j’illustrerai comment la théologie, dans chacun des
domaines évoqués, à la marge et au carrefour, peut, à partir de la
différence, faire la différence.
I. LA THÉOLOGIE AUJOURD’HUI: À PROPOS DE MARGINALISATION
ET DE STRATÉGIES D’ÉVITEMENT
Il y a environ cinq ans, en 2008, je réfléchissais, comme président
de l’Association Européenne de Théologie Catholique, lors du congrès
bisannuel de cette association à Limerick, à la question de la situation
actuelle de la théologie, en particulier de la théologie catholique2.
De par les processus de sécularisation et de pluralisation, la situation
de la foi chrétienne, et donc également celle de l’Église, a fondamen-
talement changé en Europe. Cet état de fait ne pouvait demeurer
sans conséquences sur la manière dont la théologie, définie de façon
classique à partir de l’adage anselmien comme «foi – c’est-à-dire foi
chrétienne – en quête d’intelligence», fonctionne dans ce contexte
européen. Car sa crédibilité et sa pertinence, qui allaient de pair avec
le caractère évident de l’horizon de sens chrétien, se voient mises sous
pression lorsque cette évidence disparaît.
En quelques générations, la Belgique a connu un changement très
rapide. L’époque où la foi chrétienne et l’Église catholique, comme
pendant institutionnel et représentant de cette foi, bénéficiaient d’un
être-là pratiquement non-questionné, est révolue depuis déjà plusieurs
décennies. Ceci se marque non seulement dans les chiffres drasti-
quement en baisse de la fréquentation ecclésiale et de l’autodéfini-
tion religieuse comme catholique, mais également dans une familia-
rité moins assurée avec les récits, les images et les sensibilités
2 Cf. L. BOEVE, «Theology at the Crossroads of Academy, Church and Society»,
dans ET Studies 1, 2010, p. 71-90.
96500_RTL_2013/3_03_Boeve.indd 38996500_RTL_2013/3_03_Boeve.indd 389 3/09/13 15:543/09/13 15:54

390 L. BOEVE
chrétiennes3. À côté de cette sécularisation est apparue en même
temps, en partie en raison des migrations mais pas exclusivement, une
pluralisation religieuse, qui a contribué à affaiblir davantage encore
le caractère évident de l’horizon de sens catholique. La sécularisation
de la Belgique a conduit à une société postchrétienne, qui n’est cepen-
dant pas, sans plus, areligieuse ou athée. À peu près un tiers de la
population belge se décrit lui-même comme n’appartenant à aucune
dénomination religieuse, sans se considérer comme athée4, et nombre
de ces personnes déclarent être sensibles au spirituel et au transcen-
dant5. La situation postchrétienne est donc, en même temps, une situa-
tion postséculière. Dans ces deux catégories, le terme «post» ne
signifie pas simplement «après» (comme si ces deux réalités et leurs
effets avaient disparu), mais plutôt que, culturellement parlant, notre
relation à la foi chrétienne et au processus de sécularisation a changé6.
À les considérer de plus près, ces processus ont abouti à une situa-
tion convictionnelle qui se caractérise, en Belgique, par une étrange
combinaison. D’une part, par défaut, une sorte de position postchré-
tienne de quasi-neutralité – influencée par la sécularisation – est mise
en avant dans l’espace public. D’autre part, dans le cadre de ce qu’on
appelle société multiculturelle, une sorte de pluralisme postséculier de
convictions philosophiques et religieuses est reconnu. Cette combi-
naison est cependant marquée par une ambiguïté fondamentale. Elle
se manifeste, par exemple, lorsque les religions ou les convictions
veulent faire valoir leurs positions aussi dans l’espace public, ou
3 Cf. L. VOYÉ, K. DOBBELAERE & J. BILLIET, «Une église marginalisée?», dans
L. VOYÉ, K. DOBBELAERE & K. ABTS (éd.), Autres temps, autres mœurs: travail,
famille, éthique, religion et politique: la vision des Belges, Tielt, Lannoo, 2012,
p. 145-172.
4 Ibid., p. 147.
5 Ibid., p. 156.
6 La signification du terme postchrétien est la suivante: bien que les traces de la
foi chrétienne soient encore abondamment présentes dans notre société et notre cul-
ture, dans la formation de notre identité collective et individuelle, la foi chrétienne
n’est, en même temps, plus la toile de fond de la donation de sens qui peut être
acceptée comme évidente. Le terme postséculier, quant à lui, désigne le fait que les
présupposés de la thèse séculariste ne s’imposent pas davantage: la modernisation de
la société ne mène pas tout simplement à la disparition de la religion, mais à un mode
transformé de rapport à la religion – et aux convictions en général –, et à sa pluralisa-
tion. Voir, à ce propos, le premier chapitre de mon ouvrage God onderbreekt
de geschiedenis: Theologie in een tijd van ommekeer, Kapellen, Pelckmans, 2006,
p. 21-38 [traduit en anglais sous le titre: God Interrupts History: Theology in a Time
of Upheaval, New York, Continuum, 2007, 13-29].
96500_RTL_2013/3_03_Boeve.indd 39096500_RTL_2013/3_03_Boeve.indd 390 3/09/13 15:543/09/13 15:54

THÉOLOGIE, ÉGLISE, UNIVERSITÉ, SOCIÉTÉ 391
lorsque des conceptions ou des comportements convictionnels d’indi-
vidus ou de communautés semblent perturber la position-par-défaut
de quasi-neutralité. Cela apparaît aussi clairement dans l’incompré-
hension et l’indignation des défenseurs de la position-par-défaut de
quasi-neutralité, lorsque le système de valeurs sous-jacent à cette
position est mis en question, et lorsque ses présupposés souvent «soft-
sécularistes» sont critiqués: «neutre n’est en fait pas vraiment
neutre».
En conséquence de ceci, la place de la théologie dans les trois
domaines où elle s’exerce et auxquels elle entend s’adresser – l’uni-
versité, l’Église et la société – a subi un déplacement fondamental.
La théologie se rapporte effectivement à ces trois domaines: en tant
que discipline universitaire, qui aborde la foi chrétienne de manière
scientifique, la théologie exerce en même temps ses fonctions dans
l’Église, où elle contribue à l’expression réflexive de la compréhen-
sion de foi du peuple de Dieu7. Et dans la mesure où la foi chrétienne
vise à apporter une réponse aux questions de sens de personnes et de
communautés, la théologie doit également jouer un rôle dans le
domaine socio-culturel. Mais en raison des importants déplacements
contextuels déjà mentionnés, la théologie a perdu sa position centrale,
même lorsqu’il s’agit de son core business convictionnel, et elle a été
poussée vers la marge. Aujourd’hui, aussi bien à l’université que dans
l’Église et dans la société, sa voix est perçue d’une autre manière
qu’autrefois.
Voyons maintenant de quelle façon la théologie a été poussée vers
la marge dans chacun de ces trois domaines. Par la suite, j’indiquerai
comment la théologie réagit à cette marginalisation, et tente d’y
échapper. Il apparaîtra alors clairement que la façon dont la théologie
se déplace dans un des domaines a des conséquences sur sa position
dans les autres domaines. La même chose se produit lorsque, en raison
des déplacements mentionnés, la théologie redéfinit elle-même sa
place: la reconfiguration de la théologie dans un domaine a la plupart
du temps un impact immédiat sur son rôle et sa place dans les autres
domaines.
7 Voir, à ce propos, la récente déclaration de la Commission Théologique Inter-
nationale, Theology Today: Perspectives, Principles and Criteria (faite à Rome, le
8 mars 2012, et disponible sur www.vatican.va).
96500_RTL_2013/3_03_Boeve.indd 39196500_RTL_2013/3_03_Boeve.indd 391 3/09/13 15:543/09/13 15:54

392 L. BOEVE
(a) À l’université, la traditionnelle première place de la théologie
parmi les disciplines académiques a été, soit supprimée depuis long-
temps, soit réduite à une pure tradition. En ce qui concerne l’Univer-
sité de Louvain, l’acte d’érection de la faculté de théologie en 1432,
sept ans après la fondation de l’université en 1425, stipule explicite-
ment que cette nouvelle faculté reçoit la préséance sur les autres,
et que, par conséquent, ses professeurs doivent occuper la première
place dans la procession des togati. Aujourd’hui encore, ce dernier
point demeure d’actualité, mais cela n’a plus grand-chose à voir avec
le prestige de la discipline théologique.
Cette perte de prestige est bien entendu liée au changement de posi-
tion de la foi chrétienne dans notre société, et à l’émergence, égale-
ment à l’intérieur des universités catholiques, d’une position-par-
défaut postchrétienne, «soft-séculariste», parfois renforcée par un
positivisme empirico-scientifique. Effectivement, les théologiens se
rapportent explicitement à la tradition chrétienne, et ils ont pour
objectif d’apporter une contribution à cette tradition, à partir de leur
propre réflexion. Dans la mesure où la théologie tend vers cette fina-
lité théologique, elle s’ajuste de moins en moins bien au cadre uni-
versitaire actuel, et son statut en tant que discipline académique se
voit contesté. Plus encore, dans une période de pluralisme religieux,
la théologie demeure alors par trop attachée à une seule tradition,
greffée sur une seule communauté de foi, devenue peu à peu une
minorité. Ce changement de position vient par ailleurs s’ajouter à un
déplacement qui concerne l’ensemble des sciences humaines: les
tendances empirico-positivistes et pragmatiques que de nombreuses
universités adoptent à l’égard de la recherche et de l’enseignement
(avec une attention centrée sur la recherche de fonds, l’applicabilité
économique des résultats des recherches, la pertinence sociétale quasi-
immédiate, la disponibilité à l’emploi des jeunes diplômés…) portent
atteinte à la place de nombreuses disciplines dans des facultés telles
que les facultés de lettres, de sciences sociales, de pédagogie, de
philosophie et de théologie.
Dans les pays qui nous entourent, cette marginalisation a souvent
incité les facultés de théologie et les théologiens individuels à relati-
viser la finalité théologique de leurs disciplines et à se replier sur
la teneur scientifico-religieuse de leur occupation. Des facultés de
théologie se muent en départements de sciences des religions, et
se consacrent de plus en plus à la recherche empirique, historico-
96500_RTL_2013/3_03_Boeve.indd 39296500_RTL_2013/3_03_Boeve.indd 392 3/09/13 15:543/09/13 15:54
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%