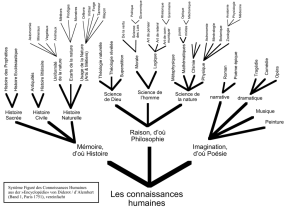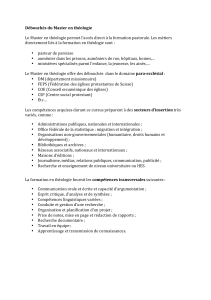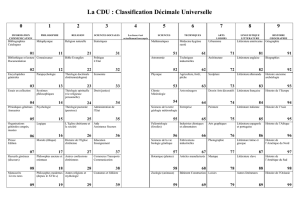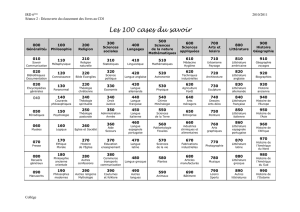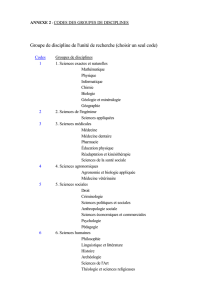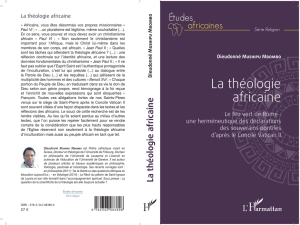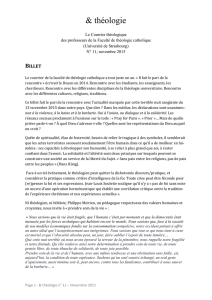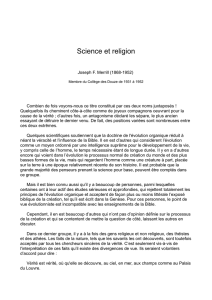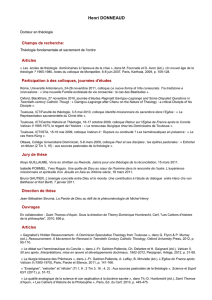disc card ravasi inauguration

QUELLES POSSIBILITÉS POUR LA THÉOLOGIE
DE SE RENDRE PRÉSENTE DANS LA CULTURE?
de S. E. le Cardinal Gianfranco RAVASI
Excellence,
Messieurs et Mesdames les Professeurs,
Chers Etudiants,
Je suis particulièrement heureux d’intervenir au sein d’une institution
académique aussi prestigieuse que celle de l’Université de Fribourg, parce que j’ai
moi-même passé une bonne partie de ma vie dans le milieu de l’enseignement, à la
Faculté de théologie de l’Italie septentrionale. C’est pour cette raison que mon
discours sera un discours allant à l’essentiel, prononcé dans un climat de familiarité
entre élèves et professeurs à qui j’adresse mes plus affectueuses salutations. La
réflexion que je vous propose sera très simplifiée car les deux pôles du sujet qui m’a
été assigné sont de nature complexe et admettent une infinité de parcours analytiques
possibles.
D’une part, en effet, la théologie, de même que le message religieux, revêt des
formes multiples. Comme l’écrit Karl Barth dans sa fameuse Einführung in die
evangelische Theologie, « de toutes les sciences, la théologie est la plus belle, celle
qui touche le plus profondément l’intelligence et le cœur, celle qui s’approche au plus
près de la réalité humaine et offre les plus claires visions de la vérité […]. Mais elle
est aussi la plus difficile et la plus dangereuse ; celle, lorsqu’on s’y engage, qui
conduit bien vite au désespoir ou, ce qui est presque encore pire, à l’orgueil ; celle qui
peut devenir la plus horrible chose qui soit : sa propre caricature ». En outre, dans la
société contemporaine, elle se trouve confrontée aux défis tout-à-fait nouveaux et
difficiles de la vague de la sécularisation, pour accoster sur les nouvelles apparitions

du sacré qui balancent entre la vive excitation du fondamentalisme et de l’intégrisme
et la fade confusion du syncrétisme, entre le traditionalisme dévot et le conformisme
inerte des nouveaux modèles de masse.
D’autre part, même la culture, conçue par le passé comme l’aristocratie de l’art
et de la science, s’est transformée en une catégorie anthropologique de portée
générale qui comprend de manière transversale l’intégralité de la pensée et de l’agir
social dans ses formes les plus diverses, jusqu’à inclure toutes les productions
contemporaines. On peut simplement se demander ce que signifie l’évolution du
langage et de la communication avec l’arrivée du digital, d’internet, de la
cyberculture. De même manière, l’art a adopté de nouvelles grammaires expressives
bien loin des grammaires classiques, alors que les cultures des jeunes révèlent des
modèles de vie et de pensée tout à fait inédits si on les compare avec ceux des
générations précédentes. En outre, la domination des techno-sciences se fait de plus
en plus puissante au point de conditionner la morale commune, comme on peut le
constater dans le domaine de la bioéthique. Une infinité de phénomènes migratoires
et celui de la globalisation ont créé une société dans laquelle domine l’interculturalité,
avec tous les corolaires qu’elle comporte.
La foi chrétienne est par sa nature « incarnée ». Elle exige nécessairement de se
confronter avec un tel horizon, fluide et complexe. Pour ce faire, il faut éviter toute
stratégie basée sur la seule défensive, mais bien plutôt accepter le dialogue. Cela
suppose avant toute chose la protection de son identité propre et la conscience de la
vérité que l’on porte, mais aussi la confrontation et l’écoute du logos de l’autre, avec
ses thèses et ses vérités. Certes, comme l’indiquait Maritain, le fait de « se poser »
dans la société signifie également « s’opposer », générant ainsi un rapport
dialectique. Cependant le fait de « se poser » ne doit jamais se transformer en
« s’imposer », si ce n’est par l’évidence de l’argumentation et des valeurs. Il faut dès
lors « composer » dans un dialogue qui dévoile les points communs mais préserve
l’harmonie dans la diversité. Au duel doit donc se substituer le duo, cet exercice
musical qui permet de conjuguer dans l’harmonie un basson et un soprano, sans

renoncer aux timbres de leurs voix pourtant radicalement différentes, et de les inclure
dans un projet sym-phonique [la symbiose des sons].
C’est là le sens du « Parvis des Gentils » que, avec grand succès et sous
l’impulsion de Benoit XVI, le Conseil Pontifical de la Culture met en place dans une
véritable constellation de villes et de nations européennes et américaines, en attendant
d’en organiser dans les autres continents. Croyants et non croyants se confrontent sur
les grands thèmes de l’être et de l’exister, sur l’éthique et la culture, sur l’immanence
et la transcendance, cherchant à confronter les opinions respectives, générant ainsi
bien souvent un dialogue fécond. Par cette activité, on cherche à toucher également
les milieux populaires, les expériences des jeunes, jusqu’à créer un surprenant et
vivace « Parvis des enfants » de familles croyantes, indifférentes ou explicitement
dépourvues de tout intérêt religieux.
C’est justement à cause de ce grand nombre de parcours possibles que j’ai
choisi de ne proposer, dans ce temps limité, qu’un emblème du lien et de la
confrontation entre théologie et culture, dédiant ma réflexion trop simplifiée à l’un
des dialogues les plus ardus et les plus problématiques, celui entre la théologie et la
science.
Nous partirons de la provocation si fameuse d’Einstein sur la science boiteuse
et la religion aveugle quand elles s’ignorent, et qui a trouvé un écho dans le discours
de Jean-Paul II précisément à l’occasion du centenaire de la naissance d’Einstein
(1879-1979). Le Pape, en effet, citant le document de Vatican II Gaudium et spes
(n°7), rappelait : « Les conditions nouvelles affectent la vie religieuse elle-
même…. L’essor de l’esprit critique la purifie d’une conception magique du monde
et des survivances superstitieuses ». Le célèbre savant Max Planck a été encore plus
explicite dans son essai Connaissance du monde physique (1906, 1947), lorsqu’il
écrivait : « Science et religion ne sont pas en opposition, mais ont besoin l’une de
l’autre pour se compléter dans l’esprit de l’homme qui pense sérieusement ».

Ainsi, il faut que l’homme de science renonce à cette autosuffisance
orgueilleuse qui le pousse à reléguer la théologie parmi les restes d’un paléolithique
intellectuel et à cette hybris qui lui fait croire à la capacité de la science de tout
comprendre, dans une connaissance exhaustive de la totalité de l’être et de l’exister,
du sens et des valeurs. Mais il faut aussi que soit vaincue la tentation du théologien
désireux de délimiter le terrain de la recherche scientifique et d’en orienter les
résultats vers un soutien apologétique de ses propres thèses. Il convient de redire que
savant et théologien doivent rester fidèles à leurs propres règles de recherche, mais
prêts également à respecter et à prendre en considération les méthodes et les résultats
des autres approches.
Saint Augustin en était déjà conscient lorsqu’il affirmait dans la polémique
Contre Felice Manicheo : « On ne lit pas dans l’Evangile que le Seigneur a dit : Je
vous enverrai le Paraclet qui vous enseignera comment se meuvent la terre et le
soleil. Il voulait former des chrétiens, non des mathématiciens ». La ligne de
démarcation tracée par Galilée dans la célèbre lettre à l’abbé bénédictin Benedetto
Castelli est donc toujours valide : « L’autorité de l’Esprit-Saint a pour but de
convaincre les hommes des vérités qui, étant nécessaires à leur Salut et surpassant
tous les discours humains, ne peuvent être connues par d’autre sciences ni par nul
autre moyen sinon par la bouche de ce même Esprit-Saint ». On délimite ainsi la
« vérité » authentique que la Bible veut transmettre, une vérité qui n’est pas de type
scientifique mais théologique, comme le répétera Dei Verbum au Concile Vatican II :
« Les livres de la Sainte Ecriture […] enseignent fermement, fidèlement et sans
erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les Lettres sacrées pour notre
salut » (n. 11).
Il importe donc avant tout que règne une sorte de respect mutuel au niveau
méthodologique, de coexistence pacifique entre science et foi, laissant de côté cet
affrontement qui a connu un apogée dans le positivisme d’Auguste Comte, qui niait
la « légitimité de toute interrogation au-delà de la physique ». Des positions
semblables se retrouvent dans le néopositivisme du 20ème siècle. Le Tractatus logico-

philosophicus de Ludwig Wittgenstein (1921) déclarait privées de sens scientifique
les propositions de la métaphysique, de l’éthique et de l’esthétique parce qu’elles ne
sont l’image d’aucune réalité de ce monde.
Si cette affirmation se limitait à l’horizon scientifique, elle serait
compréhensible. Mais les néo-positivistes du « Cercle de Vienne » (Schlick, Neurath,
Carnap et autres) sont allés au-delà et ont radicalement dévalué l’affirmation de
Wittgenstein au sujet des propositions non strictement « scientifiques ». En réalité,
pour le philosophe viennois –qui n’était pas un agnostique- il s’agissait seulement
dans de telles propositions d’une « ineffabilité », signifiant : « sur ce dont on ne peut
pas parler, il faut se taire », et certainement pas de leur absurdité. Même s’il y a
encore des épigones vigoureux des thèses du « Cercle », tels que les défenseurs d’un
scientisme outrancier (Dawkins, Hitchens, Onfray, Odifreddi), de semblables
positions sont désormais regardées comme simplificatrices, même par de nombreuses
personnalités « laïques » ou « humanistes séculières ».
Les rapports entre les deux camps se déroulent en effet de plus en plus dans un
respect mutuel et cohérent : la science se consacre aux faits, aux données, à la
« scène », au « comment » ; la métaphysique et la religion aux valeurs, aux
significations ultimes, au « fondement », au « pourquoi », chacune selon des
protocoles spécifiques de recherche. C’est ce que le savant américain Stephen J.
Gould, mort en 2002, a systématisé dans sa formule des NOMA (Non Overlapping
Magisteria), c’est-à-dire des parcours non superposables : celui de la connaissance
philosophico-théologique et celui de la connaissance empirico-scientifique. Ils
correspondent à deux niveaux méthodologiques, épistémologiques et linguistiques
qui, se situant à des plans différents, ne peuvent se croiser, sont incommensurables
entre eux, mutuellement intraduisibles, et n’entrent donc pas en conflit. Comme
Nietzsche l’écrivait déjà en 1878 dans Humain, trop humain, « Entre religion et
science n’existe ni parenté ni amitié, ni non plus inimitié : elles vivent dans des
sphères différentes ».
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%