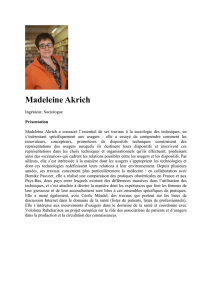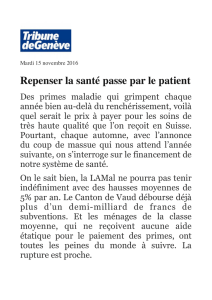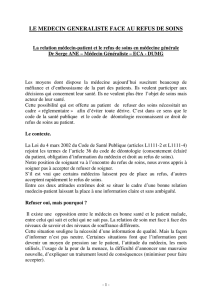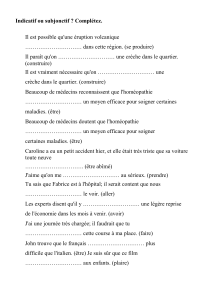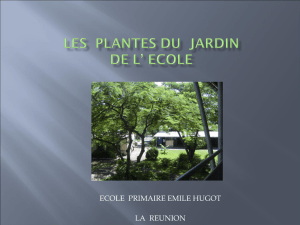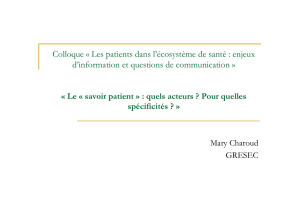Ce que soigner veut dire

Ce que soigner veut dire
Les patients, la vie quotidienne et les limites du choix

© Presses des MINES, 2009
60, boulevard Saint-Michel - 75272 Paris Cedex 06 - France
email : [email protected]
http://www.ensmp.fr/Presses
ISBN : 978-2-911256-09-7
Dépôt légal : 2009
Achevé d’imprimer en 2009 (Paris)
Tous droits de reproduction, de traduction, d’adaptation et d’exécution réservés pour
tous les pays.

3
Annemarie Mol
Ce que soigner veut dire
Les patients, la vie quotidienne
et les limites du choix
Traduit par Monique Debauche et Chantal Debauche

COLLECTION SCIENCES SOCIALES
Paris, Presses des mines
Responsable de la collection : Cécile Méadel
Centre de sociologie de l’innovation (http://www.csi.ensmp.fr/)
Dans la même collection
Madeleine Akrich, Cécile Méadel et
Vololona Rabeharisoa
Se mobiliser pour la santé. Les
associations de patients témoignent.
Madeleine Akrich, Joao Nunes,
Florence Paterson
et Vololona Rabeharisoa (eds)
The dynamics of patient organizations
in Europe
Maggie Mort, Christine Milligan,
Celia Roberts and Ingunn Moser (ed.)
Ageing, Technology and Home Care
Madeleine Akrich, Michel Callon et
Bruno Latour
Sociologie de la traduction. Textes
fondateurs
Alain Desrosières
Pour une sociologie de la
quantification.
L’Argument statistique I
Gouverner par les nombres.
L’Argument statistique II
Coordonné par Antoine Savoye et
Fabien Cardoni
Frédéric Le Play, parcours, audience,
héritage
Anthologie établie par Frédéric
Audren et Antoine Savoye
La Naissance de l’ingénieur social
Anne-France de Saint Laurent-Kogan
et Jean-Louis Metzger (dir.)
Où va le travail à l’ère du numérique ?
Bruno Latour
Chroniques d’un amateur de sciences
Vololona Rabeharisoa
et Michel Callon
Le Pouvoir des malades
Sophie Dubuisson
et Antoine Hennion
Le Design : l’objet dans l’usage
Philippe Larédo
L’Impact en France des programmes
communautaires de recherche

5
Introduction
Ce livre oppose deux façons d’envisager la maladie. L’une, la logique
du soin, est le sujet central du livre, tandis que l’autre, la logique du
choix, fait contraste. Mais laissez-moi d’abord vous raconter quelques
histoires. On peut les présenter comme des expériences personnelles ou
comme des observations ethnographiques, la différence n’est pas
vraiment pertinente. Toutes relatent des événements qui m’ont amenée
à écrire ce livre, et elles fournissent une première approche des
préoccupations qui l’animent.
Première histoire. Au début des années 1980, la télévision
néerlandaise programme un débat sur la Fécondation In Vitro (FIV). En
tant que jeune universitaire féministe, philosophe étudiant les sciences
biomédicales et leurs techniques, je m’installe pour regarder comment
les attentes et les problèmes provoqués par la FIV vont être présentés.
Sans doute sera-t-il surtout question de bébés très désirés. Mais que
dira-t-on des doses massives d’hormones qu’il faut injecter aux femmes
en cours de traitement ? Mentionnera-t-on que la vie de ces femmes va
tourner pendant de longs mois autour des cycles d’ovulation et des
cultures d’embryons ? La discussion s’attardera-t-elle sur l’espoir des
parents d’avoir un enfant “à eux”, une aspiration continuellement
alimentée, alors qu’elle restera insatisfaite dans la plupart des cas. Je
me rends bien compte qu’il est peu probable que l’un des invités
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%