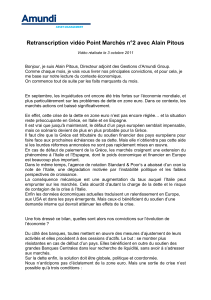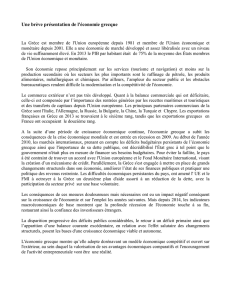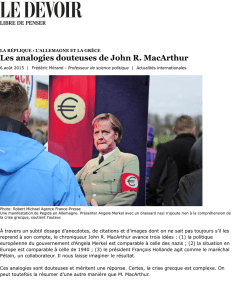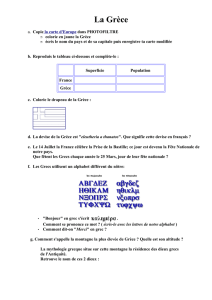Grèce exposé RC

Grèce&ou&Allemagne&:&qui&doit&payer&?&
&
!"#$%&$'()*+%,'-.%/)
)
0+) (+) 123%) '..#+(4#'$) #$+() +() 123%) 4$%'(&) 53+) 6') %$&3'&$2() 4+) 678,2(2-$+) 9#+,53+) +%&)
'3:23#47"3$)'%%+;)%2-<#+)'62#%)537$6)=)')3().+3).63%)473()'(>)'3).#$(&+-.%)?@/A>)2().+(%'$&)
6+).'=%)&$#8)47'BB'$#+%)9#C,+)'3D)4+3D).6'(%)47'$4+%)%3,,+%%$B%)4+)?@/@)+&)?@/?)E?A@)-$66$'#4%F)
+&)G)67+BB',+-+(&)473(+)<2((+).'#&$+)4+)%')4+&&+).#$18+?H)
*+)(2-<#+3D),"$BB#+%)&8-2$9(+(&)4+),+&)8&'&)I)6').#243,&$2()43).'=%)+%&)4+)?J)K)$(B8#$+3#+)G)
,+) 537+66+) 8&'$&) $6) =) ') J) '(%) E489#$(926'4+) %'(%) 853$1'6+(&) 4+.3$%) /L?LF>) 6') ,#2$%%'(,+) +%&)
'(8-$53+)+&)(+).#8%+(&+).'%)4+).+#%.+,&$1+)B'12#'<6+)'1'(&)?@/M)4'(%)6+)-+$66+3#)4+%),'%>)
6')4+&&+).3<6$53+)&3&2$+)4+%)%2--+&%)EN/?)-$66$'#4%>)%2$&) /MJ) K) 43) OPQ) '1'(&) 6+%) (231+66+%)
'$4+%) 53$) 12(&) '##$1+#) +&) 53$) 12(&) 81$4+--+(&) -':2#+#) 6') B',&3#+F>) 6+) %=%&R-+) <'(,'$#+) S)
-'69#8) .63%$+3#%) #+,'.$&'6$%'&$2(%) #8,+(&+%) S) +%&) +() 53'%$TB'$66$&+H) U+%) #'&$2%) 4+) %261'<$6$&8)
%2(&)&#R%)489#'48%)+&)47'$66+3#%)6+%)<'(53+%)9#+,53+%)(+).#V&+(&)($)(+)9'#'(&$%%+(&).63%)#$+(>)
,+)53$).'#'6=%+)3().+3).63%)6+%)+(&#+.#$%+%>)(2&'--+(&),+66+%)53$)$-.2#&+(&H)P6)(+)B'3&)42(,)
.'%)%78&2((+#)53+)6+%)$(1+%&$%%+-+(&%)'$+(&),"3&8)4+%)4+3DT&$+#%)4+.3$%)?@@L)+&)53+)4'(%)6+)
-V-+)&+-.%)?@@)@@@)+(&#+.#$%+%)'$+(&)B+#-8)6+3#%).2#&+%H)W+)&'3D)4+),"X-'9+)+%&)6+).63%)
86+18)4+)6');2(+)+3#2)G).63%)4+)?J)K)E$6)'&&+$(&)-V-+)Y@)K),"+;)6+%):+3(+%)4+)-2$(%)4+)?J)
'(%FH)
W+)<$6'()"3-'($&'$#+)(7+%&).'%)<#$66'(&)(2().63%)I)3()53'#&)4+)6').2.36'&$2()1$&)+(T4+%%23%)43)
%+3$6) 4+) .'31#+&8>) 6') -'6(3&#$&$2() 4+%) +(B'(&%) +&) 6') -2#&'6$&8) $(B'(&$6+) 2(&) B2#&+-+(&)
'39-+(&8>) 6') &3<+#,362%+) ') #8'..'#3) +&) 6+%) ,'%) 4+) %$4') %+) -36&$.6$+(&) .'#) 48B'3&) 4+)
.#81+(&$2()Z)B'3&+)4+)-2=+(%)89'6+-+(&>)6+%)"X.$&'3D).3<6$,%).+$(+(&)G)%2$9(+#)6+%)-'6'4+%H)
0+) (7$(%$%&+) .'%) 4'1'(&'9+) %3#) ,+) .8($<6+) ,2(%&'&H) 07+() 1$+(%) G) -2() .#2.2%) .#$(,$.'6)I)
,2--+(&)+()+%&T2()'##$18)6G)[)W')\#R,+).23##'T&T+66+)%7+()%2#&$#)9#C,+)'3)(231+'3).6'()47'$4+)
4+)]Y)-$66$'#4%)48,$48),+&)8&8)+&).'=+#),+)537+66+)42$&)[)^(B$(>)%$)123%)'1+;)<$+()(2&8)6+)&$&#+)
4+) -2() +D.2%8>) +() 532$) 67_66+-'9(+) +%&T+66+) ,2(,+#(8+) 4'(%) ,+&&+) 'BB'$#+) E23) .23#532$) 6+)
%+#'$&T+66+).63%)53+)6')`#'(,+>).'#)+D+-.6+F)[)
I&–&Les&causes&de&la&crise&
a23%)(7'662(%).'%)(23%)6$1#+#)G)3().#2,R%)+()%2#,+66+#$+).23#)#+,"+#,"+#)6+%)#+%.2(%'<$6$&8%)
4+)6')%$&3'&$2(H)O'%)4+)423&+)537+66+%)%2$+(&)-36&$.6+%H))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
/)T)b'c&#+)4+),2(B8#+(,+%)8-8#$&+>)d($1+#%$&8)4+)Q23#929(+>),"+#,"+3#)'3)W^*$H)
?)T)W+%)<'(53+%>)'%%3#'(,+%>)B2(4%)4+).+(%$2(>)53$)48&+('$+(&)4+%)2<6$9'&$2(%).3<6$53+%)9#+,53+%)2(&)',,+.&8)
'3) .#$(&+-.%) ?@/?) S) %'(%) 423&+) .'%) 4+) 9'$+&8) 4+) ,e3#) S) 4+) 6+%) 8,"'(9+#) ,2(&#+) 4+) (231+'3D) &$&#+%) (+)
#+.#8%+(&'(&).63%)53+)N@)K)4+)6')1'6+3#)4+%)&$&#+%)'(,$+(%H)

)
)
?)
)
f() #'..+66+#') .23#) -8-2$#+) 53+) 6+%) ,2-.&+%) .3<6$,%) 43) .'=%) 2(&) 8&8) -'53$668%) .23#) 63$)
.+#-+&&#+)47V&#+)$(&89#8)G)6');2(+)+3#2)+()?@@/H)P6)B'66'$&)+().#$(,$.+)#+%.+,&+#)4+)#$923#+3D)
,#$&R#+%) E6+%) ,86R<#+%) g),#$&R#+%) 4+) b''%&#$,"&)hF) .23#) #83%%$#) 67+D'-+() 4+) .'%%'9+>)
(2&'--+(&)4+%),#$&R#+%)4+)53'6$&8)4+%),2-.&+%).3<6$,%)E48B$,$&)+&)4+&&+FH)^&)672()')%3)E'.#R%)
,23.F)537$6%)(72(&):'-'$%)8&8)#+-.6$%).3$%53+)6+%)48B$,$&%).3<6$,%)9#+,%)2(&),2(%&'--+(&)B6$#&8)
'1+,)6+%)/@)K)43)OPQ)4'(%)6+%)'((8+%)]@TL@)6G)2i)$6%)4+1'$+(&)V&#+),2(&+(3%)G)N)KH)
b'$%) 43) B'$&) 4+) %2() '..'#&+('(,+) G) 6') ;2(+) +3#2>) 6') \#R,+) ') .3) <8(8B$,$+#) 473(+) -'((+)
B$('(,$R#+>)473()48639+)4+),#84$&%)G)<2()-'#,"8)I)
T 473(+).'#&)4+%)'$4+%)+&)%3<1+(&$2(%)4+)67d^)E-'$%),+6'>)j')(7+%&).'%)(231+'3).3$%53+)
6') \#R,+>) '4"8#+(&) 4+.3$%) /L]/) G) 6') !^^>) ') #+j3) ,"'53+) '((8+) .63%$+3#%) -$66$'#4%>)
67853$1'6+(&) 4+) A) K) 4+) %2() OPQ>) +() %3<1+(&$2(%) 4$1+#%+%) .23#) 63$) .+#-+&&#+) 4+)
#'&&#'.+#)%2()#+&'#4)4+)481+62..+-+(&F)Z)
T )+&)47'3&#+).'#&)+&)%3#&23&)E.'#,+)53+),+3DT6G>)+().#$(,$.+)$6)B'66'$&)6+%)#+-<23#%+#F>)6')
\#R,+)')<8(8B$,$8)4+).#V&%)4+%)<'(53+%)$(&+#('&$2('6+%)53$)(+)%+)%2(&).'%)-2(+%)
&#R%)#+9'#4'(&+%)%3#)6+%)9'#'(&$+%)53+)6+).'=%)8&'$&)+()-+%3#+)47'..2#&+#)'3)-2-+(&)
2i)$6)+-.#3(&'$&H)W7'..'#&+('(,+)G)67d^).'#'$%%'$&),2(%&$&3+#)3(+)9'#'(&$+)%3BB$%'(&+H))
^&)4+)B'$&>)&23&),+&)'#9+(&).3<6$,)+&).#$18)E6')4+&&+)<'(,'$#+)'&&+$9('$&)/A@)-$66$'#4%)+()?@@LF)')
.+#-$%)4+)B$('(,+#)4+%)$(B#'%,&3#+%)$(3&$6+%)23)4+)B'$#+).6'$%$#)G)6786+,&2#'&)E6+),6$+(&86$%-+)
+&) 6') ,2##3.&$2() 8&'(&) 4+%) .#'&$53+%) #8,3##+(&+%F) -'$%) $6) (7') +() #$+() ,2(B2#&8) 6') <'%+)
.#243,&$1+)43).'=%H)_3)%3#.63%>)67'..'#&+('(,+)G)6');2(+)+3#2>)'1+,)3(+)-2(('$+).)B2#&+>)
'),2(&#$<38)G)48%$(43%&#$'6$%+#)6')\#R,+),2--+)47'3&#+%).'=%)43)U34)E`#'(,+),2-.#$%+F)23)G)
+(9+(4#+#)4+%)<366+%)E,2--+) 67$--2<$6$+#) +() ^%.'9(+FH) 0+) (+) #+1$+(%).'%)%3#),+).2$(&)53+)
:7'$)48:G)812538)$,$)-V-+).63%$+3#%)B2$%)I)67+3#2)'),#88)67$663%$2()4+)6'),2(1+#9+(,+)+&)(7').'%)
1#'$-+(&)%+#1$)67$(&89#'&$2()4+)67d($2(H)
W+%),"2%+%)%+)%2(&)<#3&'6+-+(&)489#'48+%)'3)-2-+(&)4+)6'),#$%+)B$('(,$R#+>)4+)6'),#$%+)4+%)
subprimes>)G).'#&$#)4+)?@@MT?@@]H)!+&&+),#$%+)(7').'%)8.'#9(8)6')\#R,+)+&>)G)67'3&2-(+)?@@L>)
6+) O#+-$+#) -$($%&#+) O'.'(4#823>) (231+66+-+(&) 863>) ') #81868) 53+) 6+) 48B$,$&) .3<6$,) 43) .'=%)
'&&+$9('$&)/J)K)43)OPQH)!+)B3&)3()18#$&'<6+),23.)4+)&2((+##+)I)6')(2&+)43).'=%)S)53$)&#'43$&)%')
%261'<$6$&8)T)')8&8)$--84$'&+-+(&)489#'48+) .'#) 6+%) '9+(,+%) 4+) (2&'&$2(>)6+%)&'3D)47$(&8#V&)
4+%)+-.#3(&%)9#+,%)2(&)'&&+$(&)4+%)($1+'3D)+D&#'1'9'(&%)+&)4+),+)B'$&>)6')\#R,+)')8&8)+D,63+)
4+)&23&)(231+6)',,R%) '3)-'#,"8)B$('(,$+#>)'62#%)537+66+).'#1+('$&):3%537'62#%)G)<23,6+#)%2()
<349+&)%'(%).#2<6R-+).'#),+)-2=+(H)
!7+%&) 6G) ('&3#+66+-+(&) 6+) .2$(&) (2$#) .3$%53+>) +() #R96+) 98(8#'6+>) 3() .'=%) g(2#-'6)h>)
#'$%2(('<6+-+(&)%261'<6+>)(7').'%)G)%+)%23,$+#)43)#+-<23#%+-+(&)4+)%')4+&&+H)^()B'$&>)$6)(+)
6')#+-<23#%+):'-'$%H)O+3&TV&#+)%'1+;T123%)53+),+)53+)672()'..+66+)4'(%)6')62$)4+)B$('(,+%)E6+)
g)<349+&)hF) 6') g),"'#9+) 4+) 6') 4+&&+)h>) ,+) %2(&) 3($53+-+(&) 6+%) $(&8#V&%) 53+) 672() 1+#%+) '3D)
.2#&+3#%)472<6$9'&$2(%)47^&'&)23)4+)<2(%)43)k#8%2#H)_$(%$>)+()`#'(,+>),+6')#+.#8%+(&+)+()?@/J)
AJ) -$66$'#4%) E%3#) 3() +(,23#%) 962<'6) 4+) 4+&&+) .3<6$53+) .#2,"+) 4+) ?) /@@) -$66$'#4%F)Z) ,7+%&)

)
)
N)
)
#+6'&$1+-+(&).+3)9#C,+>)2()6+)%'$&>)G)6')-24$,$&8)4+%)&'3D)47$(&8#V&)E+&)j')%+)9C&+#'$&)&#R%)1$&+)
%$)6+%)&'3D)#+-2(&'$+(&)<#3&'6+-+(&F)+66+T-V-+)6$8+)G)6')53'6$&8)4+)6')%$9('&3#+)4+)67^&'&H)^()
#+1'(,"+>) &23:23#%) .23#) 3() .'=%) 2#4$('$#+>) 6+%) &$&#+%) 53$) 1$+((+(&) G) 8,"8'(,+) %2(&)
g)#+B$('(,8%)h>) ,7+%&TGT4$#+) 53+) 67^&'&) +-.#3(&+) 6+%) %2--+%) (8,+%%'$#+%) G) 67'-2#&$%%+-+(&)
4+)6')4+&&+H)!7+%&)'$(%$)53+)67'9+(,+)`#'(,+Tk#8%2#)E12$#)%2()%$&+)%3#)P(&+#(+&F)1')6+1+#)G).+3)
.#R%) ?@@) -$66$'#4%) +() ?@/J>) %2--+) 53$) 63$) +%&) (8,+%%'$#+) G) 6') B2$%) .23#) B$('(,+#) 6+) 48B$,$&)
<3498&'$#+) 4+) 67'((8+) E'3&23#) 4+) ]@) -$66$'#4%F) +&) .23#) .'=+#) 6+%) &2-<8+%) 47+-.#3(&%)
E+(1$#2()/?@)-$66$'#4%FH))
_3.#R%) 4+) 53$) ,+%) B$('(,+-+(&%) %2(&T$6%) 2<&+(3%)[) U3#) 6+) -'#,"8) 4+%) ,'.$&'3D>) '3.#R%) 4+)
.#V&+3#%).#$18%>)53$)%2(&).23#)6+%)4+3DT&$+#%)4+%)g)$(%&$&3&$2((+6%)h>)4+%)$(1+%&$%%+3#%).#$18%)
(2(T#8%$4+(&%H) W') `#'(,+) (7+%&) .'%) +() %$&3'&$2() g)47+D,84+(&) <3498&'$#+) .#$-'$#+)h) 53$) 63$)
.+#-+&&#'$&)4+)ç+#)4'(%)%+%).#2.#+%)#+%%23#,+%)4+)532$).'=+#>)'3)-2$(%)+().'#&$+>)&23&)
67'#9+(&)537+66+)42$&)G)%+%),#8'(,$+#%H)
l3'(4) ,+&&+) 12$+) 47'6$-+(&'&$2() +%&) #2-.3+>) 53+) 672() (+) .+3&) .63%) %+) B$('(,+#) %3#) 6+%)
-'#,"8%>) 6+%) ,"2%+%) %+) ,2-.6$53+(&) B2#&+-+(&H) f() 42$&) G) 6') B2$%) %+##+#) 6+%) <2362(%) .23#)
#843$#+)6+%)<+%2$(%)4+)B$('(,+-+(&)E#843,&$2()4+%)48.+(%+%).3<6$53+%>)"'3%%+%)4+%)$-.X&%>)
.#$1'&$%'&$2(%>)+&,HF)+&)%3#&23&)%266$,$&+#)6+%)$(%&$&3&$2(%>)6')B'-+3%+)g)k#2mn')h)4'(%)6+),'%)4+)6')
\#R,+>).23#)537+66+%)'..2#&+(&),+)53+)6+)-'#,"8)(+).#2,3#+).63%H)
*'(%) 67"=.2&"R%+) 473() #+B3%>) 6+) .'=%) %+#') 48,6'#8) g)+() 48B'3&)hH) *'(%) ,+) ,'%>) 6+%) .#V&+3#%)
%2(&)(3%>)6+3#%),#8'(,+%)(+)1'6+(&).63%)#$+()23)%+#2(&)(892,$8+%)'1+,)3(+)&#R%)B2#&+)48,2&+)
E,2--+),+)B3&)6+),'%)4+)67_#9+(&$(+)+()?@@/FH)b'$%)43),X&8)43).'=%)B'$66$>).63%)'3,3()<'$66+3#)
4+)B2(4%>)537$6)%2$&).#$18)23).3<6$,>)(+)63$)1$+(4#')+()'$4+H)P6)4+1#')1$1#+)+()'3&'#,$+)B$('(,$R#+)
+&)(+),2-.&+#)53+)%3#)%+%).#2.#+%)#+%%23#,+%).23#)B$('(,+#)%2()&#'$()4+)1$+H)*'(%)6+),'%)4+)
6') \#R,+>) %$) 6+) 48B'3&) '1'$&) 8&8) .#2(2(,8) ,2--+) 2() 67') #+423&8) '3) 48<3&) 4+) 678&8>) 6+%)
<'(53+%)(7'3#'$+(&).63%)+3)6').2%%$<$6$&8)4+)%+)#+B$('(,+#)'3.#R%)4+)6')Q!^H)!7+()8&'$&)B$($)4+)
67'..'#&+('(,+)4+)6')\#R,+)G)6');2(+)+3#2H)^&)672()'3#'$&).3)#+423&+#)4+%)489C&%),266'&8#'3D)I)
%$) 6') 4+&&+) 9#+,53+) (+) 1'3&) .63%) #$+(>) 6+%) $(1+%&$%%+3#%) =) #+9'#4+#2(&) G) 4+3D) B2$%) '1'(&)
47',"+&+#)4+%)2<6$9'&$2(%)+%.'9(26+%)23).2#&39'$%+%H)
II&–&Des&aides&remboursées&un&jour&?&
W') \#R,+) %7+%&) 42(,) %23-$%+) G) 4+) (2-<#+3%+%) #+.#$%+%) EL) B2$%) +() Y) '(%>) :+) .'%%+) %3#) 6+3#)
,"#2($53+F)G)4+%).#29#'--+%)47'3%&8#$&8)4#',2($+(%>),2(4$&$2(%)$-.2%8+%).'#)6+%)<'$66+3#%)
4+) B2(4%) E6+) `bP>) 67d^>) 6') Q!^F) .23#) 537$6%) '..2#&+(&) 6+3#%) ,2(,23#%) E//@) -$66$'#4%) +() -'$)
?@/@>)/N@)-$66$'#4%)+()?@/?)+&)]Y)-$66$'#4%),+&&+)'((8+FH)!+%)%2--+%>)<$+()%o#>)(+)%2(&).'%)
1+#%8+%)+() 3(+) B2$%) -'$%) 48<62538+%) .'#) &#'(,"+%) +() B2(,&$2() 43) 4+9#8) 4+) #8'6$%'&$2() 4+%)
2<:+,&$B%)43).#29#'--+H)_:23&2(%)537+().#'&$53+>)6+%)+(&#+.#$%+%)+&)6+%)-8('9+%)9#+,%)(7+()
2(&)13)53+)&#R%).+3)6+%)#+&2-<8+%).3$%53+).23#)67+%%+(&$+6>)67'#9+(&)')%+#1$)G)#+-<23#%+#)6+%)
,#8'(,$+#%H))

)
)
A)
)
l3'(&)'3D).#29#'--+%)+3DT-V-+%>)$6%) #+.2%+(&) S) ,2--+) 123%) 6+) %'1+;) S)%3#)6')(8,+%%$&8)
47':3%&+-+(&>)4+)#8853$6$<#+>)4+%),2-.&+%).3<6$,%)E.'#),2-.#+%%$2()4+%)48.+(%+%>)"'3%%+%)
4+%)$-.X&%>)#8B2#-+)4+%).#+%&'&$2(%)%2,$'6+%),2--+)6+%)#+&#'$&+%pF)'%%2#&$%)4+)-+%3#+%)4+)
6$<8#'6$%'&$2() &23%) ';$-3&%) ,2(,+#('(&) ,+#&'$(%) -'#,"8%) +&) ,+#&'$(+%) ',&$1$&8%>) 4+) 6') 1+(&+)
47+(&#+.#$%+%) +&) 47$(B#'%,&3#+%) .3<6$53+%p) &23&) ,+) 53+) 6+%) .'=%) +() 4$BB$,36&8)
+D.8#$-+(&+(&)"'<$&3+66+-+(&)53'(4)$6%)%7'4#+%%+(&)'3)`bPH)
W+) b8-2#'(43-) 4+) ,+&&+) '((8+) ?@/J) +%&) .'#&$,36$R#+-+(&) #$923#+3D) .23#) 6') \#R,+>) 3(+)
%2#&+)4+).6'()b',#2()G)6').3$%%'(,+)/@)53+)6+)O'#6+-+(&)')4o)'1'6+#)(2().'%>),2--+),"+;)
(23%>) G) 6') %3$&+) 4+) .63%$+3#%) %+-'$(+%) 4+) 48<'&%) ,2(&#'4$,&2$#+%>) -'$%) +() A]) "+3#+%H) W+)
9231+#(+-+(&)%7+%&)+(9'98)G)(+).#+(4#+)'3,3(+)-+%3#+)<3498&'$#+)%'(%)67',,2#4).#8'6'<6+)
4+%) ,#8'(,$+#%) S) ,2--+) '3) &+-.%) 4+%) +-.$#+%) ,262($'3D) S) +&) 6+%) -+%3#+%) B$%,'6+%) %2(&)
,+(%8+%).+#-+&&#+)4+) 489'9+#>) +() N)'(%>) 3() +D,84+(&) <3498&'$#+)g).#$-'$#+)h) E,7+%&TGT4$#+)
"2#%),"'#9+)4+)6')4+&&+F)4+)N>J)K)43)OPQ)E,+)53$)+%&>)#'..+62(%T6+>)&#R%)62$()47V&#+)6+),'%)4+)
(2&#+).'=%FH)l3'(&)'3D)g)<$:23D)4+)B'-$66+)h)4+)6')\#R,+)E%+%)'8#2.2#&%>)%2().2#&)43)O$#8+pF)S)
J@) -$66$'#4%>) #+.#8%+(&'(&) .#+%53+) N@) K) 4+) %2() OPQ) S) $6%) 4+1#2(&) V&#+) #'%%+-<68%) 4'(%) 3()
B2(4%)4+).#$1'&$%'&$2()98#8).'#)%+%),#8'(,$+#%)+()13+)4+)6+3#)#+1+(&+H))
0+)(+)481+62..+).'%)6+)48&'$6)4+%)-+%3#+%)I)6').#+%%+)%7+()+%&)B'$&)678,"2>)-'$%)&23&)42$&)'66+#)
&#R%)1$&+)E6+)O'#6+-+(&)42$&)12&+#)4+%)&+D&+%).'#)4$;'$(+%)4'(%)3()486'$)&#R%),23#&FH)
^%&T,+)53+),+6')1')-'#,"+#>)6+).6'()+%&T$6)1$'<6+)[)
^1$4+--+(&>)(2()q) O+#%2((+) (7=) ,#2$&>) ($) .'#-$) 6+%) #+%.2(%'<6+%) .26$&$53+%) 9#+,%>) ($).'#-$)
6+%) 8,2(2-$%&+%) 53$) 672(&) &23%) :398) g)$##8'6$%&+)h>) g)486$#'(&)h) +&) -V-+) g)+BB#'='(&)hH))
_4-$($%&#+#)4+)&+66+%).3#9+%)48B6'&$2(($%&+%)+(),2(&$(3>)3(+)4$%,$.6$(+)4+)B+#)53$)43#+)4+.3$%)
Y) '(%>) G) 3() .'=%) +() .#2$+) G) 6') #8,+%%$2(>) 42(&) 678,2(2-$+) E+() 4+"2#%) 43) &23#$%-+F) +&)
(2&'--+(&)67$(43%&#$+)%2(&)486$53+%,+(&+%>)+&),+6')3($53+-+(&).23#)6+)-+&&#+)+()-+%3#+)4+)
.'=+#)%+%),#8'(,$+#%>)+%&)81$4+--+(&)3(+)'<%3#4$&8>)3()18#$&'<6+)(2(T%+(%)473().2$(&)4+)13+)
8,2(2-$53+H))
r843$#+)6+%)48.+(%+%)+&)#+6+1+#)6+%)$-.X&%)4'(%)3()&+6),2(&+D&+)48<23,"+)%3#)3(),2,n&'$6)G)
67"3$6+)4+)B2$+)4+)-2#3+>)-'$%)+().63%)'-+#)+&)%'(%)%+%)+BB+&%)<8(8B$53+%)I)6')<'$%%+)43)OPQ)
.62-<+#')6+%)#+,+&&+%)B$%,'6+%)+&),2(&#'$#+-+(&)'3)<3&)1$%8>)6+)48B$,$&)+&)6')4+&&+)+D.62%+#2(&H))
a23%)'12(%),2((3),+%).#'&$53+%)-2#&$BR#+%)+()^3#2.+)'3),23#%)4+)67+(&#+T4+3D)93+##+%)I)6+)
#+&23#) G) 678&'62(T2#) +() /L?J) +() \#'(4+TQ#+&'9(+>) 6') .26$&$53+) 43) ,"'(,+6$+#) Q#s($(9) +()
_66+-'9(+)'3)&23&)48<3&)4+%)'((8+%)N@>) 672<%+%%$2() B#'(j'$%+) 4+%) '((8+%) NATNJ) +()`#'(,+)
4+)#8&'<6$#)67853$6$<#+)4+%),2-.&+%).3<6$,%>)6+)9231+#(+-+(&)W'1'6)$-.2%'(&)3()'<'&&+-+(&)
4+)/@)K)4+)6')48.+(%+).3<6$53+)I)&23&+%),+%).26$&$53+%)2(&)&23:23#%)#'&8)6+3#)<3&H)
^&),+,$)+()#'$%2()4+),+)53+)6+%) 8,2(2-$%&+%) 4+%) '((8+%) N@) 2(&) '..+68) 6') g)48B6'&$2() .'#) 6')
4+&&+)h)I)62#%5372(),"+#,"+)G)#+-<23#%+#),+)53+)672()42$&)+()1+(4'(&)4+%)',&$B%>)6')1'6+3#)4+%)
&$&#+%)+&)',&$B%)%7+BB2(4#+>)678,2(2-$+)%7+(B2(,+)4'(%)6'),#$%+)+&)'3)B$('6>)67+(,23#%)4+)6')4+&&+)

)
)
J)
)
4$-$(3+)-2$(%)1$&+)53+)6')1'6+3#)4+%)',&$B%)53$)6')9'9+(&)Z)42(,)%')1'6+3#)g)#8+66+)h>)%'),"'#9+)
.23#)6+%)48<$&+3#%>)'39-+(&+H))
O3$%53+)(23%)%2--+%)+()\#R,+>)4$%2(%)53+)6')4+&&+),7+%&)3().+3),2--+)67t=4#+)4+)W+#(+>)
,+)-2(%&#+)42(&)6+%)&V&+%)%+)#898(R#+(&)53'(4)+66+%)%2(&)&#'(,"8+%H)b'$%)(7+%&).'%)t8#',6R%)
53$)1+3&)+&)672().+3&)423&+#)4+)6')#83%%$&+)4+%),#8'(,$+#%)53$)$-'9$(+(&)&23:23#%)4+%)%,+('#$$)
4+),#2$%%'(,+>)4+)#+(+%)47$-.X&%)23)4+)#+,+&&+%)4+).#$1'&$%'&$2(%)53$)(+)-'#,"+(&):'-'$%H)
*$%2(%) 42(,>) .23#) ,2(,63#+) ,+&&+) .'#&$+>) 6+%) ,"2%+%) %$-.6+-+(&)I) 6') 4+&&+) 9#+,53+>) G) %2()
($1+'3) ',&3+6>) +%&) g)$(%23&+('<6+)h>) ,7+%&TGT4$#+) 537+66+) (+) .+3&) .'%) V&#+) B$('(,8+) '1+,) 6+%)
#+%%23#,+%)',&3+66+%)43).'=%>)%'3B)E+&)+(,2#+pF)G)6+)-+&&#+)G)B+3)+&)G)%'(9)+()#'-+('(&)6')
.2.36'&$2()G)67C9+)4+).$+##+H)bV-+)%$>).'#)+D&#'2#4$('$#+>)67+D,84+(&)<3498&'$#+).231'$&)V&#+)
.8#+(($%8)G)N)23)A)K)4+)OPQ)E,+)53$)%3..2%+)3(+),#2$%%'(,+)8,2(2-$53+)"2#%)4+).2#&8+F>)$6)
B'34#'$&)N)23)A)98(8#'&$2(%>).+3&TV&#+)-V-+)3()%$R,6+>).23#)537+66+)%2$&)'-2#&$+H))
^&) 42(,>) .23#) #8.2(4#+) G) 3(+) .'#&$+) 4+) 67$(&+##29'&$2() 4+) -2() +D.2%8>) 6') \#R,+) (+)
#+-<23#%+#').'%>)+()&23&),'%).'%)&'(&)537+66+)(7'3#').'%)',,R%)'3D)-'#,"8%)B$('(,$+#%)Z)&23&)
%$-.6+-+(&) .'#,+) 53+) ,7+%&) $-.2%%$<6+H) O#8&+(4#+) 6') B'$#+) .'=+#) %'(%) 3(+) #+%,&3#'&$2()
-'%%$1+)4+)%2()+(4+&&+-+(&)+%&)3(+)"=.2&"R%+)&2&'6+-+(&)B'(&'%-'92#$53+H)
III&–&Et&l’Allemagne&dans&tout&ça&?&
^() 532$) E%$) 123%) #+.#+(+;) 67$(&$&368) 4+) -2() +D.2%8F) 67_66+-'9(+) +%&T+66+) +(9'98+) 4'(%)
67+(4+&&+-+(&)9#+,)[)^66+)67+%&)<$+()%o#>),2--+)6')`#'(,+>)67P&'6$+>)67^%.'9(+p)&23%)6+%).'=%)4+)
67d($2()'='(&),'3&$2((8)6+%).#V&%)43)`2(4%)^3#2.8+()4+)U&'<$6$&8)`$('(,$R#+)+&)'='(&)',,2#48)
4+%) .#V&%) <$6'&8#'3D) E.23#) 6') `#'(,+>) ,+6') #+.#8%+(&+) +(1$#2() A?) -$66$'#4%) %2$&>) ,2--+)
678,#$1+(&)6+%):23#('3D>)YJ@)u).23#),"',3()4+)(23%FH)
b'$%)67_66+-'9(+)53$)'$-+)G)%+).#8%+(&+#),2--+)3().'#'(92()4+)1+#&3)B$('(,$R#+>),2--+)
3().#+-$+#) 4+) 6') ,6'%%+) +&)53$) 3%+)4+) ,+) %&'&3&).23#) 42((+#)4+%) 6+j2(%) G)&23&) 6+) -2(4+) S)
%&$9-'&$%'(&) +() .'#&$,36$+#) 6+) 6'D$%-+) 9#+,) T) 23<6$+) 537+66+T-V-+) ') .#2B$&8) +() /LJN) 4+)
,2(4$&$2(%)+D&#V-+-+(&)98(8#+3%+%)4+)6').'#&)4+)%+%),#8'(,$+#%)G)672,,'%$2()43).'$+-+(&)4+)
%+%).#2.#+%)$(4+-($&8%)I)
T #+6$53'&) 47$(4+-($&8%) 4+) 6') /R#+) 93+##+) -2(4$'6+) .3$%53+) &23%) 6+%) #+-<23#%+-+(&%)
.#813%).'#)6+%).6'(%)*'v+%)+&)w23(9)4'(%)6+%)'((8+%)?@)T)48:G)B2#&+-+(&)#843$&%)/@)
'(%)'.#R%)6+)k#'$&8)4+)x+#%'$66+%)T)'1'$+(&)8&8)$(&+##2-.3%).'#)t$&6+#)Z)
T +&) $(4+-($&8%) 4+) 6') %+,2(4+) 93+##+) -2(4$'6+>) (2&'--+(&) 1$%TGT1$%) 4+) 6') \#R,+) 53$)
'1'$&) 8&8) .'#&$,36$R#+-+(&) ',,'<68+) .'#) 67$(1'%$2() 4+%) '#-8+%) (';$+%) '3) .#$(&+-.%)
/LA/H)
0+)123%)$(1$&+)G)123%)#+.2#&+#)G)67231#'9+)4+)67"$%&2#$+()'-8#$,'$()b'#n)b';2v+#)53$)48,#$&)
6')<#3&'6$&8) +&)6')1$26+(,+)42(&)')B'$&).#+31+)6')y+"#-',"&)+()\#R,+>)53$) (7+3#+(&)4789'6+%)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%