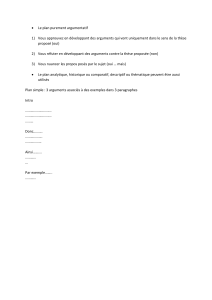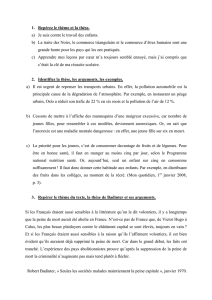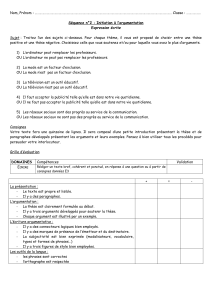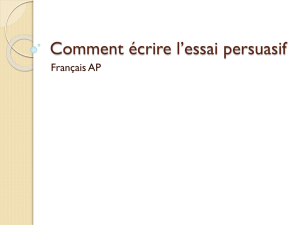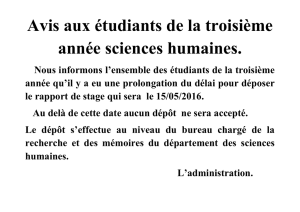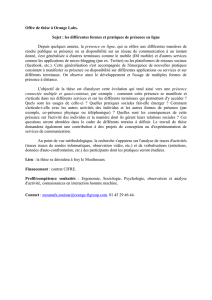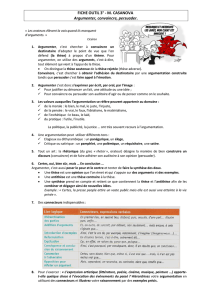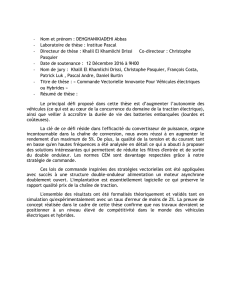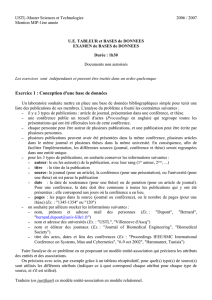Lire Le Lycéen Parution de Decembre 2016

L
L
Philo-Synthèse
Pages 3 - 7
Le Lycéen, nous informons pour former
.
T
él: (229) 97 69 21 97
E-mail: lelyceen@yahoo.fr
Nous informons pour former.
T
él: (229) 97 69 21 97
E-mail: lelyceen@yaho
o.fr
Bulletin pédagogique d’informations, d’analyses et d’éducation
.
N° 012 de Décembre 201
6
200F cfa
Carton
Rouge
NON AU BAVARDAGE
Le
bavardage est l’une des
principales causes d’échec
scolaire. Il déconcentre et per-
turbe les camarades. Alors,
mon ami (e), ne sois pas la
cause de ton propre échec et
celui des autres.
Le silence est le langage des sages
.
N°982/MISPCL/DC/SG/DAI/SCC
L
e
L
y
céen
COLLEGE-ACTU
Page 2
Trois raisons de choisir le CSNDA
Zoom sur le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres
-
La dissertation philosophique
(Méthodologie de rédaction et Exercices traités)
-
Résumé de cours sur la Raison
Jeunesse & Education
Droits humains info: Doit-on limiter le droit de l’enfant à l’information?
La chronique de JR
Les « allumeuses »
Rouge aux lèvres, apparence
bien soignée, tenue plus ou
moins sexy, voilà quelques
traits physiques des « allumeu-
ses ». Ces élèves aux allures
physiques remarquables ne
passent pas inaperçues. Mais
que valent-elles intellectuel-
lement ? Rien. Du moins, ces
paresseuses ne font preuve
que d’une vacuité intellectuelle
évidente. Fainéantes, elles ne
sont ingénieuses que dans les
plans de séduction. (Suite à la page 9)
Pages 9-10
2ème édition des Olympiades des
Droits humains pour les jeunes
Dieudonné Dagbéto
s’engage
pour la
promotion de
la tolérance et
de la paix.

Le Lycéen, nous informons pour former.
Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr
«L’école est sanctuaire autant que la chapelle» Victor HUGO
Structure d’obédience catholique, le Cours Secondaire Notre Dame
des Apôtres de Cotonou est créé le 6 décembre 1953 par les
Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Cette école est ouverte aux filles
de toutes les couches sociales et de toutes les confessions religieu-
ses. Sa devise, inspirée du latin, est « Optimus esse aut non esse » ce
qui signifie « Etre le meilleur ou ne pas être. » La vision du CSNDA,
l’ambiance dans laquelle on y travaille et ses résultats sont de bon-
nes raisons pour choisir ce collège de plus de 60 ans d’existence.
Le Lycéen, nous informons pour former.
Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr
COLLEGE-ACTU
P. 02
Trois bonnes raisons de choisir le CSNDA
Zoom sur le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres
Sœur Florence LAOUROU, Directrice du CSNDA
Le CSNDA, une école pour la dignité féminine.
Le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres de Cotonou est une école ex-
clusivement ouverte aux filles. La principale raison de cette féminisation de
l’école est de promouvoir la dignité féminine car pendant longtemps la gent
féminine a été marginalisée et sous-estimée. C’est pour corriger cette injustice
sociale et pour valoriser les talents et potentiels intellectuels de la femme que le
CSNDA s’investit dans l’éducation des filles. Et cette vieille école n’a jusque-là
pas failli à sa mission car tout y est mis en œuvre pour une éducation complète.
Réalisé par Jonce Riquier AHIMIHOUE
Le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres est un excellent cadre pour
assurer convenablement l’éducation des apprenantes. En effet, sa superficie
constitue un grand atout géographique favorable à l’épanouissement des filles.
Dans ses salles de classes bien aérées, s’enseignent non seulement toutes les
disciplines au programme, mais également la musique, le dessin, l’informati-
que, la puériculture, la couture, l’instruction civique et la culture religieuse
et morale. Des activités culturelles s’organisent régulièrement pour éveiller
chez les filles leurs talents cachés. Quant à la discipline, un mot de satisfac-
tion est à décerner. En effet, aucun cas d’indiscipline notoire n’est à enregis-
trer selon la Sœur Florence LAOUROU, Directrice du Collège. « Certes, la
puberté joue sur certaines filles qui cherchent à paraître ce qu’elles ne sont
pas. Mais nous les rappelons vite à l’ordre. Sinon la majorité des filles que
nous accueillons sont ambitieuses, elles se battent pour réussir leurs études
et leur avenir » ajoute-elle. Ces propos se justifient car les résultats aux dif-
férents examens nationaux témoignent de cette bonne ambiance de travail.
Le CSNDA, un cadre approprié pour l’éducation
Message de la Directrice du CSNDA
«Je remercie très sincèrement les
pa
rents d’élèves qui nous font confian-
ce en inscrivant leurs filles chez nous.
Un grand Merci à nos professeurs qua-
lifiés et rompus à la tâche avec de très
bonnes méthodes de travail pour aider
les apprenantes surtout celles dont le
niveau est faible. Merci aux Sœurs, aux
secrétaires, au personnel administratif,
aux agents de soutien. J’encourage les
filles et je leur souhaite le succès dans
leurs études et dans toute leur vie. Je
leur demande de se montrer davantage
volontaires et dévouées au travail. Je
remercie le Bureau Exécutif de l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves qui nous
prête main-forte dans l’exécution de
notre tâche commune. A tous et à cha-
cun, je souhaite une bonne fin d’année
2016 et que le Seigneur veille sur nous
tout au long de la nouvelle année 2017
dans la joie, la paix et toutes ses grâ-
ces».
Depuis longtemps le CSNDA s’est fait une place de choix dans le rang des
meilleures écoles du Bénin. Ses résultats aux examens nationaux des trois der-
nières années ont largement franchi la barre des 80% au BEPC, 90% au CAP et
70% au BAC. En effet, de 2014 à 2016, les taux de réussite des apprenantes sont
de 99% ; 91.83% et 81.50% au BEPC. Au CAP/EB le CSNDA a obtenu un taux
de réussite de 100% en 2014 et en 2015, et de 90% en 2016. Au CAP/AC les ré-
sultats sont aussi excellents : 96.96% en 2014 et en 2015 et 100% en 2016. Par
ailleurs, malgré les faibles taux de réussite souvent obtenus au plan national,
les filles du CSNDA réussissent majoritairement au BAC. En 2014, 71.07% des
candidates ont obtenu leur Baccalauréat. 68.12% en 2015 et 78.16% en 2016. En
2016 la deuxième et la huitième du Bénin au Bac A2, de même que la huitième
au Bac B sont de purs produits du CSNDA. Ces résultats confirment la bonne
ambiance et l’esprit d’équipe dans lequel le travail se fait dans cette institution.
Des résultats élogieux
«Optimus esse aut non esse» «Etre le meilleur ou ne pas être.»
Directeur de Publication:
Jonce Riquier AHIMIHOUE
Tél.: (229)9769 21 97
Rédacteur en Chef:
Juvenale GOMIDO
Imprimerie: Imp. SAINTE JEANNE
Tél.: (229) 65 19 01 01
PHILO - SYNTHESE
P. 03
«
On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.
» Emmanuel KANT
RESUME DE COURS SUR LA RAISON
Support: Blaise Pascal « Deux excès : Exclure la raison n’admettre que la raison
»
Consigne
1- Définis la raison.
2- Montre l’importance de la raison dans le domaine de la connaissance et de la morale.
3- Montre les limites de la raison dans le domaine de la connaissance et face à la foi.
Synthèse des idées
Blaise Pascal nous recommande d’éviter d’une part d’exclure la raison et d’autre part
de n’admettre que la raison. Il faut éviter d’exclure la raison parce qu’elle est une faculté
très importante du psychisme humain. Il faut cependant éviter de n’admettre que la
raison car elle a des limites. On peut donc dire que par ces mots, Blaise Pascal met en
exergue l’importance et les limites de la raison. Qu’est-ce que la raison ? Quel rôle joue-
t-elle, et quelles sont ses limites ?
I- Définition de la raison
Le mot Raison vient du latin
«Ratio » qui signifie calcul ou
compte. Généralement la raison
désigne le motif explique ou jus-
tifie un fait ou un acte. (Exemple:
l’élève X s’est absenté pour raison
de santé). Au sens propre, la raison
est la faculté par laquelle l’homme
connaît et juge selon des principes.
Avoir raison, c’est être fondé dans
ce que l’on dit ou fait, c’est bien ju-
ger. Elle est donc la faculté de juge-
ment, de discernement. (Exemple :
j’en appelle à votre raison.) C’est ce
que Descartes appelle le « bon sens
» ou « la puissance de bien juger et
distinguer le vrai d’avec le faux ».
Dans le Discours de la méthode il
écrit que «Le bon sens est la chose
du monde de la mieux partagée»
pour signifier que la raison est in-
née, et que tous les hommes la pos-
sède à part égale. Mais si la raison
est également partagée pourquoi
les hommes ne raisonnent-ils pas
tous de la même manière ? Pour-
quoi certains paraissent-ils même
plus ou moins raisonnables que
d’autres ? A cela, Descartes répond
que le fait que nous ayons souvent
des avis partagés ne signifie pas
que les uns sont plus raisonnables
que les autres. La diversité de nos
opinions vient plutôt de ce nous ne
conduisons pas notre raison par les
mêmes voies et ne considérons pas
toujours les mêmes choses. Il ajoute
qu’ « il n’est pas assez d’avoir l’es-
prit bon, le principal est de l’appli-
quer bien. » Par ailleurs la raison
se fonde sur des principes qui ga-
rantissent l’universalité, la logique,
l’objectivité, et la régularité de ses
connaissances. On peut citer entre
autres les principes d’identité, de
contradiction, du tiers exclu, de
causalité,
de finalité etc.
II- Valeur de la raison
Pour les rationalistes la raison est toute puissante et
c’est elle qui guide les actions de l’homme aussi bien
dans le domaine de la connaissance que de la morale
Dans le domaine de la connaissance, la raison ga-
rantit l’universalité et l’objectivité du savoir, car elle
se fonde sur des principes universels et une méthode
rigoureuse. C’est la thèse que soutiennent les philo-
sophes rationalistes comme Platon, Descartes, Leib-
niz, Malebranche etc. Le rationalisme est en effet la
doctrine philosophique selon laquelle la connaissance
provient de la raison. La raison en tant que faculté
de jugement, de discernement aboutit à des vérités
certaines et universelles. Comme le dit Malebranche
« si la raison que je consulte n’était pas la même qui
répond au Chinois, il est évident que je ne pourrais
pas être aussi assuré que je le suis, que les Chinois
voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi la raison
que nous consultons quand nous rentrons dans nous-
mêmes est une raison universelle » Mieux, c’est sur
la raison que se fonde la connaissance scientifique.
La science est un savoir rationnel, objectif, fondé sur
la raison et non sur les sens. Le « bon sens » substitue
aux données trompeuses des sens et aux fantasmes
de l’imagination, l’ordre de la pensée fondé sur une
méthode rigoureuse. Descartes montre à cet effet que
connaître (scientifiquement) c’est mesurer grâce à
l’intervention de la raison qui assure ordre et régula-
rité. Pour lui, « l’âme est plus aisée à connaitre que le
corps. » C’est-à-dire que l’entendement ou la raison
permet de mieux connaitre et plus objectivement que
les sens qui nous trompent d’ailleurs. La raison en
tant que faculté de jugement, de discernement abou-
tit à des vérités certaines et évidentes.
Dans le domaine de la morale la raison par sa
fonction de discernement, de jugement entretient
un lien étroit avec la conscience morale. Pour Em-
manuel Kant, l’action humaine doit émaner du devoir
moral qui a pour fondement la raison. Henri BERG-
SON soutient que le bon sens est l’attention même
orientée dans le sens de la vie. La conscience et la
raison sont donc intimement liées. En cela, la raison
est l’apanage de l’homme et elle appartient à tous les
hommes. Descartes dira à juste titre qu’il n’y a pas
d’homme aussi hébété ou stupide qui n’en soit pour-
vu. Par contre, il n’y a pas d’animaux aussi parfaits
qui puissent faire preuve de raison. On comprend
donc que la raison est la caractéristique fondamen-
tale de l’espèce humaine et qu’elle doit fonder toute
action de l’homme. Mais peut-on tout expliquer par
la raison ?
III- Les limites de la raison : l’irrationnel
L’irrationnel désigne tout ce qui est inaccessible à la rai-
son. C’est l’ensemble des choses auquelles la raison ne
peut donner une explication par démonstration.
Dans le domaine de la connaissance la théorie empiriste
ne manque pas de pertinence face au rationalisme. L’empiris-
me est la doctrine selon laquelle toute connaissance provient
de l’expérience sensible. Pour les empiristes comme David
HUME et John LOCKE, seule l’expérience fondée sur l’ob-
servation sensible nous permet de connaitre véritablement.
Cette conception se retrouve dans l’ouvrage Théétète de Pla-
ton. En effet, le personnage Théétète déclare que « Celui qui
sait une chose sent ce qu’il sait ». C’est-à-dire que savoir c’est
sentir. La connaissance est indissociable des sens. Même si
la conception empiriste conduit au relativisme de la connais-
sance elle ne manque pourtant pas de pertinence. Car, même
si les sens ne garantissent pas une connaissance universelle,
ils sont quand-même la première source d’informations sur
l’objet à connaitre. Toute connaissance débute avec les sens
avant que la raison ne vienne harmoniser les données sen-
sibles. Telle est la thèse kantienne qui tente de concilier les
deux doctrines antagonistes. Emmanuel Kant montre dans
son ouvrage Critique de la raison pure que la connaissance
provient de l’union entre l’Entendement (la raison) et la Sen-
sibilité (les sens). Aussi, y a-t-il des choses que nous ne pou-
vons connaitre par la raison. Blaise Pascal déclare à ce propos
que « nous connaissons la vérité non seulement par la raison,
mais encore par le cœur.»
Dans le domaine de la foi la raison perd son pouvoir de
démonstration. En effet, la foi est la croyance en un être que
l’on estime supérieur à soi. Le croyant est convaincu de l’objet
de sa foi, et n’a point besoin d’une quelconque démonstration
à ce sujet. Elle intervient surtout dans le domaine religieux
et a donc un caractère dogmatique. Mais croire, est-ce dérai-
sonner? Les vérités religieuses ne sont pas démontrables et
semblent s’opposer même aux principes de la raison. Néan-
moins, elles sont vraies et fondent même la connaissance de
l’homme. L’immortalité de l’âme, la virginité de Marie, la
résurrection et l’ascension du Christ, la réincarnation, la cer-
titude d’une vie après la mort, la sainte Trinité et d’autres
mystères sont autant de vérités non reconnues par la raison
mais qui ont une réalité tangible dans le cœur des hommes.
D’un autre côté il faut noter que la raison même a foi en ses
propres principes. Car, qu’est-ce qui justifie la certitude des
principes rationnels ? On les accepte ainsi parce qu’on y croit.
On comprend donc que la raison elle-même a un caractère
dogmatique. Mieux, elle se soumet à la foi car elle ne peut
tout expliquer. Blaise Pascal affirme à ce propos que « le cœur
a ses raisons que la raison ne connait point » et conclut que
la dernière démarche de la raison c’est de reconnaître qu’il y
a une multitude de choses qu’elle ignore. En outre, face aux
passions la raison est faible. En effet les préférences de la
passion et les sentiments influencent fortement la raison et fi-
nissent par la dominer. La force de l’amour, l’inclination pour
certaines choses de la vie, sont des réalités que la raison ne
peut expliquer, encore moins contrôler. David HUME dans
son ouvrage, Traité de la nature humaine conclut que « la
raison est et elle ne peut qu’être l’esclave des passions, elle ne
peut prétendre à d’autre rôle qu’à les servir et à leur obéir.»

Le Lycéen, nous informons pour former.
Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr
«L’école est sanctuaire autant que la chapelle» Victor HUGO
Structure d’obédience catholique, le Cours Secondaire Notre Dame
des Apôtres de Cotonou est créé le 6 décembre 1953 par les
Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Cette école est ouverte aux filles
de toutes les couches sociales et de toutes les confessions religieu-
ses. Sa devise, inspirée du latin, est « Optimus esse aut non esse » ce
qui signifie « Etre le meilleur ou ne pas être. » La vision du CSNDA,
l’ambiance dans laquelle on y travaille et ses résultats sont de bon-
nes raisons pour choisir ce collège de plus de 60 ans d’existence.
Le Lycéen, nous informons pour former.
Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr
COLLEGE-ACTU
P. 02
Trois bonnes raisons de choisir le CSNDA
Zoom sur le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres
Sœur Florence LAOUROU, Directrice du CSNDA
Le CSNDA, une école pour la dignité féminine.
Le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres de Cotonou est une école ex-
clusivement ouverte aux filles. La principale raison de cette féminisation de
l’école est de promouvoir la dignité féminine car pendant longtemps la gent
féminine a été marginalisée et sous-estimée. C’est pour corriger cette injustice
sociale et pour valoriser les talents et potentiels intellectuels de la femme que le
CSNDA s’investit dans l’éducation des filles. Et cette vieille école n’a jusque-là
pas failli à sa mission car tout y est mis en œuvre pour une éducation complète.
Réalisé par Jonce Riquier AHIMIHOUE
Le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres est un excellent cadre pour
assurer convenablement l’éducation des apprenantes. En effet, sa superficie
constitue un grand atout géographique favorable à l’épanouissement des filles.
Dans ses salles de classes bien aérées, s’enseignent non seulement toutes les
disciplines au programme, mais également la musique, le dessin, l’informati-
que, la puériculture, la couture, l’instruction civique et la culture religieuse
et morale. Des activités culturelles s’organisent régulièrement pour éveiller
chez les filles leurs talents cachés. Quant à la discipline, un mot de satisfac-
tion est à décerner. En effet, aucun cas d’indiscipline notoire n’est à enregis-
trer selon la Sœur Florence LAOUROU, Directrice du Collège. « Certes, la
puberté joue sur certaines filles qui cherchent à paraître ce qu’elles ne sont
pas. Mais nous les rappelons vite à l’ordre. Sinon la majorité des filles que
nous accueillons sont ambitieuses, elles se battent pour réussir leurs études
et leur avenir » ajoute-elle. Ces propos se justifient car les résultats aux dif-
férents examens nationaux témoignent de cette bonne ambiance de travail.
Le CSNDA, un cadre approprié pour l’éducation
Message de la Directrice du CSNDA
«Je remercie très sincèrement les
pa
rents d’élèves qui nous font confian-
ce en inscrivant leurs filles chez nous.
Un grand Merci à nos professeurs qua-
lifiés et rompus à la tâche avec de très
bonnes méthodes de travail pour aider
les apprenantes surtout celles dont le
niveau est faible. Merci aux Sœurs, aux
secrétaires, au personnel administratif,
aux agents de soutien. J’encourage les
filles et je leur souhaite le succès dans
leurs études et dans toute leur vie. Je
leur demande de se montrer davantage
volontaires et dévouées au travail. Je
remercie le Bureau Exécutif de l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves qui nous
prête main-forte dans l’exécution de
notre tâche commune. A tous et à cha-
cun, je souhaite une bonne fin d’année
2016 et que le Seigneur veille sur nous
tout au long de la nouvelle année 2017
dans la joie, la paix et toutes ses grâ-
ces».
Depuis longtemps le CSNDA s’est fait une place de choix dans le rang des
meilleures écoles du Bénin. Ses résultats aux examens nationaux des trois der-
nières années ont largement franchi la barre des 80% au BEPC, 90% au CAP et
70% au BAC. En effet, de 2014 à 2016, les taux de réussite des apprenantes sont
de 99% ; 91.83% et 81.50% au BEPC. Au CAP/EB le CSNDA a obtenu un taux
de réussite de 100% en 2014 et en 2015, et de 90% en 2016. Au CAP/AC les ré-
sultats sont aussi excellents : 96.96% en 2014 et en 2015 et 100% en 2016. Par
ailleurs, malgré les faibles taux de réussite souvent obtenus au plan national,
les filles du CSNDA réussissent majoritairement au BAC. En 2014, 71.07% des
candidates ont obtenu leur Baccalauréat. 68.12% en 2015 et 78.16% en 2016. En
2016 la deuxième et la huitième du Bénin au Bac A2, de même que la huitième
au Bac B sont de purs produits du CSNDA. Ces résultats confirment la bonne
ambiance et l’esprit d’équipe dans lequel le travail se fait dans cette institution.
Des résultats élogieux
«Optimus esse aut non esse» «Etre le meilleur ou ne pas être.»
Directeur de Publication:
Jonce Riquier AHIMIHOUE
Tél.: (229)9769 21 97
Rédacteur en Chef:
Juvenale GOMIDO
Imprimerie: Imp. SAINTE JEANNE
Tél.: (229) 65 19 01 01
PHILO - SYNTHESE
P. 03
«
On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.
» Emmanuel KANT
RESUME DE COURS SUR LA RAISON
Support: Blaise Pascal « Deux excès : Exclure la raison n’admettre que la raison
»
Consigne
1- Définis la raison.
2- Montre l’importance de la raison dans le domaine de la connaissance et de la morale.
3- Montre les limites de la raison dans le domaine de la connaissance et face à la foi.
Synthèse des idées
Blaise Pascal nous recommande d’éviter d’une part d’exclure la raison et d’autre part
de n’admettre que la raison. Il faut éviter d’exclure la raison parce qu’elle est une faculté
très importante du psychisme humain. Il faut cependant éviter de n’admettre que la
raison car elle a des limites. On peut donc dire que par ces mots, Blaise Pascal met en
exergue l’importance et les limites de la raison. Qu’est-ce que la raison ? Quel rôle joue-
t-elle, et quelles sont ses limites ?
I- Définition de la raison
Le mot Raison vient du latin
«Ratio » qui signifie calcul ou
compte. Généralement la raison
désigne le motif explique ou jus-
tifie un fait ou un acte. (Exemple:
l’élève X s’est absenté pour raison
de santé). Au sens propre, la raison
est la faculté par laquelle l’homme
connaît et juge selon des principes.
Avoir raison, c’est être fondé dans
ce que l’on dit ou fait, c’est bien ju-
ger. Elle est donc la faculté de juge-
ment, de discernement. (Exemple :
j’en appelle à votre raison.) C’est ce
que Descartes appelle le « bon sens
» ou « la puissance de bien juger et
distinguer le vrai d’avec le faux ».
Dans le Discours de la méthode il
écrit que «Le bon sens est la chose
du monde de la mieux partagée»
pour signifier que la raison est in-
née, et que tous les hommes la pos-
sède à part égale. Mais si la raison
est également partagée pourquoi
les hommes ne raisonnent-ils pas
tous de la même manière ? Pour-
quoi certains paraissent-ils même
plus ou moins raisonnables que
d’autres ? A cela, Descartes répond
que le fait que nous ayons souvent
des avis partagés ne signifie pas
que les uns sont plus raisonnables
que les autres. La diversité de nos
opinions vient plutôt de ce nous ne
conduisons pas notre raison par les
mêmes voies et ne considérons pas
toujours les mêmes choses. Il ajoute
qu’ « il n’est pas assez d’avoir l’es-
prit bon, le principal est de l’appli-
quer bien. » Par ailleurs la raison
se fonde sur des principes qui ga-
rantissent l’universalité, la logique,
l’objectivité, et la régularité de ses
connaissances. On peut citer entre
autres les principes d’identité, de
contradiction, du tiers exclu, de
causalité,
de finalité etc.
II- Valeur de la raison
Pour les rationalistes la raison est toute puissante et
c’est elle qui guide les actions de l’homme aussi bien
dans le domaine de la connaissance que de la morale
Dans le domaine de la connaissance, la raison ga-
rantit l’universalité et l’objectivité du savoir, car elle
se fonde sur des principes universels et une méthode
rigoureuse. C’est la thèse que soutiennent les philo-
sophes rationalistes comme Platon, Descartes, Leib-
niz, Malebranche etc. Le rationalisme est en effet la
doctrine philosophique selon laquelle la connaissance
provient de la raison. La raison en tant que faculté
de jugement, de discernement aboutit à des vérités
certaines et universelles. Comme le dit Malebranche
« si la raison que je consulte n’était pas la même qui
répond au Chinois, il est évident que je ne pourrais
pas être aussi assuré que je le suis, que les Chinois
voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi la raison
que nous consultons quand nous rentrons dans nous-
mêmes est une raison universelle » Mieux, c’est sur
la raison que se fonde la connaissance scientifique.
La science est un savoir rationnel, objectif, fondé sur
la raison et non sur les sens. Le « bon sens » substitue
aux données trompeuses des sens et aux fantasmes
de l’imagination, l’ordre de la pensée fondé sur une
méthode rigoureuse. Descartes montre à cet effet que
connaître (scientifiquement) c’est mesurer grâce à
l’intervention de la raison qui assure ordre et régula-
rité. Pour lui, « l’âme est plus aisée à connaitre que le
corps. » C’est-à-dire que l’entendement ou la raison
permet de mieux connaitre et plus objectivement que
les sens qui nous trompent d’ailleurs. La raison en
tant que faculté de jugement, de discernement abou-
tit à des vérités certaines et évidentes.
Dans le domaine de la morale la raison par sa
fonction de discernement, de jugement entretient
un lien étroit avec la conscience morale. Pour Em-
manuel Kant, l’action humaine doit émaner du devoir
moral qui a pour fondement la raison. Henri BERG-
SON soutient que le bon sens est l’attention même
orientée dans le sens de la vie. La conscience et la
raison sont donc intimement liées. En cela, la raison
est l’apanage de l’homme et elle appartient à tous les
hommes. Descartes dira à juste titre qu’il n’y a pas
d’homme aussi hébété ou stupide qui n’en soit pour-
vu. Par contre, il n’y a pas d’animaux aussi parfaits
qui puissent faire preuve de raison. On comprend
donc que la raison est la caractéristique fondamen-
tale de l’espèce humaine et qu’elle doit fonder toute
action de l’homme. Mais peut-on tout expliquer par
la raison ?
III- Les limites de la raison : l’irrationnel
L’irrationnel désigne tout ce qui est inaccessible à la rai-
son. C’est l’ensemble des choses auquelles la raison ne
peut donner une explication par démonstration.
Dans le domaine de la connaissance la théorie empiriste
ne manque pas de pertinence face au rationalisme. L’empiris-
me est la doctrine selon laquelle toute connaissance provient
de l’expérience sensible. Pour les empiristes comme David
HUME et John LOCKE, seule l’expérience fondée sur l’ob-
servation sensible nous permet de connaitre véritablement.
Cette conception se retrouve dans l’ouvrage Théétète de Pla-
ton. En effet, le personnage Théétète déclare que « Celui qui
sait une chose sent ce qu’il sait ». C’est-à-dire que savoir c’est
sentir. La connaissance est indissociable des sens. Même si
la conception empiriste conduit au relativisme de la connais-
sance elle ne manque pourtant pas de pertinence. Car, même
si les sens ne garantissent pas une connaissance universelle,
ils sont quand-même la première source d’informations sur
l’objet à connaitre. Toute connaissance débute avec les sens
avant que la raison ne vienne harmoniser les données sen-
sibles. Telle est la thèse kantienne qui tente de concilier les
deux doctrines antagonistes. Emmanuel Kant montre dans
son ouvrage Critique de la raison pure que la connaissance
provient de l’union entre l’Entendement (la raison) et la Sen-
sibilité (les sens). Aussi, y a-t-il des choses que nous ne pou-
vons connaitre par la raison. Blaise Pascal déclare à ce propos
que « nous connaissons la vérité non seulement par la raison,
mais encore par le cœur.»
Dans le domaine de la foi la raison perd son pouvoir de
démonstration. En effet, la foi est la croyance en un être que
l’on estime supérieur à soi. Le croyant est convaincu de l’objet
de sa foi, et n’a point besoin d’une quelconque démonstration
à ce sujet. Elle intervient surtout dans le domaine religieux
et a donc un caractère dogmatique. Mais croire, est-ce dérai-
sonner? Les vérités religieuses ne sont pas démontrables et
semblent s’opposer même aux principes de la raison. Néan-
moins, elles sont vraies et fondent même la connaissance de
l’homme. L’immortalité de l’âme, la virginité de Marie, la
résurrection et l’ascension du Christ, la réincarnation, la cer-
titude d’une vie après la mort, la sainte Trinité et d’autres
mystères sont autant de vérités non reconnues par la raison
mais qui ont une réalité tangible dans le cœur des hommes.
D’un autre côté il faut noter que la raison même a foi en ses
propres principes. Car, qu’est-ce qui justifie la certitude des
principes rationnels ? On les accepte ainsi parce qu’on y croit.
On comprend donc que la raison elle-même a un caractère
dogmatique. Mieux, elle se soumet à la foi car elle ne peut
tout expliquer. Blaise Pascal affirme à ce propos que « le cœur
a ses raisons que la raison ne connait point » et conclut que
la dernière démarche de la raison c’est de reconnaître qu’il y
a une multitude de choses qu’elle ignore. En outre, face aux
passions la raison est faible. En effet les préférences de la
passion et les sentiments influencent fortement la raison et fi-
nissent par la dominer. La force de l’amour, l’inclination pour
certaines choses de la vie, sont des réalités que la raison ne
peut expliquer, encore moins contrôler. David HUME dans
son ouvrage, Traité de la nature humaine conclut que « la
raison est et elle ne peut qu’être l’esclave des passions, elle ne
peut prétendre à d’autre rôle qu’à les servir et à leur obéir.»

Le Lycéen, nous informons pour former.
Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr
PHILO - SYNTHESE
P. 04
«
On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.
» Emmanuel KANT
Le Lycéen, nous informons pour former.
Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr
PHILO - SYNTHESE
P. 05
«
On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.
» Emmanuel KANT
Disserter, de façon générale, c’est traiter méthodiquement un sujet par écrit ou oralement. La disser-
tation est donc un exercice littéraire qui consiste à analyser une notion, une question ou une thèse
par une démonstration synthétique, cohérente et étayée par des références et exemples pertinents. Cet
exercice a pour but d’apprécier la capacité de l’apprenant à réfléchir sur un sujet afin de donner son point
de vue par un discours cohérent et bien structuré.
L’apprenant doit lire et relire attentivement
le sujet. Ensuite il le reformule clairement avec
des mots ou expressions plus simples. Ce travail
lui permet de dégager et de formuler la problé-
matique du sujet. La problématique est l’ensem-
ble des questions que l’on se pose par rapport à
un sujet. Une question qui n’admet qu’une seule
réponse n’est donc pas une problématique. L’ap-
prenant doit s’imaginer toutes les questions qui
pourront lui permettre de mettre en relief les dif-
férents aspects (thèse et antithèse, explication et
discussion, analyse et critique, mérites et limites)
du sujet. Il peut formuler la problématique sous
la forme d’interrogation directe ou indirecte.
A- Le travail préparatoire
LA DISSERTATION PHILOSOPHIQUE
1 - La compréhension et la problématisation du sujet
2
-L’élaboration du plan
Il n’y a pas de plan standard en dissertation phi-
losophique. Toutefois l’apprenant doit respecter la
démarche en deux ou trois parties (thèse/antithèse
et synthèse). Pour cela, il peut organiser son devoir
suivant le schéma
Thèse, Analyse ou Explication
-
Idée directrice
: Enoncer de façon claire (affir-
mative) l’idée que l’on veut soutenir dans la pre-
mière partie du corps du devoir.
-
Arguments
: Ce sont les raisons qui jus-
tifient l’idée directrice. Les arguments doi-
vent être conduits de façon chronologique.
-
Illustrations
(citations, références à des auteurs
ou exemples) Les citations ou exemples doi-
vent cadrer avec les arguments. Aussi, faut-il
éviter de donner des exemples trop personnels,
subjectifs, tendancieux, ou peu philosophiques.
NB : Les citations ont une grande importance
dans un devoir philosophique. Elles témoignent
en effet de la culture philosophique et littéraire de
l’apprenant. Cependant un amas de citations ne fait
pas une dissertation philosophique. De même, l’ap-
prenant doit éviter d’utiliser des citations qui ne
cadrent pas avec l’idée qu’il développe. Il doit aussi
éviter d’inventer des citations par souci d’illustrer
coûte que coûte son devoir. Ce qui est recherché,
c’est sa capacité à réfléchir à partir des théories ou
notions philosophiques qu’on lui a enseignées. Les
références, les citations ou les exemples ne vien-
nent donc que pour étayer, renforcer l’idée ou les
arguments développés. Lorsqu’une référence philo-
sophique ou citation ne peut être rappelée in ex-
tenso c’est-à-dire intégralement, l’apprenant peut
la paraphraser (l’expliquer par des synonymes).
Mais dans ce cas il ne met pas les guillemets. Les
guillemets ne sont mis que lorsque l’apprenant a
le nom exact de l’auteur et sa pensée in extenso.
(Exemple : Rousseau affirme que « L’obéissance
à la loi qu’on s’est prescrite est liberté») Mais si
l’apprenant ne peut se rappeler cette pensée in
extenso, il la paraphrase : (exemple : Pour Rous-
seau la liberté consiste à obéir aux lois.) Il en est
de même pour les noms d’auteurs. C’est-à-dire
qu’il ne faut pas mettre les guillemets lorsqu’on
ne connait pas ou ne se souvient pas du nom
d’un auteur. Il faut éviter les apocryphes (cita-
tion faussement attribuée à un auteur) et sur-
tout d’inventer des noms d’auteurs. La citation
est dans ce cas utilisée comme un argument.
Antithèse, Critique ou Discussion
L’antithèse ne signifie pas le contraire de la
thèse. Sinon, le devoir se présenterait comme
une contradiction dans l’argumentation. L’ap-
prenant peut évoquer les théories philosophi-
ques qui s’opposent à la théorie développée au
niveau de la thèse certes, mais il ne faut pas à
tout prix chercher à contredire la thèse. Ce qu’il
y a plutôt lieu de faire c’est de dépasser la posi-
tion soutenue dans la thèse. L’antithèse, la criti-
que ou encore la discussion consiste donc à mon-
trer les limites ou insuffisances de la thèse. Elle
répond aussi au schéma Idée directrice/Argu-
ments/Illustrations
Synthèse
Elle est l’accord de la thèse et de l’antithèse. Elle
constitue un dépassement des différentes posi-
tions soutenues au niveau de l’analyse et de la
discussion. Mais cette troisième partie du corps
du devoir n’est pas toujours envisageable. Pour
certains sujets, elle ne s’impose pas. Il faut tou-
tefois noter que sa structure logique est la même
que celle de la thèse et de l’antithèse.
B- Le travail rédactionnel
Elle comporte généralement trois éléments :
a- L’idée générale : Elle présente le contexte
global dans lequel s’inscrit le sujet. L’apprenant
peut commencer par un constat général (mais il
faut éviter les formules trop populaires ou passe-
partout) ou une brève définition de la notion dont
traite le sujet ou encore une idée établissant un
rapport d’analogie ou d’opposition avec le sujet.
b- L’énoncé et la problématique du sujet:
Après l’idée générale, l’apprenant ramène ou
reformule le sujet avant d’en dégager le pro-
blème. La problématique est l’ensemble des ques-
tions que l’on se pose par rapport à un sujet.
c- L’annonce du plan : c’est la démar-
che à suivre pour résoudre le problème pré-
cédemment posé. Elle est une ébauche du
corps du devoir. Elle peut être faite en deux ou
trois petites phrases interrogatives ou non.
1
-L’introduction
2- Le corps du devoir
C’est ici que l’apprenant déploie ses capacités ar-
gumentatives. Le corps du devoir comporte deux
parties au moins (la thèse et l’antithèse et une syn-
thèse si possible) reliées par des phrases de transi-
tion. Il consiste à rédiger un discours argumenta-
tif cohérent à partir du plan élaboré au brouillon.
a-La thèse/Analyse/Explication
- Lorsqu’il s’agit d’un sujet citation, la
première partie (la thèse) est consacrée à ex-
pliquer et à justifier les propos de l’auteur.
- Lorsqu’il s’agit d’un sujet question, le
plan est plus ou moins libre. Mais l’apprenant
doit expliquer la question. Il peut dans la pre-
mière partie, évoquer et justifier la réponse
de l’opinion générale face au problème posé.
Il doit en tout état de cause soutenir sa posi-
tion avec des arguments et des citations, réfé-
rences philosophiques ou exemples. Les différen-
tes idées sont développées en des paragraphes.
b-L’antithèse/Critique/Discussion
L’antithèse n’est pas le contraire de la thèse. Si-
non, le devoir se présenterait comme une contra-
diction dans l’argumentation. Lorsqu’il s’agit
d’un sujet citation l’apprenant peut évoquer les
théories qui s’opposent à la thèse de l’auteur
certes, mais il ne faut pas à tout prix chercher à
contredire la thèse si on n’en a pas les arguments.
Ce qu’il y a plutôt lieu de faire c’est de montrer
les limites ou insuffisances de la thèse. Il en est
de même pour le sujet-question. L’apprenant doit
également soutenir sa position avec des argu-
ments et des citations, références philosophiques
ou exemples. Les phrases doivent être reliées avec
des connecteurs logiques bien choisis. Et les dif-
férentes idées sont développées en paragraphes.
c- La synthèse. Elle est l’accord de la thèse et
de l’antithèse. Elle constitue un dépassement
des différentes positions soutenues au niveau de
l’analyse et de la discussion. Mais cette troisiè-
me partie du corps du devoir n’est pas toujours
envisageable. Pour certains sujets, elle ne s’im-
pose pas. Il faut toutefois noter que sa structure
logique est la même que celle de la thèse et de
l’antithèse.
d-La transition : Elle est une manière de passer
d’un raisonnement à un autre, de lier les parties
d’un discours. C’est donc une sorte de pont qui
relie la thèse à l’antithèse. Elle peut être formu-
lée en une ou deux phrases interrogatives ou af-
firmatives.
3
-La conclusion
C’est la dernière phase du devoir. Elle est aus-
si importante que les autres. Si l’apprenant
la bâcle, son devoir risque d’être mal achevé
voire déséquilibré. La conclusion ne doit être
ni trop longue ni trop courte. Elle doit faire
la synthèse des idées directrices qui compo-
sent le corps du devoir et apporter une solution
ou une approche de solution au problème posé
dans l’introduction. Elle peut finir en ouvrant
un horizon sur d’autres perspectives ou problè-
mes ayant rapport avec le sujet traité.
J’apprends par l’exemple
Sujet 1:Sommes-nous prisonniers de notre passé ?
Développement
La mémoire est la faculté qui permet à l’homme de revi-
vre le passé
avec le sentiment qu’il est passé. Mais le passé peut-il
constituer un obstacle à ma liberté ? Autrement dit, l’homme est-il
prisonnier de son passé ? Cette question pose le problème de la va-
leur des souvenirs et de la liberté qu’a l’homme de se les rappeler.
En quels sens les souvenirs peuvent-ils être une entrave à la liberté
du sujet ? Et l’homme peut-il, ou doit-il se souvenir de tout?
La mémoire permet à l’homme de se souvenir de ses états
et de ses actes passés. De ce fait, le passé n’est définitivement pas
passé, car l’homme peut grâce aux cadres sociaux de la mémoire,
le revivre par la pensée. Il se dégage de cette idée que mon action
présente est déterminée par mon passé. Mieux encore, l’homme est
lié par son passé ou son histoire qui le suit et le poursuit. Le phi-
losophe allemand Martin HEIDEGGER déclare à juste titre que
« l’homme est l’être des lointains. » Il est un être lié au temps. Il
va donc sans dire que l’homme est le prisonnier de son histoire.
Ne dit-on pas souvent que l’histoire rattrape toujours ? Cet adage
se justifie par le fait que l’homme réagit souvent en fonction de ses
expériences passées, lesquelles expériences le hantent et influencent
fortement ses états et ses actions dans le présent. On peut même dire
que les souvenirs l’empêchent d’exprimer toute sa liberté à l’instant
présent. En outre, les mauvais souvenirs constituent un obstacle pour
son épanouissement et l’harmonie sociale. DELACROIX affirme
à ce propos que « Le souvenir d’une agression peut provoquer la co-
lère » et nous réagissons violemment à ce souvenir, et cette colère est
une réaction présente. André GIDE s’inscrit dans la même logique
et déclare que « L’imagination tourmente moins que le souvenir».
On comprend donc à quel point le passé embrigade l’homme et
conditionne ses actions présentes et futures. Toutefois, l’homme ne
peut-il pas, grâce à la conscience et à l’oubli se libérer du passé ?
Pour le philosophe français Henri BERGSON la
conscience signifie mémoire. Autrement dit, le souvenir est un acte
conscient, et qui dit conscience dit avant tout liberté. En effet, la
conscience nous permet de choisir librement. La mémoire a une
fonction sélective qui évite à l’homme d’être esclave de son passé. Et
s’il se souvient des événements passés, c’est pour en tirer des leçons
afin d’affronter le présent et d’anticiper l’avenir. Mieux, il est libre
de se souvenir, et il se souvient pour agir librement. Aussi, la mé-
moire ne nous évoque pas tout notre passé. Elle cède souvent place
à l’oubli qui assure l’équilibre psychique. C’est dire donc que même
si l’on considère le passé comme une entrave à la liberté du sujet,
l’oubli délivre l’homme de cette emprise. CHAMPFORT conseille
à cet effet de beaucoup oublier, « d’éponger la vie à mesure qu’elle
s’écoule. » Pour le philosophe allemand Friedrich NIETZS-
CHE, il est impossible de vivre libre et heureux sans oublier.
L’oubli qui est un acte psychique fréquent chez l’homme est
donc libérateur. C’est pourquoi l’homme oublie beaucoup
pour ne pas se sentir esclave de son passé. Il ne peut, et ne
doit pas se souvenir de tout. C’est ainsi qu’il se sent libre.
Il ressort des idées qui précèdent que la mémoire est
une faculté qui lie l’homme à son passé. Car la plupart de
nos actions présentes sont déterminées par nos souvenirs.
De ce point de vue on peut dire que l’homme est prison-
nier de son passé. Mieux, le passé empêche-t-il l’homme de
jouir de sa liberté. Mais au regard du caractère conscient
des souvenirs, on peut affirmer sans risque de se trom-
per que les souvenirs permettent à l’homme de mieux
affronter le présent et d’agir librement. Aussi, l’oubli
permet-il à l’homme d’effacer les mauvais souvenirs.

Le Lycéen, nous informons pour former.
Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr
PHILO - SYNTHESE
P. 04
«
On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.
» Emmanuel KANT
Le Lycéen, nous informons pour former.
Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr
PHILO - SYNTHESE
P. 05
«
On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.
» Emmanuel KANT
Disserter, de façon générale, c’est traiter méthodiquement un sujet par écrit ou oralement. La disser-
tation est donc un exercice littéraire qui consiste à analyser une notion, une question ou une thèse
par une démonstration synthétique, cohérente et étayée par des références et exemples pertinents. Cet
exercice a pour but d’apprécier la capacité de l’apprenant à réfléchir sur un sujet afin de donner son point
de vue par un discours cohérent et bien structuré.
L’apprenant doit lire et relire attentivement
le sujet. Ensuite il le reformule clairement avec
des mots ou expressions plus simples. Ce travail
lui permet de dégager et de formuler la problé-
matique du sujet. La problématique est l’ensem-
ble des questions que l’on se pose par rapport à
un sujet. Une question qui n’admet qu’une seule
réponse n’est donc pas une problématique. L’ap-
prenant doit s’imaginer toutes les questions qui
pourront lui permettre de mettre en relief les dif-
férents aspects (thèse et antithèse, explication et
discussion, analyse et critique, mérites et limites)
du sujet. Il peut formuler la problématique sous
la forme d’interrogation directe ou indirecte.
A- Le travail préparatoire
LA DISSERTATION PHILOSOPHIQUE
1 - La compréhension et la problématisation du sujet
2
-L’élaboration du plan
Il n’y a pas de plan standard en dissertation phi-
losophique. Toutefois l’apprenant doit respecter la
démarche en deux ou trois parties (thèse/antithèse
et synthèse). Pour cela, il peut organiser son devoir
suivant le schéma
Thèse, Analyse ou Explication
-
Idée directrice
: Enoncer de façon claire (affir-
mative) l’idée que l’on veut soutenir dans la pre-
mière partie du corps du devoir.
-
Arguments
: Ce sont les raisons qui jus-
tifient l’idée directrice. Les arguments doi-
vent être conduits de façon chronologique.
-
Illustrations
(citations, références à des auteurs
ou exemples) Les citations ou exemples doi-
vent cadrer avec les arguments. Aussi, faut-il
éviter de donner des exemples trop personnels,
subjectifs, tendancieux, ou peu philosophiques.
NB : Les citations ont une grande importance
dans un devoir philosophique. Elles témoignent
en effet de la culture philosophique et littéraire de
l’apprenant. Cependant un amas de citations ne fait
pas une dissertation philosophique. De même, l’ap-
prenant doit éviter d’utiliser des citations qui ne
cadrent pas avec l’idée qu’il développe. Il doit aussi
éviter d’inventer des citations par souci d’illustrer
coûte que coûte son devoir. Ce qui est recherché,
c’est sa capacité à réfléchir à partir des théories ou
notions philosophiques qu’on lui a enseignées. Les
références, les citations ou les exemples ne vien-
nent donc que pour étayer, renforcer l’idée ou les
arguments développés. Lorsqu’une référence philo-
sophique ou citation ne peut être rappelée in ex-
tenso c’est-à-dire intégralement, l’apprenant peut
la paraphraser (l’expliquer par des synonymes).
Mais dans ce cas il ne met pas les guillemets. Les
guillemets ne sont mis que lorsque l’apprenant a
le nom exact de l’auteur et sa pensée in extenso.
(Exemple : Rousseau affirme que « L’obéissance
à la loi qu’on s’est prescrite est liberté») Mais si
l’apprenant ne peut se rappeler cette pensée in
extenso, il la paraphrase : (exemple : Pour Rous-
seau la liberté consiste à obéir aux lois.) Il en est
de même pour les noms d’auteurs. C’est-à-dire
qu’il ne faut pas mettre les guillemets lorsqu’on
ne connait pas ou ne se souvient pas du nom
d’un auteur. Il faut éviter les apocryphes (cita-
tion faussement attribuée à un auteur) et sur-
tout d’inventer des noms d’auteurs. La citation
est dans ce cas utilisée comme un argument.
Antithèse, Critique ou Discussion
L’antithèse ne signifie pas le contraire de la
thèse. Sinon, le devoir se présenterait comme
une contradiction dans l’argumentation. L’ap-
prenant peut évoquer les théories philosophi-
ques qui s’opposent à la théorie développée au
niveau de la thèse certes, mais il ne faut pas à
tout prix chercher à contredire la thèse. Ce qu’il
y a plutôt lieu de faire c’est de dépasser la posi-
tion soutenue dans la thèse. L’antithèse, la criti-
que ou encore la discussion consiste donc à mon-
trer les limites ou insuffisances de la thèse. Elle
répond aussi au schéma Idée directrice/Argu-
ments/Illustrations
Synthèse
Elle est l’accord de la thèse et de l’antithèse. Elle
constitue un dépassement des différentes posi-
tions soutenues au niveau de l’analyse et de la
discussion. Mais cette troisième partie du corps
du devoir n’est pas toujours envisageable. Pour
certains sujets, elle ne s’impose pas. Il faut tou-
tefois noter que sa structure logique est la même
que celle de la thèse et de l’antithèse.
B- Le travail rédactionnel
Elle comporte généralement trois éléments :
a- L’idée générale : Elle présente le contexte
global dans lequel s’inscrit le sujet. L’apprenant
peut commencer par un constat général (mais il
faut éviter les formules trop populaires ou passe-
partout) ou une brève définition de la notion dont
traite le sujet ou encore une idée établissant un
rapport d’analogie ou d’opposition avec le sujet.
b- L’énoncé et la problématique du sujet:
Après l’idée générale, l’apprenant ramène ou
reformule le sujet avant d’en dégager le pro-
blème. La problématique est l’ensemble des ques-
tions que l’on se pose par rapport à un sujet.
c- L’annonce du plan : c’est la démar-
che à suivre pour résoudre le problème pré-
cédemment posé. Elle est une ébauche du
corps du devoir. Elle peut être faite en deux ou
trois petites phrases interrogatives ou non.
1
-L’introduction
2- Le corps du devoir
C’est ici que l’apprenant déploie ses capacités ar-
gumentatives. Le corps du devoir comporte deux
parties au moins (la thèse et l’antithèse et une syn-
thèse si possible) reliées par des phrases de transi-
tion. Il consiste à rédiger un discours argumenta-
tif cohérent à partir du plan élaboré au brouillon.
a-La thèse/Analyse/Explication
- Lorsqu’il s’agit d’un sujet citation, la
première partie (la thèse) est consacrée à ex-
pliquer et à justifier les propos de l’auteur.
- Lorsqu’il s’agit d’un sujet question, le
plan est plus ou moins libre. Mais l’apprenant
doit expliquer la question. Il peut dans la pre-
mière partie, évoquer et justifier la réponse
de l’opinion générale face au problème posé.
Il doit en tout état de cause soutenir sa posi-
tion avec des arguments et des citations, réfé-
rences philosophiques ou exemples. Les différen-
tes idées sont développées en des paragraphes.
b-L’antithèse/Critique/Discussion
L’antithèse n’est pas le contraire de la thèse. Si-
non, le devoir se présenterait comme une contra-
diction dans l’argumentation. Lorsqu’il s’agit
d’un sujet citation l’apprenant peut évoquer les
théories qui s’opposent à la thèse de l’auteur
certes, mais il ne faut pas à tout prix chercher à
contredire la thèse si on n’en a pas les arguments.
Ce qu’il y a plutôt lieu de faire c’est de montrer
les limites ou insuffisances de la thèse. Il en est
de même pour le sujet-question. L’apprenant doit
également soutenir sa position avec des argu-
ments et des citations, références philosophiques
ou exemples. Les phrases doivent être reliées avec
des connecteurs logiques bien choisis. Et les dif-
férentes idées sont développées en paragraphes.
c- La synthèse. Elle est l’accord de la thèse et
de l’antithèse. Elle constitue un dépassement
des différentes positions soutenues au niveau de
l’analyse et de la discussion. Mais cette troisiè-
me partie du corps du devoir n’est pas toujours
envisageable. Pour certains sujets, elle ne s’im-
pose pas. Il faut toutefois noter que sa structure
logique est la même que celle de la thèse et de
l’antithèse.
d-La transition : Elle est une manière de passer
d’un raisonnement à un autre, de lier les parties
d’un discours. C’est donc une sorte de pont qui
relie la thèse à l’antithèse. Elle peut être formu-
lée en une ou deux phrases interrogatives ou af-
firmatives.
3
-La conclusion
C’est la dernière phase du devoir. Elle est aus-
si importante que les autres. Si l’apprenant
la bâcle, son devoir risque d’être mal achevé
voire déséquilibré. La conclusion ne doit être
ni trop longue ni trop courte. Elle doit faire
la synthèse des idées directrices qui compo-
sent le corps du devoir et apporter une solution
ou une approche de solution au problème posé
dans l’introduction. Elle peut finir en ouvrant
un horizon sur d’autres perspectives ou problè-
mes ayant rapport avec le sujet traité.
J’apprends par l’exemple
Sujet 1:Sommes-nous prisonniers de notre passé ?
Développement
La mémoire est la faculté qui permet à l’homme de revi-
vre le passé
avec le sentiment qu’il est passé. Mais le passé peut-il
constituer un obstacle à ma liberté ? Autrement dit, l’homme est-il
prisonnier de son passé ? Cette question pose le problème de la va-
leur des souvenirs et de la liberté qu’a l’homme de se les rappeler.
En quels sens les souvenirs peuvent-ils être une entrave à la liberté
du sujet ? Et l’homme peut-il, ou doit-il se souvenir de tout?
La mémoire permet à l’homme de se souvenir de ses états
et de ses actes passés. De ce fait, le passé n’est définitivement pas
passé, car l’homme peut grâce aux cadres sociaux de la mémoire,
le revivre par la pensée. Il se dégage de cette idée que mon action
présente est déterminée par mon passé. Mieux encore, l’homme est
lié par son passé ou son histoire qui le suit et le poursuit. Le phi-
losophe allemand Martin HEIDEGGER déclare à juste titre que
« l’homme est l’être des lointains. » Il est un être lié au temps. Il
va donc sans dire que l’homme est le prisonnier de son histoire.
Ne dit-on pas souvent que l’histoire rattrape toujours ? Cet adage
se justifie par le fait que l’homme réagit souvent en fonction de ses
expériences passées, lesquelles expériences le hantent et influencent
fortement ses états et ses actions dans le présent. On peut même dire
que les souvenirs l’empêchent d’exprimer toute sa liberté à l’instant
présent. En outre, les mauvais souvenirs constituent un obstacle pour
son épanouissement et l’harmonie sociale. DELACROIX affirme
à ce propos que « Le souvenir d’une agression peut provoquer la co-
lère » et nous réagissons violemment à ce souvenir, et cette colère est
une réaction présente. André GIDE s’inscrit dans la même logique
et déclare que « L’imagination tourmente moins que le souvenir».
On comprend donc à quel point le passé embrigade l’homme et
conditionne ses actions présentes et futures. Toutefois, l’homme ne
peut-il pas, grâce à la conscience et à l’oubli se libérer du passé ?
Pour le philosophe français Henri BERGSON la
conscience signifie mémoire. Autrement dit, le souvenir est un acte
conscient, et qui dit conscience dit avant tout liberté. En effet, la
conscience nous permet de choisir librement. La mémoire a une
fonction sélective qui évite à l’homme d’être esclave de son passé. Et
s’il se souvient des événements passés, c’est pour en tirer des leçons
afin d’affronter le présent et d’anticiper l’avenir. Mieux, il est libre
de se souvenir, et il se souvient pour agir librement. Aussi, la mé-
moire ne nous évoque pas tout notre passé. Elle cède souvent place
à l’oubli qui assure l’équilibre psychique. C’est dire donc que même
si l’on considère le passé comme une entrave à la liberté du sujet,
l’oubli délivre l’homme de cette emprise. CHAMPFORT conseille
à cet effet de beaucoup oublier, « d’éponger la vie à mesure qu’elle
s’écoule. » Pour le philosophe allemand Friedrich NIETZS-
CHE, il est impossible de vivre libre et heureux sans oublier.
L’oubli qui est un acte psychique fréquent chez l’homme est
donc libérateur. C’est pourquoi l’homme oublie beaucoup
pour ne pas se sentir esclave de son passé. Il ne peut, et ne
doit pas se souvenir de tout. C’est ainsi qu’il se sent libre.
Il ressort des idées qui précèdent que la mémoire est
une faculté qui lie l’homme à son passé. Car la plupart de
nos actions présentes sont déterminées par nos souvenirs.
De ce point de vue on peut dire que l’homme est prison-
nier de son passé. Mieux, le passé empêche-t-il l’homme de
jouir de sa liberté. Mais au regard du caractère conscient
des souvenirs, on peut affirmer sans risque de se trom-
per que les souvenirs permettent à l’homme de mieux
affronter le présent et d’agir librement. Aussi, l’oubli
permet-il à l’homme d’effacer les mauvais souvenirs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%