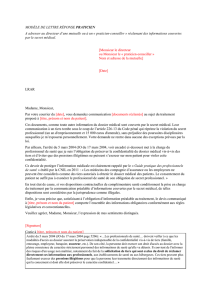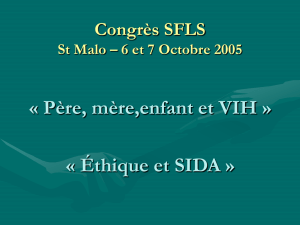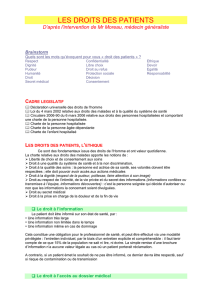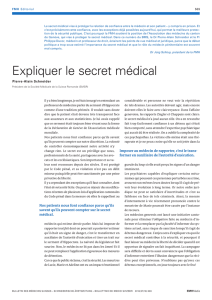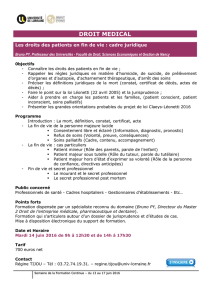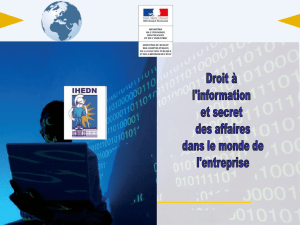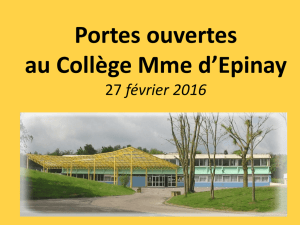Secret et confidentialité des informations médicales

28
PRATIQUES 64 JANVIER 2014
Qu’en est-il du secret médical aujourd’hui ? Quel
est le traitement social des informations relatives
au malade et à son état de santé ? Mais aussi : à qui
s’adresse le secret médical ?
Le secret est sous-tendu par des enjeux éthiques,
philosophiques et sociologiques divers, voire par-
fois contraires, avec pour conséquence que les
informations confidentielles font l’objet d’un trai-
tement paradoxal. Si l’on s’appuie sur la défini-
tion du terme, le secret désigne un « ensemble d’in-
formations qui doivent être réservées à quelques-uns et
que le détenteur ne doit pas révéler » (Le Petit Robert).
La définition ne dit pas à qui il ne doit pas être
révélé, mais la définition de l’adjectif se veut plus
éclairante : ce qui est « secret » est ce « qui est
(ou doit être) caché des autres » ; d’où la notion
de « secret professionnel », à savoir l’« obligation
de ne pas divulguer des faits confidentiels appris
dans l’exercice de la profession ». Mais la ques-
tion demeure : à qui ne faut-il pas les divulguer ?
Si l’on se reporte à la formule du serment d’Hip-
pocrate : « Quoi que je voie ou entende dans la société
pendant l’exercice ou même hors de l’exercice de ma pro-
fession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divul-
gué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil
cas », on peut aussi noter, sur ce point, une cer-
taine ambiguïté, car la question qui peut valable-
ment se poser est : à qui le médecin doit-il taire
cette information ? Qui est l’autre ? Ou qui sont
les autres ?
Pour examiner cette question, j’évoquerai trois
dimensions de la réalité sociale, susceptibles d’ali-
menter la réflexion sur les enjeux éthiques et
anthropologiques du secret.
1. Le secret donne un pouvoir à celui qui le
détient sur ceux qui en sont tenus écartés.
2. Le secret médical est légitimé par l’impératif
de protéger la personne susceptible de pâtir de
ce qu’une information la concernant est divul-
guée.
3. Le secret médical ne s’oppose pas à ce que la
famille du malade reçoive les informations
concernant son état de santé.
Comment ces trois réalités s’articulent-elles ? Et
que peut-on dire de la pratique du secret dans ses
liens avec les enjeux de l’information médicale ?
Le secret et le pouvoir
Les anthropologues qui se sont interrogés sur la
question du secret dans diverses sociétés ont mon-
tré les liens qu’il entretient avec le pouvoir. Leurs
recherches ont mis l’accent sur le pouvoir qu’im-
plique le fait même de la rétention de la parole.
L’alliance entre pouvoir et parole est d’ailleurs un
phénomène général du fonctionnement social.
D’une manière générale, la loi sociale se confond
tout particulièrement avec une loi du silence,
d’après laquelle la stratégie du pouvoir est de se
taire. Le secret a partie liée avec le silence, en tant
qu’il est dissimulation d’une parole. Mais il a aussi
partie liée avec le mensonge. Le secret s’en dis-
tingue cependant dans la mesure où il y a, dans le
mensonge, quelque chose de plus actif. Pour Sim-
mel (1964), le non-dit et le mensonge sont les
formes passive et active du secret. Le secret et le
mensonge entretiennent néanmoins des liens d’in-
clusion réciproques puisque le secret peut impli-
quer le mensonge et que le mensonge suppose
nécessairement le secret, autrement dit, il suppose
de tenir secrète la vérité. Les liens entre secret et
mensonge apparaissent clairement dès lors qu’ils
sont envisagés comme moyens d’exercer son pou-
voir ou de régir la conduite des autres. Lorsque
Hannah Arendt (1972) parle du secret comme
moyen de gouverner, elle y inclut d’ailleurs la trom-
perie, la falsification délibérée et le mensonge pur
et simple, employés par le dominant comme
moyens légitimes de parvenir à la réalisation de ses
objectifs politiques.
Le secret en médecine
Dans le domaine médical, le secret devient men-
DOSSIER
Le secret en médecine
Secret et confidentialité
des informations
médicales
Glissements dans les façons de donner, taire ou divulguer des informations : quel objet du
secret, quelle figure du patient ?
Sylvie Fainzang, anthropologue, directrice de recherche à l’Inserm (Cermes3)
Pratiques 64 _NFPratiques45C 10/02/14 12:58 Page28
Droits des patients, information
Ethique
Information médicale
Médecin généraliste, médecine générale
Patient
Secret professionnel, secret médical
Pouvoir médical, toute-puissance
Autonomie

29 JANVIER 2014 64 PRATIQUES
songe dès lors qu’il s’agit de taire au malade lui-
même la vérité sur lui et à le tromper sur son état
réel. Les médecins parlent d’ailleurs parfois du
secret pour désigner les informations tenues
cachées aux patients. Abiven (1996) déclare ainsi
que « la vérité est moins difficile à supporter que
l’angoisse dans laquelle le secret les maintient »,
récusant la pratique du mensonge « pour bien
faire » ou « par humanité », en tant que généra-
trice de souffrance. Le secret équivaut ici à la dis-
simulation, qui s’approche de l’idée de ne pas
révéler la vérité (voire de mentir). La dissimula-
tion a pour conséquence que le patient est sou-
vent peu armé pour faire un choix, compte tenu
de l’ambiguïté du diagnostic formulé par le méde-
cin, et de la difficulté pour lui de savoir quel est le
degré de gravité de son mal, d’évaluer la nécessité
d’un traitement et de fonder une décision de pré-
férence à une autre. Il n’est pas rare que le patient
à qui est dissimulé le diagnostic cherche à avoir
des éléments d’informations précis sur son mal
pour négocier la décision d’un traitement dont il
questionne l’urgence, mais dont le médecin croit
qu’il questionne la pertinence.
La problématique de l’information et du secret a
en partie à voir avec la notion de gravité, qui en
est l’enjeu principal. Dans le domaine de la can-
cérologie par exemple, le silence autrefois fait
sur l’existence d’un cancer s’est aujourd’hui
déplacé et s’effectue, à présent, sur l’existence
de métastases, en raison de la relative banalisa-
tion du premier (le cancer étant souvent consi-
déré aujourd’hui comme une maladie chro-
nique) et, parallèlement, de la connotation de
gravité des secondes. Le secret est plus souvent
gardé sur la présence de métastases car le diag-
nostic contient en lui une forme de pronostic.
Dire à un patient qu’il a des métastases, c’est l’in-
former à la fois sur son diagnostic et sur son deve-
nir possible, puisque le diagnostic peut être le
signe d’une évolution défavorable. On est là face
à ce que j’appelle la dimension pronostique du
diagnostic (cf. Fainzang, 2006). On assiste ainsi
aujourd’hui à un déplacement de la dissimula-
tion, du non-dit. Du silence fait sur la maladie,
on est passé au silence sur ses complications ou
son aggravation. Et ce qui est tenu secret a
changé de contenu.
Les justifications données par les médecins à ce
qu’ils disent et ce qu’ils ne disent pas, et donc à ce
qu’ils gardent secret ou non, permettent de
constater que l’information, le secret et la dissi-
mulation sont de véritables stratégies médicales,
mais que ces pratiques se fondent sur des logiques
différentes, selon qu’elles sont abordées sous l’an-
gle seulement thérapeutique ou sous l’angle
éthique. Dans certains cas, le contenu de l’infor-
mation a un but strictement utilitaire : inciter le
patient à se plier au traitement ; dans d’autres, il
vise à répondre à un principe éthique (le droit du
patient), les deux ne se recouvrant pas nécessaire-
ment. Mais la dissimulation peut répondre, elle
aussi, à ces deux motifs. De sorte que c’est au nom
des mêmes principes (celui de l’éthique et celui
de l’utilité) que les médecins peuvent défendre
deux pratiques contraires : garder secrète ou divul-
guer l’information sur l’état de santé du malade.
Comme on le voit, le secret, qui devrait normale-
ment maintenir la confidentialité des informa-
tions concernant le patient en les dissimulant aux
autres, est en fait parfois appliqué en direction du
patient lui-même.
Certes, le patient garde aussi parfois secrètes cer-
taines informations. Borkan & al. (1999) ont exa-
miné les différentes raisons pour lesquelles les
patients cherchent à garder des secrets face au
médecin. Ils évoquent le sentiment que l’informa-
tion n’est pas pertinente, le manque de confiance
dans le médecin, et le sentiment de culpabilité ou
de honte lié à ce qui est caché. Mais le secret a bien
d’autres raisons. Le secret est également parfois
gardé par le patient sur l’apparition de nouveaux
symptômes, potentiellement inquiétants, par
crainte que leur révélation fasse advenir un diag-
nostic d’aggravation de la part du médecin. Il n’est
pas rare que les patients tiennent à garder secrets
certains de leurs symptômes, en vue d’atténuer le
diagnostic que le médecin risque d’en inférer s’il
en est informé. Le patient peut aussi choisir de gar-
der le secret sur certains faits, par crainte de la rup-
ture de confidentialité de la part du médecin qui
en serait informé. Ou encore, il peut garder
secrètes certaines de ses conduites (non-obser-
vance, automédication, recours thérapeutiques
alternatifs, prise ou non de la contraception, etc.),
quitte à mentir au médecin qui l’interrogerait à ce
sujet.
Le secret et la famille
Par un effet de déviation du principe du secret
médical, les informations ne sont par contre pas
toujours tenues secrètes à l’entourage, en dépit
(ou en vertu) de la loi, qui comporte une part
d’ambiguïté. L’article L. 1110-4 du Code la santé
publique établit que « toute personne prise en charge
par un professionnel, un établissement, un réseau de
santé ou tout autre organisme participant à la préven-
tion et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant ». Ce secret cou-
vre l’ensemble des informations concernant la
personne et s’impose à tout professionnel de santé
ou intervenant dans le système de santé. La loi pré-
voit cependant qu’en cas de diagnostic ou de pro-
nostic grave, les proches puissent recevoir les
informations nécessaires destinées à leur permet-
tre d’apporter un soutien au malade, sauf si celui-
ci s’y oppose.
On ne peut manquer de remarquer le paradoxe
DOSSIER
UN SOCLE POUR LE SOIN
1
…/…
Pratiques 64 _NFPratiques45C 10/02/14 12:58 Page29

30
PRATIQUES 64 JANVIER 2014
d’un code qui prescrit le secret médical (et donc
la confidentialité de toute information concernant
le malade et son état de santé) et en même temps
qui préconise de faire connaître un diagnostic ou
un pronostic grave à la famille – c’est-à-dire qui
prescrit donc de rompre le secret, alors que le
malade lui-même peut être tenu dans l’ignorance
de son état. S’il est vrai que la non-information du
malade est souvent le résultat d’une demande de
l’entourage, cette demande est parfois surévaluée
par les médecins. Il arrive ainsi que le médecin se
défausse de son rôle sur la famille, attribuant alors
à l’entourage la responsabilité de l’ignorance dans
laquelle le malade est tenu.
Rigoureusement parlant, la loi ne prévoit donc
pas de droit à l’information pour l’entourage du
patient. Le patient peut toujours s’opposer à ce
que les informations concernant sa santé soient
délivrées, puisque la confidentialité reste la règle.
Mais cette question n’est posée que de manière
théorique, abstraite, au début de la prise en
charge du patient, ou bien n’est pas posée du tout.
Lorsqu’elle l’est, elle n’est bien évidemment pas
accompagnée de la précision que l’information
peut être donnée à la famille et non au patient lui-
même. Si le malade peut s’opposer à ce qu’une
information confidentielle soit délivrée à ses
proches, encore faut-il qu’il en soit lui-même
informé. On imagine mal qu’il soit demandé au
patient : « Est-ce que vous autorisez le médecin à
révéler à votre famille quelque chose qu’il ne vous
dira pas, à vous ? ».
Le secret revêt bien sûr un sens différent selon
que celui vis-à-vis de qui il est gardé est le malade
ou les autres, et les implications sociologiques du
secret sont alors différentes. Dans le cas du secret
médical, où médecins et malades partagent la
confidentialité du diagnostic, le secret crée un lien
entre eux ; en revanche, la non-divulgation au
patient d’une information qui le concerne, et sa
divulgation concomitante aux proches, créent une
distance entre le médecin et le malade. Dans un
cas, le secret lie le médecin et le malade, ensem-
ble face aux autres ; dans l’autre cas, il sépare l’un
de l’autre.
L’acte qui consiste à dissimuler l’état du malade
à l’intéressé, mais à le révéler à sa famille, déroge
donc en un sens à l’éthique du secret médical ; il
existe là deux principes contradictoires. Tout se
passe comme si la famille n’était pas un Autre,
un tiers auquel serait opposé le secret, et comme
si elle entrait dans un état de fusion avec la per-
sonne malade au point d’échapper à la défini-
tion du « tiers » (qui ne doit normalement pas
être informé de ce qui concerne intimement le
malade). État de fusion partiel cependant,
puisque la famille se voit parfois créditée d’une
information refusée au malade lui-même, pla-
çant dès lors la première dans une position de
pouvoir sur le second.
Le fait que la famille puisse être informée et non
le patient est en soi une situation problématique
dans les sociétés contemporaines. Il repose, de
manière anthropologique, la question de la défi-
nition de la notion d’autonomie et de ses liens
avec la notion d’individu, dans la mesure où l’au-
tonomie ne se pense pas, du moins en théorie,
autrement qu’attachée à l’entité singulière qu’est
la personne humaine, ici le malade. Selon Mack-
lin (1999), il ne peut y avoir d’éthique universelle
concernant le partage de l’information, car la
notion d’autonomie ne signifie pas la même chose
en Asie et en Occident. Il évoque ainsi des confi-
gurations culturelles qui, soucieuses de protéger
l’autonomie, ne s’enracinent pas pour autant dans
la valeur culturelle de l’individualisme, en faisant
allusion aux sociétés où l’autonomie implique une
détermination familiale (et non une autodétermi-
nation individuelle comme en Occident). Par
exemple, en Asie du sud-est, c’est la famille qui
constitue l’unité sociale autonome et le médecin
ne peut agir contre elle (Fan, 1997).
En définitive, l’usage du secret et les pratiques de
rupture de confidentialité du secret observables
en France conduisent donc à mettre en question
la configuration réelle dans laquelle l’individu est
réputé protégé par le secret médical. Cette situa-
tion a des conséquences à la fois éthiques, anthro-
pologiques et politiques. D’une part, parce que la
confidentialité que préserve le principe du secret
se retourne parfois contre le patient ; d’autre part,
parce que la pratique qui consiste à informer la
famille, et non le malade, tire sa logique d’une
acception équivoque de la notion d’autonomie et
d’une affirmation illusoire du caractère individuel
de cette autonomie.
Références
Abiven M., 1996, « Mentir pour bien faire ? ou le mensonge en
médecine »,
Études psychothérapiques
, vol 13, p. 39-50.
Arendt H., 1972,
Du mensonge à la violence, Essais de politique
contemporaine
, Paris, Calmann-Lévy.
Borkan J, Reis S., Steinmetz D., Medalie J.H. eds., 1999,
Patients and
Doctors. Life changing Stories from Primary Care
, Univ. Of Wisconsin
Press, London/Madison.
Fainzang S., 2006,
La relation médecins-malades : information et
mensonge
, Paris, Presses universitaires de France, 2001.
Fan R., 1997, « Self-determination versus family determination : two
incommensurable principles of autonomy »,
Bioethics
, 11, p. 309-22.
Macklin, R., 1999,
Against Relativism. Cultural Diversity and the
Search for Ethical Universals in Medicine
, New York/Oxford, Oxford
University Press.
Simmel G., 1964, « The Secret and the Secret Society », in :
The
sociology of Georg Simmel
, Glencoe/London, The Free Press.
DOSSIER
Le secret en médecine
…/…
Pratiques 64 _NFPratiques45C 10/02/14 12:58 Page30
1
/
3
100%