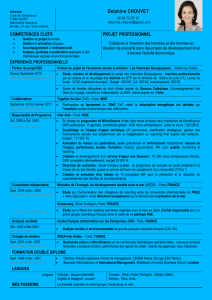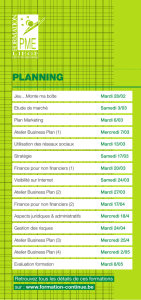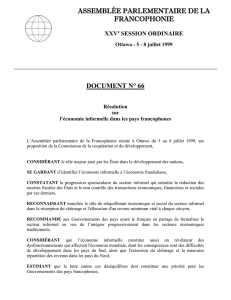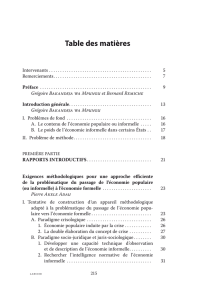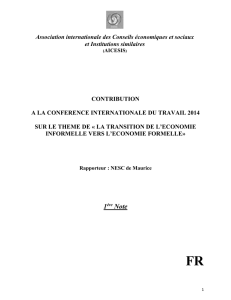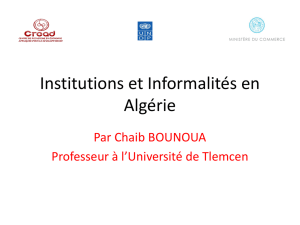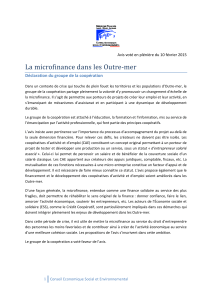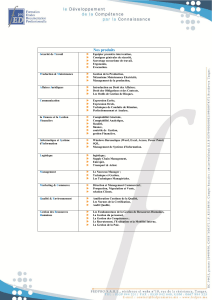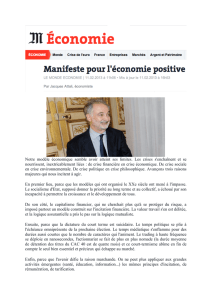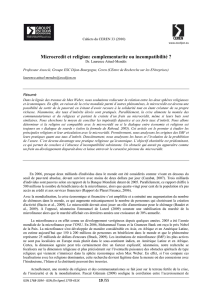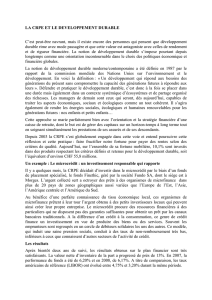DE LA NORMALISATION DES INFORMALITÉS FINANCIÈRES EN

57
DE LA NORMALISATION DES INFORMALITÉS FINANCIÈRES EN
AMÉRIQUE LATINE : ENTRE COMMERCIALISATION ET
RÉAPPROPRIATION « PAR LE BAS »
Omer KOUAKOU
Doctorant en économie sociale
Dynamiques rurales, Université Toulouse 2
Résumé
A l’intérieur du secteur informel, à consonance négative d’un strict point de vue économique,
émerge la finance informelle qui, par sa tendance à mettre le financier au service du lien social,
conserve une connotation positive. Malgré cela, les modèles de développement néolibéral qui
s’imposent en Amérique latine la considèrent en termes d’inefficacité économique. Les
informalités financières se formalisent soit « par le haut » (absorption par les réseaux bancaires
traditionnels ou évolution vers des formes bancaires), soit « par le bas » (à travers des projets de
finance solidaire, en particulier, de microfinance). Toutefois, ces deux voies de normalisation
comportent des risques élevés de financiarisation (ou commercialisation) et donc de perte de la
dimension réciprocitaire, quand s’impose l’intérêt personnel et la recherche de profit privatisé au
détriment du collectif. D’où la nécessité d’une construction du politique par la réappropriation
collective des valeurs réciprocitaires, sociales et solidaires.
Resumen
Al interior del sector informal, que tiene una connotación negativa desde un punto de vista
estrictamente económico, surge la finanza informal que, por su tendencia a colocar el financiador
al servicio del lazo social, conserva una conotación positiva. A pesar de ello, los modelos de
desarollo neoliberal que se imponen en América Latina la consideran en terminos de ineficacia
economica. Las informalidades financieras se formalizan «desde arriba» (absorpción por las
redes bancarias tradicionales o evolución hacia formas bancarias), o «desde abajo» (a través de
proyectos de finanza solidaria, particularmente de microfinanza). No obstante, estas dos vias de
normalización tienen altos riesgos de financiarización (o de comercialización) y por tanto de
pérdida de la dimensión reciprocitaria, cuando se impone el interés personal y la búsqueda de un
beneficio privatizado en detrimento de lo colectivo. De ahí la necesidad de una construcción de lo
político por medio de la reapropiación colectiva de valores reciprocos, sociales y solidarios.
Abstract
Within the informal sector, which has a negative consonance from a strict economic point of
view, arises the informal finance wich, by its tendancy to consider financial aspects as a mean to
strengthen social links, has a positive connotation. Even so, neoliberal models of development
taking place in Latina America consider them as economic ineffectiveness. These informal
finance take offence either “by the top” (absorption by traditional bank networks or evolution
towards bank forms), or “by the bottom” (through social finance projects, in particular,
microfinance). However, theses two ways contain high risks of financiarization (or
merchandizing), therefore of loss of reciprocity. This needs reconstruction of politics by a
reconquest, through collective decisions, of solidarity and social values.

58
Introduction
Le secteur informel occupe une place de choix dans les économies des pays en développement
(PED). La notion de secteur informel fait toujours débat aujourd’hui pour ce qui est notamment
des contours théoriques du concept. Toutefois, d’un point de vue économique, l’on retient en
général que le secteur informel renvoie à deux réalités : d’abord, c’est l’ensemble des activités
économiques qui se réalisent en marge de la législation pénale, sociale et fiscale ou échappant à
la Comptabilité Nationale ; ensuite, c'est l'ensemble des activités qui échappent a la politique
économique et sociale, et donc a toute régulation de l'Etat. La concept a donc, d’un point de vie
strictement économique, une consonance négative et souligne l’idée de fraude tout en
fonctionnant, paradoxalement, au vu et au su de tous. Les premiers travaux sur ce secteur n’ont
concerné que la dimension réelle de l’économie (marché du travail, marché des biens de
consommation). Le secteur informel émerge alors dans un contexte d’incomplétude de la
socialisation marchande et se donne à voir comme stratégie économique de survie et de lutte
contre les inégalités et la pauvreté. Il apparaît ainsi dans un premier temps comme une innovation
économique. Des travaux portant sur la dimension financière du secteur informel, les informalités
financières, existent également et sont récents. Cependant, les modèles de développement libéral
qui s’imposent en Amérique latine dans un contexte de crise économique et sociale tendent à
ignorer ces informalités financières (marginalisation), voire à les éradiquer pour la raison
essentielle qu’elles seraient source d’inefficacités économiques.
Face à cela, le secteur informel réagit de diverses façons. D’abord, le secteur informel peut tenter
la voie de la formalisation par l’intégration aux modèles de développement libéral. Les pratiques
d’informalité financière se transforment alors en institutions bancaires. Il s’agit d’une
appropriation et d’une normalisation de la finance informelle « par le haut ». L’innovation sociale
induite par la finance informelle se transforme alors en innovation financière. Ensuite, le secteur
informel peut tenter la voie de la formalisation par l’intégration dans le champ de l’économie
solidaire. Il s’agit alors d’une tentative d’appropriation et de normalisation de l’informalité
financière « par le bas ». C’est ainsi que des acteurs de la société civile (personne charismatique,
ONG) en sont venus à incorporer les logiques financières informelles dans les pratiques
microfinancières. Celles-ci apparaissent comme une normalisation de la solidarité financière tout
en préservant en leur sein une certaine dose de réciprocité, de solidarité.
Toutefois, ces deux aspects de la normalisation des informalités financières en Amérique latine
s’inscrivent dans la logique de la financiarisation des sociétés ; le financier tend à s’imposer et à
prendre le pas sur l’économique, le social et le politique. On court alors le risque d’une perte de
la dimension socialement encastrée de la finance informelle et d’une disparition de l’identité
solidaire des institutions de microfinance (IMF). D’où la nécessité d’une construction du
politique dans les deux cas par la réappropriation « à partir du bas » des valeurs réciprocitaires,
sociales et solidaires.
Les informalités financières en Amérique latine
1) Définition
La finance informelle renvoie à des pratiques d’épargne et de crédit qui ne sont pas tenues de
respecter un cadre ou un schéma fixé et qui mettent donc l’accent sur l’absence de formes ; d’où
l’expression « informel ». Les relations entre le débiteur et le créancier reposent sur la confiance
et sont personnelles dans la mesure où les partenaires se connaissent et font affaire comme ils

59
l’entendent. On distingue, à la suite de Lelart (2005) les pratiques informelles individuelles (les
gardes-monnaie, les banquiers ambulants, les crédits informels) et les pratiques informelles
collectives (les tontines dites mutuelles, les tontines plus élaborées).
L’expression « tontine » est née en France à partir de l’initiative d’un banquier napolitain du nom
de Tonti. Celui-ci vendit au roi Louis XV l’idée d’emprunter de l’argent sans le rembourser, en
versant annuellement seulement la totalité de l’intérêt correspondant aux seuls souscrivants
survivants jusqu’à ce que le dernier décède. L’expression de tontine en vint à caractériser une
opération tout à fait différente pratiquée dans les pays en voie de développement, lorsqu’au début
du XIXe siècle, des juristes français décidèrent d’appeler ainsi un contrat pratiqué en Indonésie
(la houei) par lequel plusieurs personnes décident d’épargner ensemble et de se prêter cet argent
les uns aux autres. Les tontines se caractérisent principalement par l’importance des relations
personnelles qui lient les participants. Ces pratiques sont parfaitement adaptées au comportement
de populations qui cultivent la solidarité et pour lesquelles l’épargne se situe davantage dans une
relation de chacun avec les autres que dans une relation isolée de chacun dans le temps.
Beaucoup plus présentes en Afrique et en Asie, elles existent également présentes dans quelques
pays d'Amérique centrale et surtout d'Amérique latine. Elles présentent partout les mêmes
caractéristiques qui tiennent à ce que les relations personnelles entre les membres sont
particulièrement étroites. L’hypothèse est que ce sont les anciens esclaves et les immigrés qui ont
amené avec eux des pratiques qui ont subsisté. Plus précisément, ces pratiques ont été importées
par les Noirs ou par les Asiatiques sur les côtes du Pacifique (Indacochea, 1994) , comme elles
l’ont été par les Sri Lankais à Londres, par les Coréens à New York, par les Sénégalais à Paris.
Au Pérou, les tontines seraient liées à l’immigration japonaise au début du XXe siècle. Des
appellations différentes sont utilisées pour désigner ces pratiques financières informelles: au
Mexique, au Brésil (le consorcio), au Pérou et en Bolivie (le pasanaku), en Jamaïque, aux
Bahamas ou à Trinité Tobago (susu, esu), au Mexique (tanda), au Guatemala (cuchubal). On les
retrouve sous d’autres noms en République Dominicaine, à la Barbade, à Belize. Toutefois, le
mot consacré reste tontine. En Amérique latine, et en l’état actuel de nos connaissances, on
n’observe pour ainsi dire que les formes collectives des pratiques financières informelles : les
tontines dites mutuelles et les tontines plus élaborées. Nous décrivons dans ce qui suit ces formes
spécifiques d’informalité financière.
2) Les tontines dites mutuelles
Dans cette forme de tontine, l’épargne collectée n’est pas gérée par une personne autre que les
épargnants mais est remise sous l’appellation de « cagnotte » à chaque épargnant à tour de rôle.
Ce type de tontine est communément appelé AREC (Association rotative d’épargne et de crédit) ,
appellation due à F.J.A. Bouman en 1977. Les AREC existent un peu partout dans le monde,
surtout dans les PVD, mais aussi parmi les groupes d’immigrants des pays développés. Les
participants sont unis par des relations personnelles ; ils appartiennent au même milieu, au même
clan, habitent le même quartier et se réunissent chez l’un ou l’autre à tour de rôle, car connaître le
domicile de chacun renforce la cohésion du groupe.
Les membres de l’AREC s’engagent à mettre de l’argent de côté dans une cagnotte à des périodes
régulières. A chaque période, la somme collectée est allouée à l’un des participants. Le processus
est répété jusqu’à ce que chaque membre reçoive sa part ; alors l’AREC est démantelée ou
reprend un autre cycle. On distingue différents types d’AREC : celles qui allouent leur fonds de
façon déterministe, selon des critères comme l’âge, l’ancienneté, etc. (AREC déterministe) ;
celles qui allouent leur fonds de façon aléatoire, par tirage au sort le plus souvent (AREC

60
aléatoire); Chaque réunion est l’occasion d’échanger des informations, de demander conseil, de
discuter de projets. La dernière est souvent l’occasion d’une fête, quand le cycle se termine et
qu’un autre doit recommencer. L’AREC constitue « une des portes d’entrée dans la société, un
des lieux où naît l’échange social. Elle est la forme première de la place publique » (Henry et
alii, 1991, cité par Lelart, 2005).
Ces tontines sont d’une souplesse extrême, à cause de l’importance des relations personnelles
entre les membres. Il arrive aussi souvent que des AREC s’organisent en désignant un président,
un secrétaire ou un trésorier, en établissant un règlement écrit qui prévoit des sanctions en cas de
retard ou de défaillance d’un membre. Dans certaines AREC, on autorise des participants à verser
deux ou plusieurs cotisations, ou seulement la moitié d’une. D’autres établissent des garanties,
une petite rémunération pour le trésorier, une augmentation des cotisations pour tenir compte de
l’inflation, etc. En fait, chaque tontine est unique et conserve sa part d’originalité.
3) Les tontines plus élaborées
Les sommes collectées dans les AREC mentionnées plus haut sont le plus souvent destinées à
l’épargne et le mode de désignation du bénéficiaire à chaque cycle est simple (déterministe ou
aléatoire). Cependant, dans des formes plus élaborées d’AREC, les fonds peuvent être utilisés à
des fins d’assurance et de crédits et les bénéficiaires peuvent être désignés à l’issue d’enchères.
En effet, il arrive que certaines tontines autorisent, en plus des mises habituelles, un complément
à destination d’une caisse de secours et qui garantit un versement, cela en cas de décès, de
naissance ou de mariage, et qui pourra l’aider en cas de maladie. Ces cotisations complémentaires
caractérisent la vocation sociale de la tontine.
La tontine peut aussi disposer d’une caisse de prêts, alimenté par le premier versement qui n’est
donc pas restitué aussitôt, ou par un versement complémentaire chaque fois. Ces fonds sont
prêtés pour quelques mois aux membres ou aux non-membres, à un taux d’intérêt qui est souvent
de 10% pour les premiers, de 15 à 20% pour les seconds. Il arrive parfois que des tontines servent
exclusivement à des prêts à des non-membres ; on parle alors dans ce cas d’ACEC (Associations
cumulatives d’épargne et de crédit). Dans certaines tontines, les fonds collectés sont alloués au
plus offrant ; on parle alors d’AREC à enchères. Ce type de tontines se retrouve surtout au
Cameroun, parmi les Bamilékés qui peuvent mettre en jeu des sommes considérables, ainsi qu’en
Asie. Nous n’avons pas, dans l’état actuel de nos connaissances, d’exemple de ce type en
Amérique latine.
Les tontines sont d’abord une aventure sociale du fait de l’importance des relations entre
membres, de la proximité et de la confiance, mais aussi une aventure financière. C’est évident
dans les tontines avec enchères puisqu’un intérêt équilibre les besoins des uns d’emprunter,
l’accord des autres pour prêter.
Une normalisation « par le haut » : la formalisation de la finance informelle sous forme
d’institutions financières et bancaires
L’idée de la formalisation des tontines en Amérique latine suppose que celles-ci ont des limites
qui rendent souhaitable leur passage vers la finance formelle. Selon ce courant, du fait de leurs
inefficacités économiques, les tontines doivent évoluer vers des structures bancaires. Ainsi, dans
de nombreux cas en Amérique latine, la formalisation de tontines s’est avérée être comme le
premier pas vers la création d’institutions bancaires.
Par ailleurs, on assiste également, hormis la voie de la formalisation, à la mise en place de
stratégies visant la disparition de tontines au profit de banques au motif que le secteur informel

61
indique également les voies de l’amélioration du système formel. Le secteur informel ne permet
alors pas seulement la résistance de la société ni de supporter les enchaînements régressifs liés à
l’insertion mondiale. Il peut également se présenter comme un véritable creuset d’innovation.
Ainsi les informalités générées par les transformations du mode de production, expression d’une
mutation sociétale radicale se présentent comme des informalités de survie, de substitution, voire
de complémentarité, pendant toute la période de transition et jusqu’à ce que de nouvelles «
régularités » apparaissent qui constitueront les axes d’un nouveau mode de production.
Avant de voir plus en détail ces deux trajectoires de la finance informelle en Amérique Latine, il
serait utile de voir les inefficacités économiques auxquelles font référence les critiques de la
finance informelle, en particulier des tontines. Ces limites des tontines sont de deux types : d’une
part, l’allocation non optimale des ressources financières à laquelle elles conduisent ; d’autre part,
leur incapacité à générer l’accumulation financière, facteur de modernisation des entreprises et de
développement économique.
1) Les limites des tontines
- Les tontines : vers une allocation non optimale des ressources financières
Dans les tontines, sauf cas exceptionnel, il n’y sort pas d’argent, et il n’y entre pas non plus, dans
la mesure où les opérations d’épargne, d’emprunt et de prêt se font à l’intérieur du groupe
constitué. Ainsi, l’argent est investi là où il est. On ne peut parler d’affectation des ressources aux
projets les plus pertinents, les plus rentables. Ainsi, dans la mesure où les ressources financières
ne sortent ni ne rentrent, autrement dit, du fait de la limitation spatiale, on ne peut pas parler
d’allocation optimale des ressources dans les tontines.
- Les tontines : Un frein à l’accumulation financière
Les tontines en Amérique latine, comme partout ailleurs, sont certes au service d’un secteur (le
secteur informel) qui fait vivre – voire survivre – une grande partie de la population, mais elles
constituent un frein à la transformation de la société en ce qu’elles perpétuent un mode
traditionnel d’organisation de cette société. Cela serait dû au fait que la finance informelle ne
permet pas à l’entreprise de changer d’échelle et de se moderniser, bref de sortir du secteur
informel de l’économie. En fait, en règle générale, la finance informelle permet de financer les
entreprises au jour le jour, sous forme d’injection de capital circulant permettant de récupérer
rapidement les fonds engagées. Il s’agit d’une finance de court terme qui finance les besoins
d’exploitation (et non d’investissement, à long terme) de commerce fonctionnant en cycle court.
Dit autrement, la finance informelle, du fait d’une limite relative au temps, n’est pas propice à
l’accumulation, facteur de développement.
Cette conclusion semble confirmée par les travaux de Bruno Lautier (1994) . En effet, Lautier
distingue, dans le cas de l’Amérique latine, plusieurs cas de figure dans l’itinéraire des opérateurs
économiques ; la mobilité tout au long du cycle de vie est relativement grande sur ce continent
dans la mesure où, après un apprentissage dans l’informel, les jeunes se tournent vers le formel
vers l’âge de 25 ans pour une quinzaine d’années, puis vers 40 ans retourneraient dans l’informel
en tant que petits patrons. Tandis que le passage dans l’informel permet l’apprentissage technique
et disciplinaire, le passage dans l’informel serait l’occasion de se constituer un capital de départ
et un réseau de relations utiles ensuite dans l’informel. Dans d’autres PVD, comme au Sénégal,
c’est au contraire dans l’informel que se réalise l’accumulation.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%