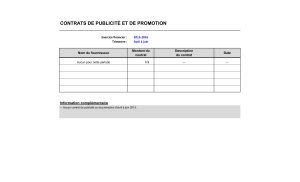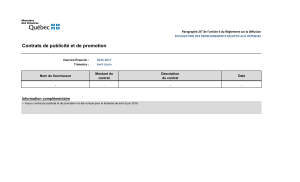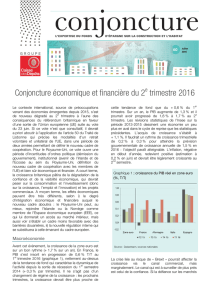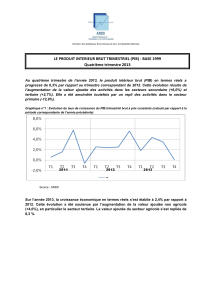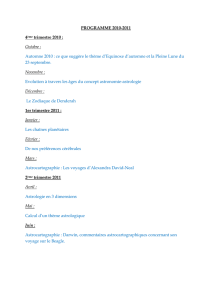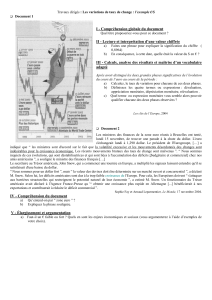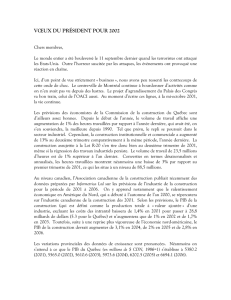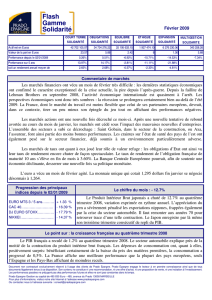un g20 historique

Conjoncture n° 219 – Novembre 2008 - 1 -
C’est de Washington où se sont rencontrées le 15 novembre dernier les vingt premières puissances économiques de la
planète (G20) que l’opinion mondiale espérait beaucoup. Ce sommet, qui réunissait outre le G7, la Russie, la Chine,
l’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie, le Brésil, le Mexique, l’Argentine, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud, l’Australie
et la Turquie ainsi que l’Union européenne, est historique dans la mesure où il rassemblait des membres qui
représentent plus de 85 % du produit intérieur brut mondial. La mondialisation implique désormais les pays émergents,
la course à la globalisation a donné une nouvelle dimension à la gouvernance mondiale. Mais les désordres financiers
ont atteint un tel niveau que les pays industrialisés et émergents, qui se sont interrogés ouvertement sur ce qu’il
conviendrait de faire pour y remédier, se sont contentés dans un premier temps de déclarations générales et de grands
principes pour relancer l’économie mondiale et lutter contre les dérives du système financier international avant de se
retrouver en avril 2009.
La globalisation des échanges, de la
production et des capitaux a montré les
insuffisances du Bretton Woods de
1944-1945, très orienté sur les questions monétaires. Les ministres des Finances des pays participants au G20, qui se
sont donné quatre mois pour ébaucher un nouvel ordre mondial, se sont engagés à mettre en place un Bretton Woods II
qui devra avoir une dimension bancaire et financière. Pour instaurer un système financier mondial plus stable et
transparent, des réformes devront être mises en œuvre pour que tous les marchés, produits et acteurs soient soumis à une
régulation ou à une surveillance. La valorisation des titres, notamment des produits complexes ou illiquides,
l’information sur les produits hors bilan, la gouvernance de l’organisme international de normalisation comptable, avec
l’objectif d’une norme unique mondiale, font partie du plan d’action qui comprend une liste impressionnante de sujets à
traiter ou à réformer à court ou à moyen terme. Par ailleurs, des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI, qui
a obtenu à l’issue du sommet un rôle accru de surveillance de la finance mondiale, seront contraintes de s’adapter, de
moderniser leur fonctionnement et leurs structures.
A la crise financière, qui s’est étendue aux pays émergents, touchant de plein fouet les entreprises industrielles, s’ajoute
la crise économique qui était engagée avant septembre 2008 et qui a pour origine l’immense volatilité des marchés
énergétiques et des matières premières importées. Si la réaction rapide des autorités financières, mais aussi des Etats a
neutralisé l’éventualité d’un krach bancaire, des menaces subsistent toujours. Le rétablissement de la situation de bilan
des systèmes bancaires prendra du temps et passera par les canaux traditionnels, baisse des coûts d’exploitation,
durcissement des conditions de crédit, appel aux marchés pour augmenter les fonds propres et « nettoyage » du bilan.
Face à la dégradation de l’économie mondiale, le G20 a appelé à adopter une politique favorisant la croissance. La
récession annoncée pour 2009 aux Etats-Unis et en Europe, aussi bien par le FMI que par l’OCDE, rendra nécessaire un
soutien budgétaire massif, des aides sectorielles, mais aussi le retour de l’épargne longue privée qui seule peut
durablement assurer un financement sain de l’économie.
Il y a dix ans, la crise financière asiatique a marqué un tournant dans la gestion des changes et dans la stratégie de
développement des pays en développement, mais la réforme de l’architecture financière mondiale, bien qu’évoquée, n’a
pas eu lieu. Désormais, les ministres des Finances des pays du G20 se sont engagés à faire des propositions pour
ébaucher une nouvelle réglementation de la finance mondiale. On peut regretter l’absence de question sur le système et
les politiques de change qui ont lourdement participé aux déséquilibres mondiaux. Concernant la crise économique,
chaque gouvernement mettra en place une politique adaptée à sa propre situation pour relancer son économie. Les Etats-
Unis ont rappelé leur attachement au libéralisme, soutenant que la solution à long terme aux problèmes actuels est une
croissance économique soutenue sur la base des principes de libre marché. Par ailleurs, pour éviter les tentations
protectionnistes, le G20 a pris l’engagement de tenter de relancer les négociations pour le cycle de Doha qui pose les
règles du commerce international.
Si les résultats de la rencontre n’ont pas été à la hauteur de toutes les
attentes qu’elle avait pu susciter, le sommet du G20 marque une avancée
positive malgré l’absence de mesures concrètes et immédiates à apporter à
la crise ou d’agenda précis susceptibles de changer significativement les perspectives à court terme. C’est le premier
forum où les pays émergents ont participé aux discussions avec les pays du G7 et où l’Europe aura parlé d’une seule
voix. L’engagement d’élargir le Forum de stabilité financière à certains pays émergents et d’accroître le poids de ces
derniers pays dans le FMI a été pris. D’autre part, le G20 a rejeté le protectionnisme et une régulation excessive des
marchés. Néanmoins, l’émergence d’un nouvel ordre mondial s’annonce longue et l’incertitude persiste. Aussi, les
marchés financiers font preuve de perplexité et d’une extrême volatilité.
UN G20 HISTORIQUE
Novembre 2008 N°219 L’INDICATEUR AVANCE EST
PRESENTE DANS UN ENCART JOINT
Dossier du mois page 6
LA CRISE FINANCIERE ET LES PAYS D’ASIE
Source : COE-REXECODE

- 2 - Conjoncture n° 219 – Novembre 2008
Environnement international
Les indicateurs mondiaux témoignent d’une nette
inflexion de l’activité bien avant l’aggravation de la
crise financière, ce qui légitime la baisse des prix des
produits de base. Les cours du Brent sont passés sous la
ligne des 50 dollars le baril malgré un abaissement des
quotas de production de l’OPEP, décision insuffisante
pour contrebalancer l’anticipation faite par les marchés
d’un fort ralentissement de l’activité économique en
2009. Le commerce mondial poursuit son
infléchissement et les pays émergents sont également
touchés par le ralentissement des échanges mondiaux.
La croissance dans les pays d’Asie-Pacifique (hors
Japon) est estimée à 6,7 % en 2009 (8,8 % en Chine)
contre une prévision à 7,1 % en septembre dernier et à
9,1 % en Chine. Les exportations chinoises
commencent à pâtir de la récession dans les pays
développés. L’indice du climat des affaires a chuté,
notamment dans l’industrie.
200820072006200520042003200220012000
150
145
140
135
130
125
120
115
C H I N E : C L I M A T D E S A F F A I R E S
I n d u s t r i e
Aux Etats-Unis, la croissance du PIB au troisième
trimestre a reculé de 0,3 % l’an après une croissance de
2,8 % l’an au second trimestre. La baisse du PIB
devrait s’accentuer au dernier trimestre sous l’effet
principalement de la contraction des dépenses des
ménages. Pour la première fois depuis 1990, la
consommation s’est repliée de 3,1 % l’an et
l’effondrement de l’indice de confiance des ménages
en octobre, qui casse tous ses plus bas niveaux
antérieurs de 1974, 1980 et début 1992, suggère une
accentuation de la contraction de la demande des
ménages en fin d’année. A 6,5 %, le taux de chômage
est plus élevé que lors de la récession de 2001. Les
entreprises ont commencé à réduire leurs dépenses en
capital fixe qui, en volume, se sont repliées au rythme
de 1 % l’an au cours de l’été après une augmentation
de 2,5 % l’an au premier semestre. La baisse concerne
uniquement l’investissement en biens d’équipement.
L’investissement en construction non résidentielle a
encore progressé au troisième trimestre (7,9 % l’an). Il
est probable qu’il baissera désormais, les banques
ayant encore durci leurs conditions de crédit aux
entreprises industrielles et commerciales.
La résorption des déséquilibres du marché du logement
est déjà bien avancée. Les ventes de logements dans le
neuf comme dans l’ancien ont rebondi et la baisse des
stocks se poursuit sur les deux segments, mais les
pressions à la baisse sur les prix ne se relâchent pas.
L’indice Case Shiller est en repli de 16,6 % sur un an,
retrouvant ses niveaux de la mi-2004.
Au Japon, le PIB, en volume, s’est contracté de 0,4 %
l’an au troisième trimestre 2008. Malgré le rebond de
la production industrielle en septembre (+1,2 %), la
sphère industrielle est entrée en récession depuis le
début de l’année. La demande interne fait toujours
défaut ce que la dégradation de l’emploi et le recul du
salaire moyen nominal contribuent à expliquer. Par
ailleurs, la demande extérieure nette, qui s’est
dégradée, pourrait encore se détériorer avec
l’appréciation du yen. La baisse des prix à la
consommation de 0,1 % en septembre annonce peut-
être le retour prochain de la déflation.
Dans la zone euro, le PIB en volume a reculé de 0,8 %
l’an au troisième trimestre. La production industrielle a
baissé en septembre. Les carnets de commandes se
dégarnissent, les perspectives de production se
dégradent et les stocks s’alourdissent.
20082007200620052004200320022001
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
Z O N E E U R O
P e r s p e c t i v e s d e p r o d u c t i o n d a n s l' i n d u s t r i e
( m o y. 8 9 - 0 7 ) 6,7 %
E n % s o l d e s d ' o p i n i o n
Presque dans tous les pays, les taux d’utilisation des
capacités de production reculent sous leur moyenne de
long terme. Dans l’industrie, l’indice mesurant le
climat des affaires a retrouvé ses points bas de 1996 ou
2001. La chute des commandes s’adressant à
l’industrie allemande, surtout de celles provenant des
marchés à l’exportation, annonce la poursuite du
ralentissement industriel. De même, dans le secteur de
la construction, l’indice du climat des affaires est au
plus bas depuis 1998. Aussi, le taux de chômage (7,5 %
en septembre) devrait monter. Partout, les dépenses de
consommation fléchissent, notamment sur le marché
automobile. En revanche, la baisse des prix à la
consommation en Allemagne (-0,2 %), leur faible
hausse en Italie (+0,1 %) et leur stabilité dans
l’ensemble de la zone confirment une accélération du
reflux de l’inflation. Au Royaume-Uni, la poursuite de
la baisse des prix de l’immobilier et la chute du marché
automobile en octobre annoncent que l’économie
britannique est probablement entrée en récession dès le
début du deuxième semestre 2008.
La BCE a confirmé un sensible durcissement des
conditions du crédit, aussi fortement pour les
entreprises que pour les ménages, que les crédits soient
destinés aux petites ou aux grandes entreprises, qu’ils
soient à court ou à long terme. Si les statistiques sur les
nouveaux crédits accordés ne confirment que
partiellement cette appréciation quantitative, il est
probable que depuis octobre, les engagements de
crédits accordés aux entreprises aient reflué.

Conjoncture n° 219 – Novembre 2008 - 3 -
Conjoncture française
La croissance française a augmenté de 0,6 % l’an au
troisième trimestre 2008. Cette faible activité s’inscrit
sur fond d’une croissance en repli dans l’ensemble de
la zone euro (-0,8 % l’an). Le vif recul du PIB observé
au printemps dernier n’a pas été confirmé, mais les
enquêtes de conjoncture ou l’indicateur avancé du
Crédit Mutuel, qui a retrouvé ses niveaux de la fin de
l’année 1992, annonçant un recul du PIB de 0,9 % en
1993, ne permettent pas de prolonger cette progression
du PIB au-delà du troisième trimestre. Néanmoins, les
circonstances de 1993 et de 2008 ne sont pas
comparables. Dans le premier cas, la récession avait été
associée aux brutaux bouleversements de change intra-
européen et au retournement de l’activité outre-Rhin.
En 2008, les causes du fort ralentissement actuel se
trouvent dans les difficultés du système bancaire et
dans le choc pétrolier. Toutefois, une baisse de même
ampleur que celle qui avait été observée en 1992-1993
provoquerait une diminution des effectifs employés de
l’ordre de 150 000 et une remontée du taux de
chômage de 0,4 point d’ici à l’hiver 2009.
En volume
(en %) 2007
2006 2008
2e tr. 2008
3e tr. 3e tr.08
3e tr.07
PIB
Consom.privée
FBCF totale
ménages
productif
Exportations
Importations
2,1
2,4
5,0
3,0
7,3
3,2
5,9
-1,1
-0,1
-5,7
-10,2
-4,0
-7,3
-1,6
0,6
0,9
-1,2
-6,2
1,2
7,6
7,6
0,6
0,6
-0,4
-3,7
1,2
2,7
1,9
Le climat des affaires s’est vivement dégradé en
octobre. Dans tous les secteurs, le solde des opinions
des chefs d’entreprise a fortement reculé, qu’il s’agisse
des opinions sur l’activité récente, sur le niveau des
carnets de commandes ou sur l’évolution de la
demande. Les industriels ont réduit de deux points
leurs perspectives d’investissement. La hausse prévue
est ainsi ramenée à +6 % en valeur dans l’industrie
manufacturière comme dans l’ensemble de l’industrie.
L’annonce d’une exemption de la taxe professionnelle
sur les nouveaux investissements réalisés d’ici au 31
décembre 2009 ne permettra probablement que de
freiner le recul de l’investissement productif qui se
dessine.
2008200720062005200420032002
106
104
102
100
98
96
P R O D U C T I O N I N D U S T R I E L L E
C V S 2 0 0 0 = 1 0 0
H o r s B T P
Ce ralentissement de l’activité est confirmé par l’indice
de la production industrielle qui a diminué de 0,5 % en
septembre par rapport à août, un recul de 0,7 % au
troisième trimestre et de 1,6 % au deuxième. La
dégradation de la demande extérieure nette en
septembre explique le recul de la production
industrielle. Le déficit commercial a inscrit un nouveau
record à près de 75 milliards d’euros en rythme annuel
pour s’approcher des 4 % du PIB, près d’un point de
plus que le record antérieur de l’été 1982.
Dans le commerce de détail spécialisé, les intentions de
commandes sont aussi en forte diminution. La baisse
rejoint celle du solde des opinions des chefs
d’entreprise dans le secteur des services aux
particuliers qui dénote à la fois une dégradation de
l’activité passée et une détérioration de celle à venir.
Aussi les dépenses de consommation des ménages, et
notamment les achats de produits manufacturés qui ont
augmenté de 2,4 % l’an au troisième trimestre, ont
reculé de 0,4 % en octobre et pourraient encore fléchir
du fait de la rapide dégradation des opinions des
commerçants de détail. Les immatriculations de
voitures ont déjà fortement corrigé à la baisse et se
replient de 16 % l’an sur les trois derniers mois connus
en octobre par rapport aux trois mois précédents.
Les ménages, pessimistes sur l’évolution de leur niveau
de vie, estiment qu’ils ont de moins en moins la
capacité d’épargner ou d’effectuer des achats
importants. L’indicateur est tombé depuis l’été à son
plus faible niveau jamais observé.
2008200720062005200420032002200120001999
40
20
0
-20
-40
-60
O P P O R T U N I T E D' E P A R G N E R E T D' A C H E T E R
O p p o r t u n i t é d' é p a r g n e r
O p p o r t u n i t é d' e f f e c t u e r
d e s a c h a t s i m p o r t a n t s
Cette observation s’effectue sur fond de stagnation du
pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages
au premier semestre, malgré une augmentation de
l’indice du salaire mensuel de base de 4 % l’an au
deuxième trimestre. Au troisième trimestre, l’avance
du salaire horaire a ralenti à 1,6 % l’an.
La dérive des prix à la consommation est passée par un
point haut. Le glissement annuel a ralenti à 2,7 % en
octobre, après un pic à 3,6 % en juin et juillet. Dans ce
contexte, la baisse du chômage s’est interrompue au
printemps dernier. Au troisième trimestre, les effectifs
salariés du secteur marchand ont reculé de 10 800 après
une destruction de 28 800 postes au trimestre
précédent. Cette diminution s’explique en grande partie
par la baisse des effectifs dans l’intérim. Le taux de
chômage, calculé par l’INSEE, est estimé à 7,4 % en
fin d’année contre 7,2 % au second trimestre.
L’annonce de mesures de soutien au secteur de la
construction neuve en octobre permettra probablement
de freiner la correction baissière de l’activité qui est en
cours sans pour autant l’empêcher.

- 4 - Conjoncture n° 219 – Novembre 2008
Changes
Sur les marchés de changes, la volatilité sur les
devises est extrême sur les parités euro/dollar,
yen/dollar, ou livre/dollar. La baisse de l’euro contre le
dollar se poursuit, passant de 1,60 à 1,25 dollar en
l’espace de six mois.
NOVOCTSEPAU GJULJUNMAYAPRMARFEBJANDECNOV 20082007
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
P A R I T E E U R O - D O L L A R
1 € = ... $
La dépréciation, alors que la devise européenne se situe
encore bien au-dessus de sa PPA (1,17 dollar sur les
prix du PIB) n’est pas anormale, étant donné que la
balance commerciale de la zone euro a consolidé en
septembre un déficit d’environ 75 milliards d’euros en
rythme annuel.
Au Japon, le yen s’est apprécié vis-à-vis du dollar,
passant un moment sous la barre des 91 yens pour un
dollar, près de ses records de 1995, avant de se
stabiliser vers les 95 yens. L’euro a aussi cédé face au
yen, à 119,9 yens (le 20 novembre). L’excédent
courant pléthorique, alors que la facture à l’importation
de produits énergétiques se replie, justifie un yen fort
qui renforce les pressions déflationnistes et accentue le
risque récessif.
En Europe, la livre sterling est tombée à un plancher
historique face à l’euro (0,842 livre le 20 novembre) et
à un point bas de six ans face au dollar (1,48 dollar). La
Banque d’Angleterre envisage une forte baisse de ses
taux directeurs.
NOVOCTSEPAUGJULJUNMAYAPRMARFEBJANDECNOV 20082007
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
M A R C H E D E S C H A N G E S
1 e u r o = ...£
1 l i v r e = ...$
L i v r e D o l l a r
Les monnaies des pays émergents sont également
secouées. Si tous les pays d’Asie émergente subissent
les conséquences de la crise financière, la Corée doit
faire face aux difficultés propres de son économie
depuis la crise de 1997.
NOVOCTSEPAU GJULJUNMAYAPRMARFEBJANDECNOV 20082007
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
C O U R S D U W O N
1 $ = . . . won
Le won coréen s’est déprécié en octobre de 45 % par
rapport à sa valeur en dollar d’un an auparavant et de
186 % en taux annualisé par rapport aux trois mois
précédents. Seul le yuan continue de s’apprécier en
termes de taux de change effectif.
Les devises latino - américaines se sont également
fortement dépréciées par rapport au dollar. Seul le peso
argentin a perdu à peine plus de 10 %, la Banque
centrale intervenant massivement pour éviter une
attaque spéculative.
Taux d’intérêt %
L’Europe a procédé à une baisse massive de ses taux
d’intérêt le 6 novembre dernier. La surprise est venue
de la Banque d’Angleterre (BoE) qui a annoncé une
diminution de 150 points de base, ramenant son taux
directeur à 3 % dans l’espoir d’enrayer les effets de la
crise économique. Une baisse d’une telle ampleur
n’avait pas eu lieu depuis 1981, alors que le Royaume-
Uni était plongé dans une grave récession. Comme
attendu, la Banque centrale européenne (BCE), pour la
deuxième fois en un mois, a réduit ses taux de 50
points de base, le taux refi tombant à 3,25 %. La
Banque nationale Suisse (BNS) n’a pas attendu sa
réunion de décembre, baissant également de 50 points
de base son taux à 2 %, puis de nouveau de 100 points
de base, contre toute attente le 20 novembre dernier.
Ces décisions ont amené le Danemark et la République
thèque à suivre le mouvement et à diminuer leurs taux
respectivement à 5 % et à 2,75 %.
200820072006200520042003200220012000
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
T A U X D I R E C T E U R S
E n %
B C E
F E D
B o E
B o J
De son côté, la Réserve fédérale américaine (FED)
avait procédé le 30 octobre dernier à une baisse de son
principal taux directeur de 50 points de base, désormais
à 1 % le niveau le plus bas depuis juin 2004.

Conjoncture n° 219 – Novembre 2008 - 5 -
La Banque centrale japonaise, contrainte à la détente,
avait aussi abaissé le 31 octobre de 0,5 à 0,3 % son
principal taux directeur. La Chine a abaissé de nouveau
ses taux d’intérêt ainsi que l’Inde.
En Europe, seul le Danemark a relevé le 24 octobre ses
taux pour soutenir la couronne affaiblie par la crise
financière.
Les marchés interbancaires ont apprécié ces décisions.
L’euro euro à trois mois est tombé à 4,2 %, l’euro
sterling à 4,0 %, passant sous l’euro euro, et l’euro
franc suisse à 2,3 %. Simultanément, l’euro dollar s’est
stabilisé à 3 %. L’euro yen est stabilisé à 1,1 %.
Néanmoins, les « spreads » entre taux de marché à trois
mois et taux directeurs des banques centrales
demeurent dans tous les pays anormalement élevés.
Outre la baisse des taux, la BCE a, comme la Réserve
fédérale, profondément modifié ses instruments de la
politique monétaire pour accroître le volume des
liquidités et diminuer le coût du refinancement sur les
marchés interbancaires.
Sur le marché des emprunts d’Etat, les taux à moyen et
long terme ont reflué de chaque côté de la Manche et
en Suisse. Le taux européen à dix ans est passé sous la
ligne des 4 % ainsi que le taux britannique, le taux
suisse a baissé à 2,1%. Les taux américains restent tirés
vers le bas (2,99 % le 20 novembre) et les japonais
restent rivés sur la ligne des 1,5 %. La dégradation du
climat économique continue d’avantager les
obligations. Le taux allemand sans risque à dix ans, qui
n’était plus d’un niveau différent du taux homologue
américain, accentue de nouveau son écart.
DECOCTAU GJUNAPRFEBDECOCTAU GJUN 20082007
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
O B L I G A T I O N S D' E T A T A 1 0 A N S
E t a t s - U n i s - A l l e m a g n eE c a r t d e t a u x
Cependant, la baisse des taux sans risque ne profite
toujours pas aux obligations émises par les sociétés.
JANOCTJULAPRJANOCTJULAPRJANOCTJULAPRJAN 200
9
200820072006
13
12
11
10
9
8
7
6
5
E T A T S - U N I S
R e n d e m e n t d e s o b l i g a t i o n s à 1 0 a n s
E n %
I n d u s t r i a l B B+
I n d u s t r i a l B B B
Les taux des obligations BBB ou BB+ aux Etats-Unis à
cinq ans ou dix ans sont au plus haut. La menace sur
l’investissement des entreprises continue de se faire de
plus en plus lourde.
Les marchés boursiers
Sur les marchés boursiers, la volatilité demeure forte
comme demeure vive l’aversion au risque. Les
décisions de baisse des taux directeurs ou le plan de
relance chinois n’ont pas bénéficié aux marchés
d’actions. Le sommet du G20 n’est pas parvenu à
rassurer les places boursières. Les craintes de
récession, le désordre sur les marchés de change et le
durcissement des conditions de crédit désorientent les
investisseurs. L’indice agrégé en dollar des 39 places
est passé sous la ligne des 90 (base 100 au 1er janvier
2002). Il se trouve divisé par deux par rapport à son
niveau record inscrit à la fin du mois d’octobre 2007.
JANOCTJULAPRJANOCTJULAPRJANOCTJULAPRJAN 200
9
200820072006
200
180
160
140
120
100
80
I N D I C E B O U R S I E R M O N D I A L
3 9 P L A C E S e n $ ( 1 0 0 = 2 0 0 2)
La capitalisation boursière mondiale en expression
dollar représentait près de 119 % du PIB mondial à
l’été 2007. Un an plus tard, l’estimation est de moins
de 75 % et si les marchés d’actions se stabilisent à leur
niveau moyen de novembre, la capitalisation boursière
ne représenterait plus que 53 % du PIB mondial. La
volatilité des marchés boursiers surprend cependant par
sa brutalité, résultant probablement d’un excès de
pessimisme parfois irrationnel. Wall-Street, qui
continue de donner le ton à l’ensemble des places
boursières, évolue sous les 8000 points. A Tokyo, le
nikkei a perdu 50 % par rapport à sa moyenne de 2007.
En Europe, l’Euro Stoxx 50 accentue son repli à 2226
points (le 20 novembre) contre 4400 points en début
d’année. A Paris, l’indice CAC 40 est passé sous les
3 000 points.
NOVOCTSEPAU GJULJUNMAYAPRMARFEBJANDECNOV 20082007
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
B O U R S E D E P A R I S
( C A C 4 0 - 3 1. 1 2. 1 9 8 7 = 1 0 0 0 )
Les marchés émergents sont également victimes de
l’aversion au risque même s’ils ne baissent pas tous au
même rythme. Le marché russe a subi l’une des plus
sévères corrections. Le RTS a perdu plus de 70 % de sa
valeur entre le point haut du mois de mai et le mois
d’octobre. Cependant les premiers signaux de tensions
sont apparus bien avant le mois de septembre du fait du
conflit en Géorgie.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%