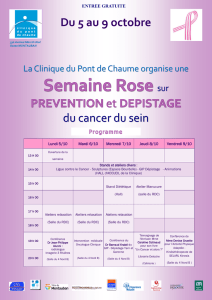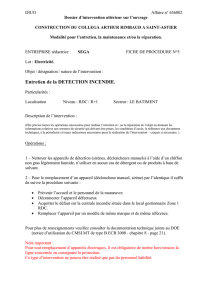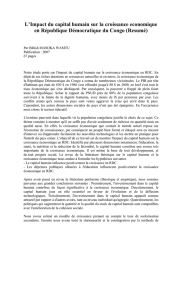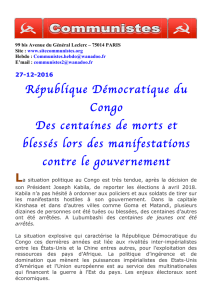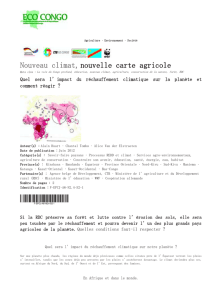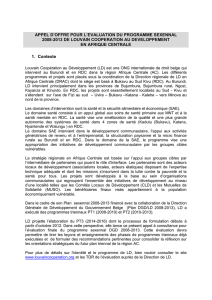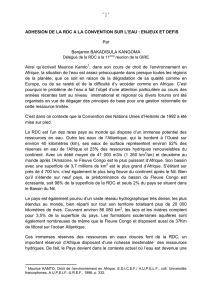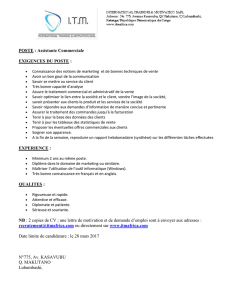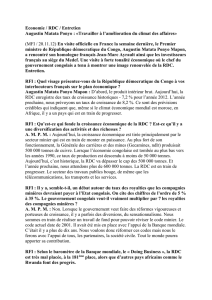Colloque international

1"
"
Colloque international
Les économies émergentes dans un monde polycentrique globalisé.
Perspectives sur les atouts et les vulnérabilités de la RDC à l’horizon 2030
Résumé
Organisé sur une base interdisciplinaire, ce colloque est centré sur les approches théoriques
des puissances émergentes et des analyses empiriques appliquées à la RDC. En privilégiant
les approches interdisciplinaires, comparatives, prospectives, géo-économiques, stratégiques
et socio-culturelles, il se veut l’occasion d’une réflexion scientifique sur la trajectoire, les
ressorts et les potentialités, les atouts et la vulnérabilité de la RDC, considérée à la fois
comme un pays en « émergence » et un champ privilégié des pays émergents.
Argumentaire
La fin de la guerre froide a entraîné des ruptures historiques sur les équilibres géo-
politiques, économiques et culturels du monde considéré jusqu’alors comme bipolaire. Dès
lors, les relations internationales ne sont plus pensées sous un prisme binaire au niveau
politique (Est/Ouest), économique (Nord/Sud), culturel (Orient/Occident) ou idéologique
(capitaliste/communiste). Le décloisonnement géopolitique subséquent à la dynamique post-
bipolaire s’accompagne de l’ébranlement des piliers de la civilisation moderne (Jean Claude
Guillebaud), du dépassement de l’économie zombie (J. Quiggin), de l’accentuation des limites
du libéralisme de marché comme vision du monde et mode de gouvernance, et des appels de
divers penseurs pour une économie porteuse des idées de révolution convivialiste et de
civilisation de l’altruisme (Matthieu Ricard, Jacques Attali, René Passet, Joseph Stiglitz,
Enrique Dussel, Tshiunza Mbiye et Laurent Sebisogo). Il voit émerger des puissances
économiques nouvelles et des nouveaux acteurs aux prétentions géostratégiques se déployant
à l’échelle globale. Cette situation inédite entraîne plusieurs discontinuités.
La première est la transformation de la configuration des pouvoirs dans un monde
globalisé, que Samir Amin qualifie de « monde polycentrique »1. Ce monde sonne le glas de
l’ère des puissances euro-américaines. Les positions de celles-ci, notamment leur monopole
dans plusieurs champs pertinents de la vie internationale sont progressivement concurrencées
par les « gagnants » de la mondialisation. Issus des continents, autres que l’Europe et le nord
de l’Amérique, ces derniers sont de nos jours de plus en plus nombreux. Cette diversification
des États accédant au rang d’économies de forte croissance augure des perspectives qui
permettent de revisiter la pertinence discursive de certaines théories comme celle de la
dépendance, du développement économique, du développement durable ou du développement
inégal.
La deuxième discontinuité procède de la dévalorisation de « l’échiquier
diplomatico-stratégique » (Raymond Aron), -la dimension militaire ne prévalant pas dans les
interactions internationales, et de la prédominance de la compétitivité, de la créativité et des
innovation des entreprises au sein des Etats. Ce dernier point donne sa valeur à « l’État
commerçant » (« Trading State »), selon les termes de Richard Rosecrance. La notion de la
puissance structurelle (Susan Strange) tient compte de ce déplacement du contenu et de la
substance de la puissance à l’ère globale.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2"
"
Depuis la disparition du clivage Est/Ouest, sur le plan discursif, un
consensus domine les multiples tendances à l’œuvre dans les relations internationales
contemporaines : la montée en force de nouveaux acteurs étatiques issus pour la plupart du
Sud et qui font figure de « gagnants » de la mondialisation. L’expression « puissance
émergente » qui s’est imposée dans le langage courant est couramment usitée pour les
qualifier. Outre l’expression usuelle « puissance émergente », l’inventivité lexicale en cette
matière recourt aux termes « marché émergent » ou « nouveau pays industrialisé ». Les pays
émergents d’Asie ont tour à tour été appelés « dragons d’Asie » ou « tigres d’Asie » (Corée
du Sud, Hong-Kong, Singapour et Taïwan), « bébés tigres » (Malaisie, Indonésie, Thaïlande,
Philippines et Vietnam). Ceux d’Amérique latine ont été dénommés « jaguars américains »
(Mexique, Chili, Colombie). L’acronyme BRICS désigne, quant à elle, le Brésil, la Russie,
l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Certains auteurs parlent de « tigres politiques » ou de
« lions financiers » à propos de pays émergents africains (Nigéria, Botswana, Ghana, Côte
d’Ivoire, Rwanda).
Si en 2012, Sebastian Santander pouvait affirmer qu’« en dépit de son succès
médiatique, la notion d’émergence se démarque par un certain flou au contenu élastique. À
défaut d’apporter une définition précise au concept, celle-ci recouvre une réalité particulière,
celle de la diffusion du pouvoir mondial et, partant, d’une remise en cause progressive du
monopole de la puissance conservée depuis cinq siècles par le monde occidental »2, il y a lieu
de soutenir qu’à ce jour, le débat a beaucoup évolué. Ce n’est pas tant le contenu élastique qui
pose problème que la diversité des émergents qui est intéressante à comprendre. La notion
d’émergence convoque une diversité des pays marquée par la variété et une certaine disparité.
Ces diversité, variété et disparité sont adossées à des trajectoires différentes, mais qui
convergent toutes vers la dynamique de la montée en puissance de ces pays. Le
questionnement théorique sur la notion d’émergence suggère deux champs de préoccupations
au colloque. Le premier champ est un travail de déconstruction du concept d’émergence
économique des États pour, d’abord, en comprendre la nature et la substance, et ensuite, en
analyser les implications en relations internationales. Le deuxième champ est une analyse des
récits d’expérience de l’émergence de certains pays. La relation de ces récits peut ouvrir des
fenêtres aux débats susceptibles de baliser des perspectives suggestives pour une prospective
appliquée à la RDC.
L’application des sciences sociales à la RDC, rend le colloque attentif aux enjeux
d’un monde globalisé, multipolaire, polycentrique et postcolonial. En lançant en 2011 le
programme de la modernisation du pays, les dirigeants de la RDC inscrivaient son émergence
à l’horizon 2030. Noble ambition qui remémore « l’objectif 80 » promu autour des années 70
par le Président J.-D. Mobutu. La détermination de faire du Zaïre de l’époque une puissance
économique trouve un écho chez le Président J. Kabila. Celui-ci en effet, s’assigne comme
objectif de faire du Congo la Chine de demain, de transformer la société, non pas avec des
changements cosmétiques, mais par des bouleversements en profondeur.
La Faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l’Université de
Lubumbashi veut participer à ce projet de transformation de la société congolaise en évaluant
ses acquis et ses avancées, ses succès et ses échecs. Elle en précise les paramètres
d’évaluation (émergence de la classe moyenne, développement des ressources agricoles et
énergétiques, démocratisation de l’État, croissance du PIB et de l’investissement,
libéralisation des échanges, accueil des capitaux étrangers, protection sociale, investissement
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3"
"
dans le social, industrialisation et urbanisation, amélioration des conditions de vie…), et
propose les linéaments d’une prospective à l’horizon 2030. Cette perspective oriente les
travaux du colloque vers deux directions : la RDC comme pays en « émergence » et les leçons
que nous pouvons retenir des expériences de succès d’émergence des autres pays.
Le colloque privilégie les approches interdisciplinaires, comparatives,
prospectives, géo-économiques, stratégiques et socio-culturelles. Les perspectives théoriques
sont encouragées ainsi que des analyse orientées vers l’action (policy-oriented analysis). En
insistant sur l’émergence économique, nous souhaitons que des communications qui s’y
rapportent, analysent les ressorts de ce phénomène à partir, d’une part, de l’examen socio-
économique et stratégique de la situation de la RDC, et d’autre part, à partir de l’étude des
relations diplomatiques, économiques, commerciales, universitaires, militaires, et de la
coopération au développement entre la RDC et les pays émergents.
Axes thématiques
Les thématiques à considérer pour la soumission des communications s’articulent autour
de trois axes :
1- Approche théorique sur les concepts porteurs.
2- La RDC, un pays en « émergence » : enjeux et perspectives.
3- La RDC comme partenaire des puissances émergentes
Axe 1 : Approche théorique sur les concepts porteurs
Cet axe s’intéresse aux concepts porteurs du colloque notamment ceux de pays émergents,
développement (développement économique, développement durable, développement inégal,
développement holistique), gouvernance responsable, dépendance, monde multipolaire,
monde polycentrique. Il cherche en outre à préciser les contours de la notion de pays
émergent et à vérifier sa consistance épistémologique. Se cantonne-t-elle aux considérations
purement économiques ou requiert-il une approche holiste ? L’attention sera aussi portée aux
nuances apportées par les facteurs politique, militaire, diplomatique ou identitaire à
l’intelligence de ladite notion. Il serait aussi suggestif de thématiser le rapport entre
l’émergence et les notions de dépendance et d’autonomie.
Axe 2 : La RDC, un pays en « émergence » : enjeux et perspectives
Cet axe privilégie un travail d’historicisation qui éclaire le contexte historico-politique et
idéologique des efforts consentis par l’État congolais en vue de l’émergence de la RDC. Il
s’intéresse à ses progrès économiques, commerciaux et militaires. Il rend compte de ses
rapports avec les institutions financières internationales, de sa planification, de ses cadres
logiques et de ses stratégies, de l’évolution de son enseignement universitaire et de son
approche de la coopération au développement, de sa politique étrangère ainsi que de sa
diplomatie. L’enjeu est d’établir l’apport spécifique de ces différents secteurs à l’émergence
de la RDC. Un des apports non négligeables de cet axe est de préciser les paramètres
d’évaluation d’un pays émergent au sud du Sahara (gouvernance responsable, émergence de
la classe moyenne, développement des ressources agricoles et énergétiques, démocratisation

4"
"
de l’État, croissance du PIB et de l’investissement, libéralisation des échanges, accueil des
capitaux étrangers, protection sociale, investissement dans le social, stratégies de lutte contre
la pauvreté, industrialisation et urbanisation, amélioration des conditions de vie, moralisation
de la vie publique…), et de proposer, enfin, les linéaments d’une prospective applicable à la
RDC à l’horizon 2030.
Axe 3 : La RDC comme partenaire des puissances émergentes
L’Afrique est, pour reprendre Sebastian Sandanter3, un nouveau terrain de jeu des émergents.
Le jeu a de multiples enjeux pour la RDC qui demeure un des champs privilégiés des pays
émergents. Il importe dès lors de définir ces enjeux (politiques, économiques, commerciales,
stratégiques, éthiques…) ainsi que les stratégies des différents protagonistes du jeu des
émergents. Cet axe s’y attèle en proposant des études de cas (Chine, Brésil, Inde, Turquie,
Afrique du Sud, Turquie, pays du Maghreb, etc.) qui précisent l’impact des économies
émergentes et leurs implications sur le système international. Ces études dégagent les
conséquences empiriques de la relation entre la RDC et les pays émergents à l’horizon 2030.
La compréhension des logiques politiques, économiques et culturelles des puissances
émergentes agite la question des stratégies de la RDC. Inscrivent-elles la RDC dans la voie
d’autonomie ou d’une nouvelle dépendance ? Réécrivent-elles l’histoire de la RDC avec les
puissances occidentales ou ouvrent-elles des nouvelles avenues propices à son émergence?
L’on s’interrogera aussi sur les convergences et divergences/affrontements entre les
puissances traditionnelles et les puissances émergentes. Une approche comparative sur les
facilités accordées à la mobilité des élites, sur les secteurs d’investissements privilégiés
(transport, télécom, aménagement, gestion des eaux et électricités, infrastructures…) et sur les
innovations technologiques soutenues par les deux puissances est attendue.
Modalités de soumission de proposition de communication
Les propositions de communication (un résumé ne dépassant pas 500 mots) sont à
envoyer conjointement, accompagnées des coordonnées et de l’affiliation institutionnelle au
auteurs sélectionnés seront notifiés le 20 janvier 2016. Les textes à présenter devront être
envoyés avant le 10 mars 2016. Les informations sur des hôtels à Lubumbashi seront
communiquées au début du mois de janvier 2016. Les frais d’enregistrement et de
confirmation de la participation sont fixés à 60 USD. Leurs modalités de paiement seront
communiquées en janvier 2016.
Conseil scientifique
Germain Ngoie Tshibambe Germain - Université de Lubumbashi
Numbi Kanyepa - Université de Lubumbashi
Mulumbeni Munyenga - Université de Lubumbashi ;
Nkuku Khonde César- Université de Lubumbashi
Tshiyembe Muahila- Universités de Paris XII, de Kisangani et de Lubumbashi
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

5"
"
Ignace Ndongala Maduku - Université de Montréal
Comité d’organisation
- Germain Ngoie Tshibambe - Université de Lubumbashi
- Nkuku Khonde – Université de Lubumbashi
- Kakez Kayeb – Université de Lubumbashi
- Roger Fumbisha –Radio Télévision Mwangaza
Catégories
Sociologie, sciences politiques, économie, droit, histoire, anthropologie, éthique
Lieu
Faculté des Sciences sociales, politiques et administratives, Université de Lubumbashi,
Lubumbashi (R.D.C)
Date
23-25 mars 2016
Mots-clés
Pays émergents, développement, autonomie, stratégie
Contacts
Mulumbeni Munyenga: [email protected]
URLS de Référence
Source de l’information
Ngoie Tshibambe : [email protected]
Pour citer cette annonce
1
/
5
100%