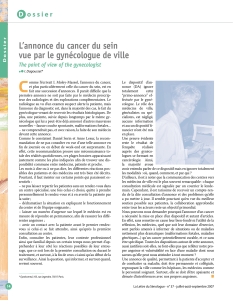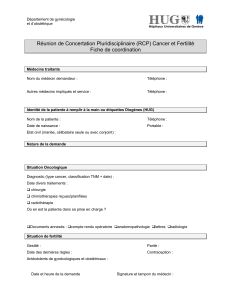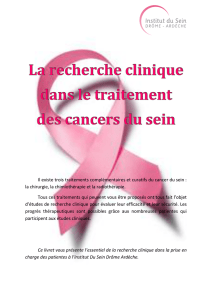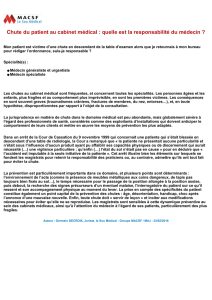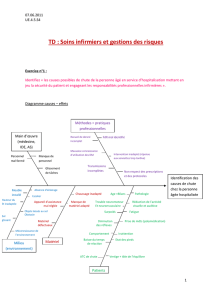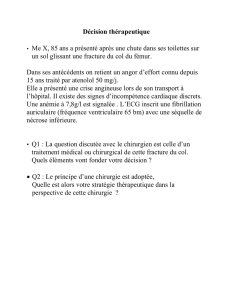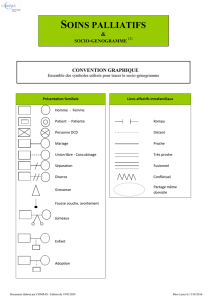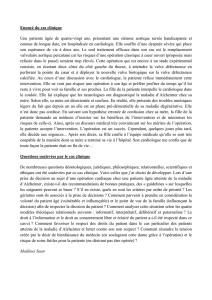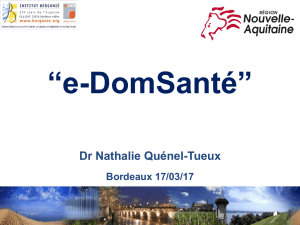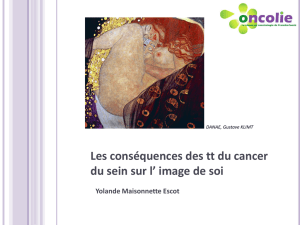Les Nouvelles d`Europa Donna

2 La démocratie
sanitaire, des textes
à la pratique
2 Regards croisés
du psychologue et
de l’oncologue
3 Propos de radiologue
4 Propos d’oncologue
5 Propos de généticien
6 Regards croisés
du psychologue et
de l’oncologue
7 Propos sur
les récidives et
les métastases
8 Propos sur
la mastectomie et
la reconstruction
9 Propos sur
la sexualité
9 La Coalition à Paris
10 Octobre rose
12 Informations
importantes
Sommaire
Coalition Européenne
contre le cancer du sein
La démocratie sanitaire fait une place signicative aux
associations de patients.
Il faut s’en féliciter car il n’est pas rare qu’elles soient celles
qui lèvent les freins lorsqu’il s’agit de passer de l’intention
ou de la bonne action à la décision politique.
Ce sont elles, aussi, qui rappellent la nécessité d’enrichir la prouesse médicale de l’apport
des sciences humaines, de considérer la personne autour du malade.
Le 17e Colloque annuel d’Europa Donna, qui s’est inscrit dans cette démarche, a ainsi abordé
des questions essentielles, déjà reconnues comme telles ou qui s’imposeront rapidement.
La reconstruction mammaire et la sexualité font partie intégrante du processus de guérison
sociétale et affective. Il est pertinent d’envisager une prise en charge intégrative de l’en-
semble de la reconstruction d’un individu au cours de son parcours de soin. Il ne faut pas,
notamment, abdiquer face au problème que pose le nancement de la reconstruction, dont le
coût est souvent critiqué alors même celui de traitements nettement plus onéreux ne suscite
aucune hésitation.
Le progrès va amener des discussions, complexes et même compliquées, sur l’allocation des
ressources disponibles. On réalise aujourd’hui certaines dépenses dont l’utilité, en termes de
bénéce pour le patient, n’est pas certaine alors que, demain, on pourrait ne pas en faire
d’autres dont le bénéce est avéré. Il faudra rendre des arbitrages, appuyés sur la bonne
indication et le bon usage de l’outil de soin. Il faudra sortir du dogmatisme et trouver des solu-
tions dans un nouveau contrat social.
Il est heureux que l’on parle aujourd’hui de maladie chronique lorsque l’on parle de cancer.
Mais la chronicité suggère une linéarité, qui caractérise le diabète ou d’autres affections,
mais pas le cancer, maladie à rechutes, maladie à étapes. Il faudra rééchir à la terminologie,
parce que des nouveaux termes amèneront à penser de nouveaux modes de prise en charge,
de traitement, de rémunération, adaptés aux évolutions.
Grégoire Moutel
Les Nouvelles d’Europa Donna
Bulletin de l’Association Europa Donna Forum France
Ensemble contre le cancer du sein N°29 - Février 2016
Avec le patronage du Ministère de la Santé et le soutien de la Ligue nationale contre le cancer et de l’Institut National du Cancer
Edito
Crédit photos : Sandra Chiche

2
17e Colloque annuel : Le cancer du sein sans tabou Tout dire, tout savoir ?
Natacha Espié et Marc Espié
Il est impossible de séparer « Tout dire, tout
savoir, tout demander, tout entendre », puisque
ces quatre propositions vont se rejouer tout au
long du parcours de la patiente dans un enchevê-
trement complexe. Que va dire le médecin, que
saura la patiente ? Que dira la patiente, que
saura le médecin? Que va entendre le médecin
des demandes de la patiente ? Que pourra
entendre la patiente?
C’est la même histoire, qui débute par le colloque
singulier médecin – patiente, pierre angulaire de
toute pratique médicale.
La consultation est une œuvre singulière qui
n’appartient qu’à ce duo que forment la femme
et le médecin.
La prise en charge psychologique des patientes
par leur médecin est indispensable. Elle est le
plus souvent intuitive et nécessite que le médecin
soit intéressé par l’autre et qu’il ait envie de l’en-
tendre. Il s’agit, bien sûr, de cela dans ce col-
loque singulier: trouver une parole commune.
Angoissant dépistage
Si l’on associe un mot au dépistage, qu’il soit
organisé ou individuel, c’est « angoisse ». Il
revient tout au long du parcours qui mènera au
diagnostic. C’est le sentiment d’un danger immi-
nent auquel on pense ne pas pouvoir échapper.
Cette peur a un ancrage dans la réalité relayé
dans le psychisme par tout ce que le cancer
évoque fantasmatiquement. C’est un signal qui
témoigne de la difculté d’un sujet face à une
situation qu’il ne se sent pas capable d’affronter,
signal désagréable mais adapté. L’angoisse est,
ainsi, un moyen qui permet de s’ajuster à la
menace. Son côté adaptatif peut se révéler pro-
tecteur. L’angoisse ne devient un symptôme que
lorsqu’elle est répétitive, que lorsqu’elle est
excessive.
Dès la première alerte, la patiente est prise dans
un engrenage dont la seule libération est le dia-
gnostic, « oui » ou « non », et tout ce qui en
dépend.
Violente annonce
L’annonce du diagnostic va venir conrmer et
renforcer les inquiétudes apparues lors de la
découverte de la tumeur. « La vie bascule »,
disent les patientes.
Si l’on évoque l’annonce, c’est le mot «violence»
qui revient le plus souvent. Nicole Alby nous le
dit : « l’annonce du diagnostic est un bon
exemple de ces situations où le médecin doit dire
ce qu’il n’a pas envie de dire à une femme qui
n’a pas envie de l’entendre.»
Il n’existe pas de bonnes façons d’annoncer un
cancer, mais il en existe de moins mauvaises.
C’est toute la difculté et la richesse de l’an-
nonce. Chaque patiente est, bien évidemment,
différente, mais chaque médecin et chaque
moment d’annonce le sont également.
L’annonce d’un cancer est loin d’être une simple
transmission d’information, et, avant de dire, il
serait certainement important d’écouter ce que
sait la patiente, ce qu’elle souhaite savoir. Bien
évidemment, il faut rester dans le registre de la
vérité, mais s’ajuster au rythme de la patiente.
Cela contraint le médecin à s’adapter aux diffé-
rents types de réactions des patientes, ce qui fait
de la consultation une relation à la fois unique et
imprévisible, mais c’est ici et maintenant que se
construira la relation de conance avec son
médecin.
L’annonce, c’est celle de la maladie, mais aussi
celle du plan d’action, des mesures de guerre
pour endiguer ce cancer.
C’est souvent après la chirurgie que les méde-
cins ont toutes les cartes en mains, et peuvent
annoncer le résultat anatomopathologique, l’ex-
pliquer et parler des propositions thérapeutiques.
Leur rôle est aussi de faire accepter aux patientes
une réalité insupportable et des traitements inac-
ceptables, de les accompagner, non seulement
pour des raisons d’humanité, mais aussi pour
leur offrir les meilleures chances de guérison.
L’accompagnement fait partie intégrante de la
fonction médicale. Il est une des conditions du
traitement. Pour Nicole Alby, il s’agit d’un «pacte
de non-abandon».
La démocratie sanitaire – dénie par le diction-
naire comme un système participatif où chacun a
droit de vote et appréhendée par les ARS comme
une approche visant à faciliter le dialogue avec
les usagers et les patients – doit être in ne un
espace de dialogue où sera promu le point de
vue des usagers et des patients.
La loi Kouchner de 2002, la loi HPST de 2009 et
la loi de modernisation de notre système de
santé de 2015 en jalonnent la voie. Il reste beau-
coup à faire, mais la démocratie sanitaire avance.
Regards croisés du psychologue et de l’oncologue
La démocratie sanitaire, des textes à la pratique
François Sarkozy

3
17e Colloque annuel : Le cancer du sein sans tabou Tout dire, tout savoir ?
Jean-Yves Seror
Le radiologue est un médecin, qui a prêté le ser-
ment d’Hippocrate et celui du Conseil de l’Ordre
des Médecins qui l’engage à la sincérité envers
ses patients. Il est, aussi , tenu au respect de la
loi et, notamment, de celle du 4 mars 2002 rela-
tive aux droits des patients qui stipule que toute
personne a le droit d’être informée de son état de
santé, par un médecin dans le cadre de ses com-
pétences.
Le radiologue est-il compétent pour faire une
annonce en cancérologie ? Quelle annonce ; la
bonne nouvelle – situation très fréquente, fort
heureusement, et très satisfaisante – ou la mau-
vaise? Quelle mauvaise nouvelle: l’anomalie ou
le cancer?
La première difculté de l’exercice radiologique
est que le radiologue est le premier maillon de la
chaîne diagnostique et n’a, en l’absence d’histo-
logie et quelles que soient les données de
l’image, aucune certitude de son caractère bénin
ou malin. Doit-il exprimer ses doutes, ses incerti-
tudesface à une patiente convaincue qu’il sait ?
Ensuite, ce qui ajoute à la complexité de la pra-
tique, le moment du diagnostic d’imagerie est
aussi celui de l’annonce, le plus souvent d’un
examen normal, mais parfois – une fois sur deux
cent environ – d’une anomalie non prévue, dont
l’annonce n’a pas été anticipée en termes de
temps.
Paroles de patientes
« J’en ai beaucoup voulu au
radiologue de ne pas m’avoir dit
la vérité. »
« L’annonce a été très brutale,
car la radiologue m’a tout de
suite dit qu’il faudrait m’enlever
le sein, pour m’assurer la vie. »
Il n’existe pas de recette. Dire c’est, peut-être,
révéler la vérité pas à pas en essayant de suivre
le rythme des patientes dans leur quête du savoir,
au prix d’erreurs et de tâtonnements, permettre à
la patiente de sortir de la consultation d’annonce
en sachant qu’il y a des solutions et des res-
sources thérapeutiques. Annoncer, c’est égale-
ment l’art de préserver l’espoir, de le faire
perdurer. Aider la patiente à quitter son sentiment
de victime pour trouver une position acceptable
pour elle-même paraît essentiel.
L’écrivain et psychiatre Irving Yalon nous offre
l’exemple d’Eva qui «se donne, un jour, comme
dé de parvenir à humaniser son médecin onco-
logue et à établir une relation plus humaine avec
lui. Cette stratégie donnait un nouveau sens à
ses visites et diminuait son sentiment d’être vic-
time.»
Annonce et annonces
Au quotidien, le radiologue rencontre différentes
situations d’annonce, toutes difciles à gérer:
- dans le cadre du dépistage, soit à une femme
qui a été convoquée et que, généralement, il
ne connaît pas, soit à une femme qui pré-
sente un symptôme. Dire est toujours violent,
mais davantage pour la première que pour la
seconde, déjà préparée à l’éventualité de la
lésion.
- au moment de la biopsie, à une patiente qu’il
connaît pour avoir pratiqué la mammogra-
phie de dépistage ou à une patiente adressée
par un confrère
- avec les résultats de la biopsie et une idée,
prudemment exprimée, de ce qui va pouvoir
lui être proposé
- lors de la récidive, circonstance très difcile,
à une patiente qui sait déjà ce que c’est.
Il peut avoir aussi à exercer dans des contextes
particuliers où la vie et la mort cohabitent : au
cours de la grossesse ou juste après l’accouche-
ment, dans le cadre du parcours de Procréation
Médicalement Assistée, avant la mise en place
de prothèses.
Annonce ou pré-annonce
En pratique, parce que c’est le plus souvent lui
qui les découvre, le radiologue doit annoncer les
anomalies, mais pas le cancer, ne serait-ce que
parce qu’il ne connaît pas toujours ni la patiente
ni l’intégralité du dossier médical, qu’il n’est pas
formé pour le faire et qu’il n’a pas toujours –
à moins d’un niveau d’expertise signicatif –
connaissance des schémas thérapeutiques qui
pourront être proposés. La majorité des radiolo-
gues, « généralistes », doit faire une pré-
annonce, au sens de «préparation à l’annonce»,
en fournissant quelques éléments qui permet-
tront ensuite au médecin traitant, au gynécologue
ou à l’oncologue de faire l’annonce dans des
conditions optimales.
La pré-annonce doit être progressive, pour amor-
tir le choc, sans dissimuler ni la réalité ni la gra-
vité– résultats partiels, analyse complémentaire
des images, absence d’histologie… – et en dire
ni trop ni trop peu. Elle doit être modulable, pour
permettre l’expression de la patiente, insister sur
les éléments positifs, créer l’espoir et éviter les
situations de doute ou de regret («c’était déjà là
il y a 2 ans») ou de culpabilité («vous auriez dû
venir plus tôt»)
L’orientation vers une lière de prise en charge
par une équipe pluridisciplinaire est un élément
rassurant, d’autant que le radiologue saura
donner des réponses qui ne la mettra pas en dif-
culté et l’informer de ce qui a été et pas été dit à
la patiente.
Face à un malentendu qui veut que la force de
l’image vaut diagnostic pour la patiente mais pas
pour le radiologue et au traumatisme violent que
constitue l’annonce du cancer, le radiologue doit
éviter les erreurs, notamment verbales, qui seront
indélébiles, respecter la volonté de la patiente en
termes d’information, favoriser, selon sa person-
nalité et son expertise, l’annonce ou la pré-
annonce, associer sa compétence médico-tech-
nique à une compétence relationnelle et ne pas
avoir peur de ses émotions
Propos de radiologue

4
17e Colloque annuel : Le cancer du sein sans tabou Tout dire, tout savoir ?
Mario Campone (et Pascal Pujol)
Paroles de patientes
« Les films que je pouvais
me faire étaient mille fois plus
angoissants qu’une quelconque
réalité. Tout ce qu’on me dirait
était moins grave que ce que
je pouvais imaginer. »
« Hormis la chute des cheveux,
on ne m’a parlé d’aucun
des eets de la chimiothérapie,
de la radiothérapie ou
du curage axillaire. »
Paroles de patientes
« On est un objet, plus du tout
une femme. On répond à
des questions très techniques,
mais on ne parle pas de
la femme. »
« J’ai été choquée par les mots
utilisés. »
Paroles de patientes
« Quand on est malade, on a une
sensibilité accrue à la personne
humaine qui vous répond.
On sent les réticences,
les peurs, l’envie de noyer
le poisson. Avoir en face un
professionnel qui comprend
l’importance d’une réponse
cohérente et rationnelle, quelle
qu’elle soit, et est prêt à vous
la livrer, cela fait autant de bien
qu’un médicament. »
«Tout dire? Tout savoir?» n’est pas une ques-
tion spécique au cancer. Elle se pose au sein
des couples, des familles …
Mais en oncologie, elle a ceci de spécique que
dire va remettre en cause beaucoup de choses
pour le patient.
L’annonce est à la rencontre de deux histoires:
celle de la patiente – ses antécédents, son rela-
tionnel familial… – et celle du médecin, qu’il faut
faire cohabiter en un laps de temps très court:
alors que chacun s’est construit sur des années,
la consultation dure environ 30 minutes pendant
lesquelles il faudrait tout décoder.
Il n’y a pas de recette pour réussir la consultation
d’annonce.
Au-delà de l’aspect psychologique – à prendre
en charge – et de l’aspect juridique – la loi
impose de tout dire – l’idée clé est d’aider la
patiente à récupérer son autonomie, vis-à-vis de
sa maladie, de sa famille, de son entourage
socio-professionnel. Cela est très complexe et,
malgré les mesures qui favorisent la médecine
personnalisée et intégrative, reste difcile au
quotidien.
Le médecin fait ce qu’il peut.
Propos d’oncologue

5
17e Colloque annuel : Le cancer du sein sans tabou Tout dire, tout savoir ?
Pascal Pujol
Savoir, entendre et dire
Le besoin de savoir, en génétique, interroge l’his-
toire personnelle et familiale: y-a-t-il une cause
à ma maladie, se situe-t-elle dans un cadre fami-
lial, quel est mon risque de second cancer, quel
est le risque pour mes enfants, comment préve-
nir le cancer ?
La motivation des femmes qui consultent en
génétique sont les enfants. Alors qu’elles n’ont
pas envie de savoir, d’entendre qu’elles sont por-
teuses d’une mutation génétique, elles assument
le risque parce qu’elles comprennent des enjeux
importants.
Connaître le risque c’est, aussi, se donner la pos-
sibilité d’agir contre lui.
Le risque est une notion probabiliste ; rien en
génétique du cancer du sein n’est inéluctable et
sa transmission n’est pas systématique.
La femme concernée attend une information per-
sonnalisée, adossée à des conseils de prise en
charge, pour, à son tour, informer ses enfants, sa
famille, aidée du médecin et du psychologue.
Paroles de patiente
« La diculté, lorsqu’on est porteuse d’une mutation, c’est de transmettre
l’information à ses enfants.
Il faut s’approprier la diculté et le risque de la maladie, qui n’est pas
une certitude. »
Du dépistage aux thérapies ciblées
L’information génétique, contenue soit dans tous
les gènes soit dans les gènes de la tumeur, est
aujourd’hui utilisée au- delà du dépistage et de la
prévention : pronostic, réponse thérapeutique,
ciblage thérapeutique… Ainsi, les patientes
atteintes d’un cancer de l’ovaire et porteuses
d’une mutation BRCA1, facteur de meilleur pro-
nostic, reçoivent aujourd’hui un traitement spéci-
que, très actif.
Cette évolution est rendue possible par trois élé-
ments concomitants : le progrès des connais-
sances – comme l’identication récente du gène
PALB2 qui rend compte d’histoires familiales de
cancer du sein jusque-là sans étiquette, désor-
mais inclus dans les tests de prédisposition – les
progrès technologiques – qui permettent
aujourd’hui le séquençage du génome en 24h et
pour 1000€, contre 15 ans et 3 milliards € pour
le premier séquençage il y a 30 ans – et l’émer-
gence des thérapies ciblées.
On attend beaucoup de la génomique pour
répondre à la question cruciale de l’utilité et de la
pertinence de la chimiothérapie.
On dispose aujourd’hui de nombreux tests d’uti-
lité médicale reconnue – tests familiaux, théra-
pies ciblées, signatures… – qui rendent
nécessaire d’augmenter l’offre de soins – pla-
teaux techniques, accès aux tests et aux consul-
tations spécialisées, prise en charge…
Il faut aussi garder en tête que toute avancée
médicale, surtout dans des domaines aussi sen-
sibles que la génétique, doit s’accompagner
d’une réexion éthique.
Et le généticien doit être un médecin comme les
autres, à l’écoute de la personne, en mesure de
répondre à son besoin et son envie de savoir ,
dire et faire comprendre ce qu’elle veut bien
entendre.
Propos de généticien
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%