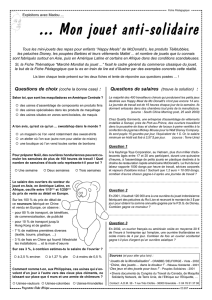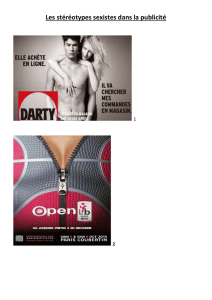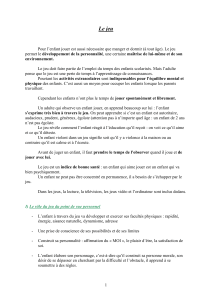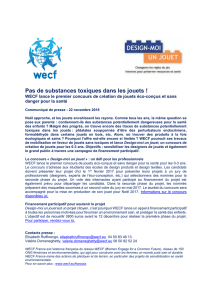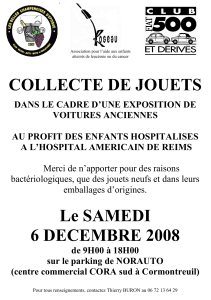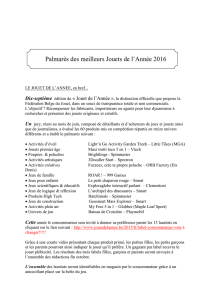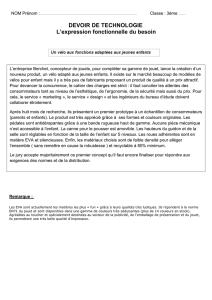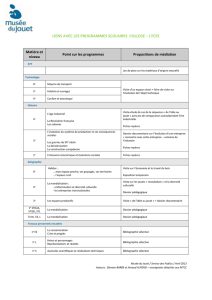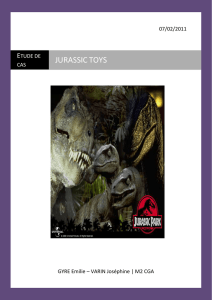Le jeu vidéo, entre jouet et produit audiovisuel : de la

Le jeu vidéo, entre jouet et produit audiovisuel : de la perception de l'objet
vidéoludique par les réseaux de distribution français (1974-1987).
La réflexion ici engagée accompagne les recherches que nous menons, dans le cadre de notre thèse
d’École des Chartes, sur la distribution du jeu vidéo en France, dans les décennies 1970-1980. Nous
nous intéressons en particulier au rôle actif des sociétés de distribution, grossistes comme
revendeurs, dans la conception du jeu vidéo, à la manière dont elles peuvent influer sur la
fabrication du jeu, sous sa forme physique comme logicielle - le postulat de base de nos recherches
étant de démontrer que les sociétés de distribution sont davantage que de simples passeurs du jeu
vidéo entre l'éditeur et le consommateur. Le projet est également de développer une histoire
alternative du jeu vidéo en France, histoire lue non plus du côté des développeurs et des éditeurs,
mais du côté des distributeurs et des commerçants.
Nos recherches s'appuient sur une grande disparité de sources, du fait du manque d'archives
classiques sur le jeu vidéo en France : à l'exception des archives de Bertrand Brocard, déposées à la
cinémathèque de Dijon, et de celles d'Édiciel, la société de logiciels d'Hachette, déposées à l'IMEC,
la grande majorité des acteurs de l'époque ont détruit ou perdu leurs archives. Nous avons travaillé
principalement à l'aide de la presse non seulement vidéoludique, avec Tilt, mais également touchant,
de près ou de loin, au jeu vidéo : presse informatique avec L'ordinateur individuel et Hebdogiciel, et
presse dédiée au jeu de manière générale avec Jeux et Stratégie et Jeux et Jouets. Plusieurs
interviews ont par ailleurs été réalisées avec des éditeurs de l'époque, dont Bertrand Brocard de
Cobra Soft et Laurant Weill de Loriciels, ainsi que deux entretiens avec Denis Thebaud, président
d'Innelec, principal grossiste de jeu vidéo français, apparu en 1983. Enfin, une étude des packagings
de jeu vidéo a été effectuée à partir des fonds de l'association MO5.COM, en s'attachant aux
indications données par les boîtes de jeu vidéo sur les réseaux de distribution traversés par celles-ci,
et sur les étapes de leur conception.
Les années 1970 et 1980 correspondent à la période où se constituent en France les réseaux de
distribution du jeu vidéo. En 1974, d'après www.pong-story.com, est importée en France pour la
première fois de manière officielle une console de jeu, l'Odyssey de Magnavox, renommée
Odyssée1. Les premiers grands micro-ordinateurs disposant d'un catalogue de jeux vidéo notable,
l'Apple II, le Commodore PET et le TRS 80, arrivent sur le territoire à la fin des années 1970, suivis
par les consoles de la deuxième génération à partir de 1980, avec le Vidéopac puis l'Atari 2600.
L'industrie vidéoludique française et le marché se développent principalement à partir de 1983, avec
la naissance des premiers éditeurs comme Loriciels, ainsi que des premiers grands distributeurs se
dédiant au jeu vidéo comme Innelec. C'est surtout autour du micro-ordinateur que s'axe la création
comme le marché français dans la décennie 1980, avec la prédominance de machines comme l'Oric
ou l'Amstrad CPC, et le développement d'une industrie micro-informatique nationale autour de
Thomson notamment, et dans le courant du Plan Informatique pour Tous lancé en 1985.
Au fil des années 1980, la distribution se structure autour de plusieurs sociétés, associant par
ailleurs bien souvent à leurs fonctions de grossiste, des fonctions de développeur, d'éditeur ou
d'importateur : Coconut Informatique, VTR Software, Innelec, disposent d'une branche édition
parfois assez développée. À la fin des années 1980, les réseaux de distribution sont structurés autour
1 David Winter, « The Odyssey in France », www.pong-story.com, consulté pour la dernière fois le 25 mai 2013
<www.pong-story.com/odypubfr.htm>.

de quatre grands groupes, dont les fonctions s'étendent par ailleurs bien souvent au-delà de la stricte
distribution : Innelec, Ubi Soft, Micromania, et Cable, le regroupement de l'éditeur de Thomson
France Image Logiciel et de la société de distribution d'Infogrames Cadre, se partagent le marché.
L'arrivée de la NES et de la Master System en France en 1987, puis l'effondrement de France Image
Logiciel et de Cable en 1988, suite à la fin du plan Informatique pour Tous, transforment par la suite
la structure de celui-ci.
J'ai décidé, dans le cadre de cette communication, d'étudier la façon dont les sociétés de distribution
et les revendeurs des années 1970 et 1980 puisaient, pour distribuer et pour commercialiser le jeu
vidéo, dans des modèles préexistants, et en l'occurrence dans deux grands types de modèles : ceux
offerts par d'autres produits culturels, comme le livre, le disque ou la cassette vidéo ; et celui offert
par le jouet. Ces deux grandes catégories de modèles n'influent par l'industrie de la même manière,
ni avec la même importance. Cette réflexion sur les modèles empruntés par l'industrie du jeu vidéo
provient d'une observation effectuée sur les circuits empruntés par les programmes de jeux, lors de
leur commercialisation. Les jeux vidéo, en effet, se retrouvent pendant longtemps à emprunter des
circuits commerciaux communs à d'autres types de produits. Les premières publicités réalisées par
RCA pour les programmes d'Activision, que la société distribue en France, contiennent ainsi un
formulaire destiné aux revendeurs intéressés par ses produits ; les différentes catégories de
détaillants sous lesquelles ceux-ci peuvent s'inscrire mentionnent, au même titre que celui de
boutique d'informatique, des intitulés comme particulier, vidéo-shop, disquaire, magasin de radio-
hi-fi, ou encore boutique de jouets2. Comment expliquer, alors, cette diversité de débouchés pour le
jeu vidéo, et quelles conséquences a-t-elle ?
Le jeu vidéo, un produit culturel comme un autre ?
L'industrie française du jeu vidéo ne se construit par ex nihilo. En établissant des structures
d'édition et de développement, ses acteurs s'inspirent de modèles pré-existants, la plupart du temps
offerts par d'autres industries culturelles, et les copient de manière plus ou moins importante. Jean-
Louis Le Breton, de Froggy Software, assimile ainsi sa fonction d'éditeur à celle d'un éditeur
classique de littérature, ayant lui-même travaillé comme auteur et libraire3 ; Infogrames, en
demandant au studio de Bertrand Brocard de s'occuper du développement de Full Metal Planète en
1989, met en place un système de co-production sur le modèle de ce qui se fait dans l'industrie du
cinéma4. De la même manière, les sociétés de distribution vont chercher des modèles auprès des
industries culturelles pré-existantes.
Les liens importants entre les industries du jeu vidéo et du livre nous ont amené, dans un premier
temps, à réfléchir à l'importance du modèle du livre. De nombreuses maisons d'édition, en effet,
disposent de leurs sociétés d'édition de logiciel, comme Vifi pour Nathan, ou Édiciel pour Hachette.
Les liens entre les industries du jeu vidéo et du livre, ou plus particulièrement de la bande dessinée,
sont par ailleurs très importants dès les années 1980, qui voient la réalisation de plusieurs
adaptations de bandes dessinées en jeux, comme La marque jaune par Cobra Soft ou Les passagers
du vent par Infogrames, voire la réalisation de bandes dessinées en accompagnement de jeux,
comme Turlogh le rôdeur5. Les éditeurs de livres classiques ont ainsi recours à leurs réseaux de
distribution traditionnels dans le cadre de la distribution de leurs logiciels : les archives d'Édiciel
2 Publicité Activision, Tilt n°1, septembre-octobre 1982, pp. 16-17.
3 Entretien avec Jean-Louis Le Breton, 28 mars 2012.
4 Archives de Bertrand Brocard, dossier Full Metal Planète. Les archives n'étant pas inventoriées lorsque nous les
avons consultées, il ne nous est pas possible de renvoyer à une cote précise.
5 Cobra Soft, 1988. La bande dessinée est éditée par Delcourt.

montrent que la quasi-totalité, non seulement de la distribution, mais également de la fabrication des
boîtes et de la duplication des programmes, est effectuée par une autre filiale d'Hachette, la Librairie
Pédagogique du Centre, en lien avec tout un réseau de libraires, papetiers, buralistes, et
commerçants du livre de manière générale6.
Dans les méthodes de distribution mises en place, toutefois, le modèle offert par le livre ne fait pas
florès. Interrogé sur un éventuel usage de l'office, technique de distribution du livre visant à délivrer
à un libraire un assortiment régulier d'ouvrages suivant un processus automatisé, Denis Thebaud
évoque la difficulté à mettre en place de tels systèmes de commercialisation du jeu vidéo, du fait de
la jeunesse et du manque de structuration de l'industrie7. Par ailleurs, si la conception du livre et du
jeu vidéo connaît un traitement comparable, de par la mise en place d'une organisation
auteur/éditeur, leur traitement commercial est quant à lui très différent. Le jeu vidéo, produit virtuel
que le consommateur ne peut consulter qu'au travers d'une interface particulière, et qu'il doit
également acheter, est à ce titre comparable au disque ou à la cassette vidéo. Par ailleurs, la rapide
évolution du marché, des goûts et des tendances ayant lieu sur celui-ci, la grande majorité des
programmes de jeu n'ayant qu'une durée de vie très courte, rapproche davantage le jeu vidéo du
disque. Cette affinité entre les industries de la musique et du jeu vidéo peut également être constatée
sur le plan technique, les deux objets ayant recours dans certaines circonstances à des supports
physiques communs. Ainsi, pour la duplication de leurs cassettes de jeux, Loriciels utilise ainsi les
services de Stéréophonique, et No Man's Land ceux du Témoignage, deux sociétés à l'origine
spécialisées dans la duplication de cassettes de musique8.
Du fait des points communs connus par les deux marchés, les sociétés de distribution de jeu vidéo
puisent dans les réseaux de distribution utilisés pour la distribution du disque, mais également de la
cassette vidéo. Ici encore, Loriciels et Innelec, dans leurs structures de distribution respectives,
s'inspirent beaucoup de ces ces modèles, et recrutent du personnel provenant du milieu du disque9.
Certains modèles commerciaux particuliers sont directement empruntés aux industries culturelles
pré-existantes. Ainsi, la mise en place de système de location de jeux vidéo, se développe dès le
début des années 1980, autour de boutiques comme Alpha Loisirs, qui mettent par ailleurs en place,
bien souvent, des systèmes de clubs d'adhérents pour fidéliser les consommateurs10. Un article de
Jeux et Jouets note la similitude entre les procédés de location du jeu, et ceux ayant cours dans le
milieu de la cassette vidéo11 ; est par ailleurs notable le fait que de nombreux vidéo-clubs, bien
souvent avant même les boutiques de micro-informatique, ouvrent la voie à ce marché, à l'exemple
de Micro-Vidéo, que Tilt érige en «premier club de location de vidéo-cassettes de jeux»12.
Jeux et jouets, le jeu vidéo comme loisir
Cette perception du jeu vidéo comme assimilable aux produits audiovisuels que sont le disque et la
cassette vidéo est principalement tributaire de l'évolution du marché dans les années 1980. Une
autre interprétation de l'objet vidéoludique est notamment offerte par un article de Jeux et jouets,
périodique adressé aux détaillants de jouets. Le jeu vidéo y est analysé non pas suivant les logiques
prévalant dans sa consommation et sa commercialisation, mais en fonction de sa finalité de loisir : il
6 Rapport du conseil d’administration à l’Assemblée Générale Ordinaire, 28 juin 1984, conservé dans les archives
d’Édiciel, IMEC, carton HAC S5 B5 C106.
7 Entretien avec Denis Thebaud, 22 mai 2012.
8 Entretien avec Laurant Weill, 22 octobre 2012 ; entretien avec Denis Thebaud, 22 mai 2012.
9 Ibid.
10 Publicité Alpha Loisirs, Jeux et Stratégie n°14, avril-mai 1984, p. 109.
11 « Vidéo cassettes : bien sûr, du nouveau... », Jeux et jouets n°23, janvier 1982, p. 14.
12 «Cassettes surprises», Tilt n°1, septembre-octobre 1982, p. 4.

est par là rattaché au jouet, à une époque où les jouettistes s'intéressent au marché du logiciel
vidéoludique13. Cette assimilation du jeu vidéo au jouet découle de réflexions plus anciennes. Il est
nécessaire, ici encore, d'insister sur les liens importants unissant les industries du jeu vidéo et du
jouet. Dès les années 1970, des géants du jouet se lancent sur le marché du jeu vidéo, comme Mattel
qui commercialise l'Intellivision dès 1979 aux États-Unis14, ainsi que les premiers jeux
électroniques portables à écran LCD ; Nintendo, Bandaï, Parker Brothers, investissent le marché du
jeu vidéo de différentes manières, produisant pour les premiers des jeux électroniques sur LCD15,
pour ce dernier des logiciels pour Atari 2600. En parallèle à cet important héritage industriel, le jeu
vidéo est perçu, tout du moins pour la première génération de consoles, comme du jouet
électronique. Stephen Kline, dans Digital Play, souligne le lien de l'objet vidéoludique à la
télévision, lien technologique certes, mais également formé par les univers communs aux deux
objets, avec l'importance du genre de jeu d'aventure, ou les imaginaires développés par les différents
programmes de jeux des premières générations16. De la même manière, le jouet comme défini par
Gilles Brougère développe autour de lui, notamment à l'aide de la télévision, un ensemble narratif
complexe, notamment composé par les dessins animés adaptés de licences connues17. Les deux
objets sont en contact permanent avec la télévision, sont intrinsèquement liés à celle-ci, au point que
Stephen Kline qualifie le jeu vidéo des premières générations de « toy for the boys »18.
De la même manière que dans le cas des produits audiovisuels classiques, le jeu vidéo va emprunter
au jouet ses réseaux de distribution, lors de sa commercialisation en France. Bandaï, Parker
Brothers, Mattel, ont recours à leur arrivée sur le territoire à leurs distributeurs classiques,
importants auprès des jouettistes : ainsi, les produits Parker Brothers sont distribués par Miro-
Meccano, les deux sociétés appartenant au même groupe industriel, et Miro-Meccano étant ici
davantage implanté en France que Parker19. De nombreuses sociétés ont par ailleurs recours à des
distributeurs de jouets traditionnels, à l'image de la console Colecovision, importée en France par
Ideal Loisirs, également distributeur du Rubik's Cube et de jeux électroniques comme Electronic
Detective ou Les stratèges sur le territoire20. Les chaînes de magasins de jouets comme JouéClub
occupent ainsi une place prépondérante sur le marché des consoles de seconde génération : fin
1983, Mattel et Milton Bradley font un tiers de leur chiffre d'affaires en France par l'intermédiaire
de ces réseaux21. Il est nécessaire de préciser ici que tous les constructeurs de console ne
développent pas la même stratégie de distribution : à son arrivée en France, Atari préfère miser
avant tout sur les magasins de hi-fi, avant de se tourner vers les jouettistes22.
Le rôle de la grande distribution
Les détaillants évoqués jusqu'alors, magasins de hi-fi, jouettistes et disquaires, occupent toutefois
13 «Consoles pour jeux vidéo : on en parle trop, ou pas assez ?», Jeux et jouets n°23, janvier 1982.
14 Donovan (2010), p. 79.
15 Gorges (2009).
16 Kline (2003), p. 107.
17 Brougère (2008).
18 Kline (2003), p. 107.
19 Publicité «Parker Jeux vidéo», Tilt n°3, janvier-février 1983, p. 96 ; Joëlle Ilous, «Pas de panique !», Tilt n°7,
septembre-octobre 1983, pp. 16-61.
20 Plusieurs publicités pour les produits Ideal Loisirs ont pu être consultés dans le périodique Jeux et Stratégie.
Publicité «Rubik’s Cube», Jeux et Stratégie n°6, décembre 1980-janvier 1981, p. 59 ; publicité «Electronic
Detective», Jeux et Stratégie n°5, octobre-novembre 1980, p. 59 ; publicité «Les stratèges», Jeux et Stratégie n°10,
août-septembre 1981, p. 70.
21 «Les problèmes qui se posent aux détaillants pour vendre des consoles vidéo et des micro-ordinateurs », Jeux et
jouets n°30, op. cit.
22 Ibid.

une place principalement symbolique dans les réseaux de distribution du jeu vidéo. Innelec, tenant
des statistiques sur son réseau de détaillants, compte parmi ceux-ci principalement des boutiques de
micro-informatique, les autres revendeurs n'étant ici somme toute que peu représentés, et ne
détenant qu'une part relativement mineure du marché23. Bien plus importante dans la
commercialisation du jeu vidéo est la grande distribution, par ailleurs déjà présente de manière
prépondérante dans les réseaux de distribution du jouet24. Les consoles de première génération, en
particulier, transitent par les réseaux de cette dernière : plusieurs packagings de consoles de
première génération réalisées par la Compagnie Occitane d'Électronique, présents dans les
collections de l'association Silicium, portent trace d'étiquettes de prix renvoyant à différentes
enseignes de la grande distribution25 ; la grande distribution acquiert par la suite une place
importante dans les réseaux de distribution du jeu vidéo sur micro-ordinateur, en particulier à partir
du milieu des années 198026.
Le traitement du jouet, par la grande distribution en général, se distingue par une très forte
saisonnalité, le marché étant très marqué par la période de Noël, à laquelle est associée une
consommation importante de jeux et jouets : Gilles Brougère revient sur le sens nouveau qu'acquiert
ce dernier à cette période de l'année27. La fin de l'année conditionne par conséquent également les
ventes de consoles de jeux, assimilées pour une large part au jouet. Cette assimilation se lit en
filigrane dans la presse non spécialisée en la matière, comme en témoignent les dossiers que
L'ordinateur individuel consacre au jeu vidéo, entre 1980 et 1983, systématiquement au mois de
décembre ; une certaine confusion peut d'ailleurs être remarquée, dans les premiers mois, entre le
jeu vidéo sur console et le jeu électronique, les types de dispositifs, présentés les uns avec les autres,
n'étant pas toujours différenciés de manière évidente28.
Laurant Weill évoque également l'importance de la grande distribution dans la normalisation des
packagings de jeu vidéo, et à une époque où la forme de ceux-ci est rarement fixée29. Certains
formats de boîtes de jeu, empruntés à d'autres objets audiovisuels, se répandent alors, comme les
boîtes cristal pour les cassettes de jeux. Plusieurs éditeurs français de programmes sur Thomson par
ailleurs, dont France Image Logiciel et Vifi-Nathan, dédoublent leurs packagings. Ainsi, Carte du
ciel, logiciel d'astronomie de Thomson Answare datant de 1984, est réalisé en même temps sous le
packaging traditionnel des produits Thomson Answare puis France Image Logiciel30, dans un carton
noir, et dans une boîte VHS classique, réadaptée quelque peu rapidement pour pouvoir conserver le
logiciel et sa notice ; le jeu Backgammon de Vifi Nathan connaît un traitement semblable31. La
réalisation de ces packagings empruntant à d'autres objets audiovisuels les formes de leurs boîtes
répond à un double impératif pratique de la grande distribution, de stockage et transport d'une part,
et de présentation d'autre part : la grande distribution peut ainsi disposer les logiciels dans des étals
dont elle dispose déjà.
Les réseaux de distribution ne sont pas responsables de cette assimilation entre le jeu vidéo et le
jouet, ou de manière générale entre le jeu vidéo et d'autres produits audiovisuels, celle-ci étant pour
une large part tributaire d'héritages historiques divers, remontant aux origines du medium.
Toutefois, les réseaux de distribution empruntés par le jeu vidéo, à l'époque où ceux-ci se
structurent, alimentent cette perception complexe du jeu vidéo, comparé tantôt à la cassette vidéo et
23 Entretien avec Denis Thebaud, 26 septembre 2012. Nous ne savons pas si ces statistiques ont été conservées.
24 Brougère (2003), p. 10.
25 Correspondance avec René Speranza, président de l'association Silicium, 21 septembre 2012.
26 Entretien avec Laurant Weill, 22 octobre 2012.
27 Brougère (2003), p. 208.
28 Le périodique fait par ailleurs état de sa difficulté à différencier les deux objets, avec un article de Thierry Courtois,
«Des jouets ou des jeux ?», L’ordinateur individuel n°43, décembre 1982, p. 120.
29 Entretien avec Laurant Weill, 22 octobre 2012.
30 Thomson Answare devient France Image Logiciel en 1985.
31 Les packagings ont été observés dans les fonds de l'association MO5.COM. Faute d'inventaire des collections, il
nous est impossible de renvoyer à des références précises.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%