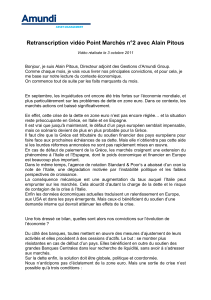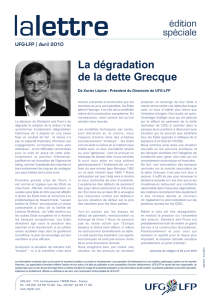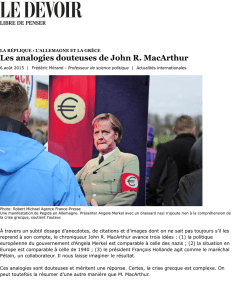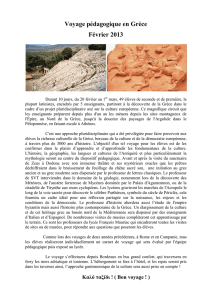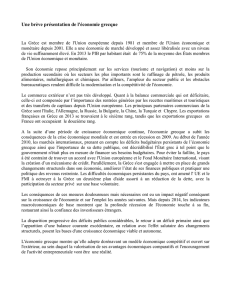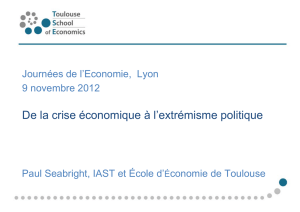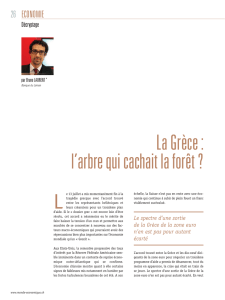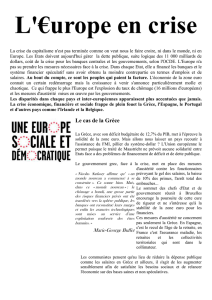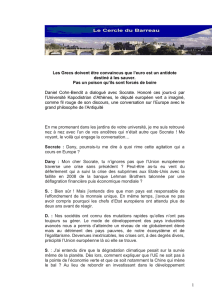La crise de la dette publique grecque

!"#$%1%&'(%5%
%
LA CRISE DE LA DETTE PUBLIQUE GRECQUE
La crise de la dette publique grecque procède d'une part des craintes qui portent sur la
capacité de la Grèce à rembourser sa dette publique, et d'autre part du poids que le
remboursement des intérêts de cette dette fait peser sur l'économie du pays. Elle prend
forme avec la crise économique mondiale de 2008 sous l'effet de facteurs propres au pays
tels que le fort endettement (environ 177 % du PIB fin 2014) et le déficit budgétaire (plus de
13 % du PIB), loin des critères de convergence. Le manque de transparence dont a fait
preuve le pays lors de son entrée dans la zone euro et dans la présentation de sa dette a
participé à l'aggravation de la crise. De plus, l'ampleur des problèmes structurels du pays, sa
difficulté à prélever l'impôt, son budget militaire surdimensionné et sa dépendance aux fonds
structurels européens sont des composantes fortes de la crise grecque dans la zone euro.
Il s’agit en première analyse d'une crise de nature économique liée à soutenabilité de la
dette grecque. Mais il s’agit aussi d'une crise politique qui révèle les enjeux et les limites de
la construction de l'Union européenne et met en lumière le fonctionnement de ses
institutions.
I. Une&crise&financière&révélée&tardivement&
La crise a connu trois pics de tension :
A. Premier&plan&:&mai&2010&
Le premier pic survient en 2010 alors que l'Irlande, le Portugal et l'Espagne sont aussi en
grandes difficultés. Pour éviter que la crise se généralise, les pays de la zone euro et le FMI
décident d'aider la Grèce.
! Un accord du 2 mai 2010 prévoit des prêts à la Grèce pour 110 milliards d’euros (80 par
l’UE1 et 30 par le FMI). En contrepartie le gouvernement de ce pays s’engage à un « plan
d’ajustement structurel » : hausse de la TVA (23%), taxation sur les résidences illégales,
gel des salaires des fonctionnaires et suppression des 13° et 14° mois, augmentation de
la durée des cotisations retraites… Ce plan, très impopulaire, provoque une vive réaction
de la rue.
! Parallèlement, les européens créent un fonds de stabilisation financière (FESF), qu’ils
dotent de 440 Md€, pour rassurer les marchés sur l’éventuelle propagation de la crise
grecque à d’autres pays également touchés par la crise financière (voir fiche…)
B. Deuxième&plan&:&mai&2011/&juin&2012.&
En mai 2011, le pays qui n’arrive pas à réduire la fraude fiscale et voit la récession aggravée
par les mesures d’austérité, fait à nouveau appel aux pays européens et au FMI. Un débat
s’instaure entre le FMI et certains pays (dont la France) d’une part, et les pays du Nord (dont
l’Allemagne) d’autre part. Ces derniers sont favorables à une restructuration de la dette2 dont
la charge devrait être supportée à la fois par les contribuables et par les banques qui ont
prêté sans réellement prendre en compte la situation du pays. Les premiers, craignant qu’un
défaut de la Grèce ne provoque une nouvelle tourmente financière, sont favorables à un ré-
échelonnement dans le temps.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
)%*"%+(",-$%-.,/(01'$%2%3"'/$'(%4$%)5%647%
8%9$%:'0%;$'/%40($%&.,%,.,%($61.'(&$6$,/%<"(/0$=%

!"#$%2%&'(%5%
%
! Un plan de réforme, imposé par les créanciers, est adopté par le Parlement grec en juin
2011. Il prévoit une réduction accrue des dépenses (masse salariale des fonctionnaires),
une baisse des sommes allouées à la protection sociale et une politique vigoureuse de
rentrées fiscales. Ce dispositif conditionne le plan de sauvetage.
! Un plan de sauvetage de 109 Md€ de fonds publics est conclu en juillet 2011 : 79 venant
du FESF et du FMI et 30 des privatisations. Le secteur privé doit aussi participer pour 50
Md€. Les taux des prêts du FESF sont bas et leur durée de remboursement est allongée.
! Mais les négociations sont difficiles à finaliser en raison du manque de confiance des
européens vis-à-vis de leur partenaire. Un nouvel accord est trouvé le 21 février 2012,
qui porte l’aide publique à 130 Md€ mais qui renforce la conditionnalité (réforme du
marché du travail, baisse du salaire minimal). En même temps les créanciers privés
acceptent une réduction de 53,5 % de leurs créances (soit 107 Md€)3.
Mais au printemps 2012, la Grèce a encore pris du retard sur son programme d'autant que la
conjoncture économique n'a pas été bonne. Aussi, le pays a été obligé de demander une
nouvelle aide. Le FMI voulait un abaissement de la dette à 120 % du PIB en 2020 mais cela
exigeait que les États européens, pour abandonner une partie de leurs prêts, sollicitent leurs
contribuables ce qu'ils ne voulaient pas faire. Pour éviter un défaut de paiement ils fixent un
objectif de 124 % du PIB assortis d’une combinaison de mesures : moratoire de dix ans sur
les taux d'intérêts des prêts consentis par le FESF, nouveaux délais de remboursement,
baisse des taux sur les prêts bilatéraux du premier plan d'aide... Parallèlement une aide de
34,4 Md€ est versée en décembre suivie de 12 Md€ par tranches l'année suivante.
C. Troisième&phase&critique&:&2015&
Alors que des signes de reprise économique (retour de la croissance, amélioration de la
balance commerciale, excédent primaire du budget de l’Etat), se manifestent à la fin 2014,
une troisième période de tensions survient avec l'arrivée du SYRIZA au gouvernement en
janvier 2015, élu sur un programme très hostile aux réformes suggérées par les autorités
européennes, d'autant que le plan de 2012 arrive à expiration. Après un semestre de
négociations, les tensions entre la Grèce et les autres pays de la zone sont telles que la
sortie de la Grèce de la zone euro est envisagée. Le gouvernement d’Aléxis Tsípras
organise un référendum le 5 juillet 2015 sur l'acceptation du plan proposé par les créanciers
qui se conclut par un « non ». Néanmoins, un plan semblable est accepté dans les jours qui
suivent puis approuvé par le parlement grec.
Les partenaires européens renforcent leurs exigences : excédent budgétaire primaire,
réformes fiscale, de la TVA, des retraites, adoption d’un code de procédure civile,
transposition de la directive européenne sur le renflouement des banques…. Sous ces
conditions, la Grèce doit recevoir 86 Md€ en trois ans.
Au total, depuis 2010, plus de 310 milliards d'euros ont déjà été prêtés, ou vont l’être,
à la Grèce, sans compter les abandons de créances.
II. Les&causes&de&la&crise&
Ces causes sont politiques et économiques
A. La&défiance&envers&le&partenaire&grec.&&
! Au niveau politique, la Grèce a été pénalisée à la fois par sa classe politique très
longtemps marquée par le népotisme et l'existence de dynasties politiques, au niveau de
l’Etat, dans les régions et dans les mairies. Par ailleurs celle-ci a souvent montré un
double visage : un à Bruxelles où elle parle anglais et se dit prête aux réformes et un en
Grèce où elle préfère laisser faire les choses.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
>%*$&%1",:'$&%?(",@"0&$&%&.,/%06<"-/A$&%<.'(%)>%B47%

!"#$%3%&'(%5%
%
! La Grèce n’a jamais su construire une administration publique efficace. Le cadastre qui
permettrait de recouvrir efficacement les impôts fonciers alors que 20 % des Grecs sont
propriétaires, n'est toujours pas mis en place. Les aides et fonds structurels européens
(environ à 4 % de son PIB entre 2002 et 2009) n'ont pas été utilisés pour bâtir un
système productif solide. Les responsables politiques, peu soucieux de l'équilibre
budgétaire, ont eu tendance à considérer les emprunts comme des revenus fermes, à
recruter massivement dans la fonction publique, et à construire une prospérité artificielle
et un système social très généreux (pré-retraites à 45 ans pour certaines mères de
famille).
! Par deux fois, la communauté européenne s’est aperçue que les déficits et la dette
n'avait pas été correctement déclarés. La première fois en 2004 et la seconde fois en
2010. Concernant la dette publique, la Commission européenne a demandé à la Grèce
de s’expliquer sur les instruments financiers auxquels elle aurait eu recours pour
dissimuler son ampleur. Elle aurait utilisé des contrats de swaps de change pour décaler
artificiellement de plusieurs années le paiement des intérêts de sa dette.
! La population grecque n'est culturellement pas favorable à l'impôt qu'elle considère
souvent comme une simple spoliation. Pourtant la fiscalité avait fortement augmenté
dans les années 1990, avec un taux d'imposition passant de 28 à 42 % du PIB, pour
immédiatement baisser dès l’entrée dans l'euro. Selon ATTAC, les allègements fiscaux
ont bénéficié aux classes les plus aisées (réduction des droits de succession, diminution
des taux d’imposition sur le revenu et lois d’amnistie fiscale pour les fraudeurs).
B. Les&préoccupations&géopolitiques&&
En fait les préoccupations géopolitiques ont été à l’origine de la volonté d’adhésion de la
Grèce à la communauté économique européenne, puis à la zone euro. Elles ont pris le pas
sur l’évaluation de sa capacité structurelle à intégrer l’ensemble européen.
Après la chute de la dictature des colonels, certains dirigeants (Valéry Giscard d'Estaing),
ont désiré intégrer le pays « berceau de la démocratie » mélangeant ainsi le symbole grec,
essentiel pour l'identité européenne avec l'État grec moderne. En intégrant les frontières de
la Grèce dans son espace, l'Europe a aussi cherché un équilibre face aux États-Unis dans
une logique de barrage vis à vis des périls qu'elle voyait monter à l'Est (Iran, Afghanistan).
Ce faisant, les États membres ont délégué à la Grèce un rôle stratégique, profitant par la
même occasion d'opportunités militaro-industrielles, avec la vente de leurs productions,
tandis que le pays transformait cette situation en une rente d'environ 30 milliards d'euros par
an.
L'adhésion de la Grèce à la zone euro procède aussi de la volonté, au moins de la France,
que la monnaie unique se fasse avec les pays d'Europe du Sud pour éviter un face à face
avec le Deutsche Mark. Cette volonté politique conduira la Grèce à ne jamais respecter les
critères de convergence et les européens à fermer les yeux.
C. La&dérive&économique.&&
Dès l’origine de la zone euro, le système économique et financier de la Grèce a posé
question
! Depuis 1997, l’inflation de la Grèce a été très forte et a provoqué une perte de
compétitivité entraînant un fort déficit de la balance commerciale (16% du PIB en 2008).
Or l'appartenance à la zone euro ne lui permet pas de regagner en compétitivité en
dévaluant et l'oblige à pratiquer une politique de rigueur, ce qu’elle n’a pas fait. En bref,

!"#$%4%&'(%5%
%
les Grecs ont consommé beaucoup plus qu'ils n’ont produit. Ils ont trouvé 40 Md€ à
l'étranger pour financer cette consommation.
! Tirée par la consommation et l’apport des capitaux étrangers, l'économie de la Grèce
était une des plus dynamiques de la zone euro de 2000 à 2007 avec un taux de
croissance de 4,2 %. Une économie dynamique et une baisse des taux d'intérêts (grâce
à son entrée dans la zone euro) lui permettaient de financer d'importants déficits
structurels. La crise économique et financière de 2007-2010 a particulièrement
touché la Grèce. Ses deux principaux secteurs économiques, le tourisme et le transport
maritime, ont été sévèrement affectés (baisse de revenu de 15 % en 2009).
! Les dépenses publiques engendrées par les jeux olympiques de 2004 s’élèvent
officiellement à 11 milliards de dollars (d’autres estimations portent ce chiffre à plus de 20
Md€). Elles ont été financées par l'emprunt en pure perte ; la majeure partie des
infrastructures sportives a été abandonnée. Leur entretien se révèle aussi très coûteux.
! La Grèce consacre environ 4 % de son PIB au budget de sa défense depuis des
décennies4. Elle est un des plus gros importateurs d'armes au monde. Les forces armées
grecques sont surdimensionnées ce qui grève son budget et sa dette depuis la fin de la
seconde guerre mondiale. Malgré la crise, les dépenses d’armement augmentent :
avions de combat américains, six frégates de guerre et des hélicoptères de combat
français, six sous-marins d'attaque allemands.
III. Une&dette&publique&insoutenable&
Entre 2002 et 2009, l’État a dépensé 830 milliards d’euros quand ses recettes sur la période
s’élevaient à 680 milliards.
A. La&spirale&d’endettement&
! La Grèce est le deuxième pays le plus endetté du monde, après le Japon5 (229%) et
avant la Jamaïque (137%). Depuis son entrée dans la zone euro, la dette publique
grecque a toujours été supérieure à 100 % du PIB. Sa maturité est très longue : 15 ans
contre 7 ans pour la dette française. Par son ampleur, la dette hellénique représente
potentiellement le plus gros défaut du monde.
! Les taux d’intérêt : avant l’avènement de l’euro, seules les banques publiques ont pu
acheter de la dette grecque, sous forme de bons du Trésor, avec des taux supérieurs au
taux de référence. En 2002, ils ont été alignés sur ceux des autres pays européens
jusqu'en 2009. Mais lorsque le montant réel de la dette a été connu, ces taux ont à
nouveau grimpé. Le risque de faillite a fait peser un risque financier mondial de nature
systémique, les banques étant fortement exposées soit en direct, soit via des paris pris
sur l'absence de défaut de la Grèce (credit default swaps). Les deux premiers plans
d'aide ont permis de mutualiser près de 80% de la dette rachetée par des entités
publiques en appliquant des taux moindres (4,5% ; 3,5%) et de desserrer les contraintes
pesant sur le pays.
! La Grèce a dégagé en 2014 un excédent primaire de l’ordre de 1% ce qui est aussi un
objectif du nouvel accord. C’est un signe d’amélioration mais il est nettement insuffisant
pour enrayer l’accumulation de la dette publique (effet « boule de neige »).
B. Grexit&ou&pas&?&&
La Grèce est confrontée à l’alternative suivante : soit accepter une politique d’austérité qui
rétablisse la compétitivité du pays au sein de la zone euro, soit restaurer les équilibres
économiques par une dévaluation monétaire, ce qui suppose la sortie de la zone euro.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
C%D%/0/($%4$%-.6<"("0&.,E%=F$??.(/%4$%4A?$,&$%$&/%4$%8E>G%4'%!HI%"'%J.K"'6$LM,0E%4$%)ENG%$,%+(",-$E%$/%4$%)E8G%
$,%D==$6"#,$O%
P%930??($&%8Q))%4'%+BH%R%)P8G%S%="%4$//$%<'1=0:'$%T"<.,"0&$%$&/%<($&:'$%$,/0U($6$,/%4A/$,'$%<"(%=$&%,"/0.,"'V%
W-0(-'0/%?$(6AX%

!"#$%5%&'(%5%
%
La question qui se pose est de savoir si le plan d’austérité imposé à la Grèce n’aura pas un
effet récessif sur l’économie qui serait contreproductif. Les opposants soulignent d'une part
que l'impact négatif des mesures restrictives annihile les effets positifs des taux d'intérêt
réduits et d'autre part, que les troubles sociaux qu'elles engendrent ont un impact négatif sur
l'investissement et la croissance de long terme. Dès 2010, certains économistes ont donc
avancé que face à l'ampleur de la dette et à l'importance de la charge des intérêts, la seule
issue pour le pays serait de sortir de la zone euro et de dévaluer pour redonner un souffle à
la Grèce. Les positions allant dans ce sens ont augmenté en 2011 à mesure que les
problèmes du pays s’accroissaient. La PIB de la Grèce représente seulement 2% de celui de
la zone euro ; l’impact sur l’économie de l’Europe serait négligeable.
La grande inconnue réside dans la réaction des marchés financiers susceptibles d’attaquer
l’euro dont ils anticiperaient un démantèlement de la zone monétaire.
Finalement la Grèce, acteur secondaire du développement économique, a été un pays
central de la construction européenne par les enjeux géopolitiques qu’elle présentait.
Révélant la fragilité de la monnaie européenne, elle reste toujours un acteur central, par les
enjeux politiques de notre monde de plus en plus « financiarisé ».
Franc-Gilbert Banquey
25 août 2015
1
/
5
100%