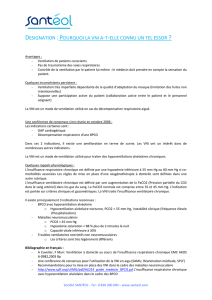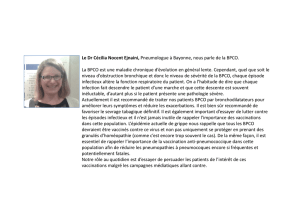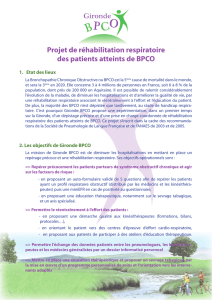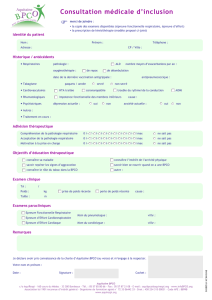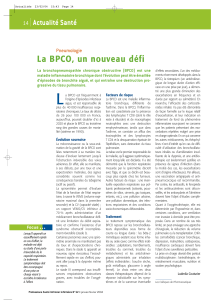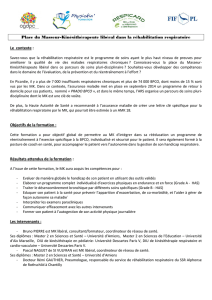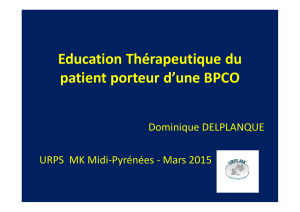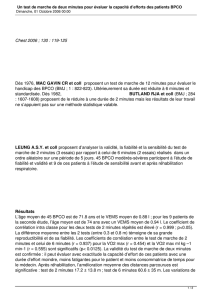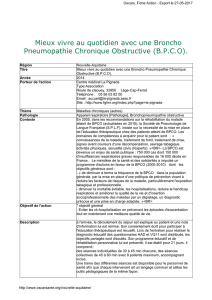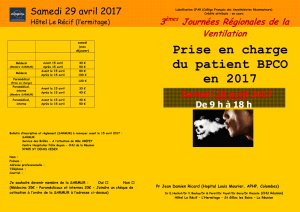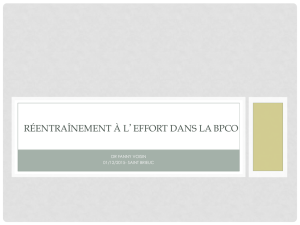Congrès de l`ERS - Stockholm 2007

Editorial
Congrès de l’ERS - Stockholm 2007
La société de l’information change
nos pratiques professionnelles et de
plus en plus de médecins sont abonnés
à des sites médicaux en ligne ; et
l‘information médicale en libre accès
sur Internet est souvent décriée.
Plusieurs équipes ont réfléchi à l’utilisation d’Internet
pour optimiser la prise en charge des patients.
Deux populations sont ciblées : les jeunes et les
patients très dépendants. Pour la population des
asthmatiques adolescents le site Internet a deux
fonctions : donner de l’information (documents,
réponses aux questions en ligne), partie personnelle
mise en place d’un programme thérapeutique
individuel accessible par un mot de passe en fonction
des symptômes, du palier initial du traitement et
du calendrier des allergènes. L’intérêt est démontré
dans la population d’asthmatiques non contrôlés ;
ces patients acceptent une augmentation significative
de la corticothérapie inhalée, par rapport aux autres
patients suivis classiquement.
Pour les patients dits « chroniques » de nos services,
plusieurs évaluations ont été réalisées. L’utilisation
active d’un site web n’est pas envisageable, sociale-
ment et/ou culturellement, dans cette population
qui est plus âgée. La prise en charge des affections
E-santé et prise en charge des patients. . . p. 1
Visite des stands avec
les représentants de l’Antadir. . . . . . . . . . . p. 2
La réhabilitation respiratoire
enuntourdecongrès.................p.3
Moderniser la technologie
delaconsultation.....................p.6
C’estquoileSNUS?...................p.7
Lesnanoparticules....................p.7
Le déficit en alpha 1 antitrypsine
sous l'égide de l'alpha one
international registry . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
Comorbidité complexe
et chronique dans la BPCO. . . . . . . . . . . . . p. 9
LaTuberculose .......................p.10
Les valves endobronchiques dans
le traitement de l’emphysème :
résultats préliminaires de l’étude VENT . . p. 11
La ventilation positive continue . . . . . . . . . p. 12
Syndrome d’apnée obstructif du sommeil
(SAOS) et différences de genre . . . . . . . . . p. 13
Le processus de mise en place
de la ventilation à domicile (VAD)
etla«learningcurve».................p.13
Ventilation non invasive :
Quoideneuf?........................p.14
Quand la PPC ne suffit pas :
la prise en charge des SAS « difficiles ». . . p. 15
n°15 - décembre 2007
E-santé et
prise en charge
des patients
Dr Galichet Cédric,
Hôpital Ste Catherine (Saverne)
Sommaire
Le congrès 2007 de l’ERS
a été comme chaque année
le temps fort de la pneumologie
Européenne.
Il s’est tenu à Stockholm à
la mi-septembre ou près de
16 000 congressistes étaient
présents.
Forte de l’expérience de
l’année passée, l’Antadir
a souhaité communiquer sur
ce congrès par l’entremise
d’un groupe de pneumologues
encadrés par le Dr Dan Veale,
coordonnateur médical de
notre Fédération.
Vous trouverez, dans ce
numéro plusieurs temps forts
de l’ERS 2007 relatifs aux
progrès réalisés dans le
domaine de la prise en
charge des maladies
respiratoires chroniques.
Un grand merci à tous pour
l’important travail réalisé
et à l’année prochaine.
Pr Jean-François Muir,
Président, Antadir Association

Inspirer n°15 - décembre 2007
2
chroniques représente 62 % des
admissions d’un centre hospitalier,
et 9% de ces patients sont admis
plusieurs fois par an. Les affections
respiratoires (BPCO, ...) et les pathologies
néoplasiques en représentent une
part significative. Pour ces patients,
une télésurveillance permet de diminuer
le nombre d’hospitalisations en
urgence et de réduire la mortalité de
20 %, par rapport au groupe contrôle.
Des programmes de réentraînement
à l’effort ont ainsi pu être menés sous
télésurveillance sans déplacement
chez le kinésithérapeute et apporter
un bénéfice clinique (surveillance
VEMS, saturation, pouls, TA 1 ou 2x/j).
Ces programmes de suivis individuels
permettent de modifier certaines
conduites thérapeutiques (appel plus
précoce du médecin de famille,
surveillance de l’auto-médication).
Une oratrice américaine est moins
enthousiaste pour ces gadgets « high
tech ». Les entretiens téléphoniques
quotidiens réalisés dans les années
80 aux USA donnent des résultats
similaires, avec une bonne satisfaction
des patients, un bon équilibre financier
(réduction des passages physiques
au domicile des patients, optimisation
des admissions hospitalières - admission
directe dans le service adéquat et de
jour). En conséquence un programme
d’E-santé doit respecter certains
critères :
« High risk, high cost, high use
groupe » (pathologie à haut risque,
coût élevé de prise en charge, grand
groupe d’utilisateurs)
critères d’inclusions basés sur des
besoins
mise en place de protocoles clairs
pour les principales situations
Les méthodologistes ont défini plusieurs
niveaux d’intervention selon la gravité
de la pathologie, du plus simple au plus
complexe, donc du moins onéreux au
plus coûteux :
centre d’appel téléphonique
site Internet d’information et
d’éducation coûts gravite de la
pathologie
centre médical de recueil de
données télémétriques
centre de télé éducation
centre de télé consultation
Pour mettre en place cette nouvelle
approche les mêmes mots magiques
reviennent : training unit, research
unit, administrative center. Il manque
juste les mots certification, évaluation,
comptabilité analytique.
Visite des stands avec
les représentants de l’Antadir
L'ERS est un grand congrès scientifique avec des forêts de posters écrits, des posters électroniques et
des communications orales. Les participants au congrès ont des motivations diverses et variées allant
du scientifique au visiteur, de l'industriel à l'ingénieur biomédical. Le congrès de l'ERS est le premier
congrès de l'année universitaire. C'est l'occasion pour les industriels de « sortir » leurs nouveautés,
et notamment de discuter avec leurs futurs clients des « proto » en cours de développement pour
« sentir » le marché. C'est un peu le MIDEM* de la ventilation et de l'oxygénothérapie.
Ainsi le hall des expositions n'est pas
dénué d'intérêt et Messieurs Forêt Didier
et Leclercq Dominique ont enchaîné les
rendez-vous et les présentations pour
traquer les nouveautés techniques
présentes et à venir. J'ai suivi pour vous,
les deux représentants de l’ANTADIR sur
les stands de Breas® et d'invacare®. Les
discussions sont courtoises mais précises.
BREAS nous a présenté la gamme
e sleep® et Vivo® avec le nouveau concept
d'asservissement au travail respiratoire du
patient. Le concept est intéressant. Puis
démonstration des nouveaux softs sur
flash card. La vision possible en direct de
flux sur un ordinateur portable en phase
d'adaptation du patient est séduisante.
L'ergonomie du logiciel programmé en
java doit être optimisée. Puis nous avons
visité le stand d'INVACARE® avec son
système de remplissage des bouteilles
d'oxygène gazeux de déambulation à
domicile. L'ergonomie et les sécurités ont
été testées. Les nouveautés intéressantes
seront généralement évaluées technique-
ment par les centres référents de l’ANTADIR
avant d’envisager un référencement à la
Centrale d’Achats d’ANTADIR Assistance.
Pour les années futures se dessinent la
miniaturisation des turbines, des concen-
trateurs portables avec une autonomie
correcte et l'optimisation de logiciels
des ventilateurs en particulier avec la
visualisation des courbes en directe sur
un ordinateur portable.
* Midem : the world's music market
Dr Galichet Cédric,
Hôpital Ste Catherine (Saverne)

Inspirer n°15 - décembre 2007 3
Pr Jean-François Muir,
Président, Antadir Association
1. Quels patients ?
La BPCO représente la majorité des
indications d'inclusion dans les
programmes (90% au Canada - P674).
Tout patient atteint de BPCO compliquée
de handicap respiratoire devrait pouvoir
bénéficier d'une réhabilitation,
quelle que soit la sévérité de la BPCO,
quel que soit son âge.
Une analyse rétrospective de l'efficacité
de la RR sur les capacités à l'effort
(TM6), la qualité de vie (CRQ) et le bien
être psychique (HADS) chez 48 patients
ne montre pas de différences significatives
selon l'âge ou le VEMS (P685).
Dans la BPCO sévère (stade IV),
le bénéfice de la RR sur la dyspnée,
la tolérance à l'effort et la qualité de
vie, est retrouvé par d'autres équipes
(1606, E3095 ; P689), à condition que
ses modalités soient adaptées à la
sévérité du handicap fonctionnel :
RR à domicile avec encadrement
professionnel soutenu (P689)
intensité des exercices physiques
adaptée à la tolérance du patient :
en effet, les patients contraints de
marquer plus d'une pause par exercice
de réentraînement ont des bénéfices
sur leur capacité à l'effort (TM6)
inférieurs à ceux du groupe contrôle
« bien tolérant » aux exercices (1606)
éventuellement, techniques de réen-
traînement alternatives : une équipe
mexicaine propose des techniques
de neurostimulation des quatre
membres à 13 patients BPCO
présentant une hypoxémie aggravée
par l'altitude, et obtient un gain
significatif sur le test de marche
et la force musculaire (E3095).
En dehors de la BPCO, la RR est
proposée dans d'autres pathologies
respiratoires chroniques compliquées
de handicap :
asthme : le réentraînement musculaire
et l'éducation thérapeutique améliorent
significativement la capacité à l'effort,
les symptômes, la qualité de vie, par
rapport à l'éducation thérapeutique
seule (E4517)
insuffisance respiratoire secondaire
à une cyphoscoliose : les exercices
d'endurance et de force musculaire
améliorent la dyspnée, la capacité à
l'effort, la force musculaire et la
qualité de vie (E4518)
les maladies neuromusculaires :
la RR est d'autant plus efficace sur
les paramètres fonctionnels qu'elle
est débutée précocement dans la
myopathie de Duchenne (E4510)
le syndrome d'apnées du sommeil :
une tendance à la diminution de la
masse grasse et des paramètres
tensionnels est observée après
quatre semaines de réentraînement
associant exercices de force musculaire
et d'endurance sur appareil ergomé-
trique, (étude sur 13 patients - P3400)
fibroses interstitielles diffuses :
douze semaines de réentraînement
des muscles inspiratoires entraînent
une régression de la dyspnée, une
amélioration de la qualité de vie et
du test de marche ainsi que de la force
des muscles respiratoires (PI max)
(E4519)
insuffisance cardiaque chronique :
le réentraînement augmente la
performance à l'exercice et la qualité
de vie dans une étude portant sur
57 patients atteints d'insuffisance
cardiaque avec FEVG moyenne à
31 % comparée à un groupe
contrôle (E4512).
2. Quels outils d'évaluation ?
L'évaluation des différentes composantes
de la RR est déjà bien codifiée.
Quelques nouveaux outils sont expéri-
mentés. Certains sont spécifiques de
l'une des composantes de la RR, d'autres
intègrent plusieurs paramètres pour
une appréciation globale de l'état de
santé du patient puis de l'impact
du programme de réhabilitation
respiratoire.
Dr Guillaumot Anne,
Hôpital du Brabois (Nancy)
La réhabilitation respiratoire
en un tour de congrès
Abréviations :
TM6 :
test de marche de six minutes
CRQ :
chronic respiratory
questionnaire
HADS :
Hospital Anxiety
Depression Scale
LINQ* :
Lung Information
Needs Questionnaire
BCKQ* :
Bristol COPD Knowledge
Questionnaire
BPQ* :
Breathing Problems
Questionnaire
SGRQ :
Saint George Respiratory
Questionnaire
*A notre connaissance, ces questionnaires
ne sont pas traduits en français.
Sont indiqués entre parenthèses les codes
des sessions.
L'intérêt et les bénéfices de la réhabilitation respiratoire (RR) ont été largement démontrés,
tant pour le patient que d'un point de vue économique. Le chantier de sa mise en place avance
et l'ERS a été le cadre de nombreux échanges d'expériences pratiques. La plupart confirment
les résultats connus et la pertinence des recommandations en vigueur. Certains apportent des
idées innovantes et lancent des pistes de réflexion pour d'autres expériences, voire des études
de plus large envergure.

Inspirer n°15 - décembre 2007
4
Outils spécifiques
Des questionnaires d'évaluation
des connaissances sont conseillés :
initialement au diagnostic éducatif,
pour identifier les besoins
puis, après le stage initial, pour
évaluer les acquis et l'adéquation
du programme aux besoins. Les
questionnaires LINQ* et BCKQ*
fournissent ainsi :
- des informations qualitatives sur
les connaissances à améliorer
- un score quantitatif objectif
d'appréciation du niveau de
connaissance globale ou par
domaine au cours du programme
éducatif (1603, P3391)
Mesure de l'activité physique :
le bracelet d'actimétrie, comparé à un
dispositif d'accélérométrie chez des
volontaires sains, permet des apprécia-
tions de l'activité physique et de la
dépense énergétique bien corrélées
aux outils de référence. Il pourrait
constituer un moyen simple et fiable
de mesure de l'activité physique avant
et au cours de la RR (P3801)
Appréciation de la qualité de vie :
les différents questionnaires disponibles
se caractérisent notamment par leur
sensibilité à détecter une variation
significative de la qualité de vie au
cours du temps. Ainsi, le BPQ* paraît
plus sensible que le score CRQ (4047).
Cette propriété devrait être prise en
compte dans le choix du test, au
même titre que simplicité, reproducti-
bilité et exhaustivité.
Index globaux :
L'index BODE intègre des paramètres
cliniques (BMI, dyspnée) et fonctionnels
(degré d'obstruction bronchique et
capacité à l'exercice) utiles à l'évaluation
et au suivi du patient BPCO engagé en
RR. Il semble bien corrélé à la sévérité
de la maladie, aux paramètres
morphométriques, biologiques (CRP),
à la qualité de vie (E4562) et serait
même prédictif d'une aggravation de
la qualité de vie (1600).
Plus simple, l'index DOSE, construit à
partir du score de dyspnée, du degré
d'obstruction bronchique, du statut
tabagique et du nombre d'exacerbations,
semble démontrer une bonne corrélation
avec l'index BODE, les scores de qualité
de vie (SGRQ, CRQ), le BMI, le TM6,
le nombre d'hospitalisations et de
consultations en urgence et semble
prédictif des exacerbations et de la
mortalité (1601).
3. Quelles modalités
pratiques ?
Le principe du stage initial personnalisé
et encadré n'est pas remis en cause.
Le choix du cadre (hospitalisation,
ambulatoire ou au domicile) reste
encore limité par l'offre locale de soins.
Pour certaines équipes, le domicile
paraît mieux adapté à la RR des patients
atteints de BPCO sévère (P689).
La contrainte des trajets répétés,
domicile/centre de RR, semble un
facteur limitant de l'assiduité aux séances,
notamment en milieu rural (P683).
Mise à part cette contrainte, les
programmes ambulatoires s'avèrent
aussi efficaces que les programmes
hospitaliers sur les bénéfices en terme
de qualité de vie, bien être psychique,
capacité à l'effort (P684).
L'encadrement des séances de RR par
un support télévisuel (exercices
musculaires vidéo-dirigés) améliore les
bénéfices sur la capacité à l'effort et la
dyspnée par rapport à un support écrit
seul (E3084).
4. Techniques et modalités
du réentraînement à
l'exercice (RE)
Les programmes associant exercices
d'endurance et de force musculaire
semblent plus efficaces sur la force
musculaire que les exercices de force
musculaire isolés. Les bénéfices des
programmes combinés ou séparés sur
la qualité de vie et la capacité à l'effort
sont comparables (E3086).
Le réentraînement des muscles respi-
ratoires améliore la force musculaire
inspiratoire (PI max) et réduit la dyspnée
(E3083). Les bénéfices obtenus par
le RE peuvent être potentialisés par
l'administration de bronchodilatateurs
(Tiotropium) pendant les séances (E3091).
L'intensité cible de l'effort au cours du
réentraînement est fixée idéalement
entre 50 et 80% de la puissance
maximale aérobie définie à l'épreuve
d'effort initiale. Cet objectif quantitatif
conditionne les bénéfices du réentraî-
nement sur les paramètres fonctionnels
et sur la capacité à l'effort, effectivement
d'autant meilleurs, que l'objectif est
atteint (P3799). Cependant, cet objectif
peut et doit être nuancé en fonction
de la tolérance du patient puisque :
un réentraînement à une puissance
d'intensité sous maximale reste efficace
(E3080)
un réentraînement trop intense avec
interruptions répétées des exercices
limite les bénéfices (1606).

Inspirer n°15 - décembre 2007 5
Afin de déterminer l'intensité cible
adéquate, une équipe propose d'ajuster
l'intensité de l'effort prescrit pendant
les séances de réentraînement, à
l'intensité de la dyspnée observée
pendant l'exercice, en proposant par
exemple un score de dyspnée cible à
4 selon Borg pour des BPCO de stade
GOLD II - III (E3085).
5. Quels bénéfices ?
Outre les bénéfices clairement démon-
trés sur le contrôle des symptômes, la
qualité de vie, l'autonomie et le bien
être psychosocial des patients, d'autres
effets plus mineurs de la RR sont explorés :
sur l'inflammation : diminution de
certains marqueurs inflammatoires
(PCR, TNF (, IL6, IL8) après RR chez
des patients BPCO comparativement
à un groupe témoin bénéficiant
d'éducation thérapeutique isolée
(E3082).
sur les performances cognitives :
des tests neuropsychiques sont
effectués avant et après RR chez 44
patients BPCO comparés à 32 sujets
contrôle. La proportion de patients
révélant des performances cognitives
normales augmente de 69 % à 90 %
après 4 semaines de réhabilitation
(P3388).
6. La réhabilitation
à long terme
Après programme initial complet,
le bénéfice du reconditionnement
musculaire sur la force musculaire
et la tolérance à l'effort se maintient
pendant au moins 6 mois (E3079).
A partir de douze mois, les bénéfices
sur la dyspnée, la tolérance à l'effort,
le bien être psychique déclinent, et
semblent perdus à 18 mois (retour aux
valeurs de base). Le taux d'hospitalisation
augmente à partir de 24 mois (P679).
Ces constats confirment l'importance
d'un protocole d'entretien, organisé
selon des modalités très variables
d'une équipe à l'autre. Des exercices
musculaires sur appareil ergométrique
à domicile, avec suivi ambulatoire
bimensuel (E4506) ou des exercices
à domicile avec séances hebdomadaires
en présence d'un kinésithérapeute
(4045) maintiennent les bénéfices
pendant au moins quatre ans (E4506).
Selon les moyens locaux, certains
programmes utilisent les infrastructures
sportives existantes (équipement,
associations). Le choix entre plusieurs
formules (individuelle, collective,
à domicile, ambulatoire ou combinée)
doit être proposé au patient dans la
mesure du possible, pour mieux répondre
aux attentes de chacun, à recueillir
éventuellement par questionnaire
(E3092).
7. Comment améliorer
la compliance ?
L'amélioration de l'observance des
patients à un programme complet
poursuivi à long terme reste une
préoccupation essentielle des équipes.
Afin de réduire le taux d'abandon,
certains auteurs ont testé des séances
collectives de sensibilisation, co-animées
par un psychologue et un kinésithé-
rapeute, préalables à la signature de
l'engagement. Leur taux d'abandon
a chuté de 14 à 3.4 %, les autorisant
à juger cette proposition efficace,
bien que coûteuse en temps et en
moyens. (P687).
Le facteur de proximité semble
également déterminer l'observance
des programmes ambulatoires,
justifiant l'objectif de développer
des structures en réseau au plus
près des patients, notamment en
milieu rural (P683).
Conclusion :
La RR représente une offre de soins
efficace et adaptable à toute forme
de handicap respiratoire. Sur la base
des recommandations validées, les
programmes doivent se développer :
quantitativement, vers le plus grand
nombre de patients potentiellement
concernés,
dans la diversité, en tenant compte
des facteurs propres aux patients et
aux pathologies, des moyens
humains et techniques, et des
particularités territoriales,
au plus près des patients.
Son développement et son succès
dépendent largement des capacités
de coordination des professionnels
concernés, des structures de soins, des
pouvoirs publics, du tissu associatif et
des infrastructures locales, autour du
patient, au centre du dispositif.
Les expériences locales méritent d'être
évaluées, partagées, voire étendues
et éventuellement validées à grande
échelle, pour améliorer l'accès des
patients à une prise en charge de
qualité du handicap respiratoire.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%