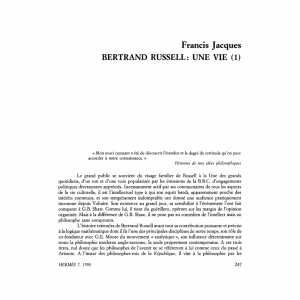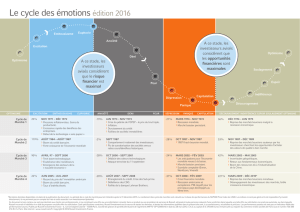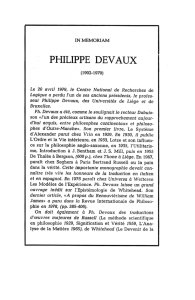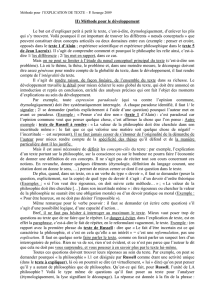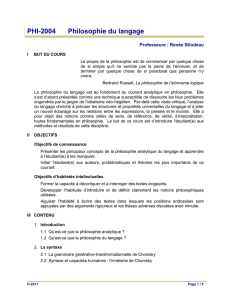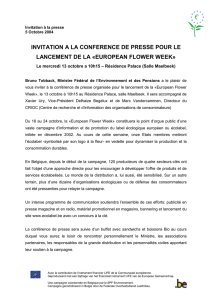La réduction des entités chez Bertrand Russell

1
Cyril HUNAULT
La réduction des entités
chez Bertrand Russell
(la construction logique du
“ monde physique ”)
Mémoire de maîtrise de soutenu en 1999 sous la direction de
François Schmitz au Département de Philosophie de l’Université de
Nantes.

2
Il partit...
Chercher des vérités étranges dans des pays inexplorés.
SHELLEY, Alastor.
On peut poser la question sous cette forme : étant
donné un énoncé dans un langage dont nous ne
connaissons que la grammaire et la syntaxe, mais non le
vocabulaire, quelles significations peut-on donner à
l’énoncé, quelles significations peut-on donner aux mots
dont le sens est inconnu, de manière à rendre vrai cet
énoncé ?
RUSSELL, Introduction à la philosophie mathématique.
Le réductionnisme
consiste à croire que tout énoncé doué de signification
équivaut à une construction logique à partir de termes qui
renvoient à l’expérience immédiate.
QUINE, Les deux dogmes de l’empirisme.
Avertissement :
Par honnêteté intellectuelle je me suis refusé à corriger ce texte après la soutenance. L’essentiel
est qu’il n’y ait pas d’erreur quand à l’interprétation et l’exposé des thèses de Russell ainsi que l’ont
relevé mes correcteurs MM Schmitz et Gnassounou.
Cependant, si j’avais à réécrire ce mémoire j’y intégrerai plus de point de vue personnel, i.e. il
serait moins historique et d’avantage orienté par mes propres thèses philosophiques, lesquelles mûrissent
chaque jours et me permettent de prendre du recul par rapport à ce travail. C. H. (septembre 2000)

3
Abréviations
P.L. A critical exposition of the philosophy of Leibniz ; La philosophie de Leibniz
P.
of M. Principles of mathematics ; Les principes des mathématiques
O.D. On denoting ; De la dénotation
N.T. On the nature of truth ; De la nature de la vérité
P.E. Philosophical essays ; Essais philosophiques
P.M. Principia Mathematica
K.A.K.D. Knowledge by acquaintance and knowledge by description ; Connaissance par
acquaintance et connaissance par description
R.U.P On the relations of universals and particulars ; Les relation entre les
universaux et les particuliers
P.
of P. The problems of philosophy ; Problèmes de philosophie
M.13 The 1913 manuscript ; Le manuscrit de 1913
O.K.E.W. Our knowledge of external world ; Notre connaissance du monde extérieur
R.S.D.P. The relation of sens data to Physics ; La relation des données-sensibles à la
Physique
O.S.M.P. On scientific method in philosophy ; La méthode scientifique en philosophie
U.C.M. The ultimate consituents of matter ; Les constituants ultimes de la matière
I.M.P. Introduction to mathematical philosophy ; Introduction à la philosophie
mathématique
M.L. Mysticism and logic ; Le mysticisme et la logique
P.L.A. The philosophy of logical atomism ; La philosophie de l’atomisme logique
M.P.D. My philosophical development ; Histoires de mes idées philosophiques
Table des matières

4
Introduction
1. Du réalisme au phénoménalisme.
•1.1. La matière et l’espace dans les Principles of mathématics.
• 1.1.1. l’ontologie formelle et l’épistémologie
• 1.1.2. la réalité de l’espace et de la matière
• 1.1.3. les propriétés spatio-temporelles de la matière
• 1.2. Le réalisme épistémologique des Problèmes de philosophie.
• 1.2.1. l’émergence des questions épistémologiques
• 1.2.2. l’existence de la matière
• 1.2.3. la nature de la matière
• 1.2.4. le problème de l’inférence existentielle
•1.3. Du réalisme au phénoménalisme.
• 1.3.1. la connaissance primitive et la connaissance inférée
• 1.3.2. l’analyse de l’expérience perceptive
• 1.3.3. l’inférence des objets physiques peut-elle être justifiée ?
2. La construction logique des objets matériels
et des concepts physiques.
• 2.1. L’interprétation d’un système : la définition
opérationnelle des entités.
2.1.1. la définition en philosophie mathématique
• 2.1.2. la nature de l’abstraction mathématique
• 2.1.3. « il faut que nos nombres soient déterminés ».
• 2.2. La relation du monde physique et du monde sensible.
• 2.2.1. le constructionnisme et la philosophie des sciences
• 2.2.2. la vérification empirique de la physique
• 2.3. La construction de l’espace physique.
• 2.3.1. les conceptions absolues, relatives et opératoires de l’espace
• 2.3.2. les mondes et espaces privés
• 2.3.3. le système des perspectives : l’espace physique
• 2.4. La construction de l’objet physique et de la matière.
• 2.4.1. l’objet physique du sens commun
• 2.4.2. la matière du physicien
• 2.4.3. les inférences autorisées, la continuité et la causalité.
3. Excursus métaphysique : ce qu’il y a 1
• 3.1. La logique et la métaphysique.
• 3.1.1. la logique et l’ontologie
• 3.1.2. l’analyse ontologique : les particuliers et les universaux
• 3.1.3. l’analyse formelle : les noms propres et les faits
• 3.2. Qu’est ce que la réalité ?
• 3.2.1.le principe de parcimonie
• 3.2.2. l’objet matériel et les entités physiques
1 Titre de la 8ème conférence de La Philosophie de l’Atomisme logique

5
• 3.2.3. l’ego métaphysique
Conclusion
Bibliographie
Table des matières
Introduction
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
1
/
92
100%