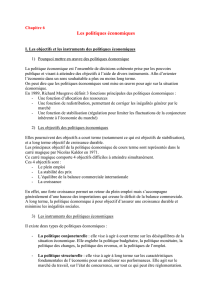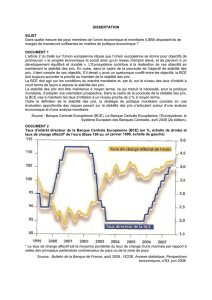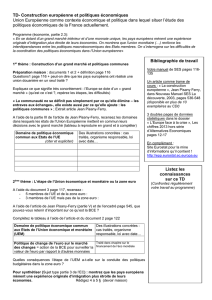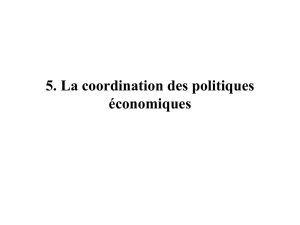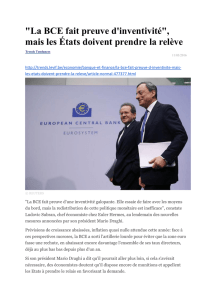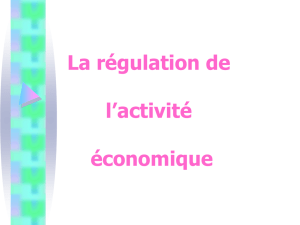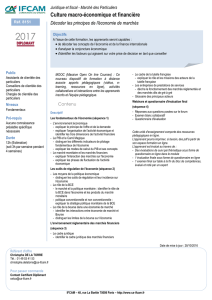Compte rendu du colloque - CIRAC - Université de Cergy

CIRAC, octobre 2014
1
PROGRAMME DE FORMATION-RECHERCHE
Culture monétaire, culture budgétaire en Allemagne et en France.
Divergences et convergences franco-allemandes.
Sur la voie d’une nouvelle gouvernance européenne ?
COMPTE RENDU DU COLLOQUE
Gouvernance économique, financière et monétaire
de l’Union européenne
Goethe-Institut (Paris), les 6 et 7 octobre 2014
Cette rencontre constitue le dernier volet du projet de formation-recherche « Culture moné-
taire, culture budgétaire en Allemagne et en France. Divergences et convergences franco-
allemandes. Sur la voie d’une nouvelle gouvernance européenne ? ». Ce projet est conduit sur
la période 2012-2014 par le Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne
contemporaine (CIRAC), le centre de recherche Civilisations et identités culturelles
comparées (CICC) de l’université de Cergy-Pontoise (UCP) et l’Institut franco-allemand de
Ludwigsburg (DFI), avec le soutien du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur
l’Allemagne (CIERA). En avril et en novembre 2013, deux journées d’étude ont permis
d’analyser les cultures monétaires puis budgétaires en France et en Allemagne (comptes
rendus disponibles sur le site du CIRAC : http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php ). Ce
colloque vient clore en outre le cycle thématique « France-Allemagne-Europe » de l’Institut
d’études avancées (IEA) de l’UCP.
Quelle(s) politique(s) économique(s) pour la zone euro ?
En guise d’introduction à cette première table ronde et à l’aune des dernières données
disponibles, Christian Kastrop, directeur du département des Études de politique
économique à l’OCDE, a montré qu’en comparaison avec la zone euro, les États-Unis
présentent actuellement de meilleures perspectives de croissance, ont davantage consolidé
leurs finances publiques depuis 2009 et ont mené une politique d’assouplissement monétaire
plus marquée depuis 2008, tout en disposant d’un marché du travail plus flexible. Pour
Christian Kastrop, il est nécessaire d’allier consolidation budgétaire et réformes structurelles
dans la zone euro, en tenant compte des spécificités de chaque pays. La politique monétaire de
la Banque centrale européenne (BCE), dont les mesures non conventionnelles pourraient
réduire les efforts à fournir en la matière, souffre pour sa part de l’absence de gouvernance
commune.

CIRAC, octobre 2014
2
Par la suite, Jean-Marc Daniel, économiste et professeur associé à l'ESCP Europe, a
affirmé qu’il faut cesser de croire que le problème de croissance est un problème d’emploi,
que la zone euro subit une déflation et qu’il faut déprécier la monnaie européenne. Deux
réformes sont nécessaires : il s’agit d’un côté de respecter le Traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance (TSCG) et de réduire le déficit structurel et, de l’autre, de
mettre en œuvre une politique de formation raisonnée et gérée en concurrence afin
d’améliorer la gestion de la population active. Selon Jean-Marc Daniel, il est souhaitable à la
fois de faire reposer la croissance sur l’usage des nouvelles technologies de l’information et
de la communication (NTIC) – comme c’est le cas aux États-Unis –, d’insérer l’Angleterre
dans le dispositif et de faire de l’Europe le porteur d’un modèle intellectuel où on favorise le
progrès technique, le profit et la concurrence, en vertu du théorème d’Helmut Schmidt : « les
profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain ».
Henrik Uterwedde, directeur adjoint du DFI, a indiqué que la crise a montré les failles du
système de Maastricht. Si l’Allemagne se montre inflexible sur l’application stricte du TSCG
et sur son refus de mutualiser la dette en l’absence d’une intégration plus forte des politiques
fiscales, elle reste souple sur le délai accordé à la consolidation budgétaire. Pour le
gouvernement allemand, les réformes structurelles, la stabilité budgétaire et les
investissements d’avenir doivent permettre de stimuler l’emploi et la croissance. Toutefois, si
le pays a adopté des mesures sociales, il lui faut également accroître les investissements
(notamment dans les infrastructures) en mobilisant des capitaux privés – ce qui vaut aussi
pour l’Europe. Pour conclure, Henrik Uterwedde observe un rapprochement des positions des
gouvernements français et allemand, parfois mal compris par l’opinion publique et de
nombreux responsables politiques. Dès lors, il plaide en faveur d’un débat public sur les
enjeux européens et les politiques nécessaires.
La dernière intervenante de cette table ronde, Natacha Valla, directeur adjoint du Centre
d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), a précisé que la France
n’a pas avancé, malgré la crise, sur la nécessité d’une Europe politique derrière la monnaie
unique. Par ailleurs, le pays a des difficultés à assumer une position dans la gouvernance
collective et connaît, en comparaison avec l’Allemagne, un rapport différent au respect des
règles, tout en cultivant assez maladroitement l’art de l’ambiguïté vis-à-vis des réformes
structurelles et de la rigueur budgétaire. En ce qui concerne le rôle accordé à la BCE, Natacha
Valla déplore le fait que la politique monétaire soit peu abordée dans le débat public français.
Enfin, pour relancer l’investissement public et privé dans la zone euro, elle propose de
réformer la Banque européenne d’investissement (BEI) et de mettre en réseau les banques
d’investissement nationales.
Au cours de la discussion qui a suivi, Natacha Valla a ajouté qu’il serait utile de mettre en
place un audit supranational des finances publiques par des corps autonomes. Henrik
Uterwedde a souligné la nécessité, pour les responsables politiques, de recrédibiliser l’Europe
aux yeux des citoyens en assumant sur le plan national les décisions prises au niveau
européen. Jean-Marc Daniel a pour sa part spécifié que la création d’un budget commun serait
une erreur car on ne peut pas contraindre les peuples à être solidaires entre eux.
Quel rôle doit jouer la BCE aux yeux des politiques français et allemands
et quelle est sa politique actuelle ?
Sur cette deuxième thématique, Jacques Mistral, membre du Cercle des économistes, a
structuré son propos en sept points :
• la BCE a eu un comportement exemplaire dans la gestion de la crise ;

CIRAC, octobre 2014
3
• si l’idée de la dévaluation continue de séduire en France (malgré son impact négatif
sur le pouvoir d’achat), les peuples restent tout de même très attachés à l’euro ;
• la question du chômage et des conditions sociales ainsi que celle de la déflation restent
de vrais sujets ;
• l’Union économique et monétaire (UEM) présente un caractère hybride. En l’absence
de pouvoir politique et de circuits privés de financement, la fragmentation entre
espaces nationaux reste très présente. Dès lors, il existe une sorte de régime de change
fixe qui encourage la déflation ;
• la Grande-Bretagne apporte une contribution utile à la culture européenne. Dans le
renforcement de l’intégration de la zone euro, il faudrait par conséquent tenir compte
des préférences des Britanniques et de la dynamique du continent ;
• la politique monétaire ne peut pas tout. L’Europe a besoin d’investissements ;
• les responsables politiques devraient développer une vision européenne répondant aux
attentes des jeunes.
Pour Philippe Moutot, conseiller principal au sein de la Direction générale de l’Économie
de la Banque centrale européenne, la vision que les responsables politiques ont du rôle de la
BCE est le résultat direct des expériences historiques nationales : en France et en Allemagne,
deux perceptions opposées prévalent sur la centralisation et le fédéralisme ainsi que sur le lien
entre risque inflationniste et risque d’instabilité financière. Philippe Moutot a ajouté qu’avec
la crise de la dette fin 2010, il n’était plus possible de distinguer les problèmes issus d’un
manque d’union bancaire des problèmes de nature budgétaire. Au-delà de la politique
monétaire, les efforts de la BCE et des États membres se sont dès lors concentrés sur la mise
en place d’instruments de soutenabilité budgétaire et de stabilité financière, l’annonce des
opérations monétaires sur titres (Outright Monetary Transactions, OMT) ayant pour sa part
convaincu les marchés. La BCE ne pouvant assurer seule la pérennité de l’euro sans la
coopération des États, l’enjeu est désormais de mettre en œuvre des réformes structurelles
différenciées selon les pays pour accroître le potentiel de croissance.
La contribution de Friedrich Heinemann, chef du département Fiscalité des entreprises et
finances publiques au Centre d’études économiques européennes (ZEW) de Mannheim,
a porté sur la perception qu’a l’opinion publique allemande de la politique de la BCE. Pour les
Allemands, la déflation n’est pas le problème prioritaire. Ils sont davantage préoccupés par le
fait que la BCE outrepasse ses compétences, ce qu’a d’ailleurs confirmé la Cour
constitutionnelle fédérale dans son arrêt du 14 janvier 2014 en contestant la compatibilité du
mécanisme des OMT avec le mandat de la BCE. Les Allemands craignent également qu’une
« répression financière » s’installe pour les épargnants en raison de la baisse des taux
d’intérêt. Enfin, prônant une solidarité conditionnelle, ils redoutent que le temps gagné par la
BCE ne soit pas utilisé à bon escient par les pays de la zone euro – et notamment par la
France – pour mener à bien les réformes structurelles qui s’imposent.
En complément, Gerald Braunberger, rédacteur en charge de la rubrique Marchés
financiers au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, a précisé que du fait des traditions
culturelles, la France privilégie la demande et l’Allemagne, l’offre. En outre, il estime que le
secteur financier est négligé – à tort – dans de nombreuses analyses de la politique monétaire
et qu’il existe un lien étroit entre la stabilité des prix (la politique monétaire), la surveillance
des banques (la stabilité financière) et la stabilité de la dette publique (la politique budgétaire
nationale). Dans une telle configuration, la BCE sert à assurer les États contre des risques
macroéconomiques graves, malgré l’aléa moral que cela implique. Pour Gerald Braunberger,
la zone euro ne se trouve pas dans une situation de déflation et les effets du quantitative

CIRAC, octobre 2014
4
easing sont incertains et difficiles à évaluer. En somme, il ne faut pas surestimer la puissance
de la politique monétaire.
Christian de Boissieu, professeur d’économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
a réagi aux propos précédemment tenus en évoquant l’élargissement du mandat de la BCE qui
résulte de l’union bancaire. Dans sa fonction de supervision des banques, la BCE va être
concernée par les nouvelles règles prudentielles de Bâle III. Il a également rappelé la
validation, par la Cour de Karlsruhe, des plans de sauvetage de la zone euro et a regretté le
rejet par la France de la proposition faite par Angela Merkel à l’automne 2010 sur le système
de sanction dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance (PSC), suivant laquelle un pays
qui ne respecterait pas les règles du traité pourrait se voir privé de droit de vote dans les
instances communautaires et/ou se verrait refuser l’accès aux fonds structurels.
Regards communautaires sur les enjeux
de la politique économique et financière européenne
Au cours de son bref exposé introductif, Guntram B. Wolff, directeur de l’Institut Bruegel,
a mentionné deux débats en cours à Bruxelles, le premier ayant trait à l’égalité de traitement
des pays quant au respect des règles budgétaires. Bien qu’il en aille de la crédibilité des
règles, on ne peut peut-être pas attendre le même ajustement d’une petite économie ouverte
que d’une grande économie moins ouverte. Le second débat porte quant à lui sur les réformes
structurelles à réaliser dans les différents pays de la zone euro. Au-delà de ces deux débats,
Guntram Wolff déplore les divergences de vue sur les perspectives à donner à l’union
monétaire à moyen et à long terme.
Dans un premier temps, Miguel Moltó Calvo, professeur à l’Institut universitaire d’études
européennes de l’Université San Pablo de Madrid, s’est penché sur le cas de l’Espagne.
Avant la crise, malgré un taux de croissance supérieur à la moyenne de la zone euro et une
situation budgétaire saine, le pays présentait de nombreux signes de vulnérabilité (perte de
compétitivité, bulle immobilière, fort endettement privé, déficit extérieur et dette externe
élevée). Pour faire face à la crise, le gouvernement a d’abord opté pour une politique
budgétaire expansive avant de mener, à partir de 2010, une stratégie de consolidation
budgétaire accompagnée d’un renforcement du système financier et de réformes structurelles.
Si le programme de stabilité espagnol 2014-2017 prévoit une amélioration du potentiel de
croissance et une réduction du déficit, les estimations relatives au chômage, à la dette et à la
pression fiscale demeurent préoccupantes. Pour conclure, Miguel Moltó Calvo a déclaré que
l’avenir de l’UEM passait par l’adoption d’un système fédéraliste, l’objectif de convergence
économique devant aller de pair avec une certaine flexibilité dans l’approche de l’austérité et
l’application du PSC.
Dans un deuxième temps, Gustavo Piga, professeur d’économie politique à l’Université de
Rome, s’est prononcé pour la création de mécanismes favorisant la mise en œuvre de
politiques anticycliques, en vertu desquelles l’austérité et les réformes doivent être décidées
en priorité au cours de périodes conjoncturelles favorables. Dans la zone euro, après
l’adoption du pacte budgétaire inclus dans le TSCG, le chômage a connu une nouvelle
augmentation due à la réticence des entreprises (et des ménages) à investir dans un contexte
de consolidation budgétaire induisant le maintien prolongé d’un niveau élevé de fiscalité.
L’Italie doit désormais stimuler la demande en augmentant l’investissement public, ce qui
sera possible via un examen des dépenses. L’austérité y est un échec, la dette en pourcentage
de PIB ayant atteint son plus haut niveau depuis 1928. Aux yeux de Gustavo Piga, l’union

CIRAC, octobre 2014
5
budgétaire suppose l’existence d’une culture commune. Or, même aux États-Unis, cela a pris
du temps.
Antoin E. Murphy, professeur émérite d’économie au Trinity College de Dublin, a
achevé ce tour d’horizon européen en s’intéressant au sort de l’Irlande. Il est revenu sur
« l’âge d’or » des années 1994-2000, le Tigre celtique servant alors de passerelle entre la
Silicon Valley et l’Europe. Les filiales des multinationales implantées dans le pays
soutenaient l’activité de nombreuses entreprises de services et du secteur de la construction,
qui subit toutefois un revers en 2001. La stimulation excessive du marché qui s’ensuivit créa
alors une bulle immobilière, dont l’éclatement en 2008 entraîna une crise bancaire, une crise
budgétaire et une crise financière de sorte qu’en 2010, la Troïka décida d’intervenir. Trois ans
plus tard, l’Irlande est parvenue à sortir du plan de sauvetage. Même si la situation reste
difficile, le pays a des raisons d’espérer, les multinationales pouvant notamment connaître un
nouvel essor dans un environnement international apaisé. Pour Antoin Murphy, la gestion de
la crise en Irlande ne relève pas de l’austérité, mais plutôt d’un retour au bon sens.
Pour clore cette rencontre, Henrik Uterwedde a affirmé qu’il fallait dépasser les visions
nationales et a salué l’ouverture du débat en France et la prise en compte des problèmes
structurels. Il a en outre souligné la nécessité de sortir le débat de sa focalisation sur les
sanctions pour s’interroger davantage sur l’Europe que nous voulons. Il s’agit ainsi de
retrouver une confiance mutuelle pour redonner envie de construire l’Europe. En ce qui
concerne le respect des règles de déficit, René Lasserre, directeur du CIRAC, a suggéré de
passer d’une logique normative à une logique contractuelle d’engagement sur les réformes
structurelles à effectuer, la solidarité se construisant par le contrat.
Les actes de ce colloque seront intégrés à un ouvrage collectif à paraître en 2015.
Solène Hazouard
1
/
5
100%