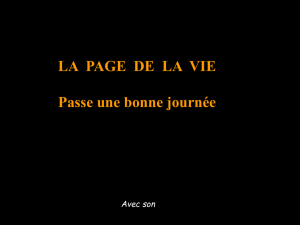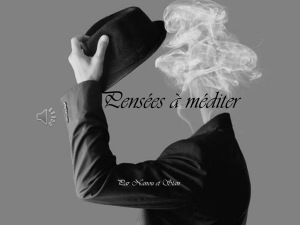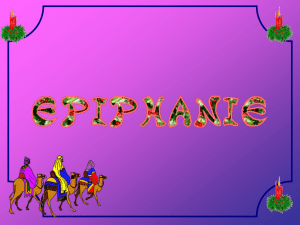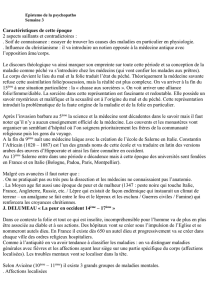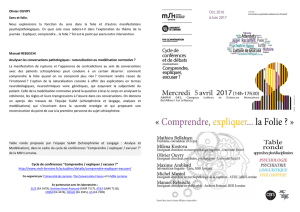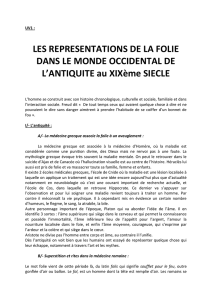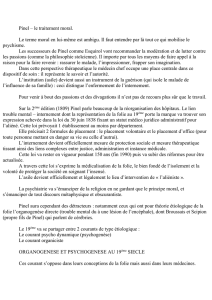Images et représentations de la folie

1
Cet article est distribué par http://zwyx.org
Pour contacter l’auteur : malysse@zaz.com.br
Toute reproduction ou diffusion est interdite
sans une permission écrite du diffuseur ou de l’auteur
____________________________________________________________________________
Images et représentations de la folie:
De l’autre coté du miroir de la normalité.
Stéphane MALYSSE 1
« C´est lorsque les normaux et les stigmatisés viennent à se trouver
matériellement en présence les uns des autres, et surtout s´ils s´efforcent
de soutenir conjointement une conversation, qu´a lieu une des scènes
primitives de la sociologie, car c´est bien souvent à ce moment-là que les
deux parties se voient contraintes d´affronter directement les causes et les
effets du stigmate. »
Erving Goffman, Stigmate.
Voir ailleurs (Salvador de Bahia, Brésil) et voir autrement (à travers l’objectif d’une
caméra photographique et vidéographique) et découvrir, presque la même chose, voire ce
que l’on attendait, au delà de l’exotisme, en cherchant à y voir et rencontrer les folies
ordinaires, quotidiennes et pathologiques d’un groupe de femmes, internées dans un hôpital
public de santé mentale, un hôpital « psychanalytique ». Comment voir la folie des autres ?
Comment la comprendre à partir des images que l’on s’en fait et qu’elle diffuse
irrémédiablement dans le champs des interactions sociales ? Comment l’expérimenter
anthropologiquement entre construction et révélation ? Cet article propose une réflexion en
1 Docteur de l’E.H.E.S.S en Anthropologie et Chercheur/ Professeur de l’Université Fédérale de Bahia, Salvador, Brésil.

2
images autour d’une expérience d’anthropologie visuelle du corps appliquée au vaste thème
de la folie féminine2.
En revoyant les images de la folies, rendues publiques par des psychiatres
« visualistes » comme les docteurs Charcot, Luys, Bourneville et Régnard, Londes et
Duchenne de Boulogne, puis en cherchant à élucider les relations entre ces images et les
manifestations de la folie, j’ai suivit deux parcours de terrain : le premier cherche à penser
les relations entre les « images du corps »3 et la folie, tandis que le second s’appuie sur mes
propres expériences de terrain anthropologique, effectuées au sein de l’hôpital Juliano
Moreira à Salvador4. A partir d’une méthodologie appliquée à mes terrains de recherche
antérieurs ( Hygiène corporelle parisienne5 et Culte du corps à Rio de Janeiro6), définie
comme une anthropologie visuelle du corps, j’ai réalisé une recherche de terrain d’une
durée de huit mois dans un Hôpital de Salvador, en focalisant mon regard sur l’aspect
audiovisuel du monde social et matériel d’un groupe d’internées et en cherchant à
comprendre la façon dont cet univers était vu et vécu subjectivement par ces femmes.
En passant de l’autre coté de la normalité en produisant des images et des
enregistrements sonores comme données de recherches, j’ai essayé d’ouvrir un espace de
réflexion interdisciplinaire (Psychiatrie, Psychologie, Psychanalyse, Anthropologie visuelle
et sonore, Anthropologie du corps, Herméneutique...) et réflexif (en tenant compte de mon
contre-transfert et de mes à priori) afin de mettre en évidence non seulement la prolifération
des discours et des représentations que la folie suscite mais également la polysémie de la
folie en soi. Pour renouveler le discours sur la folie, une des possibilité évoquée par le
directeur de l’hôpital Juliano Moreira, consiste à se diriger vers le patient sans aucune
2 Pour des raisons de stratégie de terrain anthropologique et parce qu’il est facile de voir que la folie « version masculine »
est bien différente, dans ses manifestations extérieures, que celle observable dans les aires féminines d’un hôpital
psychiatrique. En outre, le caractère plus “performatique” de la folie féminine explique sans doute le fait que la
photographie psychiatrique française du XIXème siècle ( Archives photographiques de la Salpetrière...) se soit concentré
presque exclusivement et de manière symptomatique sur les études de l’hystérie féminine.
3 Le terme d’image du corps désigne de façon générique, une représentation photographique ou vidéographique du corps,
tout en gardant le sens de représentation sociale du corps mise en image.
4 L’hôpital Juliano Moreira accueille actuellement 168 patients, séparés par sexe en deux espaces : 102 femmes et 66
hommes. L’ hôpital, dirigé par le psychanalyste lacanien Marcello Veras, réalise plus de 3000 consultations par mois. En
effet, depuis un an, l’hôpital fonctionne de manière ouverte, et favorise la sortie des patients qui rentrent chez eux
rapidement (internement d’un mois en moyenne) et qui ne reviennent à l’hôpital que pour des entretiens et pour retirer
leurs médicaments.
5 D.E.S.S d’Ethnométodologie, Sales d’eau: les mises en scènes de l’hygiène corporelle parisienne,1996.

3
connaissance préalable et se soumettre complètement à la narration des délires et des
performances en jeux dans cet espace clos.
Les psychanalystes lacaniens se posent comme des «secrétaires de la psychose » et
considèrent cette entrée dans le monde psychique de leurs patients comme une forme de
psychanalyse sur le vif. En entrant dans « le laboratoire tragique des cliniques
psychiatriques, où l´étude des démontages des gestes humains projette parfois de si vives
lumières sur les lois profondes qui en commandent la marche normale » (Jousse,1974:12),
j’ai résolument suivi les perspectives de recherche ouvertes par Erving Goffman et David
Le Breton, en cherchant à observer les échanges de regards et le langage corporel dans un
champs de visibilité mutuelle et de co-présence. En réalité, cette tentative d’observer la
folie à partir d’une anthropologie visuelle et sonore ne prétend pas expliquer la folie en soi,
mais simplement élucider et interpréter ma propre interaction avec le groupe de pacientes
que je rencontrais régulièrement, en étudiant les visions qu’une personne « normale » peut
construire de la folie en pénétrant pour la première fois dans son univers « officiel ». Mon
travail de terrain s’est concentré dans l’espace féminin et plus particulièrement dans ce que
Goffman appelle les « espaces libres » – espaces dans lesquels le patient peut, avec une
certaine amplitude, se livrer à des activités interdites en d’autres lieux. Dans ce qui
apparaît clairement comme un “non-lieux” (Augé, 1992), un grand couloir à l’air libre, mon
expérimentation a prit la forme de sessions d’enregistrement d’images et de sons, dans
lesquelles ma propre interaction-filmée occupait le rôle central, vu « qu’il faut sans cesse
agir et justifier l’action, sous le regard d’autrui et que l’hôpital est un endroit d´observations
intenses et croisées.» (Peneff, 1992) A partir de cette expérience de visibilité mutuelle et
outillée, je me suis demandé comment je voyais la folie en interaction avec ces patientes, en
entrant, sans blouse blanche, dans leurs délires et performances et finalement j’ai cherché à
voir comment je pouvais distinguer le normal du « pathologique » à travers les images et
les sons que j’avais entre les mains et surtout à l´esprit ?
6 Doctorat de l’E.H.E.S.S, Corps à corps: regards dans les coulisses de la corpolatrie carioca, 1999.

4
1. Images de la psychiatrie au XIXème Siècle:
Du regard clinique au regard anthropologique.
“La visibilité est un piège.”
Michel Foucault
L’anthropologie et, avant elle, l’ethnographie, a toujours été fascinée par l’apparence
corporelle de l’Autre. Jusqu’en 1950, le corps était considéré comme le meilleur moyen de
comprendre les différences culturelles, une véritable clé pour étudier scientifiquement les
différences ethniques, esthétiques et éthique qui se reflétaient sur sa surface. C’est à partir
de cette vision du corps comme preuve visible, que le racisme scientifique se développe,
donnant naissance à deux nouvelles disciplines : l’anthropologie physique et
l’anthropométrie. Sans aucun doute, ces nouveaux « savoirs » sur le corps, en créant de
toute pièce la notion de type, ont influencé profondément l’utilisation de la photographie en
psychiatrie. Dès lors que le corps était vu comme une preuve, une évidence des différences
humaines, les scientifiques pensaient le corps comme « symptôme » et imaginaient, dans
cette logique, que les différences psychologiques et culturelles s’exprimaient exclusivement
à travers son apparence, ses signes visibles. En pensant le corps comme un simple
indicateur visuel de l’émotion, comme symptôme de l’âme, les psychiatres du final du
XIXème siècle, fascinés par la récente invention de la photographie, crûrent fermement en
son caractère « scientifique » et tombèrent tous dans l’illusion épistémologique et
méthodologique d’une photographie médicale. A partir du final du XIXème siècle, le
regard porté sur la maladie et sur le malade changent irrémédiablement, tout comme
changent les représentations du corps et les visions de ce dernier. Les psychiatres de cette
époque considère le corps comme un écran sur lequel se projettent les conflits intérieurs et
espèrent rendre visibles les traits spécifiques et la physionomie symptomatique du fou.
Dans les premières collaborations entre la photographie et la psychiatrie, « la photographie
ne servait pas seulement à identifier les patients mais elle aidait à reconnaître les
symptômes, à élaborer les typologies noséographique des maladies mentales et finalement

5
pouvait servir de substrat thérapeutique.”(Samain,1992). En réalité, le regard clinique qui
apparaît à la fin du XIXème, cherche à comprendre les maladies mentales en les rendant
visibles au niveaux de l´apparence corporelle. En passant de la maladie mentale
« invisible » au stigmate corporel photographié, les psychiatres semblent ne pas avoir pris
conscience, aveuglés par le contexte général de visualisation des maladies (catalogues des
maladies de peau et des malformations physiques, rayon X...) et par l´illusion réaliste de la
photographie, que le corps signifiant, porteur de messages passibles d´interprétations de la
part du médecin et du patient dépend également des représentations sociales du corps et de
la maladie. Ainsi, la photographie était considérée comme une aide précieuse pour décrire,
nommer et classer les différentes maladies « mentales », vu que le corps livrait finalement
ses profondeurs au scalpel de la photographie. La psychiatrie n’a pas échappé aux pièges de
la visibilité dont parle Foucault, et, dans l’immense oeuvre photographique de Charcot, le
rôle joué par l’image dans le déchiffrement des troubles mentaux montre à quel point, tout
le savoir sur la folie reste intimement lié aux images et autres représentations sociales de la
folie. De Charcot, nous passons à Freud, de Freud à Lacan et il semble finalement que, tout
comme le racisme scientifique, le rôle de l’image dans la compréhension de la folie soit
plus profond qu’il n’y parait à première vue et qu’il continue, de nos jours, à orienter
profondément les diagnostics en psychiatrie clinique tout comme en psychanalyse. A partir
de la relation ambiguë entre l’apparence et le nature des maladies dites « mentales », ces
représentations médicales de la folie invitent à questionner la nature même de l’image :
« Qu´est-ce aujourd´hui que l´image : un objet bien réel que l´on manipule ? Une
construction spirituelle que l´on accole aux choses et aux hommes ? Un élément important
du dossier médical ? » (Escande J-P, 1995) Peut-on encore croire aux pouvoirs de
révélation de l’image ?
A les regarder de plus près, ces images de la folie apparaissent toutes comme des
figures de la douleur, car « en image », la souffrance de l’autre n’est plus un simple
discours mais apparaît de façon hyperbolique. Ces images montrent également que les
médecins-psychiatres du XIXème siècle n’imaginaient pas à quel point leur propre
présence influençait les scènes de folie qu’ils enregistraient : le processus complexe de
création d’images de la folie ne confronte pas directement le médecin-photographe à son
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%