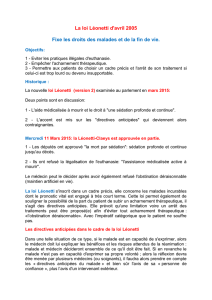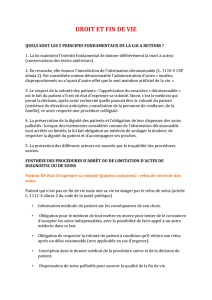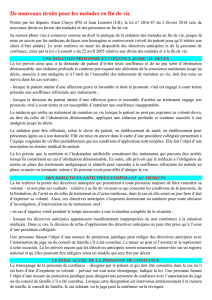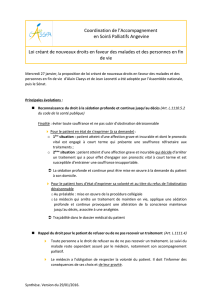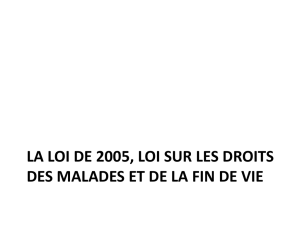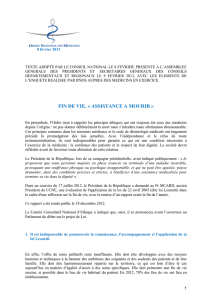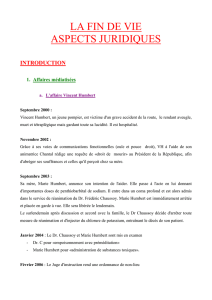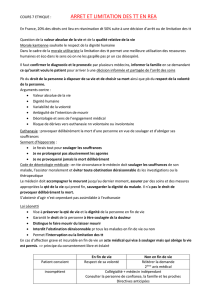sa mort choisir

PEUT-ON VRAIMENT
13 €
ISBN 978-284932-022-8
RepèRes
pouR les citoyens
et ceux qui les soignent
Préface
de Jean Leonetti
dr Bernard devaLois
SA MORT
CHOISIR
Choisir sa mort ? Éternelle question…
Ces
Repères pour les citoyens et ceux qui les soignent
balisent avec précision les contours des débats sur
la n de vie, l’euthanasie et le suicide assisté.
Pour aider chacun à en comprendre les enjeux de
société, Bernard Devalois propose une réexion
éthique, un décryptage de la loi d’avril 2005,
et démonte les manipulations médiatiques de
certaines aaires retentissantes, de Vincent Humbert
à Chantal Sébire. Des cas vécus, bouleversants
d’humanité, sont analysés à la lumière du respect
des patients et de leur famille, mais aussi de ceux
qui les soignent.
Dans sa préface, Jean Leonetti souligne que les
professionnels de santé « trouveront dans cet
ouvrage aux nombreuses facettes une source très
utile pour asseoir ou conforter leurs pratiques
professionnelles et pour nourrir leurs réexions sur
ce sujet complexe. »
Le docteur Bernard DEVALOIS, qui a été le président
de la Société Française d’Accompagnement et de Soins
Palliatifs, est anesthésiste-réanimateur de formation. Il est
actuellement responsable de l’unité des soins palliatifs de
l’hôpital de Puteaux (92).
Bernard devaLois
?
PEUT-ON VRAIMENT CHOISIR SA MORT ?
PEUT-ON VRAIMENT
CHOISIR SA MORT ?

Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Jean de la Fontaine
Dans la même collection
Superman va mourir
Journal d’une inrmière en soins palliatifs
par Pascale Boumédiane
ISBN 978-284932-022-8
© Éditions Solilang
28, rue Camille-Jullian, 87000 Limoges
www.solilang.net

Préface
Pour n’importe lequel d’entre nous, parler de la mort
et de la n de vie requiert beaucoup d’humilité. Parce que
par formation et par culture, ils sont souvent plus attachés
à une médecine technique conquérante qu’au « prendre
soin », l’exercice n’est pas plus facile pour les professionnels
de santé. Faire le choix exclusif d’une rhétorique lyrique,
loin de la réalité et des gestes quotidiens du soin ne saurait
correspondre aux attentes des patients et de leurs proches.
S’abriter derrière un discours fondé sur la seule compétence
et l’expérience professionnelle, pas davantage.
Dans son essai à la fois brillant, synthétique et
pédagogique, intitulé Choisir sa mort ?, le docteur Bernard
Devalois, responsable de l’unité de soins palliatifs de
l’hôpital de Puteaux et président de la Société française de
soins palliatifs de 2005 à 2007, sait surmonter ces obstacles.
En ayant le ton juste et en nous faisant partager une vision
humaniste du soin, il nous invite à la réexion, face à des
situations souvent complexes, toujours personnelles, ne
s’accommodant pas de raisonnements simplistes. Qu’il
s’agisse de l’obstination déraisonnable, du double eet, de
l’arrêt de l’alimentation ou de l’hydratation et du recours à
la sédation, il inscrit sa démarche dans le sillon des bonnes
pratiques professionnelles, et aronte les questions
médicales sans esquiver les interrogations éthiques. Il
rappelle qu’au terme d’une longue maturation, la loi du
22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la n de
vie a tenté de trouver une réponse sage et mesurée aux
décisions de limitation ou d’arrêt de traitement et a récusé
l’ouverture d’un droit à la mort dont on peut mesurer les
dérives dans les pays qui ont choisi cette voie.
5

6
En décryptant avec minutie les questions qui émergent
en présence d’une situation potentielle d’obstination
déraisonnable, en déclinant des analyses de cas cliniques
tirés de sa riche expérience, il plaide avec fermeté pour
l’accompagnement des malades, pour la prise en compte
de leurs souhaits à travers les directives anticipées et la
personne de conance ainsi que pour la transparence
des décisions médicales. Maîtrisant tous les enjeux
médicaux, éthiques, sociaux, juridiques et humains
de cette problématique, il appelle à l’application des
recommandations de la Mission parlementaire d’évaluation
de la loi de 2005 qu’il suit avec une extrême vigilance et
qu’il a largement inspirés.
Nul doute que les professionnels de santé, qui
connaissent encore souvent mal ces règles, trouveront dans
cet ouvrage aux nombreuses facettes une source très utile
pour asseoir ou conforter leurs pratiques professionnelles
et pour nourrir leurs réexions sur ce sujet complexe.
Jean LEONETTI
Député des Alpes maritimes.
Rapporteur de la Mission d’information de l’Assemblée nationale
de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la
n de vie.
Rapporteur de la Mission d’information de l’Assemblée nationale
sur l’accompagnement de la n de vie.
À l’homo sapiens et à l’homo galacticus,
à cette chaîne de tous mes frères humains
venant du passé ou tendant vers l’avenir,
qui nous lie dans le temps comme dans l’espace.
À tous ceux dont la sincérité
l’emporte sur la croyance en des dogmes,
À celles et ceux que j’aime
(en référence aux trois amours des Grecs :
Eros, Philia et Agapè).
Ils/Elles se reconnaîtront !
Préface

9
1. Prologue
Les faits ne pénètrent pas
dans le monde où vivent nos croyances,
ils n’ont pas fait naître celles-ci,
ils ne les détruisent pas ;
ils peuvent leur iniger les plus constants démentis,
sans les aaiblir.
Marcel Proust
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
1
/
99
100%