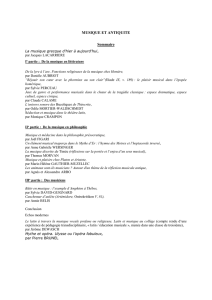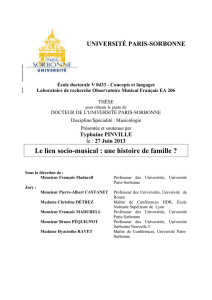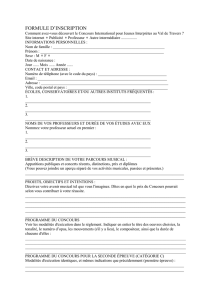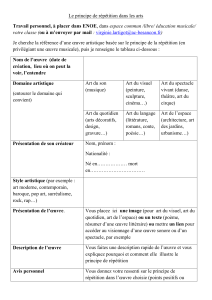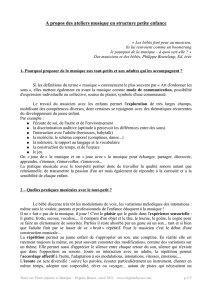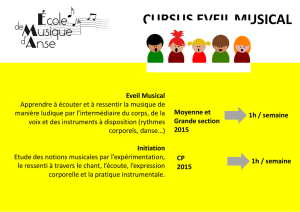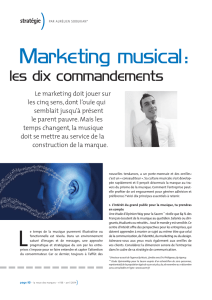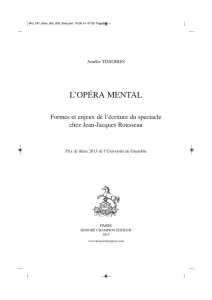PDF 415k - Revue des sciences religieuses

Revue des sciences religieuses
88/2 | 2014
Varia
Le temps musical
Entre philosophie et théologie
Philippe Capelle-Dumont
Édition électronique
URL : http://rsr.revues.org/824
DOI : 10.4000/rsr.824
ISSN : 2259-0285
Éditeur
Faculté de théologie catholique de
Strasbourg
Édition imprimée
Date de publication : 1 avril 2014
Pagination : 149-159
ISSN : 0035-2217
Référence électronique
Philippe Capelle-Dumont, « Le temps musical », Revue des sciences religieuses [En ligne], 88/2 | 2014,
mis en ligne le 15 septembre 2014, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://rsr.revues.org/824 ;
DOI : 10.4000/rsr.824
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
© RSR

Revue des sciences religieuses 88 n° 2 (2014), p. 149-160.
LE TEMPS MUSICAL
Entre philosophie et théologie 1
Platon et les Pythagoriciens avant lui ont compris sous le nom de musique
la philosophie tout entière. Suivant eux, ce sont les lois de l’harmonie qui
maintiennent le monde et toute forme ou idée musicale est proprement
l’œuvre de la divinité 2.
Cette évocation ancienne de l’historien géographe Strabon
(58 av. J.-C. – 16 ap. J.-C.), et l’accord des origines qu’elle y exprime
ne sont étonnants que pour nos oreilles déshabituées : musique, philo-
sophie et théologie, dans leurs motifs et leurs modalités expressives
propres, ont partitions liées. De Platon à saint Augustin, de Luther à
Bach, de Rousseau à Nietzsche et de Mozart à Balthasar, elles habitent
toutes trois le temps où les passions méditent, où la pensée vibre et où
le divin harmonise. La mise en jeu de l’esthétique musicale, loin de
constituer une polarité décorative, participe ainsi depuis toujours et au
premier rang, de l’effort d’intelligence du monde que prennent systé-
matiquement en charge le philosophe et le théologien.
Une intimité fondatrice
Si Platon a introduit dans la plupart de ses Dialogues des considé-
rations musicales, c’est à raison d’une exigence qui concerne le temps
de l’éducation et l’art (« technê »), dont elle relève :
Pour ces deux éléments de l’âme, le courageux et le philosophique, un
dieu, dirai-je, a donné aux hommes deux arts, la musique et la gymnas-
tique. Il ne les a pas moins donnés pour l’âme et le corps si ce n’est par
incidence, mais pour ces deux éléments là (le courageux et le philoso-
phique), an qu’ils s’harmonisent entre eux 3.
1. Version abrégée d’une conférence donnée à l’Université grégorienne de Rome
le 8 mai 2013 dans le cadre du cycle de conférences : « Ce qui se donne dans l’œuvre »,
organisé par l’Institut français de Rome (Ambassade de France près le Saint-Siège).
2. Géographie de S
trabon
, traduction de Amédée Tardieu, Tome 1, Livre X, chap.
3, §10, 1-3, Hachette, 1867.
3. Platon, République, 411c.
MEP_RSR 2014,2.indd 149 21/03/14 15:18

150 PHILIPPE CAPELLE-DUMONT
Point d’instrumentalisation « citoyenne » de la musique cependant :
adoptant la métaphore de l’harmonie enracinée dans le mythe Ἁρμονία,
lle d’Arès et d’Aphrodite, Platon en déclarait d’emblée la provenance
divine, allant jusqu’à célébrer l’ultime mot de son maître Socrate : « Y
a-t-il en effet plus haute musique que la philosophie (hôs philosophias
men ousês megistês mousikês) ? 4 », et à s’approprier la formule de Thalès
selon laquelle « tout est plein de dieux 5 ».
Si Aristote reconnut à la musique une n en soi, hors des cadres
de l’utile, il refusa de l’arrimer à l’idée d’une quelconque harmonie
céleste 6 : « Ce n’est jamais Zeus lui-même qui chante et joue de la
cithare ». Toutefois, puisque « la musique compte parmi les choses les
plus agréables », pourquoi, poursuivait-il, amusé, le dieu s’en prive-
rait-il 7 ? Une restriction de taille cependant : le grand défaut de la ûte
est qu’elle « empêche de recourir au langage
8
» contrairement à la cithare
qui porte le chant du poème
9
. La leçon était claire : dès lors qu’elle
s’oppose au temps du logos, ou l’interdit, la musique entraînera la
déance du philosophe.
Saint Augustin, dans son De Musica, n’a pas congédié le lexique
de l’harmonie pour relier analogiquement l’âme, le monde et Dieu.
« Science qui apprend à bien moduler
10
» (Livre, I, 1, 2), la musique doit
« bien » ordonner les mouvements. S’il consacre alors tant de lignes à la
question des rythmes, c’est qu’il ne veut pas voir amputée l’économie
temporelle de l’itinéraire qui mène des harmonies d’ici-bas encore maté-
rielles aux harmonies de la vérité affranchies du péché 11.
Boèce, le premier « scolastique », n’abandonnera pas lui non plus
le vocabulaire de l’harmonie pour dire la présence de la musique dans
l’univers, dans l’homme et dans les sons « mélodieux » des instruments.
Et cette approche tripartite constituera un modèle pour les traités de
musique jusqu’au 16e siècle : musica mundana, musica humana et
4. id., Phédon 61a.
5. id., Lois, X, 899b
6. ariStote, Du ciel, II, chap. 9, 290.
7. id., Politique, VIII, 5.
8. id., Politique, chap. 6, 41a, 25
9. On a pu lire ici la référence à la légende selon laquelle Athéna qui avait inventé
la ûte la rejeta après avoir vu dans un miroir les grimaces qu’inigeait à son visage
la nécessité de soufer dans le « chalumeau ». Cf. A. beliS, « Aristote et la musique »
dans Aristoxène de Tarente et Aristote, « Le Traité d’harmonique », Klincksieck, 1986,
chap. 2, p. 53-85.
10. Saint aUgUStin, De Musica, I, 1, 2.
11. « Les harmonies d’ici-bas se hiérarchisent selon leurs principes – les sens,
le jugement, la raison ; et selon cet acheminement il faut monter jusqu’à l’harmonie
tout intellectuelle de la vérité. Et nous serons ainsi détachés du péché lié au corps et
pourrons rejoindre Celui qui a tout créé », De Musica, Livre VI, 13
MEP_RSR 2014,2.indd 150 21/03/14 15:18

LE TEMPS MUSICAL 151
musica instrumentalis. Puisque l’homme prolonge la nature par l’art,
disait-il, il est naturel que la musique instrumentale réalise les mêmes
lois découvertes dans la nature.
Descartes modiera la donne. L’une de ses toutes premières œuvres,
qui fut consacrée à la musique, soit le Compendium Musicae (1618),
aura marqué le degré de précocité avec lequel le thème des passions
fut transversal à sa méditation. Si « [la musique] a pour n de plaire
et d’exciter en nous diverses passions », c’est parce qu’elle épouse et
traduit les mouvements de l’âme. La rupture cartésienne s’exprime
nettement en ces lieux : la musique ne saurait puiser sa forme dans la
nature, car elle est « un élément d’abord fait par l’art et pour l’art 12 ».
Schopenhauer considérait lui aussi que la musique, à la différence
des autres arts, ne reproduit rien : expression de toute la volonté qu’est
le monde, elle dit l’être des choses dans leur essentielle profondeur
et non leur furtive manifestation 13. On comprend d’autant mieux ce
mot de Nietzsche – qui avait dans sa jeunesse composé rien de moins
qu’un requiem, un oratorio et un miserere ! : « Sans la musique, la vie
serait une erreur 14 ». Aussi bien dans le Drame musical grec, où il
cite Schopenhauer, que dans Par-delà le bien et le mal (§ 106), où il
s’en sépare nettement, Nietzsche exalte la musique comme le vital de
la vie en ses pulsions natives. Qu’est-ce à dire ? Relisant les carnets
de Nietzsche, de Sartre et de Barthes, F. Noudelmann a fait ressortir
un surprenant trait commun ; leur goût du corps-à-corps charnel avec
l’instrument faisait advenir un tempo qui échappait au travail intellec-
tuel 15. C’est dans une direction similaire que Michaël Levinas évoque
le souvenir de son maître Lazare-Lévy qui « jouait Bach et Chopin sur
un Erard assourdi et posait les mains sur le bois du piano pour mieux
éteindre la possible vocalité indécente de l’instrument 16 ». La musique
instrumentale n’est pas exempte du devoir de discrétion.
C’est sans doute par ce biais que peut s’apercevoir l‘intimité des
contenus théologiques avec le monde musical. Toux ceux qui s’en sont
inquiétés dans des pages de commentaires souvent éloquents, relevant les
fortes et délicates inspirations des thèmes christiques dans la construction
des œuvres – l’Incarnation, la Passion, la Résurrection, la Crucixion et
12. René deScarteS, Abrégé de la musique, dans Œuvres, (Texte établi
par V. Cousin), Levrault, 1824, Tome V, p. 444.
13. Arthur SchoPenhaUer, Le monde comme volonté et représentation, Paris,
Folio-Gallimard, 2009.
14. Friedrich nietzSche, Crépuscule des idoles, « Maximes et traits », § 33, Paris,
Gallimard.
15. François noUdelmann Le toucher des philosophes, Paris, Gallimard, 2008.
16. Michaël levinaS, « Avant-propos » dans André Gide, Notes sur Chopin, Paris,
Gallimard, 2010, p.27.
MEP_RSR 2014,2.indd 151 21/03/14 15:18

PHILIPPE CAPELLE-DUMONT
152
la mort –, qu’il s’agisse de Beethoven
17
, Mozart
18
, Bach
19
et Verdi
20
ou
encore Britten
21
et Messiaen
22
. D’un autre part cependant, nous pouvons
établir entre musique, philosophie et théologie une conversation trian-
gulaire sur une base conceptuelle qui concerne la question du temps.
le concePt commUn de temPS
La musique est « temps », au point où elle ne se manifeste que dans
l’unité de temps ; son « ontologie », contrairement aux œuvres picturales
et sculpturales, est d’emblée et nécessairement temporelle. La théologie
non moins profondément est « temps » puisqu’elle manifeste son unité en
vertu du temps eschatologique de l’accomplissement christique. Quant
à la métaphysique, elle est parvenue au 20e siècle à établir l’équation
de l’être et du temps. Toutes sont à leur manière dépositaires d’un écho
mystérieux à l’ancienne énigme de saint Augustin : « Qu’est-ce que
en effet que le temps ? Qui saurait en donner avec aisance et brièveté
une explication ?… Si personne ne me pose la question, je le sais ; si
quelqu’un pose la question et que je veuille expliquer, je ne sais plus
23
».
Mais cette énigme distinctive reçoit auprès de la musique quelque
lumière si l’on se rappelle que le temps (temnein = couper) exprime
d’abord la mesure. Aristote écrivait dans sa Physique que « le temps
est le nombre (arithmon) du mouvement 24 ». Et Spinoza, qui n’hésitait
pas à soutenir, suivant Descartes, que le « temps » est une production
de l’esprit imaginatif, se demandait pourquoi l’être humain voulait
cependant le tenir pour quelque chose de « réel ». Mais ce que nous
enseigne la musique, c’est non pas le temps, ce sont « les temps », soit :
la mesure, la mesure à deux, à trois ou à quatre temps ; elle indique qu’il
n’est point de rapport à la durée sans la construction du nombré, de
l’intervalle, du divisible. Comment le temps musical, temps des mesures
17. À quand une thèse sur la musique sacrée de Beethoven ?
18. Voir les travaux de Fernando ortega, notamment Beauté et révélation chez
Mozart, Paris, Parole et silence, 1998.
19. Voir Philippe charrU (dir.), Le baroque luthérien de Jean-Sébastien Bach,
Paris, Éditions Facultés jésuites du Centre Sèvres, 2007.
20. Cf. David B. green, The Theology of Handel’s Messiah, Beethoven’s Credo,
and Verdi’s Dies Irae : How Listening to Sung Theology Leads to the Contemplation
of God, Lewiston, New York, Edwin Mellen Press, 2012.
21. Cf. « War requiem » de britten, créé en 1962 pour la nouvelle consécration
de la cathédrale de Coventry (Angleterre)
22. Cf. Siglind brUhn, Messiaen’s Language of Mystical Love, New York, Garland,
1998 ; Les visions d’Olivier Messiaen, Paris, L’Harmattan, 2008
23. Saint aUgUStin, Confessions, XI, 14, 17
24. ariStote, Physique IV, 219.
MEP_RSR 2014,2.indd 152 21/03/14 15:18
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%