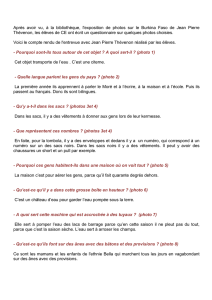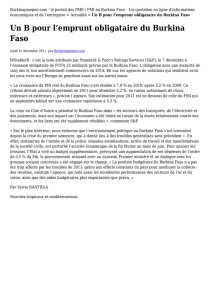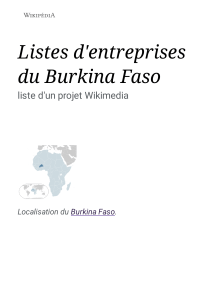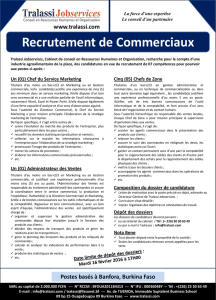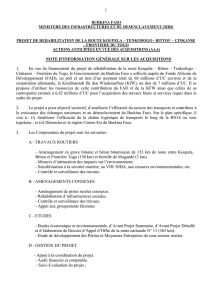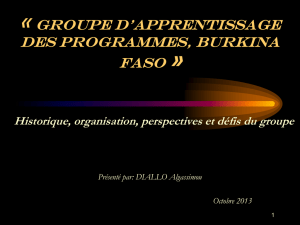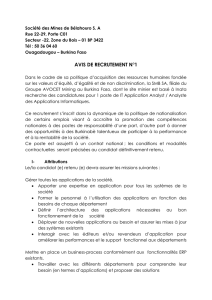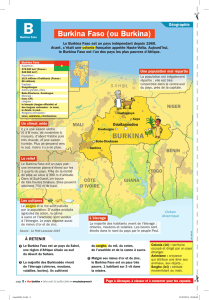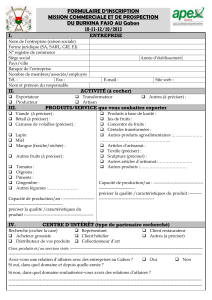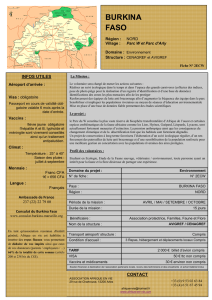RAPPORT_ASIE SUD EST_Partie II

Deuxième partie
Expérience Sud-est asiatique: implications pour la
politique de développement économique en Afrique:
cas du Burkina Faso

1
Sommaire
Sigles et abréviations………………………………………………………………………………… i
Sommaire ............................................................................................................................................. 1
Introduction .......................................................................................................................................... 2
Chapitre 1. Rappel des politiques menées dans les initiatives africaines de développement .............. 2
1.1. Le plan Sarraut .......................................................................................................................... 2
1.2. Les Programmes d'Ajustement Structurel ................................................................................. 3
1.3. Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) ................................. 5
1.4. Le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) ...................................................... 7
Chapitre 2. Lecture comparée des initiatives africaine et asiatique ................................................... 12
2.1. Les politiques communes ........................................................................................................ 12
2.2. Les politiques spécifiques aux économies asiatiques ............................................................. 22
Chapitre 3. Contribution de l'expérience asiatique au développement de l'Afrique et plus
précisément, du Burkina Faso ............................................................................................................ 28
3.1. La dynamique de la population ............................................................................................... 29
3.2. L'industrialisation par les exportations ................................................................................... 30
3.3. La politique du « Market Friendly Approch » ........................................................................ 34
Conclusion ......................................................................................................................................... 35
Annexes .............................................................................................................................................. 37
Bibliographie ...................................................................................................................................... 38
Annexe………………………………………………………………………………………………..I

2
Introduction
La première partie a retracé les traits fondamentaux de l'expérience du Sud-Est asiatique en matière
de développement économique et social. A la lumière des facteurs récurrents que cette partie initiale
a permis d'isoler, il est utile d'apprécier dans une seconde phase, les modèles africains de
développement pour y déceler d'une part, les constantes communes et d'autre part, les insuffisances
et prescrire les recommandations nécessaires à une réelle transformation économique et sociale du
continent, singulièrement du Burkina Faso. Mais auparavant, il convient de faire un tour d'horizon
des politiques menées dans les initiatives africaines régionales et nationales de développement.
Chapitre 1. Rappel des politiques menées dans les initiatives
africaines de développement
La présente section ne traite pas de tous les plans de développement qui ont jalonné l'histoire
économique et sociale du continent mais de ceux qui se sont révélés déterminants dans son
processus de développement. Ainsi, on rappellera successivement les grands axes du Plan Sarraut
(PS), des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS), du Nouveau Partenariat pour le
Développement de l'Afrique (NEPAD). Dans le souci de traiter d'un cas concret, un intérêt
particulier sera accordé à l'examen des efforts de développement du Burkina Faso à travers le Cadre
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui est le principal référentiel des interventions en
matière de réduction de la pauvreté.
1.1. Le plan Sarraut
Le Plan Sarraut (PS) est le précurseur des initiatives de développement en Afrique subsaharienne.
Son idée centrale était que la métropole française devait investir pour développer ses colonies. Par
rapport à cette vision, le plan s’est fixé deux objectifs de long terme (L
T
). Il fallait d’abord investir
massivement et méthodiquement pour développer les zones d’activités économiques (les gisements
miniers, les cultures de rente, etc.) ensuite, préparer la décolonisation et conserver les relations
économiques et politiques nouées avec les colonies. Ses dispositions comportaient à la fois des
programmes d’investissement en infrastructures et des programmes de développement social.
L’investissement en infrastructures était considéré dans le plan comme la clé du développement.
Les infrastructures privilégiées sont ceux qui jouent des effets structurant sur l’activité
économique : les chemins de fer, les routes, etc. Quant au développement social, il devait favoriser
une meilleure alimentation, une assistance médicale, une couverture sanitaire et surtout, le

3
développement des ressources humaines par la formation d’un stock de capital humain à travers
l’instruction des indigènes. Sarraut estimait qu’il était du devoir de la métropole d’assurer à la
population coloniale, la santé, l’hygiène et les forces de la vie. Pour lui, l’instruction des indigènes
était également un devoir fondamental qui s’accorde avec les intérêts économiques, administratifs,
militaires et politiques les plus évidents. En effet, l’éducation à l’avantage d’améliorer la valeur de
la production coloniale en raison des hausses de productivité des indigènes. Une croissance
économique plus rapide nécessitait alors un développement accéléré des ressources humaines. Il
insistait déjà sur l’importance du facteur humain, notamment l’utilité de l’éducation dans le
développement des colonies. Toutefois, le plan n’a pas eu tout le soutien nécessaire parce que le
parlement français n’a pas signé les projets de loi de finance (Giri Jacques, 1996). Dans leurs
dispositions, les plans africains prolongent l'esprit de Sarraut. On peut donc aisément affirmer qu'ils
ont évolué plus par continuités que par ruptures. Cependant, une rupture d'objectifs est apparue avec
les PAS dans les années 1980.
1.2. Les Programmes d'Ajustement Structurel
Les Institutions Financières Internationales (IFI) : la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire
International (FMI) estimaient que la source de la crise africaine était d’origine financière. Elles
préconisent des programmes de stabilisation et d’ajustement structurel pour redresser les agrégats
macroéconomiques (taux d’inflation, taux de croissance, soldes budgétaire et commercial). La
stabilisation visait à résorber les déséquilibres internes (déficit budgétaire et inflation galopante) et
externe (le déficit du compte courant extérieur hors dons, etc.) à travers une autérité budgétaire
(baisse des salaires et des dépenses sociales, suppression d’emplois, accroissement des recettes,
etc.), un resserrement du crédit domestique et une dévaluation pour stimuler les exportations. La
stabilisation était un préalable à l’ajustement. L’ajustement poursuivait la libéralisation des prix et
des échanges. Il fallait alors, libéraliser les taux d’intérêt pour booster l’épargne puis
l’investissement en réaction contre la répression financière, privatiser les entreprises publiques pour
une meilleure gestion et éliminer les distorsions de prix des biens et services, des intrants (ou
facteurs de production) dans les différents secteurs de l’activité économique.
A partir de 1991, le Burkina Faso s’est engagé à mener ces réformes pour assainir son cadre
macroéconomique. Toutefois, ces programmes ont engendré des incidences économiques,
financières et sociales communes aux pays africains sous ajustement. Comme incidences
économiques, les efforts d’austérité n’ont pas apporté d’amélioration significative aux grands
équilibres macroéconomiques puisque des pays se retrouvent avec un endettement accru et un
investissement en chute libre. En outre, les ajustements ont entraîné une contraction brutale des
importations d’équipement. Comme l’effet multiplicateur de celles-ci est particulièrement important
en Afrique, les conséquences pour le PIB et les investissements furent dramatiques. La recherche de

4
solution à l’endettement réside non dans la baisse des dépenses, mais dans l’accroissement des
recettes d’exportations (Norro, 1992). Bref, le développement des pays endettés. Du point de vue
monétaire et financier, la politique déflationniste du FMI a contribué à déprimer le niveau de la
production et des investissements. La théorie enseigne pourtant qu’une politique de déflation se
justifie essentiellement lorsque l’origine du déséquilibre se situe dans un excès de demande.
Attribuer la source du déséquilibre à l’absorption élucide les difficultés de l’endettement qui montre
que l’origine a surtout été extérieur : retournement conjoncturel, hausse des taux d’intérêt,
dimunition de l’inflation mondiale, etc. Dans ces conditions, la politique d’austérité fut
« autodestructrice » (CNUCED, 1985). Quant aux incidences sociales, elles semblent les plus
importantes et se regroupent en deux catégories :
• l’incidence sur les ressources humaines
La baisse des dépenses publiques consacrées aux secteurs sociaux tels que l’éducation, la santé et
l’emploi a compromis l’investissement dans le capital humain, notamment le développement et la
mise en valeur des ressources humaines, justifiant aujourd’hui la faiblesse du stock de capital
africain : baisse des niveaux en matière d’enseignement et de formation, aggravation de la
malnutrition et des problèmes de santé.
• l’incidence sur le bien-être
La réduction des dépenses sociales a permis de dégager des ressources pour assurer le service de la
dette et réduire les déficits budgétaires ; mais le coût d’opportunité a toujours été l’aggravation
croissante de la misère des populations : renforcement des inégalités de revenus et détérioration du
niveau de vie des groupes sociaux les plus vulnérables (les femmes, les enfants, les personnes
âgées, etc.) à l’origine de troubles sociopolitiques sévères (les pressions syndicales, la réaction de la
société civile, etc.).
Au total, les institutions de Bretton woods ont privilégié les équilibres macrofinanciers et les
ajustements du court terme (C
T
) aux dépens des projets de développement de longue période. En
effet, ces programmes ont dissocié les objectifs de C
T
de rétablissement des équilibres financiers de
ceux de long terme (L
T
) de transformation économique et sociale. Or précisément, le plan indicatif
qui est un réducteur d’incertitude (Massé, 1965), doit favoriser un processus de développement de
L
T
. Si les PAS ont oeuvré en partie au redressement de certains agrégats macroéconomiques,
notamment l’assainissement des finances publiques et la consécration du secteur privé comme
moteur de la croissance économique, ils n’ont pas permis de lutter efficacement contre la pauvreté.
Pis, ils ont accru l’état de pauvreté des populations du continent justifiant le passage à des
programmes de développement comme le NEPAD et les cadres nationaux de lutte contre la
pauvreté, axés essentiellement sur des politiques d’éradication de la pauvreté.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%