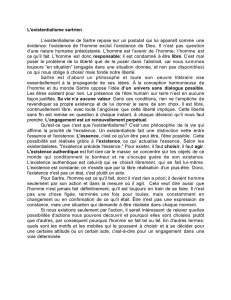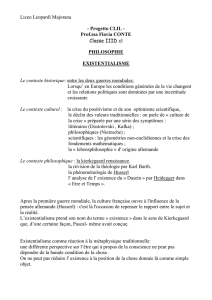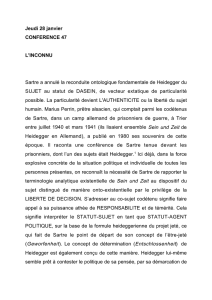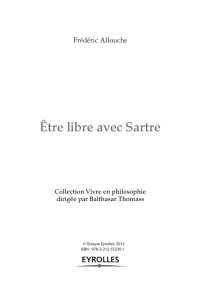Bulletin d`analyse phénoménologique Vol. 10, n°11 - ORBi

Bulletin d’analyse
phénoménologique
Vol. 10, n°11
Série Actes, 7
Don, Langage, Contre-
temps: Diagonales
giovannangeliennes
Société belge de philosophie

Bulletin d’analyse phénoménologique X 11, 2014 (Actes 7)
ISSN 1782-2041 http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/
Série Actes 7 : Don — Langage — Contretemps : Diagonales giovannangeliennes
Avant-propos
Le 2 mai 2014, la Société belge de philosophie a souhaité mettre à
l’honneur l’un de ses membres fidèles et ancien président (de 1996 à 1999),
Daniel Giovannangeli. Professeur émérite de philosophie moderne et con-
temporaine à l’Université de Liège, spécialiste de Jacques Derrida, de
l’esthétique, de la phénoménologie et de la philosophie française, Daniel
Giovannangeli peut être considéré comme une figure éminente de la philo-
sophie en Belgique. Il semblait dès lors bien naturel que la Société belge de
philosophie se penche sur ses travaux le temps d’un après-midi.
La première partie de ce volume rassemble les contributions présen-
tées à l’occasion de cette rencontre. Elle vise toutefois moins à parler de
Daniel Giovannangeli qu’à s’inscrire dans le sillage de son travail, à explorer
des pistes qu’il a lui-même creusées, à aborder des questions auxquelles il
s’est frotté tout au long de sa carrière. En quelques mots, elle entend
poursuivre l’enquête de Daniel Giovannangeli, tout en se situant à sa marge.
La seconde partie est constituée d’articles écrits par d’anciens étu-
diants, collègues ou collaborateurs, qui ont accepté de présenter le travail de
Daniel Giovannangeli au fil de ses principaux écrits. Elle dresse ainsi une
sorte de présentation bio-bibliographique qui laissera au lecteur la possibilité
d’apprécier le parcours intellectuel de Daniel Giovannangeli et, nous l’espé-
rons, le désir de (re-)découvrir ses textes marquants.
Au nom de la Société belge de philosophie, nous remercions vivement
tous les participants à cet après-midi de conférences. Les textes réunis ici
donneront au lecteur un aperçu de ce moment d’intense activité philo-
sophique. Nous remercions également l’Université Saint-Louis – Bruxelles,
qui a généreusement apporté son soutien logistique à la rencontre. Enfin,
nous remercions le comité de rédaction du Bulletin d’analyse phénoméno-
logique d’accepter la publication de ce numéro spécial.
M.-A. GAVRAY, R. GÉLY, S. RICHARD
1

Sommaire. Avant-propos. — Derrida et la décision philosophique (D. Gio-
vannangeli). — Penser ce que nous ne pouvons pas nous représenter (R.
Bernet). — De l’inconditionnel moral chez Kant et chez Sartre (J. Simont).
— Le fictionnel et le fictif (É. Clemens). — Une autre histoire de la
contingence : Parcours aux limites de l’ontologie phénoménologique, à partir
de D. Giovannangeli, Finitude et représentation (2002) (G. Dassonneville).
— Questions de méthodes : Sartre, Giovannangeli, la phénoménologie et les
« structuralistes » (G. Cormann). — L’activité d’autrui : Notes à partir de La
Passion de l’origine (A. Cavazzini). — Le langage et l’homme (F. Dubuis-
son). — L’être de la fiction : L’imagination entre donation de sens et dona-
tion sensible (B. Leclercq). — Le mutisme comme phénomène : Une lecture
de L’Animal que donc je suis (Th. Bolmain).
2

Bulletin d’analyse phénoménologique X 11, 2014 (Actes 7)
ISSN 1782-2041 http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/
Derrida et la décision philosophique
Par DANIEL GIOVANNANGELI
Université de Liège
Pour Anne.
Très tôt, Jacques Derrida a soulevé la question de la décision. Ainsi,
lisant en 1963 l’Histoire de la folie de Michel Foucault, interrogeait-il ce que
Foucault y appelait, d’un mot que Derrida qualifiait de « très fort »1, la
Décision qui opère la séparation de la raison d’avec la folie. De son côté,
Derrida proposait de parler d’une dissension « pour bien marquer qu’il s’agit
d’une division de soi, d’un partage et d’un tourment intérieur du sens en
général, d’un partage dans l’acte même du sentire »2. On sait quelle
persévérance il allait montrer à cerner cette déhiscence, dans la fidélité
déclarée (en 1990) à la parole d’Héraclite : « l’ “un différant de soi”, l’hen
diapheron heautōi d’Héraclite, voilà peut-être l’héritage grec auquel je suis
le plus fidèlement docile […] »3.
Il ne peut être question pour moi de rendre intégralement compte du
rapport que, chez Derrida, la philosophie noue avec la décision. Pour jeter un
regard rétrospectif sur ce qui a constitué l’entame de mon propre travail, à la
fin des années soixante, il s’est imposé à moi de reconsidérer ce qui m’avait
attiré vers cette pensée, à savoir l’articulation de la philosophie et de la
littérature. Je n’ajouterai donc rien de bien neuf à ce que j’ai dit et écrit4.
1 J. Derrida, L’Écriture et la Différence, Paris, Le Seuil, 1967, p. 62.
2 Ibid.
3 J. Derrida, « Nous autres Grecs », dans B. Cassin (éd.), Nos Grecs et leurs
modernes, Paris, Le Seuil, 1992, p. 273.
4 J’ai, naguère, à l’invitation de Thomas Bolmain et Grégory Cormann, consacré un
exposé à la lecture derridienne de Mallarmé. Mon texte en est issu.
3

Derrida publie d’abord son Introduction à sa traduction de L’Origine
de la géométrie de Husserl, en 1962, avant le tir groupé de 1967, qui voit
paraître De la Grammatologie, La Voix et le phénomène et L’Écriture et la
différence. La conférence (en deux séances, le 26 février et le 5 mars 1969)
que Derrida a consacrée à Mallarmé et précisément intitulée, d’une
expression de Mallarmé, « La double séance »1, marque, au moins par la
complexité de son écriture, un changement visible dans l’œuvre derridienne.
« La double séance » de Derrida reste indissociable du groupe, de la revue et
de la collection qui l’accueillirent : comme L’Écriture et la différence en
1967, La Dissémination (ce terme est lui aussi emprunté à Mallarmé, « Quant
au Livre »2) parut dans la collection « Tel Quel » des éditions du Seuil. Dans
le livre figure, outre « La double séance », l’article lui-même intitulé « La
dissémination », et qui consiste en une lecture de Nombres de Sollers, ainsi
que « La pharmacie de Platon », le tout précédé d’un « Hors livre »
largement consacré à Hegel. La conférence, « La double séance », si elle ne
fait pas référence à Sartre, commence pourtant par s’en distinguer carrément
quoique allusivement. Derrida y annonce en effet d’entrée de jeu qu’il ne
traitera pas de la question qu’est-ce que la littérature ?, « cette question
devant désormais être reçue comme une citation déjà où se laisserait solliciter
la place du qu’est-ce que, tout autant que l’autorité présumée par laquelle on
soumet quoi que ce soit, singulièrement la littérature, à la forme de son
inquisition »3. Il le redira plus loin : « il n’y a pas d’essence de la littérature,
de vérité de la littérature, d’être-littéraire de la littérature »4. Faisant en 1971
le point sur son propre travail, Derrida se retourne sur le chemin qu’il vient
de parcourir depuis le champ de l’histoire de la philosophie jusqu’à certains
textes appartenant certes au champ littéraire (Derrida use lui-même, on va le
voir tout de suite, du concept de champ, définitivement lié, désormais, à la
pensée de Pierre Bourdieu) mais qui l’ont retenu parce qu’ils lui semblaient
« marquer et organiser une structure de résistance à la conceptualité
philosophique qui aurait prétendu les dominer, les comprendre, soit directe-
ment, soit au travers des catégories délivrées de ce fonds philosophique,
celles de l’esthétique, de la rhétorique ou de la critique traditionnelles »5. On
1 Cf. Le « Livre » de Mallarmé, édité par J. Scherer, cité dans J. Derrida, La
Dissémination, Paris, Le Seuil, 1972, p. 202.
2 J. Derrida, La Dissémination, op. cit., p. 204.
3 Ibid., p. 203.
4 Ibid., p. 253.
5 J. Derrida, « Positions. Entretien avec J.-L. Houdebine et G. Scarpetta », dans
Positions, Paris, Minuit, 1972, p. 94.
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
1
/
154
100%