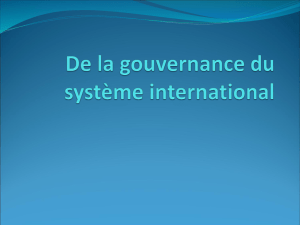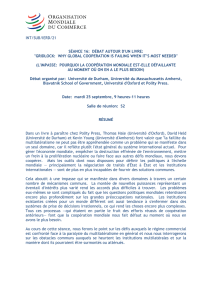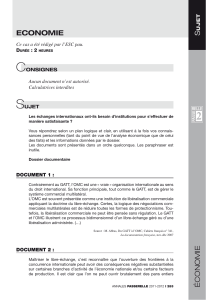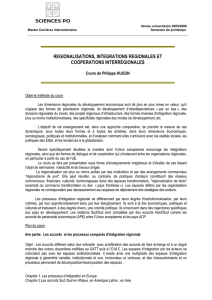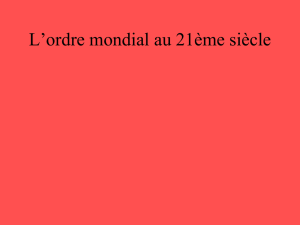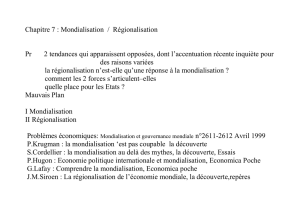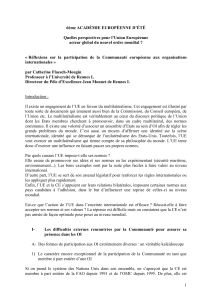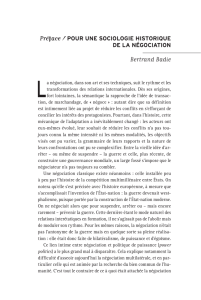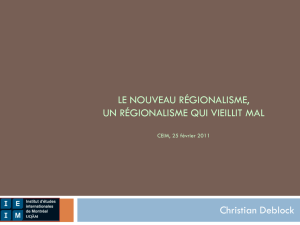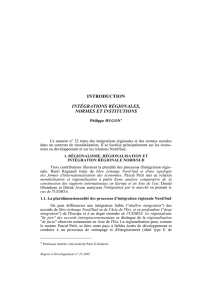Quel rôle peuvent jouer les organisations d`intégration

FORUM INTERNATIONAL SUR LES INTERFACES
ENTRE POLITIQUES ET SCIENCES SOCIALES
UNE PLATE-FORME INNOVANTE POUR RESSERER LES LIENS ENTRE RECHERCHE ET POLITIQUES
Argentine et Uruguay, 20-24 février 2006
SYMPOSIUM DE HAUT NIVEAU
SUR LES
DIMENSIONS SOCIALES DES PROCESSUS D’INTEGRATION REGIONALE
Organisé par l’UNESCO, le MERCOSUR, le GASPP et l’UNU-CRIS
Montevideo (Uruguay), 21-23 février 2006
TABLE RONDE DE REFLEXION
Les dimensions sociales des processus d’intégration régionale :
problématiques émergentes et multilatéralisme régional
Quel rôle peuvent jouer les organisations d'intégration régionale
dans une nouvelle architecture internationale ?
par
Philippe HUGON
Multilatéralisme régional N°3

Les idées et opinions exprimées dans cette publication sont celles de l’auteur et ne reflètent pas
nécessairement les vues de l’UNESCO et n’engagent pas l’Organisation.
Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent
n’impliquent de la part de l’UNESCO aucune prise de position quant au statut juridique des pays,
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant à leurs frontières ou limites.
Publié en 2006 par l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP
© UNESCO 2006
Printed in France
(SHS-2006/WS/MR/3)

Multilatéralisme régional N°3
3
Présentation
Dr Ninou Garabaghi
Spécialiste principal du programme
Secteur des Sciences sociales et humaines
La présente série de publications a été lancée à la faveur de la table ronde « Les
dimensions sociales des processus d’intégration régionale : problématiques émergentes et
multilatéralisme régional » du Forum international sur les interfaces entre politiques et
sciences sociales organisé en Argentine et en Uruguay par l’UNESCO en partenariat avec
les gouvernements d’Argentine et d’Uruguay, les Universités et les villes de Buenos Aires
et de Montevideo et plus particulièrement dans le cadre de la plate-forme de Montevideo
dédiée aux intégrations régionales. La plate-forme consacrée à la thématique
« intégrations régionales » a été constituée d’une constellation d’ateliers traitant de
questions spécifiques et d’un symposium de haut niveau dévolu aux dimensions sociales
des processus d’intégration régionale. Dans le cadre de ce symposium de haut niveau, une
table ronde a été prévue qui ambitionne de mettre en débat des visions prospectives sur
les processus et les politiques d’intégration régionale.
Cette table ronde intitulée « Les dimensions sociales des processus d’intégration
régionale : problématiques émergentes et multilatéralisme régional » qui réunit des
chercheurs, experts et décideurs de différents horizons est organisée sous forme d’une
session de réflexion (brainstorming) sur les défis et opportunités d’un multilatéralisme
régional au regard de la gouvernance mondiale en général et de la gouvernance sociale en
particulier. Mettant à profit la présence de hauts responsables des Organisations
d’intégration régionale, de décideurs politiques et de chercheurs, la table ronde tout
comme la présente série de publications sur le « Multilatéralisme régional » vise à faire
émerger de nouvelles idées et projets porteurs permettant aux communautés humaines
d’assurer une meilleure maîtrise de leur destinée.

Multilatéralisme régional N°3
4
Quel rôle peuvent jouer les organisations d'intégration régionale
dans une nouvelle architecture internationale ?
par
Philippe Hugon1
Introduction
Le système international n'est ni anarchique ni ordonné. Les Etats nations
souverains mettent en place des règles, exercent des hégémonies ou expriment des
rapports de force conduisant à une structuration. Les organisations internationales sont
des lieux de concertation, de négociation et de mise en place de règles. Inversement, il
n'y a pas d'ordonnancement par emboîtement permettant de passer du niveau local au
niveau international par le biais d'Etats nations et impliquant un gouvernement mondial
supérieur aux gouvernements nationaux (Ninou Garabaghi 2005). Il n'existe que des
processus d'équilibrations instables résultant à la fois du respect de règles et d'expression
de rapports de force. D'un côté, les puissances politiques imposent des règles et des ordres
dans des territoires nationaux, régionaux voire mondiaux. De l'autre, des acteurs privés
transnationaux ont des stratégies régionales ou mondiales. L'absence d'anarchie résulte à
la fois de règles, de régimes et de conventions acceptées par les acteurs internationaux et
de pouvoirs structurels exercés par les puissances hégémoniques sous forme de hard
power (puissance matérielle et militaire) et de soft power (persuasion, attractivité des
valeurs, des idées, de la culture et des institutions) (Hugon, Michalet 2005).
Le niveau régional est stratégique dans cette architecture en voie de restructuration
et dans cette régulation internationale. Les espaces régionaux se constituent à la fois par
un régionalisme de jure multinational qui dépasse le cadre des Etats nations et se construit
à partir d'organisations régionales et par une régionalisation de facto transnationale, liée à
des interdépendances dans le domaine social, culturel, politique et économiques, se
réalisant autour d'objectifs communs et conduisant à la constitution de clubs ad hoc. Le
multilatéralisme régional, défini comme "le système de gouvernance mondiale fondé sur
les organisations d'intégration régionale" (Ninou Garabaghi 2005) apparaît ainsi comme
une des formes que prend la régulation mondiale et comme une utopie créatrice pour
progresser dans la gouvernementalité du monde. L'espace régional est une des échelles
adéquates de la régulation de l'économie mondiale.
Ce multilatéralisme régional prend la forme d'accords et de négociations
internationales où interviennent des organisations régionales. Ainsi l'UE parle d'une seule
voix à l'OMC ou met en place un processus spécifique de protection du climat et de lutte
contre les effets de serre. Elle signe des accords commerciaux et de partenariat avec des
1 Professeur émérite, Université Paris X – Nanterre.

Multilatéralisme régional N°3
5
Etats et des organisations régionales (ex Mercorsur, CEDEAO, CEMAC, CARICOM,
SADC dans le cadre des APE). Ce multilatéralisme régional concerne également la
constitution de clubs plus ou moins informels à l’exemple du G8, du G20 ou du G90 au
sein de l'OMC, ou des groupes de pays inclus et exclus du protocole de Kyoto. La
question se pose de voir quel rôle jouent et peuvent jouer le régionalisme et la
régionalisation dans la nouvelle architecture internationale.
La première partie de cette contribution analyse la pluridimensionnalité de la
régionalisation et ses enjeux dans la mondialisation en relation avec les biens publics
régionaux.
La seconde partie analyse du point de vue commercial et économique la compatibilité du
régionalisme et du multilatéralisme ; des argumentaires théoriques en faveur du
régionalisme et du multilatéralisme. La contribution présente en conclusion les
régulations régionales et le débat entre multilatéralisme universaliste et multilatéralisme
coopératif.
I Les enjeux de la régionalisation dans la mondialisation et les biens publics
régionaux
1.1 L'architecture internationale
L'architecture internationale actuelle a été mise en place au lendemain de la
seconde guerre mondiale par la création des organisations onusiennes. Les institutions
économiques et financières internationales de Bretton Woods ont été alors crées en
séparant le politique de l’économique, en reposant sur le principe d’égale souveraineté et
sur une réalité d’un monde bipolaire dominé par la puissance hégémonique des Etats
Unis. La population mondiale était, à cette époque, de 2,5 milliards. 45 Etats sur 50
étaient membres de la Banque mondiale. Un demi-siècle plus tard, le monde s’est
profondément transformé du fait de la croissance démographique, de la décolonisation, de
la prolifération du nombre des Etats (plus de 200 membres des Nations unies), d’une
transnationalisation des flux commerciaux et financiers, d’une montée en puissance de
pays émergents (notamment du Brésil, de la Chine et de l’Inde) et d’un processus de
régionalisme multiforme.
Les organisations internationales ont pour principaux interlocuteurs les Etats.
Cette structure qui correspondait au « mercantilisme éclairé » d’après guerre n’est plus en
phase avec un monde multipolaire autour des grandes régions. L’architecture
internationale peut difficilement affronter les problèmes liés au poids des firmes
transnationales, et des opérateurs financiers privés à la globalisation financière, à la
montée d’une société civile internationale et des blocs régionaux monétaires ou
commerciaux. Les institutions internationales n’ont pas ou peu de pouvoir supranational.
Elles sont le reflet d'une" incongruité spatiale" (Palan) entre une économie en voie de
mondialisation et un système politique international reposant sur la souveraineté
nationale. Le système international reste fondé sur le principe de hiérarchie avec un rôle
de leadership des Etats-Unis (ayant le droit de veto au sein des organisations
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%