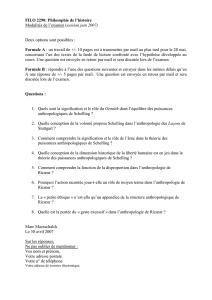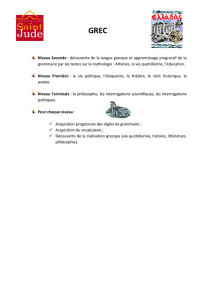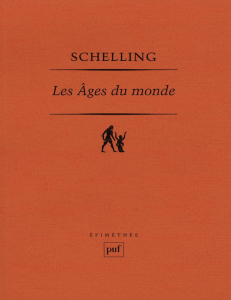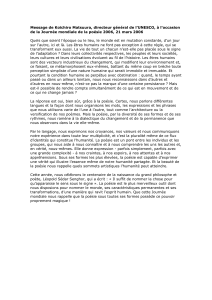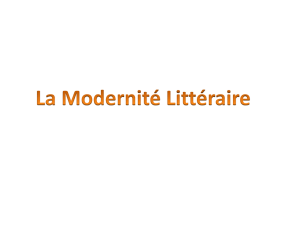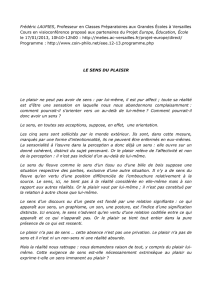L`âge d`or. Qu`est-ce qu`une époque à l`époque des Romantiques

Revue germanique internationale
18 | 2013
Schelling. Le temps du système, un système des
temps
L’âge d’or. Qu’est-ce qu’une époque à l’époque des
Romantiques allemands et de Schelling ?
Jérôme Lèbre
Édition électronique
URL : http://rgi.revues.org/1428
ISSN : 1775-3988
Éditeur
CNRS Éditions
Édition imprimée
Date de publication : 10 octobre 2013
Pagination : 39-58
ISBN : 978-2-271-07923-7
ISSN : 1253-7837
Référence électronique
Jérôme Lèbre, « L’âge d’or. Qu’est-ce qu’une époque à l’époque des Romantiques allemands et de
Schelling ? », Revue germanique internationale [En ligne], 18 | 2013, mis en ligne le 10 octobre 2016,
consulté le 26 décembre 2016. URL : http://rgi.revues.org/1428 ; DOI : 10.4000/rgi.1428
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
Tous droits réservés

CNRD Éditions - RGI nº 18 - Schelling - 170 x 240 - 10/9/2013 - 15 : 53 - page 39
L’âge d’or
Qu’est-ce qu’une époque à l’époque des
Romantiques allemands et de Schelling ?
Jérôme Lèbre
Bien sûr, l’âge d’or, nous en sommes loin, en cette période où la monnaie,
devenue presque entièrement scripturale, échappe aux Etats et leur revient sous
la forme de cette écriture négative sans fond qu’est la dette publique. Nous n’en
parlons plus, comme si ce thème mythique d’une période parfaite et reculée avait
lui-même reculé en même temps que tous les mythes. Même l’indexation de l’Euro
sur l’or semble archaïque. Pour autant nous n’entendons pas faire ici du roman-
tisme allemand un âge d’or où l’on parlait encore de l’âge d’or. Tout d’abord
parce que la poésie et la philosophie de ce lieu et de ce temps (l’Allemagne de
1795 à 1840) ne se fait aucune illusion sur l’aspect prosaïque de son propre présent :
l’enthousiasme de et pour la Révolution française n’y est déjà plus qu’un souvenir,
le Saint-Empire s’écroule mais la modernisation du pays s’enlise dans la guerre
contre Napoléon puis dans la crise économique et les tentations réactionnaires des
rois1ou des assemblées. Ensuite, parce que cette poésie et cette philosophie ne se
font pas plus d’illusion sur le retour d’un lointain passé. Bien au contraire : si elles
parlent de l’âge d’or, si elles croient encore pouvoir raviver ce mythe, c’est à
condition de pouvoir le projeter dans l’avenir. Enfin, parce que la possibilité même
de rouvrir au cœur d’un présent décevant cet horizon d’un âge meilleur n’est pas
donnée pour acquise, elle est plutôt interrogée sans relâche.
C’est sur cela que nous aimerions insister : les poètes, les philosophes de cette
période entendent se maintenir en retrait, non seulement de la mythification du
passé mais aussi de celle de l’avenir, si bien que l’appel à une nouvelle mythologie
s’accompagne d’une critique radicale de la mythologie du nouveau. L’articulation
1. L’Allemagne des années 1800 est défaite, à moitié ruinée, et bientôt envahie par l’armée française
qui occupe la rive gauche du Rhin dès 1802. Le règne en Prusse de Frédéric-Guillaume III (1797-1840)
est celui des compromis et des désillusions, dans la mesure où tout en pactisant avec Napoléon, le roi
se refuse à transformer la Prusse en monarchie constitutionnelle.

CNRD Éditions - RGI nº 18 - Schelling - 170 x 240 - 10/9/2013 - 15 : 53 - page 40
entre la nostalgie, qui n’est pas un simple regret, et la prophétie, qui n’est pas une
prévision, ne vise ainsi à rien d’autre qu’à ressaisir le présent lui-même : à trouver,
au cœur de ce que Proust nommera la « matière éternelle et commune2»du
quotidien et Lukacs son « mélange impur », les traces d’une autre éternité, celle
d’une matière rare, qui n’a de valeur que dans la mesure où elle a toujours été
une des composantes de la réalité. C’est ainsi que nous entendons déployer ce
fragment de la revue Athenaeum, attribué à August Schlegel :
L’image trompeuse d’un âge d’or passé est l’un des plus grands obstacles à l’appro-
che de l’âge d’or qui doit encore venir. Si âge d’or il y eut, il n’était pas d’or véritable.
L’or ne rouille ni ne s’altère, il ressort invinciblement pur de tous les mélanges et de
toutes les décompositions. Si l’âge d’or ne peut durer éternellement, il vaut mieux qu’il
ne commence même pas ; il n’est bon qu’à inspirer des élégies à sa perte3.
Ages d’or passés, âge d’or à venir
Pour peu qu’on lise un peu vite cet aphorisme, son sens semble évident : à
l’« image trompeuse d’un âge d’or passé », s’oppose l’âge d’or véritable, qui n’est
pas encore venu, et qui n’est même pas fait, métaphoriquement, de la même
matière. Que le premier âge d’or soit passé, qu’il ait rouillé en quelque sorte, est
la preuve qu’il n’était pas le vrai. Alors que celui qu’on attend, une fois venu,
s’installera pour toujours. Mais si nous en restons là, nous perdons la vraie relation
que cet aphorisme entretient avec tous les âges d’or passé, et donc aussi avec l’âge
d’or à venir.
L’évocation de l’âge d’or est en effet aussi bien celle du poème classique que
de ses suites. C’est d’abord au cœur du classicisme, considérant les textes antiques
comme des modèles indépassables, que travaille le fragment romantique, réinter-
rogeant quitte à la faire vaciller sa relation aux modèles qu’il se donne. Revenons
à la plus ancienne version connue de l’âge d’or, celle d’Hésiode dans Les Travaux
et les jours. Il s’agissait d’un temps maîtrisé par le temps (le temps de Kronos) qui
n’apporte aux hommes ni vieillesse ni douleur : « les pieds et les bras toujours
jeunes / ils vivaient de festins, à l’abri de toute misère/ Ils mouraient comme ils
s’endormaient. Et toutes richesses /leur revenaient : la terre, qui donne la vie
d’elle-même,/ leurs tendaient ses fruits abondants ; la joie et le calme/ présidaient
aux travaux des champs4… » Puis le sol a « recouvert cette race » une fois pour
toutes. Suivent quatre autres races d’hommes, les races d’argent et de bronze,
puissantes et violentes, puis celle des héros, et enfin la race de fer, la nôtre, qui
vit dans la souffrance, même si « quelque bonheur, pourtant, viendra se mêler à
leur peine ». L’âge d’or est donc définitivement passé, et, semble-t-il, absolument
2. Proust, A la Recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, 1987-1989, t. I, p. 479.
3. Fragments de l’Athenaeum, frag. 243, in Ph. Lacoue-Labarthe et J.-L Nancy, L’Absolu littéraire,
Paris, Seuil, 1978, trad. coll., p. 133.
4. Hésiode, Les Travaux et les jours,in Théogonie et autres poèmes, trad. J.-L. Backès, Paris,
Gallimard, 2001, p. 101 sq.
40 Schelling

CNRD Éditions - RGI nº 18 - Schelling - 170 x 240 - 10/9/2013 - 15 : 53 - page 41
regrettable. Mais de fait, ce n’est pas exactement ce que dit Hésiode. D’une part,
la décadence n’est pas constante dans la suite des temps : la race des héros, qui
se trouve en retrait de la dévalorisation des matières (or, argent, bronze) est meil-
leure, « plus juste et plus valeureuse », que celle d’argent, qui la précède. D’autre
part, le poète s’écrie au moment où il parvient à la « race actuelle, de fer » : « Si
j’avais pu ne pas vivre parmi la cinquième race ! Être mort plus tôt, ou être né
par la suite ! ». Autrement dit, le poème archaïque implique déjà en lui-même,
non un retour à l’âge d’or en tant que tel, mais la possibilité d’un avenir plus
radieux que le présent. De fait, Les Travaux et les jours ont une suite : en prescrivant
à la fois une conduite juste et un travail agricole ordonné, respectueux du juste
moment, du kaïros de chaque activité, ils entendent rendre possible une vie meil-
leure. A l’image mythique de l’âge d’or passé, s’oppose donc déjà l’ouverture d’un
âge qui n’est ni du même or, ni simplement de fer (lequel n’est pas une matière
simple, mélangeant peine et bonheur), et dont la matière est peut-être inconnue,
échappant même, comme l’âge des héros, au rang et à la valeur des différents
métaux.
Sans prétendre résumer l’immense héritage d’Hésiode, il nous faut tout de même
rappeler que les reprises fréquentes du thème de l’âge d’or, devenu à la fois un
mythe et un texte, puis des textes, impliquent ce double regard vers le passé et
vers l’avenir. L’exemple le plus célèbre se trouve dans la quatrième Bucolique de
Virgile (trad. Paul Valéry)5. « Haussons un peu le ton » (paulo majora canamus),
prévient immédiatement le poète. Puis il écrit : « Voici finir le temps marqué par
la Sibylle/ Un âge nouveau va naître : La Vierge nous revient et les lois de Saturne/
Et le ciel nous envoie une race nouvelle. / Bénis, chaste Lucine [Juno Licina, qui
préside aux accouchements], un enfant près de naître/ Qui doit l’âge de fer changer
en âge d’or ». Cette églogue écrite 40 ans avant la naissance de Jésus sous l’égide
de la prophétesse Sybille, a été une pièce maîtresse de l’interprétation allégorique
chrétienne des poètes latins, même si Virgile ne vise rien d’autre que l’éloge de
son commanditaire et patron, Asinius Pollion, consul de la Cisalpine, qui allait
être père. La suite du texte présente un futur règne politique d’une manière
explicitement mythique, comme si la nature elle-même allait y participer : « le
marin quittera la mer, et tout commerce/ Sur l’onde cessera ; tout sol produira
tout./ Terre et vigne oublieront et la herse et la serpe /…/ Mais de pourpre
éclatante ou d’une toison d’or/ Le bélier dans les prés se teindra de soi-même. »
Il va de soi que le fragment de l’Athenaeum annonçant un âge d’or éternel participe
très consciemment de cette hausse de ton, ne gardant même qu’elle, résumant
dans la seule formule de l’âge d’or tous les développements bucoliques de Virgile,
mais aussi toutes ses variations chrétiennes, dont celle de Luther. Il en découle
que ce fragment, tout en se gardant de l’image trompeuse d’un âge d’or passé,
puise bien dans le passé la formulation même de l’avenir et garde donc
toute l’ambiguïté de la « classicité », voire de la religiosité qui habite le projet
romantique.
5. Virgile, « Quatrième Bucolique », trad. P. Valéry, in Bucoliques – Géorgiques, Paris, Gallimard,
1997.
41L’âge d’or

CNRD Éditions - RGI nº 18 - Schelling - 170 x 240 - 10/9/2013 - 15 : 53 - page 42
Mais aussi, pour peu l’on baisse un peu le ton, le nouvel âge d’or s’éloigne de
l’ancien, prend une figure moins mythique ou moins religieuse et se rapproche de
la mise en vers d’un projet politique. C’est le cas dans les Géorgiques, il faudrait
dire les techniques géorgiques (agricoles) de Virgile : l’âge d’or où la nature
« donnait plus à qui n’exigeait rien6» est définitivement passé, et l’avenir se trouve
plutôt dans « l’art qui a pas lents vint adoucir les peines ». Le texte prend alors
parti très concrètement pour les réformes agricoles d’Octave, tout en les poétisant
d’une manière archaïque. Il est alors plus proche d’Hésiode, en considérant que
des préceptes (plus poétiques que pratiques) doivent soutenir les efforts que font
les hommes pour l’amélioration de leur sort. Mais il est également bien plus proche
des Romantiques allemands. En effet la traduction des Géorgiques par l’abbé Delille
(1770) appartient à la culture révolutionnaire ; elle est un des éléments de cette
immense retour à l’Antiquité qui meut la Révolution, même si, d’une manière très
claire pour Delille il s’agit de traduire non pour simplement faire revenir le passé,
mais pour signifier un écart : « traduire, c’est importer en quelque façon dans sa
langue, par un commerce heureux, les trésors des langues étrangères7. » Et cet
écart, c’est avant celui de l’agriculture antique et de l’agriculture moderne, que
Delille, avec les physiocrates des Lumières place au centre de l’économie : la
richesse nationale ne repose alors plus sur un stock de métaux précieux, le trésor
du roi (théorie mercantiliste défendue également par l’orthodoxie monétaire de
Frédéric II), mais sur la mise en valeur par le travail des richesses naturelles. La
théorie physiocratique, qu’on généralement trop à Louis XVI, a donc préparé le
renversement du principe monarchique de la Révolution française, qui s’est elle-
même pensée comme un nouvel âge d’or. Dans la même période les Géorgiques
sont traduites par Johann-Elie Schlegel, l’oncle des frères Schlegel, puis par leur
ami Johann Henrich Voss, précisément entre 1797 et 1800. Le thème d’un nouvel
âge d’or est alors tellement inévitable au moment de l’écriture de l’aphorisme cité
que « l’image trompeuse d’un âge d’or passé » peut alors tout aussi bien faire
référence à la Révolution française, le fragment tentant dans ce cas, une fois encore,
de relancer une possibilité à peine épuisée. La hausse de ton se présente ainsi
comme un mode de résistance que le langage adopterait pour s’élever au-dessus
de cet épuisement.
Les époques de la poésie
Qu’il soit encore possible d’évoquer un nouvel âge d’or devient probléma-
tique dans ce contexte. On le voit au début de L’Entretien sur la poésie, rédigé
par Friedrich Schlegel pour l’Athenaeum : « Marcus [Tieck] considérait que l’âge
d’or est décidément une maladie moderne ; chaque nation doit en passer par là,
comme les enfants par la petite vérole. – On devrait alors pouvoir essayer d’atténuer
par l’inoculation la virulence de la maladie, dit Antonio [Friedrich] ». C’est donc
6. Ibid., « Première Géorgique », p. 145.
7. Ibid., p. 328.
42 Schelling
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%
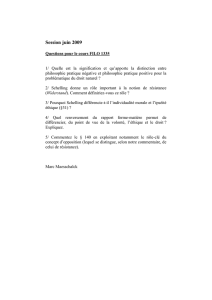
![Hegel « Le 14 Novembre [1831] mourut à Berlin le célèbre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001023432_1-a9b6716e401d92cc3aee9aa9973a15fa-300x300.png)