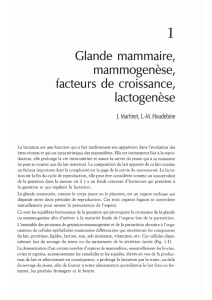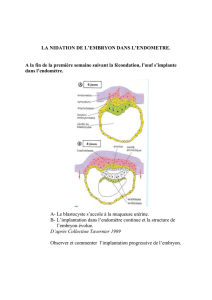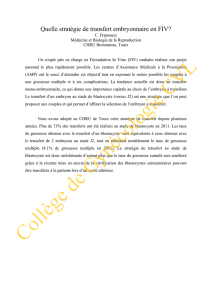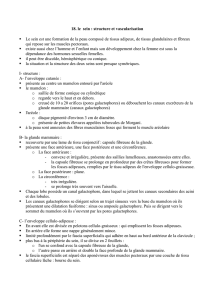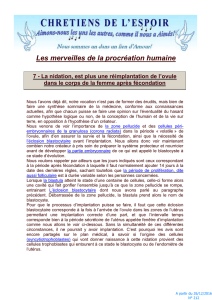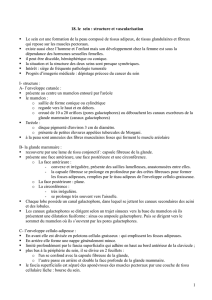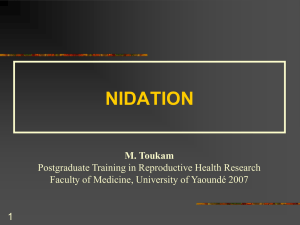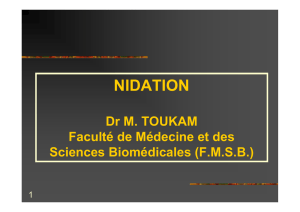Notes Gestation

Gestation & Lactation
Version du 03/02/2015
Charles Nicaise
MMEDB203 – SVETB303
1
Chapitre 11
Gestation, Placentogénèse et
Lactation

Gestation & Lactation
Version du 03/02/2015
Charles Nicaise
MMEDB203 – SVETB303
2
11 La gestation, la placentogénèse et la lactation
11.1 Organisation générale
Préambule : Ces notions seront approfondies au cours d’Embryologie et de
Reproduction. Dans les paragraphes suivants, nous nous limiterons à décrire les
modifications histologiques de l’endomètre gestationnel (« la réaction
déciduale »), la formation du placenta (« placentogénèse ») et les changements
morphologiques opérés au niveau de la glande mammaire au moment de la
lactation chez l’espèce humaine.
La gestation est un état fonctionnel particulier propre à la femelle de vivipare
qui porte un embryon en développement dans son utérus, entre la nidation de l'œuf et
la parturition ( = mise-bas ou accouchement). La durée de la gestation est très variable
selon les espèces animales. Une femelle en gestation est dite gravide. Pour la femme,
on parle de grossesse et de femme enceinte. La gestation dure en moyenne 38
semaines chez l’espèce humaine.
Quelques étapes sont cependant préalables à la gestation : la préparation de la
muqueuse utérine à accueillir un œuf fécondé et la fécondation c-à-d la fusion des
pronuclei mâle et femelle. Les différentes étapes de la gestation incluent :
l’implantation ou nidation dans l’endomètre par invasion trophoblastique, la
formation de la caduque (=réaction déciduale endométriale), la formation du placenta
et du cordon ombilical.
Le prérequis fondamental à l’implantation d’un ovule fécondé est la préparation
structurelle de la muqueuse utérine, réalisée pendant le cycle menstruel. Pour rappel,
le cycle menstruel se divise en 3 grandes phases. La phase proliférative (du J4 au J15)
est caractérisée par un épaississement de la muqueuse utérine et la formation de
glandes tubulaires endométriales, sous l’influence des œstrogènes. La phase
sécrétoire, post-ovulatoire, déclenche l’accumulation et ensuite la sécrétion de
glycogène par les cellules épithéliales des glandes endométriales sous l’influence de
la progestérone. Les sécrétions appelées « lait utérin » s’accumulent dans la lumière
des glandes endométriales dilatées et contournées et constitueront les premiers
éléments nutritifs pour l’œuf fécondé en phase d’implantation.
La fécondation de l’ovule se déroule habituellement dans l’ampoule (parfois
dans le pavillon). La seconde division méiotique ne se termine qu’au moment de la
pénétration de la zona pellucida et de la membrane plasmique ovocytaire par le
spermatozoïde. Le matériel génétique haploïde du spermatozoïde (pronucleus mâle)
fusionne avec celui de l’ovule (pronucleus femelle) formant un zygote diploïde qui
immédiatement débute plusieurs divisions mitotiques aboutissant à la formation d’une
masse cellulaire compacte appelée morula (littéralement « petite mûre »).

Gestation & Lactation
Version du 03/02/2015
Charles Nicaise
MMEDB203 – SVETB303
3
11.2 La nidation ou implantation
La morula migre dans la trompe utérine et débouche dans la cavité utérine au 4e
– 5e jour après fécondation. La morula se transforme en blastocyste comprenant une
masse cellulaire interne (= futur embryon) entourée d’une paroi cellulaire (revêtement
trophoblastique) et d’une large cavité liquidienne (= blastocèle). Le blastocyste reste à
la surface endométriale jusqu’au 6e jour après fécondation. Le blastocyste se
débarrasse alors de sa zone pellucide, mettant à nu son revêtement épithélial externe
trophoblastique. Le blastocyste exprime le récepteur du facteur de croissance
épithélial (EGF-R) et de l’IL-1 qui jouent un rôle clé dans l’interaction et la
signalisation de l'embryon vers la muqueuse utérine. L’endomètre quant à lui exprime
diverses molécules (récepteurs de l’interleukine Il-1, facteur de stimulation des
colonies CSF, facteur de croissance épithélial EGF, facteur d'inhibition de la leucémie
LIF, E-cadhérine,…), ayant pour fonction la chémoattraction du blastocyste et
l’adhésion de celui-ci à la surface endométriale.
Interaction du blastocyste avec la surface endométriale. Remarquez la masse cellulaire interne et la
couche périphérique trophoblastique. Les trophoblastes expriment des molécules d’adhérence telles des
sélectines et des intégrines.
En parallèle, le blastocyste secrète l’hormone gonadotrophine chorionique
humaine (hCG, human chorionic gonadotrophin), qui signale à l'ovaire que la
fécondation a eu lieu et que le corps jaune ovarien doit être maintenu. Le corps
jaune progestatif devient un corps jaune gestatif, volumineux (diamètre de 3 à 4
cm), qui persiste tout le 1er trimestre de la grossesse et continue à sécréter de la
progestérone. La progestérone est nécessaire pour maintenir le revêtement
endométrial et donc assurer la nutrition de l'embryon. Après le 1er trimestre, la
production hormonale du placenta prend le relais.

Gestation & Lactation
Version du 03/02/2015
Charles Nicaise
MMEDB203 – SVETB303
4
L’implantation survient aux alentours du 7e jour après fécondation (soit 21e- 22e
jour du cycle menstruel). Si elle réussit, le blastocyste gagne le chorion endométrial,
au travers de l’épithélium de surface, et au 11e jour il est totalement inclus.
L’implantation est médiée par l’adhésion du trophoblaste à l’épithélium endométrial.
Le trophoblaste est muni de microvillosités apicales interagissant avec le domaine
apical des cellules endométriales munies de micro-expansions, appelées pinopodes.
La L-sélectine exprimée par les cellules trophoblastiques se lie aux récepteurs
carbohydrates présents à la surface des cellules de l’épithélium endométrial, et permet
l’attachement initial du blastocyste à la surface endométriale. Les cadhérines sont des
molécules d'adhérence cellulaire, Ca2+ dépendantes, qui jouent ensuite un rôle lors de
l'ancrage du blastocyste à l'endomètre. Les intégrines exprimées par le trophoblaste se
lient à la laminine et à la fibronectine de la matrice extracellulaire endométriale et
favorisent d’une part l’attachement du blastocyste à l’endomètre, et d’autre part
l'enfouissement du blastocyste dans la muqueuse utérine. Ces molécules interagissent
mutuellement au niveau de voies de signalisation intracellulaire conduisant à la
différenciation du trophoblaste. Le trophoblaste se différencie alors en deux types
cellulaires distincts:
- le syncytiotrophoblaste : couche trophoblastique externe
- le cytotrophoblaste : couche trophoblastique interne
Le diagnostic biologique de la grossesse se fait par la recherche sanguine ou
urinaire de la fraction bêta de hCG. Les tests de grossesse urinaires
disponibles en pharmacie proposent un dosage qualitatif de cette hormone,
leur fiabilité est de 90 à 99 %. Le dosage sanguin, quantitatif, de la bêta-
hCG permet un diagnostic de certitude et une datation du début de la
grossesse (le taux de cette hormone double toutes les quarante-huit heures
en début de grossesse).
Le trophoblaste exprime l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (hCG). Celle-ci
se retrouve dans le sang et les urines. A gauche, détection urinaire de l’hCG. A droite,
immunomarquage pour hCG positif (coloration brune) au niveau de la couche
trophoblastique du placenta.

Gestation & Lactation
Version du 03/02/2015
Charles Nicaise
MMEDB203 – SVETB303
5
Le cytotrophoblaste consiste en une couche interne irrégulière de cellules ovoïdes
mononuclées, qui est le siège d'une activité mitotique intense.
Le syncytiotrophoblaste forme une couche de
cellules multinucléées sans limites cellulaires
distinctes (d’où la dénomination de syncytium),
qui provient de la fusion des cellules externes
du trophoblaste. Le syncytiotrophoblaste est pourvu d’une machinerie d’enzymes
protéolytiques (métalloprotéases matricielles MMP, activateurs du plasminogène), de
microvillosités et sécrète des facteurs qui lui permettent d'induire l'apoptose des
cellules épithéliales de la muqueuse utérine, de traverser la lame basale et pénétrer
dans le stroma sous-jacent riche en vaisseaux sanguins utérins. C’est l’étape
d'invasion trophoblastique et de dégradation de la matrice extracellulaire de
l’endomètre. Avec la pénétration du blastocyste dans l'endomètre, le
syncytiotrophoblaste se développe rapidement. Lorsque la pénétration est complète,
le point d’implantation de l’épithélium de l’endomètre au-dessus du blastocyste est
obturé par un caillot de fibrine. Par la suite, la surface de l’endomètre se re-
épithélialise.
Dynamique morphologique de l’implantation d’un blastocyste murin au sein de l’endomètre maternel.
En cas d’échec d’implantation, le blastocyste dégénère et il est éliminé avec les
menstruations. Parfois, l’implantation survient mais ne peut être maintenue. Les
menstruations son alors retardées et plus abondantes que d’ordinaire.
C’est le syncitiotrophoblaste
qui synthétise principalement
l’hCG.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%